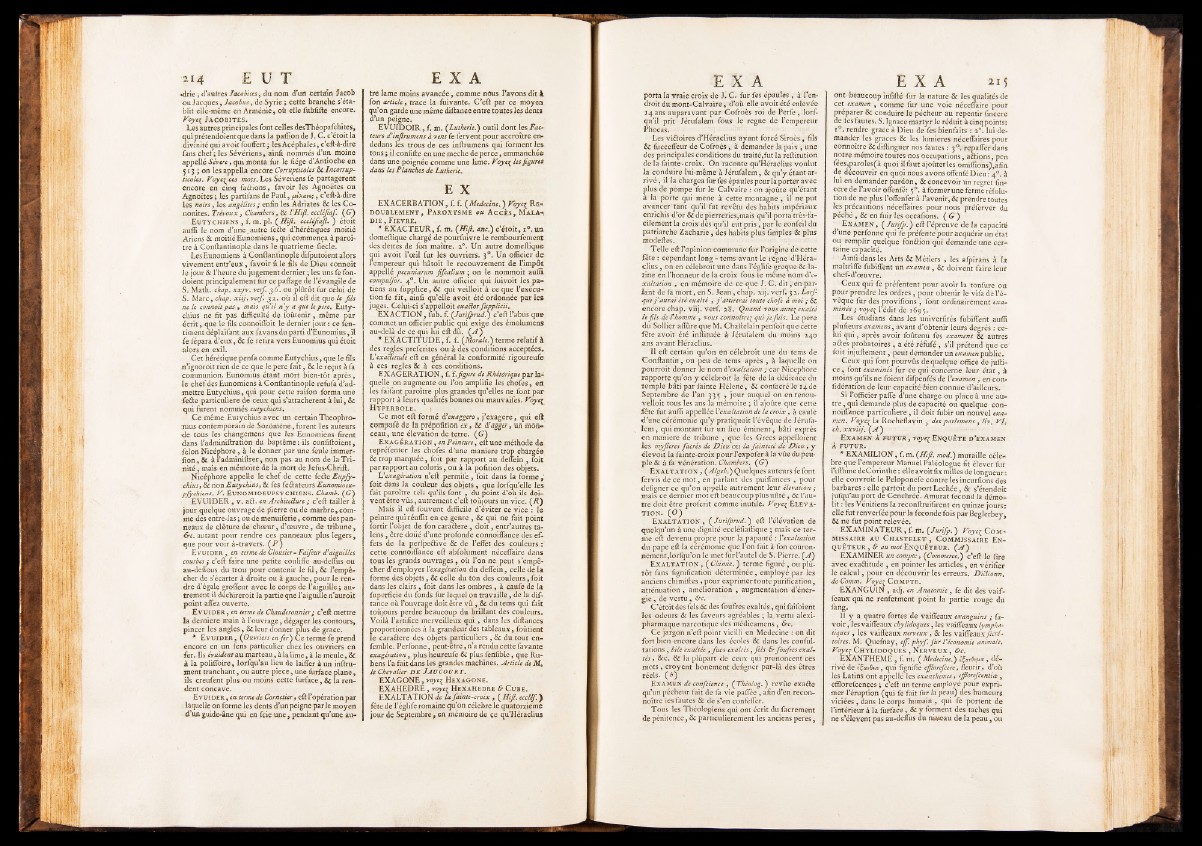
•drie ; d’autres Jacobites, du nom d’un certain Jacob
ou Jacques, Jacobus, de Syrie ; cette branche s’établit
elle-même en Arménie, où elle fubfifte encore.
Voyt{ Jacobites.
Les autres principales font celles desThéopafchites,
qui prétendoient que dans la paffionde J. C. c’étoitla
divinité qui a voit fouffert ; les A céphales, c’eft-à-dire
fans chef; les Sévériens, ainfi nommés d’un moine
appelle Sévere, qui monta fur le liège d’Antioche en
5 13 ; on les appella encore Corrupticoles 6c Incorrup-
ticoles. Foye^ ces mots. Les Séveriens fe partagèrent
encore en cinq fa&ions, favoir les Agnoëtes ou
Agnoïtes ; les partifans de Paul, p.ixa.m, c’eft-à-dire
•les noirs , les angélites; enfin les Adriates & les Co-
nonites. Trévoux , Chambers, & l ’Hijl. eccléfiaf. {G) Eutychiens , f. m. pl. ( Hifi. eccléfiafi. ) étoit
auffi le nom d’une_autre fede d’hérétiques moitié
Ariens & moitié Eunomiens, qui commença à paroî-
tre à Conftantinople dans le quatrième fiecle.
LesEimomiens à Conftantinople difputoient alors
vivement entr’eu x, favoir fi le fils de Dieu connoît
le jour & l’heure du jugement dernier ; les uns fe fon-
doient principalement fur ce paffage de l’évangile de
S. Math. chap. xxjv.verf. j 6'. ou plûtôt fur celui de
S. Marc, chap. xiij. verf. j z . où il eft dit que le fils
ne le connoît pas , mais qu'il n ’y a que le pere. Euty-
chius ne fit pas difficulté de foûtenir, même par
éc rit, que le fils connoiffoit le dernier jour : ce fen-
timent déplaifant aux favans du parti d’Eunomius, il
fe fépara d’eux, 6c, fe retira vers Eunomius qui étoit
alors en exil.
Cet hérétique penfa comme Eutychius, que le fils
n’ignoroit rien de ce que le pere fait, 6c le reçut à fa
communion. Eunomius étant mort bien-tôt après,
le chef des Eunomiens à Conftantinople refiifa d’admettre
Eutychius, qui pour cette raifon forma une
fe&e particulière de ceux qui s’attachèrent à lui, 6c
qui furent nommés eutychiens.
Ce même Eutychius avec un certain Theophro-
mius contemporain de Sozomene, furent les auteurs
de tous les changemens que les Eunomiens firent
dans l’adminiftration du baptême : ils confiftoient,
félon Nicéphore, à le donner par une feule immer-
fion, & à l’adminiftrer, non pas au nom de la T rinité
, mais en mémoire de la mort de JefusrChrift.
Nicéphore appelle le chef de cette fecle Eupfiy-
chius, & non Eutychius, & fes feftateurs Eunomioeu-
pfychiens. F. EUNOMIOEUPS Y CHIENS. Chamb. {G)
EVUIDER , v . aft. en Architecture ; c’eft tailler a
jour quelque ouvrage de p'ierre ou de marbre, comme
des entre-las ; ou de menuiferie, comme des panneaux
de clôture de choeur, d’oeuvre, de tribune,
&c. autant pour rendre ces panneaux plus légers,
que pour voir à-travers. ( P )
E v ü IDER , en terme de Cloutier-Faifeur d’aiguilles
courbes ,* c’eft faire une petite couliffe au-deflus ou
au-deffous du trou pour contenir le fil, 6c l’empêcher
de s’écarter à droite ou à gauche, pour le rendre
d’égale groffeur avec le corps de l’aiguille ; autrement
il dechireroit la partie qne l’aiguille n’auroit
point affez ouverte.
EvuiDER, en terme de Chauderonnier; c’eft mettre
la derniere main à l’ouvrage, dégager les contours,
pincer les angles, 6c leur donner plus de grâce.
* Evuider , (Ouvriers en fer) Ce terme fe prend
encore en un fens particulier chez les ouvriers en
fer. Ils évuident au marteau, à la lime, à la meule, 6c
à la poliffoire, lorfqu’au lieu de biffer à un infiniment
tranchant, ou autre piece, une furface plane,
ils creufent plus ou moins cette furface, & la rendent
concave. Evuider , en terme de Cornetier , eft l’opération par
laquelle on forme les dents d’un peigne parle moyen
d’un guide-âne qui en fcie une, pendant qu’une autre
lame moins avancée, comme nous l’avons dit à
fon article, trace la fuivante. C ’eft par ce moyen
qu’on garde une même diftance entre toutes les dents
d’un peigne.
EVUIDOIR, f. m. {Lutherie.} outil dont les Facteurs
d'infirumens à vent fe fervent pour accroître en-
dedans les trous de ces inftrumens qui forment les
tons ; il confifte en une meche de perce, emmanchée
dans une poignée comme une lime. Foye^ les figura
dans Us Planches de Lutherie.
E X
EXACERBATION, C f. (Médecine. ) Voyc^ R e-
DOUBLEMENT, PAROXYSME OU A C C È S , MALA-i
DIE , FIEVRE.
* EXAC TEU R, f. m. {Hifi. anc.) c’étoit, i° . un
domeftique chargé de pourfuivre le rembourfement
des dettes de fon maître. z°. Un autre domeftique
qui avoit l’oeil fur les ouvriers. 3°. Un officier de
l’empereur qui hâtoit le recouvrement de l’impôt
appellé pecuniarum fifealium ; on le nommoit auffi
compulfor. 4°. Un autre officier qui fuivoit les pa-
tiens au fupplice, & qui veilloit à ce que l’exécution
fe f î t , ainfi qu’elle avoit été ordonnée par les
juges. Celui-ci s’appelloit exactorfupplicïi.
EXA C T ION , fub. f. ( Jurifprud.) c’eft l’abus que
commet un officier public qui exige des émolument
au-delà de ce qui lui eft dû. {A }
* EX A C T ITU D E , f. f. {Morale.) terme relatif à
des regies preferites ou à des conditions acceptées»
L’exactitude eft en général la conformité rigoureufe
à ces regies & à ces conditions.
EXAGERATION, f. f, figure de Rhétorique par la-,
quelle on augmente ou l’on amplifie les chofes, en
fes faifant paroître plus grandes qu’elles ne font par
rapport à leurs qualités bonnes ou mauvaifes. Foye£ Hyperbole. i
Ce mot eft formé à’exaggero, j’exagere, qui eft
compofé de la prépofition ex , Si ù’agger, un monceau,
une élévation de terre. ( G) Exagération , en Peinture, eft une méthode de
repréfenter les chofes d une maniéré trop chargée
6c trop marquée, foit par rapport au deffein , foit
par rapport au coloris, ou à la pofition des objets.
Vexagération n’eft permife , foit dans la forme,'
foit dans la couleur des objets, que lorfqu’elle les
fait paroître tels qu’ils font , du point d’où ils doivent
être vus, autrement c’eft toujours un vice. {R )
Mais il eft fouvent difficile d’éviter ce viçe : le
peintre qui réuffit en ce genre , 6c qui ne fait point
lortir l’objet de fon caraâere, do it, entr’autres ta-
len s , être doué d’une profonde connoiffance des effets
de la perfpeôive & de l’effet des couleurs :
cette connoiffance eft abfolument néceffaire dans
tous les grands ouvrages, où l’on ne peut s’empêcher
d’employer l’exagération du deffein, celle de la
forme des objets, 6c celle du ton des couleurs, foit
dans les clairs , foit dans les ombres , à caufe de la
fuperficie du fonds fur lequel on travaille, de la diftance
où l’ouvrage doit être vu , & du tems qui fait
toûjours perdre beaucoup du brillant des couleurs.
Voilà l’artifice merveilleux qui , dans les diftances
proportionnées à la grandeur des tableaux, foûtient
le caraâere des objets particuliers, 6c du tout en-
femble. Perfonne, peut-être, n’a rendu cette favante
exagération, plus heureufe 6c plus fenfible, que Rubens
l’a fait dans les grandes machines. Article de M%
le Chevalier DE Ja u c o u r t .
EXAGONE, voye{ Hexagone.
EXAHEDRE, voye{ Hexahedre & Cube.
EXALTATION de la fainte—croix , { Hifi. ecc ü
fête de l’égiife romaine qu on célébré le quatorzième
jour de Septembre, en mémoire de ce qu’Héracüus
porta la vraie croix de J. C. fur fes épaules , à l’endroit
du mont-Calvaire y d’où elle.avoit été enlevée
14 ans auparavant par Cofroès roi de Perfe , lorf-
qu’il prit' Jérufalem fous* le régné de l’empereur
Phocas. -
Les viftoires d’Héraclius ayant forcé Siroès, fils
& fucceffeur de CofroèS y à demander la paix , une
des principales conditions du traité,fut la reftitution
de la fainte-croix. On raconté qu’Héraelitis voulut
la conduire lui-même à Jérufalem, & qu’y étant arrivé
; il ;la chargea fur fes épaules pour là porter avec
plus de pompe fur le Calvaire : on ajoute qu’étant
à la porte qui merie à cette' montagne , il ne put
avaneer'-fànt qu’il fut: revêtu des habits impériaux
enrichis d’or & de pierreries,mais qu’il porta très-facilement
la croix dès qu’il eut pris, par le eonfeil du
patriarche Zacharie, des habits plus fimplés1 & plus
modeftes.
Telle eft l’opinion commune' fur l’origine de Cette
fête : cependant long - tems:-avant le régné 'd’Héraclius
, on en célebroit une dans l’églife greque-& latine
en l’honneur de la croix fous le même nam d’e-
xdltàtiony e n mémoire de ce que J. C. dit £ en-parlant
de fa m ort, en S. Jean, chap. xij. verf. 3 z. Lorf-
■ que j ’aurai été exalté attirerai toute chofe à moi ; 6c
encore chap. viij. verf. z8. Quand vous aure^ exalté
le fils de-Ckomnte , vous cànnoître^ qui je fuis. Lé pere
du Sollier affûre que M. Chaftelain penfôit que cette
fête avoit été inftituée à Jérufalem dû1 moins 240
ans avant Héraclius.
Il eft certain qu’on en Célebroit une du tems de
Conftantin, ou peu de tems après , à laquelle on
pourroit donner le nom exaltation ; car Nicephore
rapporte qu’on y célebroit la fête de la dédicace du
temple bâti par fainte Hélene , 6c confacré le 14 dé
Septembre de l’an 335 > jour auquel' on en renou-
velloit tous les ans la mémoire ; il ajoute que cétte
fête fut auffi appellée l’exaltation de la croix, à caufe
d ’une cérémonie qu’y pratiquoit l ’évêque de Jérufalem
, qui montant fur un lieu éminent, bâti exprès
en maniéré de tribune , que les Grecs appelloient
les myfieres facrés de Dieu ou la fainteté de Dieu , y
élevoit la fainte-croix pour l’expo fer à la vûe du peuple
& à fa vénération. Chambers. {G)
■ Exaltation , ( Algeb.) Quelques auteurs fe font
fervis de ce mot, en parlant des puiffances , pour
defigner ce qu’on appelle autrement leur élévation ;
mais ce dernier mot eft beaucoup plus ufité, & l’autre
doit être proferit comme inutile. Vyyer ElévatioEn.
(O) xaltation , ( jurifprud. ) eft l’élévation de
quelqu’un à une dignité eccléfiaftique ; mais ce terme
eft devenu propre pour la papauté : l’exaltation
du pape eft la cérémonie que l’on fait à fon couronnement,
lorfqu’on le met fur l’autel de S. Pierre. {A) Exaltation , ( Chimie. ) terme figuré, ou plûtôt
fans lignification déterminée, employé par les
anciens chimiftes * pour exprimer toute purification,
atténuation, amélioration , augmentation d’énerg
ie , de vertu, &c.
C’étoit des fels & des fouffes exaltés, qui faifoient
les odeurs & les faveurs agréables ; la, vertu alexi-
pharmaque narcotique des médicamens, &c.
Ce jargon n’eft point vieilli en Medecine : on dit
fort bien encore dans les écoles & dans les conful-
tations, bile exaltée , fucs exaltés, fels & foufres exaltés,
&c. & ' la plupart de ceux qui prononcent ces
mots | croyent bonement defigner par-là des êtres
réels, {b ) Examen de confcience , {Théolog. ) revûe exaéie
qu’un pécheur fait de fa vie paffée , afin d’en recon-
noître les fautes & de s’en confeffer.
Tous leS Théologiens qui ont écrit du facrement
de pénitence, & particulièrement les anciens peres,
ont beaucoup infifté fur la nature & les qualités de
cet examen , comme fur une voie néceffaire pour
préparer &c conduire le pécheur au repentir fincere
de les fautes-. S. Ignace martyr le réduit à cinq points:
ï ° . rendre grâce à Dieu de fes bienfaits : z°. lui demander
les grâces & les lumières néceffaires pour
connoître & diftinguer nos fautes : 30-. répaffer dans
notre mémoire toutes nos occupations, a étions, pen
fées,paroles(à quoi il faut ajoûterles omiflïons),afin
de découvrir en quoi nous avons offenfé Dieu : 40. à
lui en demander pardôn, & concevoir un regret fincere
de l’avoir offenfé: 50. à former une ferme réfolu-
tion de ne plus l’offenfer à'l’avenir, & prendre toutes
les précautions néceffaires pour nous ' préferver du
péché, & en fuir les occafionsi ( G )
E x a m e n , ( Jurifp.) eft l’épreuve de la capacité
d’une perfonne qui fe préfente potir acquérir un état
ou remplir quelque fonétion qui demande une certaine
capacité.
Ainfi dans les Arts & Métiers , les afpirans à la
maîtriffe fubiffent un examen, & doivent faire leur
chef-d’oeuvre.
Ceux qui fe préfentent pour avoir la tonfure ou
pour prendre les ordres , pour obtenir le vifa de l’évêque
fur des proÿifiôhs , font ordinairement examinés
; voye{ l ’édit de 1695.
Les étudians dans les univerfités fubiffent auffi
plufieurs examens^ avant d’obtenir leurs'degrés : ce-
lui q ui, après avoir foûtenu fes examens 6c autres
aétes probatoires , a été réfufé , s’il prétend que ce
foit injuftement, peut demander un examen public.
Ceux qui font pourvûs de qùelque office de jufti-
ce , font examinés fur ce qui concerné letir é ta t, à
moins qu’ils ne fuient difpënfés de Vexamen, en con-
fidération de leur capacité-bien connue d ’ailleurs.
Si l’officier paffe d’une charge ou place à une; autre
, qui demande plus de capacité ou quelque connoiffance
particulière, il doit fubir un nouvel examen.
Foye1 la Rocheflavin , des parlemehs , liv. V L
ch. xxviij. {A )
Ex a m e n à f u t u r , v o y e i En q u ê t e d ’e x a m e n
À f u t u r .
* EXAMILION, f. m* {Hift. mod.) muraille célébré
que l’empereur Manuel Paléologue fit élever fur
l’ifthme deCorinthe : elle avoit fix milles de longueur t
elle couvroit le Peloponefe contre les incurfions des
barbares : elle partoit du port Lechée, & s’étendoit
jufqu’au port de Cenchrée. Amurat fécond la démolit
: les Vénitiens la reconftruifirent en quinze jours:
elle fut renverfée pour la fécondé fois par Beglerbey,
6c ne fut point relevée.
EXAMINATEUR, f. m. {Jurifp. ) Foye^ C o m m
is s a ir e a u C h a s t e l e t , C o m m i s s a ir e E nq
u ê t e u r ,& au mot En q u ê t e u r . { A )
EXAMINER un compte -, {Commerce.) c’eft l e l ir e
a v e c exaftitude , en pointer les articles, en vérifier
le calcul, pour en découvrir les erreurs. Diüionn.
de Comm. Foyer C o m p t e .
EXa NGUIN , adj. en Anatomie, fe dit des vaif-
feaux qui ne renferment point la partie rouge du
fang.
Il y a quatre fortes de vaiffeaüx exanguins ; fa-
Voir, les vaiffeaüx ckylidoques, les vaiffeaüx lympha*
tiques , les vaiffeaüx nerveux, & les vaiffeaüx fecrè-
toires. M. Quefnay, f f . phyf. fur l'économie animale.
Foye{ C h y l id o q u e s , N e r v e u x , &c.
EXANTHEME , f. m. ( Medecine.) , dérivé
de îÇavQav, qui fignifie effiorefeere, fleurir, d’où
les Latins ont appellé les exanthèmes, ejflorefcentioe ,
efflorefcences ; c’eft un terme employé pour exprimer
l’éruption (qui fe fait fur la peau) des humeurs
viciées , dans le corps humain , qui fe portent de
l’intérieur à la furface, & y forment des taches qui
ne s’élèvent pas au-deffus au nisieau de la peau, ou