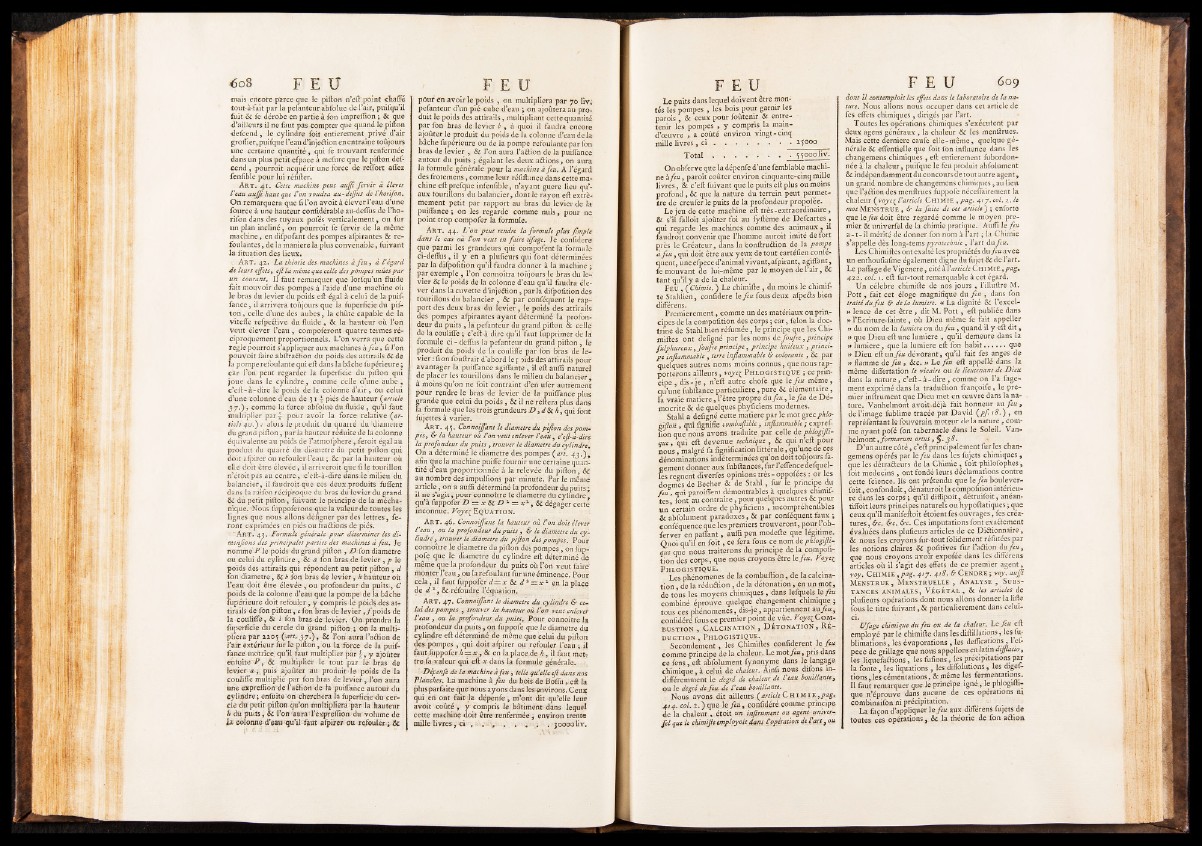
mais encore parce que le pifton n’eft“ point cîiaffé
tout-à-fait par la pefanteur abfolue de l’air, puifqu’ii
fuit & fe dérobe en partie à fon impreflion ; & que
d’ailleurs il ne faut pas compter que quand le pifton
•defcend, le cylindre foit entièrement privé d’air
groflier,puifque l’eau d’injeCtion en entraîne toujours
une certaine quantité, qui fe trouvant renfermée
dans un plus petit efpace à mefure que le pifton defcend
, pourroit acquérir une force de reflorr alfez
fenftble pour lui réfifter.
A r t . 41. Cette machine peut aujjî fervir à llever
Veau aufji haut que Von voudra au-deffus de Vhorifon.
On remarquera que fi l’on avoit à élever l’eau d’une
fource à une hauteur confidérable au-deflùs de l’ho-
rifon dans des tuyaux pofés verticalement, ou fur
un plan incliné, on pourroit fe fervir de la même
machine, endifpofant des pompes afpirantes & refoulantes,
de la maniéré la plus convenable, fuivant
la fituation des lieux.
•. A r t . 4 2 . La théorie des machines a feu y a l'egard
de leurs effets, ejl là même que celle des pompes mues par
un courant. Il faut remarquer que lorfqu’un fluide
fait mouvoir des pompes à l’aide d’une machine où
le bras du levier du poids eft égal à celui de la puif-
fance, il arrivera toujours que la fuperficie du pifton
, celle d’une des aubes, la chûte capable de la
vîtefîe refpeCtive du fluide , & la hauteur oh l’on
veut élever l’eau , compoferont. quatre termes réciproquement
proportionnels. L’on verra que cette
réglé pourroit s’appliquer aux machines à feu , fi J’on
pouvoit faire abftraCtion du poids des attirails & de
la pompe refoulante qui eft dans la bâche fupérieure ;
car l’on peut regarder la fuperficie du. pifton qui
joue' dans le cylindre, comme celle d’une aube ,
c’efl>à-dire le poids de la colonne d’air , ou celui
d’une colonne d’eau de 31 4- piés de hauteur (article
3 7 . ) , comme la force abfolue du fluide , qu’il faut
multiplier par-g- pour avoir la force, relative (ar-
ticle 40. f : alors le produit du quarré du 'diamètre
du grand pifton, par la hauteur réduite de la colonne
équivalente au poids de l’atmofphere,-feroit égal au
produit du quarré du diamètre du petit pifton qui
doit afpirer ou refouler l’eau ; & .par la hauteur oh
elle doit être é levée , il arriveroit que fi le tourillon
n’étoit pas au centre-, c’èft-à-dire dans.Ie milieu du
balancier, il faudroit-que cés deux produits fuffent
dans la râifon réciproque du bras du levier du grand
& du petit pifton * fuivant le principe de la mécha-
nique. -Nous fuppofeirons que la valeur de toutes les
lignes que nous allons déligner par des lettres, feront
exprimées en piés ou fractions de piés.
' "'Ar t . 43. Formule générale pour déterminer les di-
menjions des principales parties des machines à feu. Je
nomme /’ le poids"du grand.pifton , D (on. diamètre
ou celui du cylindre , & a fon bras-,de levier , p le
poids des attirails qui répondent au petit pifton , d
fon diamètre, & b fon bras de levier ,• h hauteur oh
l’eau doit être élevée , ou profondeur du puits.yC
poids de la colonne d’eau que la pompe de la bâche
fupérieure doit refouler ; y compris le poids des attirails
de fon pifton ; e fon bras de levier , /poids de
la çoulifle, & i fon bras-de levier. On prendra la
fuperficie du cercle du grand pifton. ; on la multipliera
par 220 5' (\att„ yyV), & l’on aura 1’aCtion de
l’air extérieur fur le pifton, ou la force de la puif-
fancbmotrice. qu’il faut multiplier par | y ajouter
ehftîîi& 'P , & multiplier le tout par le bras de
levier a.', puis ajouter au produit‘le*'pôids de la
çoulifle multiplié par fon bras de levier,-l’on aùra
line expreflion de 1’aCtibn de-ta puiflance autour du
cylindre; enfuite oh cherchera la fuperficiedu cercle
du’ petit pifton qu’on mnltiplierâ par .’la hauteur
U dû puits, & l’onraura" Fexpreftion du volume de
la colonne d’eau 'qu’il faut afpirer ou rqfouier-; &
pour en avoir le p o id s , on multipliera par 70 liv;
pefanteur d’un pié cube d’eau ; on ajoutera au produit
le poids des attirails, multipliant cette quantité
par fon bras de levier b , à quoi il faudra encore
ajoûter le produit du poids de la colonne d’eau de la
bâche fuperieure ou de la pompe refoulante par fon
bras de levier , & l’on aura l’aâion de la puiflance
; autour du puits ; égalant les deux allions, on aura
la formule générale pour la machine à feu. A l’égard
des frotemens, comme leur réfiftance dans cette machine
eft prefque infenfible, n’ayant guere lieu qu’aux
tourillons du balancier, dont le rayon eft extrêmement
petit par rapport au bras du levier de la
puiflance ; on les regarde comme nuis, pour ne
point trop compofer la formule.
A r t . 44. L'on peut rendre la formule pltis fimple
dans le cas ou Von veut en faire ilfage. Je confideret
que parmi les grandeurs qui compofent la formule
ci-defliis, il y en a plufieurs qui font déterminées
par la difpofition qu’il faudra donner à la machine ;
par exemple , l’on connoîtra toujours le bras du levier
& le poids de là colonne d’eau qu’il faudra élever
dans la cuvette d’injeCtion, par la difpofition des
tourillons du balancier , & par conféquent le rapport
des deux bras du lev ie r , le poids des attirails
des pompes afpirantes ayant déterminé la profondeur
du puits , là pefanteur du grand pifton & celle
de la çoulifle ; c’eft-àdire qu’il faut fupprimer de la
formule ci - defliis la pefanteur du grand pifton , le
produit du poids de la çoulifle par fon bras de levier
: lion fouftrait d’abord le j oids des attirails pour
avantager la puiflance agiflante , il eft aufli naturel
de placer les tourillons dans le milieu du balancier y
à moins qu’on ne foit contraint d’en ufer autrement
pour rendre le bras dé levier de la puiflance plus
grande que celui du poids, & il ne reliera plus dans
la formule que les trois grandeurs D y d& th , qui font
fujettes à varièr.
A r t . 45. Connoijfant le diamètre, du pijlon des pompes
> & la hauteur ou Von veut enlever Veau, c’ell-à-dire
la profondeur du puits , trouver le diamètre du cylindrée
On a déterminé lé diamètre des pompes (art. 4 3 .) ,
afin que la machine puiffe fournir une certaine quantité
d’eau proportionnée à la relevée du pifton, &
au nombre des impulfions par minute. Par le mêmé
article, on a aufli déterminé la profondeur du puits ;
il ne s’agit * pour connoître le diamètre du cylindre ,
qu’à fuppofer D = * & D 1 = x * , & dégager cette
inconnue. Voye^ E q u a t i o n .
A r t . 46. Connoijfant la hauteur ou Von doit élever
Veau y ou lu profondeur du puits , & le diamètre du cylindre
, trouver le didmetre du pijlon des pompes. Pour
connoître le diamètre du pifton des pompes on fup-
pofe que le diamètre du cylindre eft déterminé de
même que la profondeur du puits oh l’on veut faire
monter l’eau, ou la refoulant fur une éminence. Pour
cela, il faut fuppofer d = .x & d 2= x -2 en la place
de d 1 y & réfoudre l’équation.
A r t . 47. Connoijfant le diamètre du cylindre & celui
des pompes ^trouver la hauteur où Von veut enlever
Veau , ou la profondeur du puits. Pour connoître la
profondeur du puits, on fuppofe que le diamètre du
cylindre eft déterminé de même que «celui du pifton
des pompes , qui doit afpirer ou refouler l’eau ; il
fautfoppofer h = x , & en la place.de h , il faut met?
tre^ fa-valeur qui eft x dans la formule générale. ;,
' -Dépenfe de lamachine à feu , telle qu'elle ejl dans nos
Planches. La machine à feu du boislde Boffu , eft la
plusparfaite que nous ayons dans: les pnvirons. Ceurç
qui en ont fait la dépenfe ; m’ont dit qu’elle leur
avoit -coûté , y compris le bâtiment dans lequel
cette machine doit être renfermée * environ trente
mille livres, ci , • ■ .• «\p . ■ * - . 3 0000 liv.
Le puits dans lequel doivent être montés
les pompes , les bois^pour garnir les
parois , & ceux pour foûtenir & entretenir
les pompes , y compris la main-
d’oeuvre , a coûté environ vingt-cinq
mille livres, ci . ....................................25000
Total . . . . . . . . 5 5000 liv.
On obferve que la dépenfe d’une femblable machine
à / « , paroît coûter environ cinquante-cinq mille
livres, & c ’eft fuivant que le puits eft plus ou moins
profond, & que la nature du terrein peut permettre
de creufer le puits de la profondeur propofée.
Le jeu de cette machine eft très-extraordinaire,
& s’il falloit ajoûter foi au fyftème de Defcartes,
qui regarde les machines comme des animaux, il
faudroit convenir que l’homme auroit imite de fort
près le Créateur, dans la 'conftruCtion de la pompe
à feu , qui doit être aux yeux de tout cartéfien conféquent,
une efpece d’animal vivant, afpirant, agiffant,
le mouvant de lui-même par le moyen de l’air, &
tant qu’il y a de la chaleur.
F e u , ( Chimie. ) Le chimifte , du moins le chimif-
te Stahlien, confidere le feu fous deux afpeCts bien
différens.
Premièrement, comme un des matériaux ou principes
de la compofition des corps ; car, félon la doctrine
de Stahl bien réfumée, le principe que les Chi-
tniftes ont defigné par les noms; de foujre, principe
fulphureux, foufre principe, principe huileux , principe
inflammable , terre inflammable & colorante , & par
quelques autres noms moins connus, que nous rapporterons
ailleurs, voye^ P h l o g i s t i q u e ; ce principe
, dis - je , n’eft autre chofe que le feu même,
qu’une fubftance particulière, pure & élémentaire,
la vraie matière, l’être propre du feu, le feu de D é-
mocrite & de quelques phyficiens modernes.
Stahl a defigné cette matière par le mot grecphlo-
giflon , qui fignifie combujlible , inflammable ; expref-
fioh que nous avons traduite par celle de phlogijti-
que y qui eft devenue technique , & qui n’eft pour
nous, malgré fa lignification littérale, qu’une de ces
dénominations indéterminées qu’on doittoûjours fa-
gement donner aux fubftances, furl’eflencedefquel-
les régnent diverfes opinions très-oppofées : or les
dogmes de Becher & de Stahl, fur le principe du
feu , qui paroiffent démontrables à quelques chimif-
tes, font au contraire, pour quelques autres & pour
un certain ordre de phyficiens , incompréhenfibles
& abfolument paradoxes, & par conféquent faux ;
conféquence que les premiers trouveront, pour l’ob-
ferver en paflant, aufli peu modefte que légitime.
Quoi qu’il en f o i t , ce fera fous ce nom de phLogifli-
que que nous traiterons du principe de la compofition
des corps, que nous croyons être le feu. Voye.1
P h l o g i s t i q u e .
Les phénomènes de la combulhon, de la calcination
, de la réduûion, de la détonation, en un mot,
de tous les moyens chimiques, dans lefquels le / t t
combiné éprouve quelque changement chimique ;
tous ces phénomènes, dis-je, appartiennent a u / « ,
confidéré fous ce premier point de vûe. J'qyeç CoM-
b u s t i o n , C a l c i n a t i o n , D é t o n a t i o n , R é d
u c t i o n , P h l o g i s t i q u e . .
Secondement, les Chimiftes confiderent le feu
comme principe de la chaleur. Le mot feu , pris.dans
ce fens, eft abfolument fynonyme dans le langage
chimique, à celui de chaleur. Ainfi nous difqns indifféremment
le degré de cîialeur de leau bouillantey
ou le degré de feu de Veau bouillante.
Nous avons dit ailleurs ( article C h im i e , pag.
4/4. col. 2. ) que le feu , confidéré comme principe
de la chaleur , étoit un injlrumejit ou agent univer-,
fe l que le çhimijle employoit dans Vppération de Vart > ou.
dont il contemploit les effets dans le laboratoire de la nature.
Nous allons nous occuper dans cet article de
fes effets chimiques , dirigés par l’art.
Toutes les opérations chimiques s’exécutent par
deux agens généraux , la chaleur & les menftrues.
Mais cette derniere caufe elle-même, quelque générale
& effentielle que foit fon influence dans les
changemens chimiques , eft entièrement fubordon-
née à la chaleur, puifque le feu produit abfolument
& indépendamment du concours de tout autre agent,
un grand nombre de changemens chimiques, au lieu
que l’aftion des menftrues fuppofe néceffairement la
chaleur (voyeç l'article C h i m i e , pag. 4/7. col. 2. le
mot MENSTRUE , & la fuite de cet article ) ; enforte
que le feu doit être regardé comme le moyen premier
& univerfel de la chimie pratique. Aufli le feu
a - t - i l mérité de donner fon nom à l’art ; la Chimie
s’appelle dès long-tems pyrotechnie, l’art du feu.
Les Chimiftes ont exalté les propriétés du feu avec
un enthoufiafme également digne du fujet & de l’art.
Le paffage de Vigenere, cité à l'article C h i m i e , pag.
422. col. 1. eft fur-tout remarquable à cet égard.
Un célébré chimifte de nos jours , l’illuftre M.
P o t t , fait cet éloge magnifique du feu , dans fon
traité du feu & de la lumière. « La dignité & l’excel-
» lence de cet ê tre, dit M. P o t t , eft publiée dans
» l’Ecriture-fainte, où Dieu même fe fait appeller
» du nom de la lumière ou du fe u , quand il y eft d it,
» que Dieu eft une lumière , qu’il demeure dans la
» lumière, que la lumière eft fon habit...........que
» Dieu eft un feu dévorant, qu’il fait fes anges de
» flamme de feu , &c. » Le feu eft appellé dans la
même differtation le vicaire ou le lieutenant de Dieu
dans la nature, c’e f t - à -d ir e , comme on l’a fage-
ment exprimé dans la tradu&ion françoife, le premier
infiniment que Dieu met en oeuvre dans la nature.
Vanhelmont avoit.déjà fait honneur au feu ,
de l’image fublime tracée par David ( p f 18.) , en
j repréfentant le fouverain moteur de la nature, comme
ayant pofé fon tabernacle dans le Soleil. Vanhelmont
yformarum ortus 9 § . g 8. ?
D ’un autre côté, c’eft principalement fur les changemens
opérés par le feu dans les fujets chimiques ,
que les détracteurs de la Chimie , foit philofophes,
foit médecins , ont fondé leurs déclamations contre
cette fçience. Ils ont prétendu que le feu boulever-
fo it , confondoit, dénaturoit la compofition intérieure
dans les corps ; qu’il diflipoit, détruifoit, anéan-
tiffoit leurs principes naturels ou hypoftatiques ; que
ceux qu’il manifeftoit étoient fes ouvrages, fes créatures
, &c. &c. &c. Ces imputations font exactement
évaluées dans plufieurs articles de ce Dictionnaire,
& nous les. croyons fur-tout folidement réfutées par
les notions claires & pofitives fur l’aCtion du feu ,
que nous croyons avoir expofée dans les différens
articles où il s’agit des effets de ce premier agent,
yoy. C h i m i e ,pag. 41 y. 418. & C e n d r e ; voy. aujjt
M e n s t r u e , M e n s t r u e l l e , A n a l y s e , S u b s t
a n c e s a n i m a l e s , VÉGÉTAL, & les articles de
plufieurs opérations dont nous allons donner la lifte
fous le titre fuivant, & particulièrement dans celui-
ci. _
Ufage chimique du feu ou de la chaleur. Le feu eft
employé parle chimifte dans les diftillations, lesfublimations,
les évaporations , les déifications, 1 efpece
de,grillage que nous appelions en latin difflatio,
les liquéfactions, les fufions, les précipitations par
la fonte, les liquations , les diffolutions, les digef-
tions,les cémentations, & meme les fermentations.
Il faut remarquer que le principe igné, le phlogifti-
que n’éprouve dans aucune de ces operations ni
comhinaifon ni précipitation. v .
La façon d’appliquer le feu aux differens fujets de
toutes ces opérations, & la théorie de fon aCtion