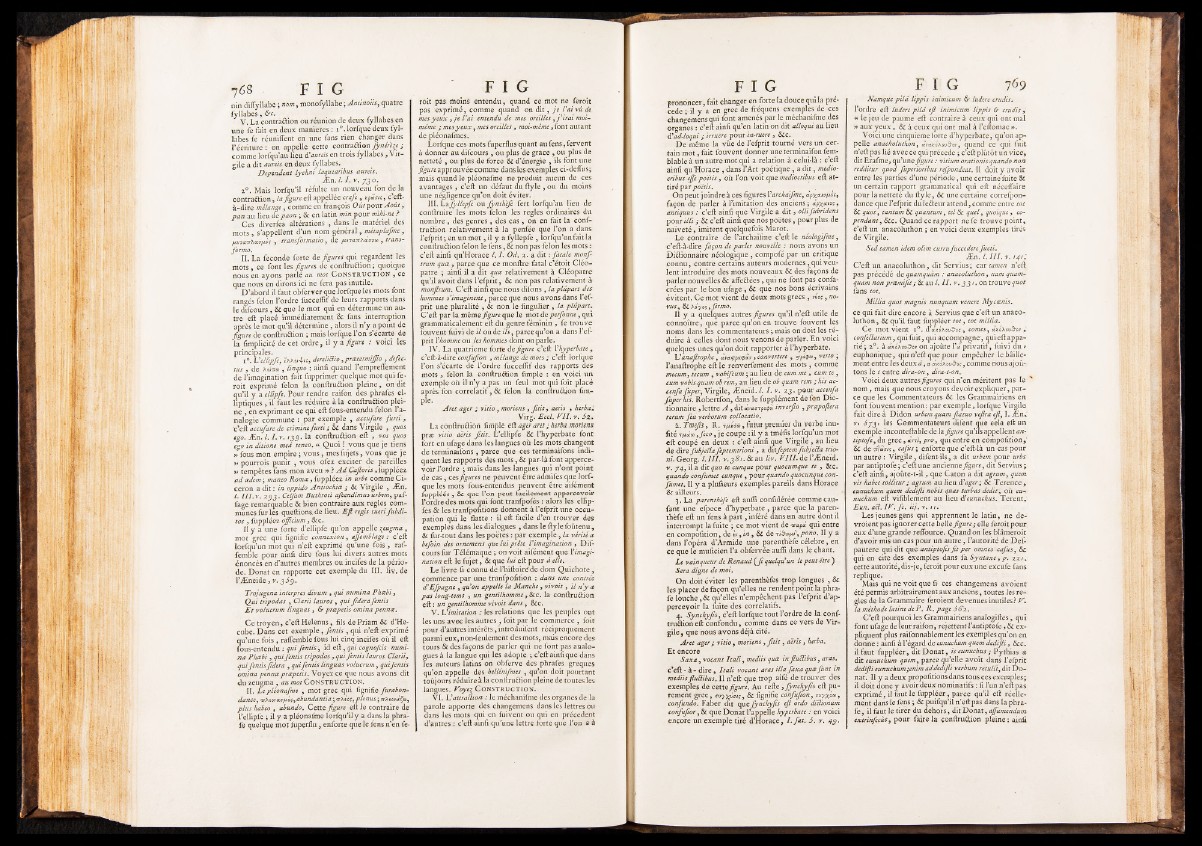
nin diffyllabe ; nom, monofyllabe ; Antinous, quatre
fyllabes, &c. ,
V. La contra&ion ou réunion de deux fyllabes en
une fe fait en deux maniérés : i°. lorfque deux iyllabes
fe réunifient en une fans rien changer dans
l’écriture : on appelle cette contraâiôn Jynerh^e ;
comme lorfqu’au lieu àlauréis en trois fyllabes , Virgile
a dit aureis en deux fyllabes.
Dépendent Lychni laquearibus aurcis.
Æn. 1. 1 . y . y 2,0.
a°. Mais lorfqu’il réfulte un nouveau fon de la
contraftion, la figure eft appellee crafe , y.pé*trn, c eft-
à-dire mélange, comme en françois O ût pour A o û t,
pan au lieu de paon ; & en latin min pour mihi-ne ?
Ces diverfes altérations , dans le matériel des
mots , s’appellent d’un nom général, métaplafme ,
pncc7r\ct<rpoç , transformado, de pvrct7txâ<nr<à , trans-
fiormo.
II. La fécondé forte de figures qui regardent les
mots , ce font les figures de conftruCtion ; quoique
nous en ayons parlé au mot C o n s t r u c t i o n , ce
que nous en dirons ici ne fera pas inutile.
D’abord il faut obferver que lorfque les mots font
rangés félon l’ordre fucceflif de leurs rapports dans
le difeours , & que le mot qui en détermine un autre
eft placé immédiatement & fans interruption
après le mot qu’il détermine, alors il n’y a point de
figure de conftruCtion ; mais lorfque l’on s’écarte de
la fimplicité de cet ordre, il y * figure : voici les
principales.
i°. Vellipfe, dereliclio, proetermijfio , defectus
, de A dira , linquo : ainfi quand l’empreflement
de l’imagination fait fupprimer quelque mot qui fe-
roit exprimé félon la conftruCtion pleine, on dit
qu’il y a ellipfe. Pour rendre raifon des phrafes elliptiques
, il faut les réduire à la conftruCtion pleine
, en exprimant ce qui eft fous-entendu félon l’analogie
commune : par exemple , accufare fu r t i ,
t ’eft accufare de crimine furti ; & dans Virgile , quos
ego. Æn. /. I .v . 13g . la conftruCtion eft , vos quos
ego in ditione meâ teneo. « Quoi ! vous que je tiens
» fous mon empire ; vous, mes fujets, vous que je
» pourrois punir , vous ofez exciter de pareilles
» tempêtes fans -mon aveu » ? A d Cafioris , l'uppléez
ad oedem ; maneo Romce , fuppléez in urbe comme Cicéron
a dit : in oppido Andochioe ; & Virgile , Æn.
/. I I I .v . z g 3 . Çelfam Buthroti afeendimus urbem, pafi
fage remarquable & bien contraire aux réglés communes
fur lés queftions.de lieu. Eft regis tuerifubdi-
tos , fuppléez officium, &c.
II y a une forte d’ellipfe qu’on appelle {tugma,
mot grec qui lignifie connexion, ajjemblage : c’eft
lorfqu’un mot qui n’eft exprimé quTune fois , raf-
femble pour ainfi dire fous lui divers autres mots
énoncés en d’autres membres ou incifes de la période.
Donat en rapporte cet exemple du III. liv. de
l’Æneïde , v. 3 6$.
Trojugena interpres divum , qui numma Phoebi ,
Q u i tripodas , Clarii lauros , qui fiderafends
E t volucrum linguas , & proepeds omina pennee.
Ce troyen, c’eft Helenus, fils de Priam & d’He-
cube. Dans cet exemple, fends , qui n’eft exprimé
qu’une fois , raflemble fous lui cinq incifes où il eft
fous-entendu : qui fen d s , id eft, qui cognofcis numi-
na Phoebi , qui fends tripodas ,q u i fends lauros Clarii,
qui fendsfidera , quifentis linguas volucrum, quifends
omina pennoe proepeds. Voyez ce que nous avons dit
d u zeugma , au mot C o n s t r u c t i o n .
II. Le pléonafme , mot grec qui lignifie furabon-
dance, <vrXiova.cpoç, abundanda ; ttMoç, plenus ; TrXtovctÇu,
plus habeo , abundo. Cette figure eft le contraire de
l’ellipfe ; il y a pléonafme lorfqu’il y a dans la phra-
fe quelque mot fuperflu, enforte que le fens n’en fer
o i t p a s m o in s e n t e n d u , q u a n d c e m o t n e f e r o i t
p a s e x p r im é , c o m m e q u a n d o n d i t , j e l'ai vu de.
mes yeux , j e Vai entendu de mes oreilles, j'ir a i moi-
même ; mes y e u x , mes oreilles , moi-même, font a u t a n t
d e p l é o n a fm e s .
Lorfque ces mots fuperflus quant au fens, fervent
à donner au difeours , ou plus de grâce , ou plus de
netteté , ou plus de force & d’énergie , ils font une
figure approuvée comme dans les exemples ci-defliis;
mais quand le pléonafme ne produit aucun de ces
avantages , c’eft un défaut du ftyle, ou du moins
une négligence qu’on doit éviter.
III. LaJ'yllepfe ou fynthefe fert lorfqu’au lieu de
conftruire les mots félon les réglés ordinaires du
nombre, des genres , dés cas , on en fait la conf-
truâion relativement à la penfée que l’on a dans
l’efprit; en un mot, il y a fyllepfe , lorfqu’onfaitla
conftru&ion félon le fens, & non pas félon les mots :
c’eft ainfi qu’Horace l. /. Od. z . a dit : fatale monf-
trum quoe., parce que ce monftre fatal c’étoit Cléopâtre
; ainfi il a dit quoe relativement à Cléopâtre
qu’il a voit dans l’efprit, & non pas relativement à
monfirum. C’eft ainfi que nous dilôns , la plupart des
hommes s'imaginent, parce que nous avons dans l’efprit
une pluralité , & non le fingulier , la plupart.
C’eft par la même figure que le mot de perfonne, qui
grammaticalement eft du genre féminin , fe trouve
louvent fuivi de i l ou de i ls , parce qu’on a dans l’efprit
l’homme ou les hommes dont on parle.
IV. La quatrième forte de figure c’eft Vhyperbate ,
c’eft-à-dire confufion , mélange de mots ; c’eft lorfque
l’on s’écarte de l’ordre fucceflif des rapports des
mots , félon la conftru&ion fimple : en voici un
exemple où il n’y a pas un feul mot qui foit placé
après fon corrélatif, & félon la conftruâion fimple.
Aret ager ; v id o , moriens , f i t i t , aeris , herba l
Virg. Eccl. V I I .v . S z ,
La conftruftion fimple eft ager aret ; herba moriens
præ vido aêris fit it . L’ellipfe & l’hyperbate font
fort en ufage dans les langues où les mots changent
de terminaifons , parce que ces terminaifons indiquent
les rapports des mots, & par-là font apperce-
voir l’ordre ; mais dans les langues qui n’ont point
de cas, ces figures ne peuvent être admifes que lorfque
les mots fous-entendus peuvent être aifément
fuppléés , & que l’on peut facilement appercevoir
l’ordre des mots qui font tranfpofés : alors les ellip-
fes & les tranfpofitions donnent à l’efprit une occupation
qui le flatte : il eft facile d’en trouver des
exemples dans les dialogues , dans le ftyle foûtenu ,
& fur-tout dans les poètes : par exemple, la vérité a
befoin des ornemens que lui prête l'imagination , Difeours
fur Télémaque ; on voit aifément que l’imagination
eft le fujet, & que lui eft pour à elle.
Le livre fi connu de l’hiftoiré de dom Quichote,
commence par une tranfpofition : dans une contrée
d'Efpagne , qu'on appelle la Manche , viv ait, i l n'y a
pas long-tems , un gentilhomme , &c. la conftruûion
eft : un gentilhomme vivoit dans, &c.
V. L'imitation : l e s r e l a t i o n s q u e l e s p e u p l e s o n t
l e s u n s a v e c l e s a u t r e s , f o i t p a r l e c o m m e r c e , f o i t
p o u r d ’ a u t r e s i n t é r ê t s , i n t r o d u i f e n t r é c ip r o q u e m e n t
p a rm i e u x , n o n - f e u l e m e n t d e s m o t s , m a i s e n c o r e d e s
t o u r s & d e s f a ç o n s d e p a r l e r q u i n e f o n t p a s a n a l o g
u e s à l a l a n g u e q u i l e s a d o p t e , ; c ’ e f t a i n f i q u e d a n s
l e s a u t e u r s l a t in s o n o b f e r v e d e s p h r a f e s g r e q u e s
q u ’ o n a p p e l l e d e s hellénifrnes , q u ’o n d o i t p o u r t a n t
t o u j o u r s r é d u i r e à l a c o n f t r u û i o n p l e i n e d e t o u t e s l e s
l a n g u e s . Voye^ C o n s t r u c t i o n .
VI. L’attraction : l e m é c h a n i fm e d e s o r g a n e s d e l a
p a r o l e a p p o r t e d e s c h a n g e m e n s d a n s l e s l e t t r e s o u
d a n s l e s m o t s q u i e n f u i v e n t o u q u i e n p r é c è d e n t
d ’ a u t r e s : c ’ e f t a in f i q u ’u n e l e t t r e f o r t e q u e l ’ o n a à
prononcer, fait changer en forte la douce qui la précédé
j'il y a en grec de fréquens exemples de ces
changemens qui font amenés par le méchanifme des
organes : c’eft ainfi qu’en latin on dit alloqui au lieu
d'ad-loqui ; irruere pour in-ruere , &c.
De même la vue de l’efprit tourné vers un certain
mot, fait fouvent donner une terminaifon fem-
blable à un autre mot qui a relation à celui-là : c’eft
ainfi qu’Horace , dans l’Art poétique , a dit, medio-
cribus effe p o id s , où l’on voit que mediocribus eft attiré
par poètis.
On peut joindre à ces figures Varchaïfme, àpxaurpk,
façon de parler à l’imitation des anciens ; «p%a/oç,
andquus : c’eft ainfi que Virgile a dit > olli fubridens
pour illi ; & c’eft ainfi que nos poètes, pour plus de
naïveté, imitent quelquefois Marot.
Le contraire de l’archaïfme c’eft le néologifme,
c’eft-à-dire façon de parler nouvelle : nous avons un
Dictionnaire néologique , compofé par un critique
connu, contre certains auteurs modernes, qui veulent
introduire des mots nouveaux & des façons de
parler nouvelles & affeCtées, qui ne font pas confa-
crées par le bon ufage , & que nos bons écrivains
évitent. Ce mot vient de deux mots grecs , vloç, no-
vus, & xiyoc ,fermo.
II y a quelques autres figures qu’il n’eft utile de
connoître, que parce qu’on en trouve fouvent les
noms dans les commentateurs ; mais on doit les réduire
à celles dont nous venons de parler. En voici
quelques unes qu’on doit rapporter àl’hyperbate.
Uanafirophe, àvetç-putpuv , convertere , ç-ptçu, verto ;
l’anaftrophe eft le renverfement des mots, comme
mecum3 tecum ,vobifcum ; au lieu de cum me , cum te ,
cum vobis quam ob rem, au lieu de ob quam rem ; his ac-
cenfa fuper, Virgile, Æneïd. I. I . v. Z 3 . pour accenfa
fuper his. Robertfon, dans le fupplément de fon Dictionnaire
, lettre A , dit àvetarfotp» inverfio , proepoflera
rerum feuverbomm collocado.
z . Tmefis, R. , futur premier du verbe inu-
fité tpclu ,fe c o , je coupe : il y a tméfis lorfqu’un mot
eft coupé en deux : c’eft ainfi que Virgile , au lieu
de dire fubjecia feptemtrioni , a fatfeptemfubjecla trio-
ni. Georg. /. I I I . v .3 81. & au liv. V I I I . de l’Æneïd.
v. 74, il a dit quo te cunque pour quocumque te , &c.
quando confumet cunque , pour quando quocunque con-
fumet. Il y a plufieurs exemples pareils dans Horace
& ailleurs.
3. La parenthtfe eft aufli confidérée comme cau-
fant une efpece d’hyperbate , parce que la paren-
thèfe eft un fens à part, inféré aàns un autre dont il
interrompt la fuite ; ce mot vient de <vra.f>d qui entre
en compofition, de iv , i n , & de d $ » p l, pono. Il y a
dans l’opéra d’Armide une parenthèfe célébré, en
ce que le muficien l’a obfervée aufli dans le chant.
Le vainqueur de Renaud ( J î quelqu'un le peut être )
Sera digne de moi.
On doit éviter les parenthèfes trop longues , &
les placer de façon qu’elles ne rendent point la phra-
fe louche ,& qu’elles n’empêchent pas l’efprit d’ap-
percevoir la fuite des corrélatifs.
4 . Synchyfis, c’eft lorfque tout l’ordre de la conf-
tru&ion eft confondu, comme dans ce vers de Virgile
, que nous avons déjà cité.
Aret agerç v id o , moriens, f i t i t , défis, herba.
Et encore
S a xa , voçant I ta li, mediis quoe ijtfiuclibüs, aras.
c’eft - à - dire, Itali vocant aras ilia fa xa quoe funt in
mediis fiuclibus. Il n’eft que trop aifé de trouver des
exemples de cette figure. Au refte , fynchyfis eft purement
grec, myxvaiç, & lignifie confufion, <svy%ou ,
confundo. Faber dit que fynchyfis efi ordo diclionum
confufior, & que Donat l’appelle hyperbate : en voici
encore un exemple tiré d’Horace, I . fa t . 5 . v . 45).
Namque pila lippis inimicum & ludere crudis.
l’ordre eft ludere p ilâ efi inimicum lippis & crudis,
« le jeu de paume eft contraire à ceux qui ont mal
» aux yeux, & à ceux qui ont mal à l’eltomac ».
Voici une cinquième forte d’hyperbate, qu’on appelle
anacholuthon, àva.y.oXovd'ov, quand ce qui fuit
n’eft pas lié avec ce qui précédé ; c’eft plûtôt un vice,
dit Erafme, qu’une figure : vitium or adonis quando non
redditur quod fuperioribus refpondeat. Il doit y avoir
entre les parties d’une période, une certaine fuite &
un certain rapport grammatical qui eft néceflaire
pour la nettete du ftyle, & une certaine correfpon-
dance que l’efprit dulefteur attend, comme entre tôt
&C quot, tantum & quantum, tel 8t quel, quoique, cependant,
&c. Quand ce rapport nefe trouve point,
c’eft un anaeôluthon ; en voici deux exemples tirés
de Virgile.
Sed tamen idem olim curru fuccedere fued.
Æn. I. I I I . v. 141I
C’eft un anacoluthon, dit Servius ; car tamen n’elt
pas précédé de quamquàm : anacoluthon, nam quam-
quam non proemifit ; & au l. I I . v. 331.011 trouve quot
fans tôt.
Millia quot magnis nunquam venere Mycoenis.
ce qui fait dire encore à Servius que c’eft un anacoluthon,
& qu’il faut fuppléer tôt, tôt millia.
Ce mot vient i°. d’aiîÔAouAoç, cornes, à.y.aXoud'ov,
confectarium, qui fuit, qui accompagne", qui eft apparié;
20. à axoAoud-ov on ajoute IV privatif, fuivi du v
euphonique, qui n’eft que pour empêcher le bâillement
entre les deux«,« «xoAoüAof, comme nous ajoutons
le t entre dira-on, dira-t-on.
Voici deux autres figures qui n’en méritent pas le p
nom, mais que nous croyons devoir expliquer, parce
que les Commentateurs & les Grammairiens en
font fouvent mention: par exemple, lorfque Virgile
fait dire a Didon urbem quam fiatuo vefira efi, I. Æn.
v. S j 3 . les Commentateurs difent que cela eft un
exemple inconteftable de la figure qu’ils appellent an-
tiptofe, du grec, *m, pro, qui entre en compofition,'
& de ifluinç, cafus ; enforte que c’eft-là un cas pour
un autre : Virgile, difent-ils, a dit urbem pour urbs
par antiptofe; c’eft une ancienne figure, dit Servius;
c’eft ainfi, ajoûte-t-il, que Caton a dit agrum, quem
virhabet tollitur; agrum au lieu à'ager', & Terence,
eunuchum quem dedifii nobis quas turbas dédit, où eu-*
nuchum eft vifiblement au lieu à’ eunuchus. Terent.
Eun. a'cl. IV . f c . iij. v. 1
Les jeunes gens qui apprennent le latin, ne de-
vroient pas ignorer cette belle figure; elle feroit pour
eux d’une grande reflource. Quand on les blâmeroit
d’avoir mis un cas pour un autre, l’autorité de Défi
pautere qui dit que andpiofis f it per omnes-cafus, &
qui en cite des exemples dans fa Syntaxe, p . z z t .
cette autorité, dis-je, feroit pour eux une exeufe fans
répliqué.
Mais qui ne voit que fi ces changemens avoient
été permis arbitrairement aux anciens, toutes les réglés
de la Grammaire feroient devenues inutiles? V .
la méthode latine de P . R . page 5 6 z .
C’eft pourquoi les Grammairiens analogiftes, qui
font ufage de leur raifon, rejettent l’antiptofe, & expliquent
plus raifonnablement les exemples qu’on en
donne : ainfi à l’égard de eunuchum quem dedifii, 6cc.
il faut fuppléer, dit Donat, iseunUckus ; Pythias a
dit eunuchum quem, parce qu’elle avoit dans l’efprit
dedifii eunuchum;enim ad dedifii verbum retulit, dit Donat.
Il y a deux propofitionsdans tous ces exemples;
il doit donc y avoir deux nominatifs : fi l’un n’eft pas
exprimé, il faut le fuppléer, parce qu’il eft réellement
dans le fens ; & puifqu’il n’eft pas dans la phra-
fe, il faut le tirer du dehors, dit Donat, affumendum
extrinfecùs, pour faire la çonftruttion pleine : ainfi