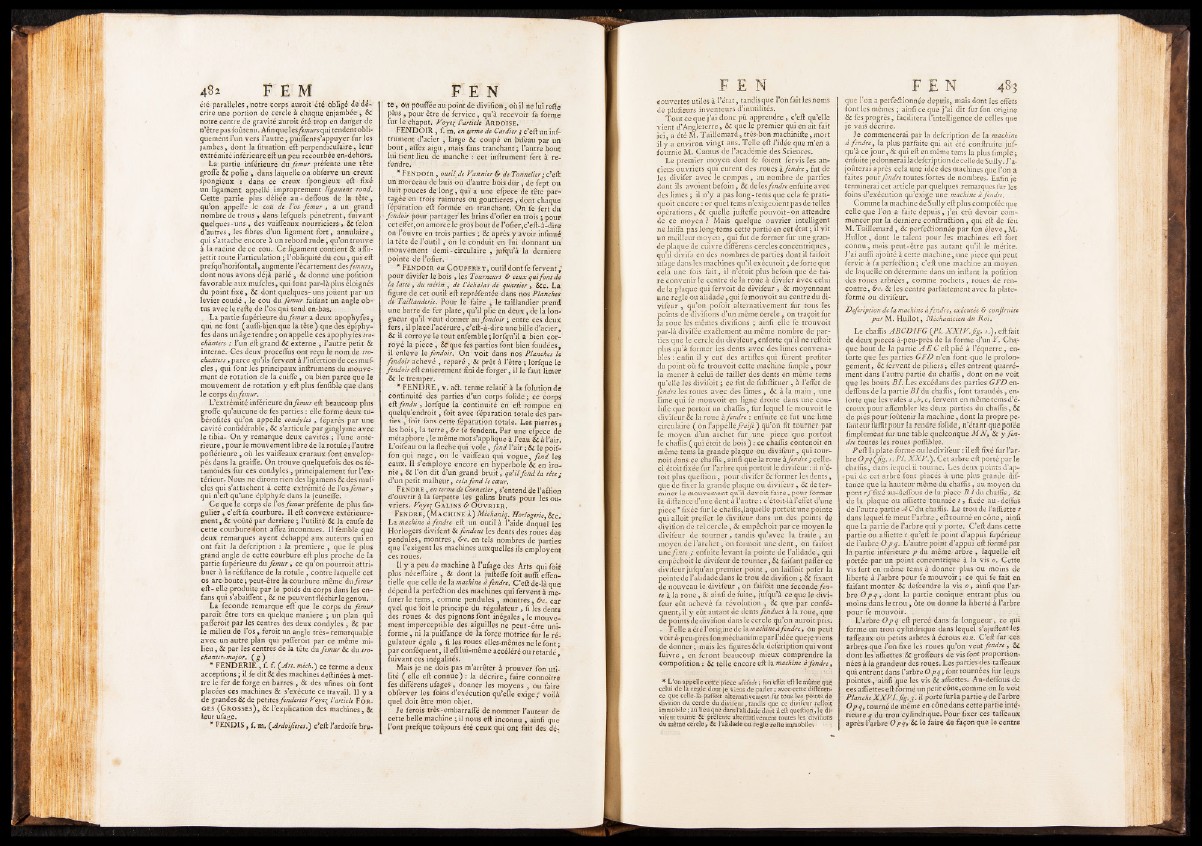
été parallèles, notre corps auroitété obligé de décrire
une portion de cercle à chaque enjambée , ôc
notre centre de gravité aiiroit été trop en danger de
n’ être pas foûtenu. Afin que les fémurs qui tendent obliquement
l’un vers l’autre, puiffent s’appuyer fur les
jambes, dont la fituation eft perpendiculaire, leur
extrémité inférieure éft un peu recourbée en-dehors.
La partie inférieuré du fémur préfente une tête
groffe ôc polie , dans laquelle on obferve un creux
îpongiçux : dans ce creux fpongieüx eft fixé
un ligament appellé. improprement ligament rond.
Cette partie plus déliée au - deffous de la tête •,
qu’on appelle le cou de Vos fémur > a un grand
nombre de trous , dans léfquels. pénètrent, fuivant
quelques-uns , des vaiffeaux nourriciers , & félon
d’autres, les fibres d’un ligament fort, annulaire,
qui s’attache encore à un rebord rude^ qu’on trouve
à la racine de ce cou. Ce ligament contient & affu-
jettit toute l’articulation ; l’obliquité du cou , qui eft
prefqu’horifontal, augmente l’écartement des fémurs,
dont nous avons déjà parlé , & donné une pofition
favorable aux mufcles, qui lont par-là plus éloignés
du point fixe, ôc dont quelques-uns joiient par un
levier coudé , le cou du fémur. faifant un angle obtus
avec le refte de l’os qui tend en-bas,
. La partie Supérieure du fémur a deux apophyfes,
qui ne font (aufli-bien que la tête) que des épiphy-
ies dans un âge tendre ; on appelle ces apophyfes trochanters
: l’un éft grand ôc externe , l’autre petit &
interne. Ces deux proceflus ont reçu le nom de tro-~
chanters , parce qu’ils fervent à l’infertion de ces mufcles
, qui font les principaux inftrumens du mouvement
de rotation de la cuiffe , ou bien parce que le
mouvement de rotation y eft plus fenfible que dans
le corps du fémur.
L’extrémité inférieure du fémur eft beaucoup plus
groffe qu’aucune de fes parties : elle forme deux tu-
bérofites qu’on appelle condyles , féparés. par une
cavité confidérable, ÔC s’articule par ginglyme avec
le tibia. On y remarque deux cavités ; l’une antérieure
, pour le mouvement libre de la rotule ; l’autre
poftérieure, où les vaiffeaux cruraux font enveloppés
dans la graiffe. On trouve quelquefois des os fé-
l'amoïdes fur ces condyles, principalement fur l’extérieur.
Nous ne dirons rien des ligamens ôc des mufcles
qui s’attachent à cette extrémité de l’os fémur ,
qui n’eft qu’une épiphyfe dans la jeuneffe.
Ce que le corps de l’os fémur préfente de plus fin-
gulier, c’eft fa courbure. Il eft convexe extérieurement
, & voûté par derrière ; l’utilité ôc la caufe de
cette courbure font affez inconnues, llfemble què
deux remarques ayent échappé aux auteurs qui en
ont fait la defcription i la première , que le plus
grand angle de cette courbure eft plus proche de la
partie fupérieure du fémur, ce qu’on pourroit attribuer
à la réfiftance de la rotule , contre laquelle cet
os arc-boute ; peut-être la courbure même du fémur
eft - elle produite par le poids du corps dans les en-
fans qui s’abaiffent, & ne peuvent fléchir le genou.
La fécondé remarque eft que le corps du fémur
paroît être tors en quelque maniéré ; un plan qui
pafferoit par les centres des deux condyles ; ôc par
le milieu de l’o s , feroit un angle très-remarquable
avec un autre plan qui pafferoit par ce même mi*
lieu , & par les centres de la tête du fémur ôc du trochanter
major, { g )
* FENDERIE, f. f. {Art. méch.) ce terme a deux
acceptions ; il fe dit ôc des machines deftinées à mettre
le fer dé forge en barres , & des ufines où font
placées ces machines & s’exécute ce travail. Il y a
de grandes & de petites fenderies Veyeç l'article F o r g
e s (G r o s s e s ) , ôc l’explication des machines, &
leur ufage.
* FENDIS , f.m. {Ardoifieres.) c’eft l’ardoife brut
e , o u pouffée au point dé d iv ifion , où il ne lui refte
plus j pour être de fe r v ic e , qu’à rec e vo ir fa forme
fur le chaput. VoyefVdrticte A r d o is e .
FENDOIR, f. m-, en terme de Cardier ; c’eft un instrument
d’acier , large ôc coupé en bifeau par un
bout, affez aigu, mais fans tranchant; l’autre bout
lui tient lieu de manche : cet infiniment’ fert à refendre.
* FENDOIR , outil de Vannier 6* de Tonnelier; c’eft.
uh nîorceàu de buis où d’autre bois dur , de fept ou
huit po'ucès de lôrig, qui' a une efpece de tête partagée
en trois rainures ou gouttières ,• dont chaque
Séparation eft forriiée en tranchant. On fe fert du
fmdoir pour partager' les brins d’ofier en trois ; pour
cet effet,On amorce le gros bóut dé l*ôfièr,c’eft-à-dire
on l’ouvre en trois parties ; ôc après y avoir infinué
la tête de l’outil ,- on le conduit en lui donnant un
mouvement demi - circulaire , jufqu’à la derniere
pointe dé l’ofîer.
* F e n d o ir ou C o u p e r e t , outil dont fe fervent
poiïr divifer le bois , les Tourneurs & ceux qui font de
la latte , du mérin, de Véckalas de quartier , Ôcc. La
figure dé cet outil eft repréfèntée dans nos Planches
de Taillanderie* Pour le faire , le taillandier prend
une barre de fer plate, qu’il plie en deux, de la longueur
qu’il veut donner au fendoir ; entre ces deux
fers, il place l’acérure ,-c’eft-à-dire une bille d’acier,
ôc il corroyé le tout enfemble ; lorfqu’il a bien corroyé
la piece , ôc*que fes parties font bien foudées,
il enleve le fendoir. On voit dans nos Planches U
fendoir a'chevé , réparé , & prêt à l’être ; lorfque le
fendoir eft entièrement fini de forger, il le faut limer
ôc le tremper.
* FENDRE, v . a&. terme relatif à la Solution de
continuité des parties d’urt corps folide; ce corps
eft fendu , lorfque la continuité eh eft rompue en
quelqu’èndroit, Soit avec 'Séparation totale des parties
, Soit fans cette Séparation totale. Les pierres,
les bois; la terre, &c fe fendent. Par une efpece de
métaphore, le même mot s’applique à l’eau ôc à l’air.
L’oifeau ou la fléché qui v o le , fend l ’air ; & le poif-
fon qui nage, ou le vaiffeau qui vogue, fend les
eaux. Il s’employe encore en hyperbole ôc en ironie
, ÔC l’on dit d’un grand bruit, qu’il fend la tête ;
d’un petit malheur, cela fend le coeur.
Fe n d r e , en terme deCornetier, s’entend de l’aûion
d’ouvrir à la ferpette lès galins bruts pour les ouvriers.
Voye^ G a l in s & O u v r ie r .
FENDRE, (MACHINE À) Méchaniq. Horlogerie &c.'
"Lu machine à fendre eft un outil à l’aide duquel les
Horlogers divifent & fendent les dents des roues des
pendules, montres, &c. en tels nombres de parties
que l’exigent les machines auxquelles ils employent
ces roues.
Il y a peu de machine à l’ufage des Arts qui foif
plus néceffaire , & dont la jufteffe foit aufli effen-
tielle que celle de la machine à fendre. C ’eft de-là que
dépend la perfection des machines qui fervent à me.
furer le tems, comme pendules , montres, &c. car
qv.el que Toit le principe du régulateur , fi les dents
des roues & des pignons font inégales , le mouvement
imperceptible des aiguilles ne peut-être uniforme
, ni la puiffance de la force motrice fur le régulateur
égale , fi les roues elles-mêmes ne le font;
par conféquent, il eft lui-même accéléré ou retardé,
fuivant ces inégalités.
Mais je ne dois pas m’arrêter à prouver fon utilité
( elle eft connue ) : la décrire, faire connoître
fes différens ufages, donner les moyens , ou faire
obferver les foins d’exécution qu’elle exige ;* voilà
quel doit être mon objet.
Je ferois très-embarraffé de nommer l’auteur de
cette belle machine ; il nous eft inconnu , ainfi que
l’ont prefque toujours été ceux qui ont fait des découvertes
utiles à l’état, tandis que l’on fait les noms
de plufieurs inventeurs d’inutilités.
Tout ce que j ’ai donc pû apprendre, c’eft qu’elle
vient d’Angleterre, ôc que le premier qui en ait fait
ic i, a été M. Taillemard, très-bon machinifte, mort
il y a environ vingt ans. Telle eft l’idée que m’en a
fournie M. Camus de l’académie des Sciences.
Le premier moyen dont fe foient fervis les anciens
ouvriers qui eurent des roues àfendre , fut de
les divifer avec le cpmpaS , au nombre de parties
dont ils avoient befoin, & de les fendre enfuite avec
des limes ; il n’y a pas long - tems que cela fe prati-
quoit encore : or quel tems n’exigeoient pas de telles
opérations, ôc quelle jufteffe pouvoit-on attendre
de ce moyen ? Mais quelque ouvrier intelligent
ne laiffa pas long-tems cette partie en cet état ; il vit
un meilleur moyen, qui fut de former fur une grande
plaque de cuivre différens cercles concentriques,
qu’il divifa en des nombres de parties dont il faifoit
ufage dans les machines qu’il exécutoit ; de forte que
cela une fois fait, il n’étoit plus befoin que de faire
convenir le centre de la roue à divifer avec celui
de la plaque qui fervoit de divifeur , & moyennant
une réglé ou alidade, qui fe mouvoit au centre du divifeur
, qu’on pofoit alternativement fur tous les
points de divifions d’un même cercle, on traçoit fur
la roue les mêmes divifions ; ainfi elle fe trouvoit
par-là divifée exa&ement au même nombre de parties
que le cercle du divifeur, enforte qu’il ne reftoit
plus qu’à former les dents avec des limes convenables
: enfin il y eut des artiftes qui furent profiter
du point où fe trouvoit cette machine fimple , pour
la mener à celui de tailler des dents en même tems
qu’elle les divifoit ; ce fi.it de fubftituer , à l’effet de
fendre les roues avec des limes , & à la main , une
lime qui fe mouvoit en ligne droite dans une cou-
liffe que portoit un chalïis, fur lequel fe mouvoit le
divifeur ôc la roue àfendre : enfuite ce fut une lime
circulaire ( on l’appelle fraife ) qu’on fit tourner par
le moyen d’un archet fur. une piece que portoit
le chaflis ( qui étoit de bois ) : ce chafils contenoir en
même tems la grande plaque ou divifeur, qui tour-
noit dans ce chaflis, ainfi que la roue à fendre ; celle-
ci étoit fixée fur l’arbré qui portoit le divifeur : il n’étoit
plus queftion, pour divifer ôc former les dents,
que de fixer la grande plaque ou divifeur , ôc de terminer
le mouvement qu’il devoit.faire, pour former
la diftance d’une dent à l’autre : c’étoit-là l’effet d’une
piece * fixée fur le chaflis,laquelle portoit une pointe
qui alloit preffer le divifeur dans un des points de
divïfion de tel cercle, & empêchoit par ce moyen le
divifeur de tourner, tandis qu’avec la fraife , au
moyen de l ’archet, on formoit une dent, on faifoit
line fente ; enfuite levant la pointe de l’alidade:, qui
empêchoit le divifeur de tourner, & faifant paffer ce
divifeur jufqu’au premier point, on laiffoit pofer la
pointe de l’alidade dans le trou de divifion ; & fixant
de nouveau le: divifeur , on faifoit une fécondé fente
à la roue, & ainfi de fuite-, jüfqu’à ce que le divifeur
eût achevé fa révolution , ôc que par conféquent,
il y eût autant de dents fendues à la roue, que
de points de divifion dans le cercle qu’on auroit pris.
. T elle a été l’origine de la machine à fendre , on peüt
voir à-peu-près fomnéchanilme par l’idée que je viens
de donner ; ,mais le$ figures & la description qui vont
fuivre , en feront beaucoup mieux comprendre la
compofition : ôc telle encore eft la machine àfendre,
* L’on appelle cette pièce alidade ; fOn effet eft le mÈrtie qüë
celui de la réglé dont je viens de parler ; aveccette différence
que celle-là- paflbit alternativement.ftjr tous lespôipts.de
djvilion du cercle du divifeur, tandis que ce divifeur .reftoit
iifitnobilé ; àii lieu que dans l'alidade dont il eft quelïiort.i)ç ai*
vifeur toüt'në & préfente alternativement toutes les/divïtions du même cercle > & falidade OU réglé reftè immobile. - -
que Fon a perfe&ionnée depuis, mais dont les effets
font les mêmes ; ainfi ce que j ’ai dit fur fon origine
ôc fes progrès,’ facilitera l’intelligence de celles que
je vais décrire.
Je commencerai par la defcription de la machine
à fendre , la plus parfaite qui ait été conftruite jufi
qu’à ce jour, & qui eft en même tems la plus fimple ;
enfuite je donnerai la defcription de cellede Sully. J’a-
joûterai après cela une idée des machines que l’on a
faites pour fendre toutes fortes de nombres. Enfin je
terminerai cet article par quelques remarques fur les
foins d’exécution qu’exige une machine à fendre.
Comme la machine de Sully eft plus compoféeque
celle que l’on a faite depuis, j’ai crû devoir commencer
par la derniere conftruâion, qui eft de feu
M. Taillemard, ôc perfeftionnée par fon éleve, M,
Hullot, dont le talent pour les machines eft fort
connu, mais peut-être pas autant qu’il le mérite.
J’ai aufli ajoûté à cette machine, une piece qui peut
fervir à fa perfeftion ; c’eft une machine au moyen
de laquelle on détermine dans un inftant la pofition
des roues arbrées, comme rochets, roues de rencontre
, &c. ôc les centre parfaitement avec la plateforme
ou divifeur.
Defcription de la machiné àfendre, exécutée & cànjlruite
par M. Hullot, Méchariicien du Roi. ,
Le chaflis ABCDIFG {PI. X X I V f g. /.), eft fait
de deux pièces à-peu-près de la forme d’un T. Chaf«
que bout de la partie A E C eft plié à l’équerre, en-
forte que les parties G FD n’en font que le prolongement
, ôc fervent de piliers ; elles entrent quarré-
ment dans l’autre partie du chaflis, dont on ne voit
que les bouts BI. Les excédans des parties GFD en-
deflous de la partie B I du chaflis, font taraudés, en-
forte que les vafes a ,b ,c , fervent en même tems d’écroux
pour affembler les deux parties du chaflis, ôc
de piés pour foûtenir la machine, dont la propre pe-
fanteurfuffitpour la rendre folide, n’étant quepofée
Amplement fur une table quelconque M H, ôc y fendre
tomés les roues poflïbles.
P eft la plate-forme ou le divifeur : il eft fixé fur l’arbre
Opq {fig. i . PL XXV.'). C et arbre eft porté-par le
chaflis, dans lequel il tourne. Les deux points d ’ap-
-pui de cet arbre font placés à une plus grande diftance
que la hauteur même du chaflis, au moyen du
pont r f fixé aundeffous de la piece B /du chaflis, ôc
de la plaque ou afîiette tournée t , fixée .au-deflus
de l’autre partie A C du chaflis. Le trou de l’afliettè t
dans lequel fe meut l’arbre, eft tourné en cône, ainfi
que la partie de l’arbre qui y porte. C ’eft dansxette
partie ou afliette r qu’eu le point d’appui fupérieur
de l’arbre O p q . L ’autre point d’appui eft formé par
la partie; inférieure p du même, arbre , laquelle eft
portée par un point concentrique à la vis o. Cette
vis fort en même tems à donner plus ou moins de
liberté à l’arbre pour fe mouvoir ; ce qui fe fait en
faifant monter ôc defcetidre-Ia vis o , ainfi que l’arbre
O pq ,-dont la partie conique entrant plus ou
moins dans le trou , ôte Ou donne la liberté à l ’arbre
pour fe mouvoir. .
L’arbre O p q eft percé dans fa longueur j ce qui
forme un trou cylindrique dans lequel s’ajuftent les
tafTeaux o'ù petits arbres à écrous mn. C’eft-fur ces
Srbres que l’on fixe les roués qu’on veut fendre, ôc
dont les affiettes ôc groffeurs de vis font proportionnées
à là grandeur des roues. Les parties des-taffeaux
qui entrent dans l’arbre G pq ; font tournées fur leurs
pointés , aihfi .que les vis ôc a/fiettes. Au-delfous de
ees affiettes eft formé un petit cône,comme on le voit
Planche X X V I . fig* 3 i il porte fur la partie q de l’arbre
O p q , tourné de même en cône dans cette partie inté*
riéure q du trou cylindrique, Pour fixer ces taffeaux
après l’qrbre O pq, ôc le faire de façon que le centre