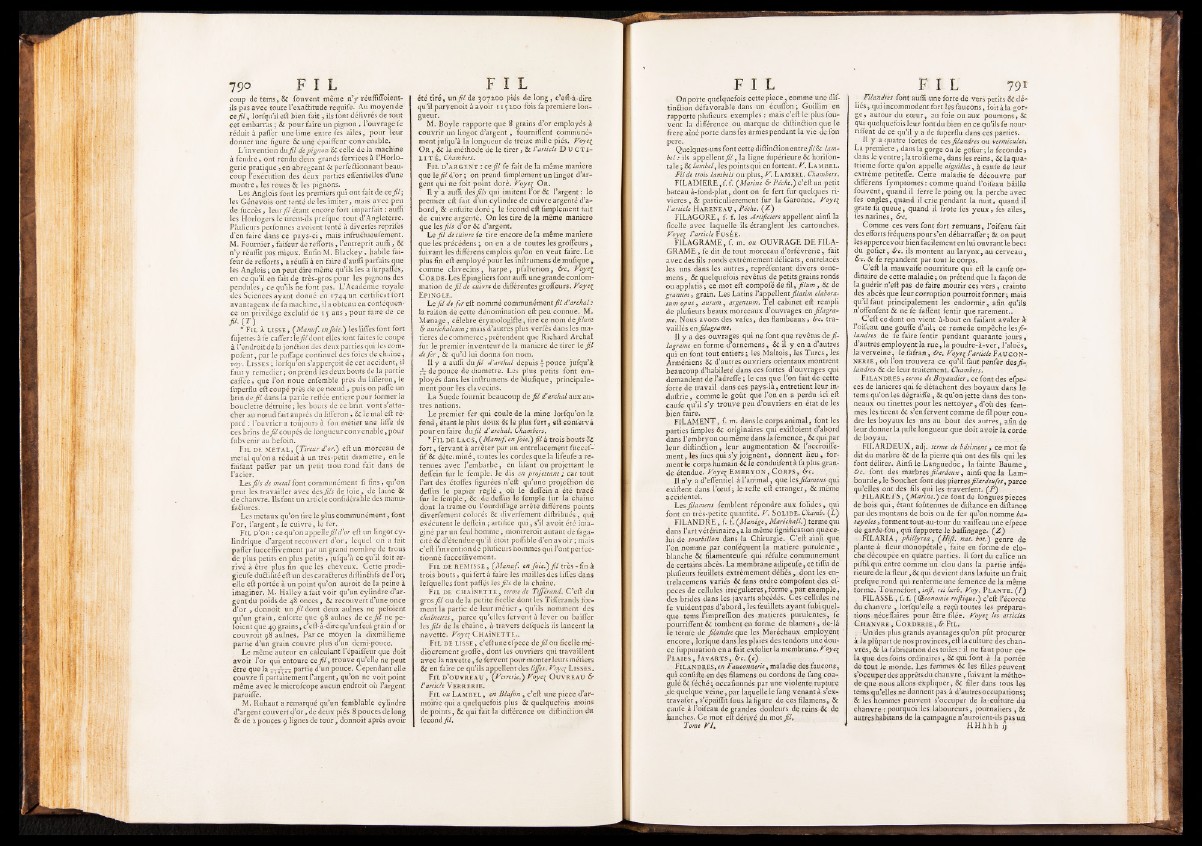
coup de tems, & fouvent même n’y rëuffiflbicnt-
ils pas avec toute l’exattitude requife. Au moyen de
ce f i l , lorfqu’il eft bien fait, ils font délivrés de tout
cet embarras ; & pour faire un pignon , l’ouvrage fe
réduit à paffer une lime entre fes aîles, pour leur
donner une figure 8c une épaiffeur convenable. ^
L’invention du f i l de p ig n o n 8c celle de la machine
à fendre, ont rendu deux grands fervices à l’Horlogerie
pratique, en abrégeant & perfectionnant beaucoup
l’exécution des deux parties effentielles d’une
montre, les roues & les pignons.
Les Anglois font les premiers qui ont fait de ce f il ',
les Genevois ont tenté de les imiter, mais avec peu
de luccès, leur f i l étant encore fort imparfait : aufli
les Horlogers le tirent-ils prefque tout d’Angleterre.
Plufieurs perfonnes avoient tenté à diverfes reprifes
d’en faire dans ce pays-ci, mais infruttueufement.
M. Fournier, faifeur de refforts, l’entreprit aulîi, &
n’y réulîit pas mieux. Enfin M. Blackey, habile faifeur
de refforts, a réufli à en faire d’aufli parfaits que
les Anglois ; on peut dire même qu’ils les a furpaffés,
en ce qu’il en fait de très-gros pour les pignons des
pendules, ce qu’ils ne font pas. L’Académie royale
des Sciences ayant donné en 17441m certificat fort
avantageux de fa machine, il a obtenu en conléquen-'
ce un privilège exclufif de 15 ans, pour taire de ce
f i l . ( J )
* F i l À L I S S E , (M a n u f. en fo ie .-) l e s l i f f e s f o n t f o r t
f u j e t t e s à f e c a f f e r : le f i l d o n t e l l e s l'o n t f a i t e s f e c o u p e
à l ’ e n d r o i t d e la j o n t t i o n d e s d e u x p a r t i e s q u i l e s c o m -
p o f e n t , p a r l e p a f f a g e c o n t i n u e l d e s f o i e s d e c h a î n e ,
voy. L i s s e s ; l o r f q u ’o n s ’ a p p e r ç o i t d e c e t a c c i d e n t , i l
f a u t y r em e d i e r ; o n p r e n d l e s d e u x b o u t s d e l a p a r t i e
c a f f é e , q u e l ’o n n o u e e n f e m b l e p r è s d u l i f l e r o n , l e
f u p e r f lu e f t c o u p é p r è s d e c e n oe u d , p u i s o n p a f f e u n
b r in d e f i l d a n s l a p a n i e r e f t é e e n t i è r e p o u r f o rm e r l a
b o u c l e t t e d é t r u i t e ; l e s b o u t s d e c e b r in v o n t s ’ a t t a c
h e r a u n oe u d f a i t a u p r è s d u l i f f e r o n , 8 c l e m a l e f t r é p
a r é : l ’o u v r i e r a t o û j o u r s à f o n m é t i e r u n e l i f t e d e
c e s b r in s d e f i l c o u p é s d e l o n g u e u r c o n v e n a b l e , p o u r
f u b v e n i r a u b e f o i n .
F i l d e m é t a l , (T ir eu r d'or.') e f t u n m o r c e a u d e
m é t a l q u ’o n a r é d u i t à u n t r è s - p e t i t d i a m è t r e , e n l e
f a i f a n t p a f f e r p a r u n p e t i t t r o u r o n d f a i t d a n s d e
l ’ a c i e r .
Les f i l s de métal font communément fi fins, qu’on
peut les travailler avec des f i l s de ioie, de laine 8c
de chanvre. Ils font un article confidérable des manufactures.
Les métaux qu’on tire le plus communément, font
l’or, l’argent, le cuivre, le fer.
F i l d ’ o r : ce qu’on appellef i l d 'o r eft un lingot cylindrique
d’argent recouvert d’o r, lequel on a fait
paffer fucceflivement par un grand nombre de trous
de plus petits en plus petits, jufqu’à ce qu’il foit arrivé
à être plus fin que les cheveux. Cette prodi-
gieufe duûilité eft un des caraûeres diftinttifs de l’or;
elle eft portée à un point qu’on auroit de la peine à
iihaginer. M. Halley a fait voir qu’un cylindre d’ar*
gént du poids de 48 onces, 8c recouvert d’une once
d’or , donnoit un f i l dont deux aulnes ne pefoient
qu’un grain, enforte que 98 aulnes de ce f i l ne pefoient
que 49 grains, c’eft-à-dire qu’un feul grain d’or
couvroit 98 aulnes. Par ce moyen la dixmillieme
partie d’un grain couvre plus d’un demi-pouce.
Le même auteur en calculant l’épaiffeurque doit
avoir l’or qui entoure ce f i l , trouve qu’elle ne peut
être que la r3- P artie d’un pouce. Cependant elle
couvre fi parfaitement l’argent, qu’on ne voit point
même avec le microfcope aucun endroit où l’argent
paroiffe.
M. Rohaut a remarqué qu’un femblable cylindre
d’argent couvert d’or, de deux piés 8 pouces de long
& de 1 pouces 9 lignes de tour, donnoit après avoir
été tiré, un f i l de 307100 piés de long, c’eft-à-dire
qu’il parvenait à avoir 115100 fois fa première longueur.
M. Boyle rapporte que 8 grains d’or employés à
couvrir un lingot d’argent, fourniffent communément
jufqu’à la longueur de treize mille piés. Vcye^
O r , & la méthode de le tirer, 8c l ’article D u c t i l
i t é . Chambers.
F i l d ’ a r g e n 't : ce f i l fe fait de la même maniéré
que le f i l d’or ; on prend fimplement un lingot d’argent
qui ne foit point doré, Voye^ O r .
Il y a aufli des fils qui imitent l’or 8c l’argent : 1©
premier eft fait d’un cylindre de cuivre argenté d’abord
, & enfuite doré ; le fécond eft fimplement fait
de cuivre argenté. On les tire de la même maniéré
que les fils d’or 8c d’argent.
Le f i l de cuivre fe tire encore de la même maniéré
que les précédens ; on en a de toutes les groffeurs ,
luivant les différens emplois qu’on en veut faire. Le
plus fin eft employé pour les inftrumens de mufique ,
comme clavecins, harpe , pfalterion, & c. Voyeç
C o r d e . Les Epingliers font aufli une grande confom-
mation de f i l de cuivre de différentes groffeurs. Voye%
E p i n g l e .
Le f i l de ficreû nommé communément f i l Marchai:
la railon de cette dénoinination eft peu connue. M.
Ménagé, célébré étymologifte, tire c e nom defilum
& aurichalcum; mais d’autres plus verfés dans les matières
de commerce, prétendent que Richard Archal
fut le premier inventeur de la maniéré de tirer le f i l
de fer t & qu’il lui donna fon nom.
Il y a aufli du f i l d.'archal depuis ~ pouce jufqu’à
tV de pouce de diamètre. Les plus petits font employés
dans les inftrumens de Mufique, principalement
pour les clavecins.
La Suede fournit beaucoup de f i l d'archal aux au-,
très nations.
Le premier fer qui coule de la mine lorfqu’on la
fond, étant le plus doux 8c le plus fort, eft confervé
pour en faire du f i l d'archal. Chambers.
* F i l d e l a c s , (Manuf. en foie.) f i l à trois bouts 8c
fort, fervant à arrêter par un entrelacement fuccef-
fif 8c détes miné, toutes les cordes que la lifeufe a retenues
avec l’embarbe, en lifant. ou promettant le
deffein fur le femple. Je dis en projettant ; car tout
l’art des étoffes figurées n’eft qu’une projeftion de
deffus le papier réglé , où le deffein a été tracé
fur le femple, & de deffus le femple fur la chaîne
dont la trame ou l’ourdiffage arrête différens points
diverfement colorés 8c diverfement diftribués, qui
exécutent le deffein ; artifice qui, s’il avoit été imaginé
par un feul homme, montreroit autant de faga-
cité 8c d’étendue qu’il étoit poflible d’en avoir ; mais
c ’eft l’invention de plufieurs hommes qui l’ont perfectionné
fucceflivement.
F i l DE R EM IS SE , ( Manuf.\ en foie.) f i l très - fin à
trois bouts, qui fert à faire les mailles des liffes dans
lefquelles font paffés les fils de la chaîne.
F i l d e c h a î n e t t e , terme de TiJférand.'C’ efi. d u
gros f i l ou de la petite ficelle .dont les Tifferands forment
la partie de leur métier, qu’ils nomment des
chaînettes, parce qu’elles fervent à lever ou baiffer
les fils de la chaîne, à-travers defquels ils lancent la
navette. Voye[ C h a î n e t t e ..
F i l d e l i s s e , c’eftuneefpece de f i l ou ficelle médiocrement
groffe, dont les ouvriers qui travaillent
avec la navette, fe fervent pour monter leurs métiers
& en faire ce qu’ils appellent des lijfes. Vqye{ L i s s e s .
F i l d ’o u v R e a u , ( Verrerie.) Voyeç O u v r e a u &
l'article VERRERIE.
F i l ou L a m b e l , en B la fon , c ’ e ft u n e p ie c e d ’a r -
m o ir ie q u i a q u e lq u e fo is p lu s 8c q u e lq u e fo is m o in s
de p o in t s , 8c q u i fa i t la d iffé r e n c e o u d ift in t t io n du
f é c o n d / / .
On porte quelquefois cette piece, comme une dif-
tinttion défavorable dans un écuffon ; Guillim en
rapporte plufieurs exemples : mais c’eft le: plus fou-
vent la différence ou marque de diftinttion que le
frere aîné porte dans fes armes pendant la vie de fon
pere.
Quelques-uns font cette diftinttion entrefil&c lambel:
ils appellent f i l , la ligne fupérieure 8c horifon-
talé ; 8c lambel, les points qui en fortent. V . L a m b e l .
F i l de trois lambels o u p lu s , V . L a m b e l . Chambers.
FILADIERE, f. f. (Marine & Pêche.) c’eft un petit
bateau à-fond-plat, dont on fe fert fur quelques rivières
, 8c particulièrement fur la Garonne. Voyeç
l'article HARENEAV, Pêche. ( Z )
FILAGORE, f. f. les Artificiers appellent ainfi la
ficelle avec laquelle ils étranglent les cartouches.
Voyt{ l'article FUSÉE.
FILAGRAME, f. m. ou OUVRAGE DE FILA-
GRAME, fe dit de tout morceau d’orfèvrerie, fait
avec des fils ronds extrêmement délicats, entrelacés
les uns dans les autres, repréfentant divers ornemens,
8c quelquefois revêtus de petits grains ronds
ou applatis ; ce mot eft compofé de fil, filum , 8c de
granum, grain. Les Latins l’appellent filatim élabora-
tum opus y aurum, argent uni. Tel cabinet eft rempli
de plufieurs beaux morceaux d’ouvrages en filagra-
me. Nous avons des vafes, des flambeaux, &c. travaillés
en filagrame.
Il y a des ouvrages qui ne font que revêtus de filagrame
en forme d’ornemens, 8c il y en a d’autres
qui en font tout entiers ; les Maltois, les Turcs, les
Arméniens 8c d’autres ouvriers orientaux montrent
beaucoup d’habileté dans ces fortes d’ouvrages qui
demandent de l’adreffe ; le cas que l’on fait de cette
forte de travail dans ces pays-là, entretient leur in-
duftrie, comme le goût que l’on en a perdu ici eft
caufe qu’il s’y trouve peu d’ouvriers en état de les
bien faire.
FILAMENT, f. m. dans le corps animal, font les
parties Amples 8c originaires qui exiftoient d’abord
dans l’embryon ou même dans lafemence, 8c qui par
leur diftinttion, leur augmentation 8c l’accroiffement,
les fucs qui s’y joignent, donnent lieu , forment
le corps humain 8c le conduifentàfa plus grande
étendue. Voye^ E m b r y o n , C o r p s , & c. i
Il n’y a d’effentiel à l’animal, que les filamens qui
exiftent dans l’oeuf; le refte eft étranger, 8c même
accidentel.
Les filamens femblent répondre aux folicles, qui
font en très-petite quantité. V . S o l i d e . Chàmh. (L )
FILANDRE, f. f. (Manège, Maréckall.) terme qui
dans l’art vétérinaire, a la même fignification que celui
de tourbillon dans la Chirurgie. C ’eft ainfi que
l’on nomme par conféquent la matière purulente ,
blanche 8c filamenteufe qui réfulte communément
de certains abcès. La membrane adipeufe, ce tiffu de
plufieurs feuillets extrêmement déliés, .dont les. en-
trelacemens variés 8c fans ordre composent des ef-
peces de cellules irrégulières, forme, par, exemple,
des brides dans les javarts abçédés. Ces cellules né
fe vuident pas d’abord, les feuillets ayant fubi quelque
tems l’impreflion des matières purulentes, fe
pourriffent 8c tombent en forme de filamens, de-là
le terme de filandre que les Maréchaux employent
encore, lorfque dans les plaies des tendons une douce
fuppuration en a fait exfolier la membrane. Voye^
Plaies , Javarts , &c. ( é)
. F i l a n d r e s , en Fauconnerie, maladie des .faucons,
qui confifte en des filamens ou cordons de fang coagulé
8c féçhé ; occafionnés par une violente rupture
jd| quelque veine, par laquelle le fang venant à s’ex-
travafer, s’épaiflit fous la figure de ces filamens, 8c
caufe à l’oifeau de grandes douleurs de reins 8c de
hanches. Ce mot eft dérivé du mot f il, ,
Tome V I ,
Filandres font aufli une forte dé vers petits Sé dé*
liés, qui incommodent fort les faucons, foit à la gorge,
autour du coeur, au foie ou aux poumons, 8ê
qui quelquefois leur font du bien en ce qu’ils fe nour»
riffent de ce qu’il y a de fuperflu dans ces parties.
Il y a quatre fortes de ces filandres ou vermiculesl
La première, dans la gorge ou le gofier ; la fécondé*
dans le ventre ; la troifieme, dans les reins, 8c la qua*
trieme forte qu’on appelle a iguilles, à caufe de leur
extrême petiteffe. Cette maladie fe découvre par
différons fymptomes : comme quand l’oifeau bâille
fouvent, quand il ferre le poing ou la perche avec
fes ongles, quand il crie pendant la nuit, quand il
grate fa queue, quand il frote fes yeux, fes aîles,
lès narines, & e .
Comme ces vers font fort rémuans, l’oiféau fait
des efforts fréquens pour s’en débarraffer; 8c on peut
les apperce voir bien facilement en lui ouvrant le bec:
du gofier, F fc . ils montent au larynx, au cerveau ,
& c . 8c fe répandent par tout le corps.
C’eft la mauvaife nourriture qui eft la caufe ordinaire
de cette maladie ; on prétend que la façon de
la guérir n’eft pas de faire mourir ces vers, crainte
des abcès que leur corruption pourrait former ; mais
qu’il faut principalement les endormir, afin qu’ils
n’offenfent 8c ne fe faffent fentir que rarement..
C’eft ce dont on vient à-bout en faifant avaler à
l’oifeau une gouffe d’ail; ce remede empêche les/ -
landres de le faire fentir pendant quarante jours ,
d’autres employent la rue , la poudre-à-ver, l ’aloës,
la verveine, le fafran, & c . V oy eç l'article Fauconnerie,
où l’on trouvera ce qu’il fautpenfer d e s f i landres
& de leur traitement. Chambers»
F i l a n d r e s , terme de Boy au d ie r , ce font des efpe-
ces de lanières qui fe détachent des boyaux dans le
tems qu’on les dégraiffe, 8c qu’on jette dans des ton*
neaux ou tinettes pour les nettoyer, d’où des femmes
les tirent & s’en fervent comme de fil pour coudre
les boyaux les uns au bout des autres, afin de
leur donner la jufte longueur que doit avoir la corde
de boyau.'
FILARDEUX, adj. terme de bâtim ent, c e niot fe
dit du marbre Sc de la pierre qui ont des fils qui les
font déliter. Ainfi le Languedoc, la fainte Baume ,
& c . font des marbres f ila rd e u x , ainfi que la Lambourde
, 1e Souchet font des pierres filardeufes, parce
qu’elles ont des fils qui les traverfent. ( P )
FILARETS, (M a r in e .) c e font de longues pièces
de bois qui, étant foûtenues de diftance en diftance
par des montans de bois ou de fer qu’on nomme ba-
tayoles , forment tout-au-tour du vaiffeau une efpece
de garde-fou, qui fupporte le baflîngage. ( Z )
FILARIA, p h illy r e a , (H ift . nat. b o t.) genre de
plante à fleur monopétale, faite en forme de cloche
découpée en quatre parties. Il fort du calice un
piftil qui entre comme un clou dans la partie inférieure
delà fleur ,.8c qui devient dans la fuite un fruit
prefque rond qui renferme une femence de la même
forme. Tournefort, in fi. rei herb. V oy ., P l a n t e . (/)
FILASSE., f. f. ((Economie rufiique.) c’eft l’écorce
du chanvre , lorfqu’elle a reçu toutes les préparations
néceffaires pour être filée. Voye^ les articles
C h a n v r e . , C o r d e r i e , & F i l .
. Un,des plus grands avantages qu’on pût procurer
à. la plupart de nos provinces, èft la culture des chanvres,
8c la fabrication des toiles.: il. ne faut pour cela
que, des Joins ordinaires , & qui font à la portée
de tout le monde. Les femmes & les filles peuvent
s’occuper;des apprêts du chanvre, fuivant la méthode
que nous.allons expliquer, & filer dans tous les
tems-qu’eftes ne donnent pas à d’autres occupations;
8c Whommes peuvent s’occuper de la-culture du
chanvre,: pourquoi les laboureurs, journaliers , 8c
autres habitans de la campagne n’auroient-ils pas un
HHhhhi j " '