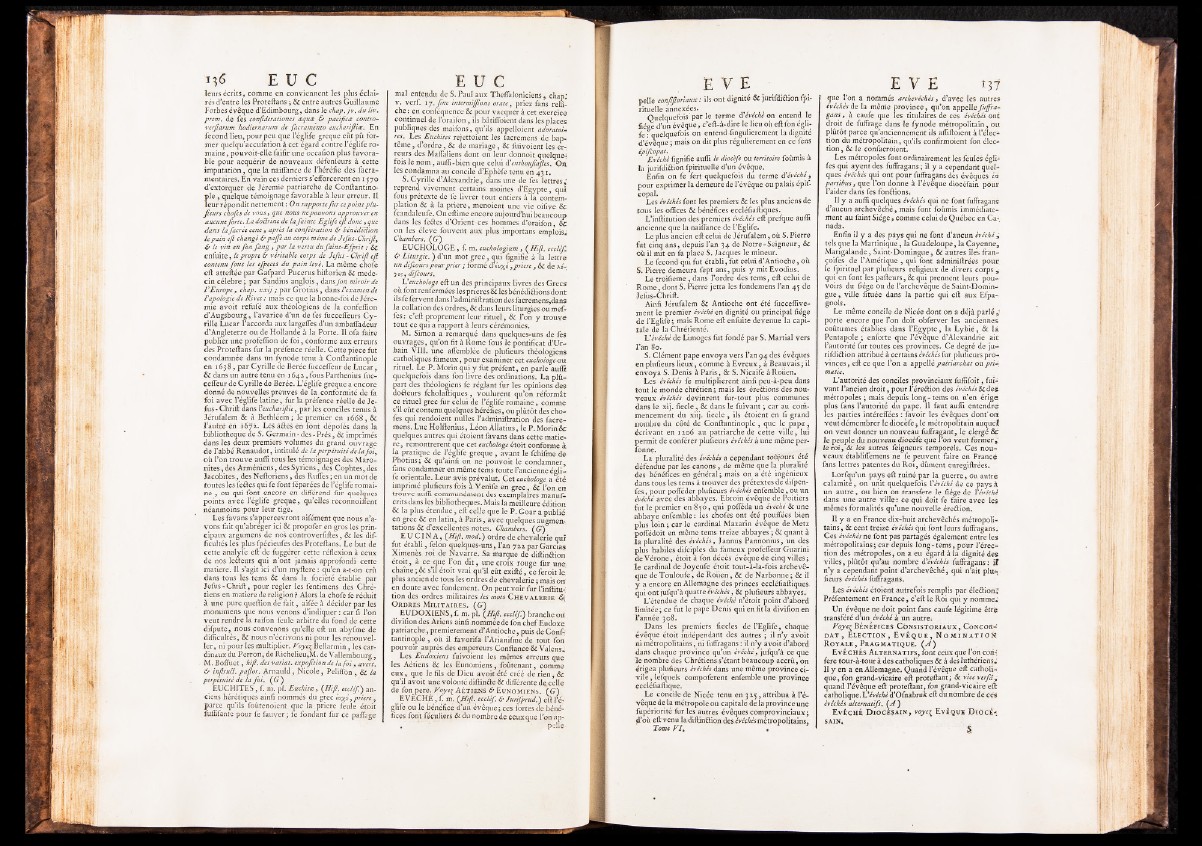
iV6 E U C leurs écrits, comme en conviennent les plus éclairés
d’entre les Proteftans ; de entre autres Guillaume
Forbes évêque d’Edimbourg, dans le chap.jv. du liv..
prem. de fes confiderationes cequa & pacifie a contro-
verfiarum hodiernarum de facramento eucharifiioe, En
fécond lieu, pour peu que l’églife greque eût pu former
quelqu’accufation à cet egard contre l’églife romaine,
pouvoit-elle faifir une occafîon plus favorable
pour acquérir de nouveaux défenfeurs à cette
imputation, que la naiffance de l’héréfie des facra-
mentaires. En vain ces derniers s’efforcèrent en 1 570
d’extorquer de Jéremie patriarche de Conftantino-
ple , quelque témoignage favorable à leur erreur. Il
leur répondit nettement : On rapporte fur ce point plu- ;
fieurs chofes de vous, que nous ne pouvons approuver en j
aucune forte. La doctrine de la fainte Eglife efi donc , que I
dans la facrée cene , après la confieration & bénédiction
le pain efi changé & paffe au corps même de Jefus-Chrifi9
& le vin en fon fang , par la vertu du faint-Efprit : de
enfuite, le propre & véritable corps de Jefus - Chrift efi
contenu fous les efpeces du pain levé. La même chofe
eft atteftée par Gafpard Pucerus hiftorien de médecin
célébré ; par Sandius anglois, dansfon miroir de
VEurope, ckap. x x ij ; par G rotius, dans C examen de
Vapologie de Rivet : mais ce que la bonne-foi de Jéremie
avoit refiifé aux théologiens de la confefîion
d’Augsbourg, l’avarice d’un de fes fucceffeurs C y rille
Lucar l’accorda aux largeffes d’un ambaffadeur
d’Angleterre ou de Hollande à la Porte. Il ofa faire
publier une profefîion de fo i, conforme aux erreurs
des Proteftans fur la préfence réelle. Cette piece fut
condamnée dans un fynode tenu à Conftantinople
en 1638, par Cyrille ae Berée fucceffeur de Lucar,
de dans un autre tenu en 1642, fous Parthenius fuc-
ceffeur de Cyrille de Berée. L’églife greque a encore
donné de nouvelles preuves de la-conformité de fa
foi avec l’églife latine, fur la préfence réelle de Jefus
Chrift dans Veucharifiie, par les conciles tenus à
Jérufalem & à Bethléem; le premier en 1668, de
l ’autre en 1672. Les a fies en font dépofés dans la
bibliothèque de S. Germain - des - Prés, de imprimés
dans les deux premiers volumes du grand ouvrage
de l’abbé Renaudot, intitulé de la perpétuité de la foi.
oit l’on trouve aufli tous les témoignages des Maronites
, des Arméniens, des Syriens, des Cophtes, des
Jacobites, des Neftoriens, des Ruffes ; en un mot de
toutes les feétes qui fe font féparées de l’églife romaine
, ou qui font encore en différend fur quelques
points avec l’églife greque, qu’elles reconnoiffent
néanmoins pour leur tige.
Les favans s’appercevront aifément que nous n’avons
fait qu’abréger ici de propofer en gros les principaux
argumens de nos controverfiftes, de les difficultés
les plus fpécieufes des Proteftans. Le but de
cette analyfe eft de fuggérer cette réflexion à ceux
de nos leâeurs qui n’ont jamais approfondi cette
matière. Il s’agit ici d’un myftere : qu’en a-t-on crû
dans tous les tems de dans la fociété établie par
Jefus-Chrift, pour regier les fentimens des Chrétiens
en matière de religion } Alors la chofe fe réduit
à une pure queftion de fait, aifée à décider par les
monumens que nous venons d’indiquer : car fi l’on
veut rendre la raifon feule arbitre du fond de cette
difpute, nous convenons qu’elle eft un abyfme de
difficultés, de nous n’écrivons ni pour les renouvel-
ler, ni pour les multiplier. Voyeç Bellarmin, les cardinaux
du Perron, de Richelieu,M. de Vallembourg,
M. Boffuet, hiß. des variât, expofition de la foi , avert.
& inflruct. pafior. Arnauld, Nicole, Peliffon , de la
perpétuité de la foi. ( G j
EUCHITES, f. m. pl. Euckitoe, (Hifi. eccléf.) anciens
hérétiques ainfi nommés du grec Ivyf, priere,
parce qu’ils foûtenoient que la priere feule étoit
fuffifante pour fe fauyer ; fe fondant fur ce paffage
E U C mal entendu de S. Paul aux Theffaloniciens, chap; V. verf. 17. fine intermiffione orate, priez fans relâche
: en cohféquence & pour vacquer à cet exercice
continuel de l’oraifon, ils bâtiffoient dans les places
publiques des maifons, qu’ils appelaient adoratoi-
res. Les Euchites rejettoient les facremens de baptême
, d’ordre, & de mariage, de fuivoient les erreurs
des Maffaliens dont on leur donnoit quelques
fois le nom, aufli-bien que celui d’enthoufiafies. On
les condamna au concile d’Ephèfe tenu en 431.
S. Cyrille d’Alexandrie, dans une de fes lettres,1
reprend vivement certains moines d’Egypte, qui
fous prétexte de fe livrer tout entiers à la contemplation
&: à la priere, menoient une vie oifive de
icandaleufe. On eftime encore aujourd’hui beaucoup
dans les feftes d’Orient ces hommes d’oraifon, Ô£
on les éleve fouvent aux plus importans emplois,1
Chambers. (G)
EUCHOLOGE, f. m. euchologium , ( Hifi. eccléf.
& Liturgie. ) d’un mot grec , qui fignifie à la lettre
un difcours pour prier ; formé $iv%é, priere , & de Ao-
yoc, difeours.
U euchologe eft un des principaux livres des Grecs
où font renfermées les prières,& les bénédictions dont
ils fe fervent dans l’adminiftration des facremens,dans
la collation des ordres, de dans leurs liturgies oumef-
fes : c’eft proprement leur rituel, de l’on y trouve
tout ce qui a rapport à leurs cérémonies.
M. Simon a remarqué dans quelques-uns de fes
ouvrages, qu’on fit à Rome fous le pontificat d’Urbain
VIII. une affemblée de plufieurs théologiens
catholiques fameux, pour examiner cet euchologe ou
rituel. Le P. Morin qui y fut préfent, en parle aufli
quelquefois dans fon livre des ordinations. La plû-
part des théologiens fe réglant fur les opinions des
dofteurs fcholaftiques, voulurent qu’on réformât
ce rituel grec fur celui de l’églife romaine, comme
s’il eût contenu quelques héréfies, ou plûtôt des chofes
qui rendoient milles l’adminiftration des facremens.
Luc Holftenius, Léon Allatius, le P. Morin &
quelques autres qui étoient favans dans cette matière
, remontrèrent que cet euchologe étoit conforme à
la pratique de l’églife greque, avant le fchifme de
Photius; & qu’ainfi on ne pouvoit le condamner,
fans condamner en même tems toute l’ancienne égli-
fe orientale. Leur avis prévalut. Cet euchologe a été
imprimé plufieurs fois à Venife en grec, de l’on en
trouve aufli communément des exemplaires manuf-
crits dans les bibliothèques. Mais la meilleure édition
& la plus étendue, eft celle que le P. Goar a publié
en grec de en latin, à Paris, avec quelques augmentations
de d’excellentes notes. Chambers. (G )
E U C IN A , (Hifi. mod.') ordre de chevalerie qui
fut établi, félon quelques-uns, l’an 722 par Garciaa
Ximenès roi de Navarre. Sa marque de diftinCtion
étoit, à ce que l’on d it , une croix rouge fur une.,
chaîne ; de s’il étoit vrai qu’il eût exifté, ce feroit le
plus ancien de tous les ordres de chevalerie ; mais on
en doute avec fondement. On peut voir fur l’inftitu-:
tion des ordres militaires O les mots Chevalerie rdres Militaires. (G)
_ EUDOXIENS, f. m. pl. (Hifi. eccléf.') branche oiï
divifion des Ariens ainfi nommeede fon chef Eudoxe
patriarche, premièrement d’Antioche, puis deConf«;
tantinople, oïi il favorifa l’Arianifme de tout fon
pouvoir auprès des empereurs Confiance de ValensJ
Les Eudoxiens fuivoient les mêmes erreurs que
les Aétiens de les Eunomiens, foûtenant, comme
eu x, que le fils de Dieu avoit été créé de rien ^ de
qu’il avoit une volonté diftinâe de différente descelle
de fon pere. Voye[ Aétiens & Eunomiens. (G)
ÉVÊCHÉ, f. m. (Hifi. eccléf. & Jurifprud.) eft l’églife
ou le bénéfice d’un évêque ; ces fortes de bénéfices
font féculiers & du nombre de ceux que l’on ap-
. ’ " x ’/'pelle-
E V E
pelle càtifiJLoriaux : ils ont dignité & jitrifdiâion ffi-
rituelle annexées. ,
Quelquefois par le terme a éveche on entend le
iiége d’un évêque, c’eft-à-dire le lieu oïi eft fon égli-
fe : quelquefois on entend fingulierement la dignité
d’éveque ; mais on dit plus régulièrement en ce fens
épifeopat.
Evêché fignifie aufli le diocèfe ou territoire foûmis à
la jurifdiûion fpirituelle d’un évêque.
Enfin on fe fert quelquefois du terme d * évêché *
pour exprimer la demeure de l’évêque ou palais épif-
copal.
Les évêchés font les premiers de les plus anciens de
tous les offices de bénéfices eccléfiaftiques.
L’inftitution des premiers évêchés eft prefque aufli
ancienne que la naiffance de l ’Eglife.
Le plus ancien eft celui de Jérufalem, ou S. Pierre
fut cinq ans, depuis l’an 34 de Notre-Seigneur, de
oîi il mit en fa placés. Jacques le mineur.
Le fécond qui fut établi, fut celui d’Antioche, oîi
S. Pierre demeura fept ans, puis y mit Evodius.
Le troifieme , dans l’ordre des tems, eft celui de
Rome, dont S. Pierre jetta les fondemens l’an 45 de
Jefus-Chrift.
Ainfi Jérufalem de Antioche ont été fucceflive-
jnent le premier évêché en dignité ou principal fiége
de l’Eglife ; mais Rome eft enfuite devenue la capitale
de la Chrétienté.
L'évêché de Limoges fut fondé par S. Martial vers
l’an 80.
S. Clément pape envoya vers i’an 94 des évêques
en plufieurs lieux, comme à E vreux, à Beauvais; il
envoya S. Denis à Paris, & S. Nicaife à Rouen.
Les évêchés fe multiplièrent ainfi peu-à-peu dans
tout le monde chrétien ; mais les érections des nouveaux
évêchés devinrent fur-tout plus communes
dans le xij. fiecle, de dans le fuivarit ; car au commencement
du xiij. fiecle , ils étoient en fi grand
nombre du côté de Conftantinople , que le pape ,
écrivant en 1206 au patriarche de cette ville , lui
permit de conférer plufieurs évêchés à une même per-
fonne.
La pluralité des évêchés a cependant toujours été
défendue par les canons , de même que la pluralité
des bénéfices en général ; mais on a été ingénieux
dans tous les tems à trouver des prétextes de difpen-
fes j pour pofleder plufieurs évêchés enfemble, ou un
évêché avec des abbayes. Ebroin évêque de Poitiers
fut le premier en 850, qui pofféda un évêché & une
abbaye enfemble: les chofes ont été pouffées bien
plus loin ; car le cardinal Mazarin évêque de Metz
poffédoit en même tems treize abbayes ; de quant à
la pluralité des évêchés, Jannus Pannonius, un des
plus habiles difciples du fameux profeffeur Guarini
de Vérone, étoit à fon décès évêque de cinq villes ;
le cardinal de Joyeufe étoit tout-à-la-fois archevêque
de Touloufe, de Roiien, de de Narbonne ; & il
y a encore en Allemagne des princes eccléfiaftiques.
qui ont jufqu’à quatre évêchés, de plufieurs abbayes.
L’étendue de chaque évêché n’étoit point d’abord
limitée ; ce fut le pape Denis qui en fit la divifion en
l’année 308.
Dans les premiers fiecles de l’Eglife, chaque
évêque étoit indépendant des autres ; il n’y avoit
ni métropolitains, ni fuffragans : il n’y avoit d’abord
dans chaque province qu’un évêché, jufqu’à ce que
le nombre des Chrétiens s’étant beaucoup accrû, on
érigea plufieurs évêchés dans une même province civile
, lel'quels compoferent enfemble une province
eccléfiaftique.
Le concile de Nicée tenu en 325, attribua à l’évêque
de la métropole ou capitale de la province une
fupériorite fur les autres évêques comprovineiaux ;
d’oii eft venu la diftinétion des évêchés métropolitains,
Tome VI» #
E V E r 37
que l’on a nommés archevêchés, d’avec les autres
évêchés de la mênie province, qu’on appelle fuffra-
gans, à caufe que les titulaires de ces évêchés ont
droit de fuffrage dans le fynode métropolitain, ou
plûtôt parce qu’anciennement ils afliftoient à l’élec^
tion du métropolitain, qu’ils eonfirmoient fon élec-*
tion j de le confacroient.
Les métropoles font ordinairement les feiilés égli-
fes qui ayentdes fuffragans; il y a cependant quel^
ques évêchés qui ont pour fuffragans des évêques in
partibus, que l’on donne à l’éveque diocéfain pour
l’aider dans fes fonttionSi
Il y a aufli quelques évêchés qui ne font fuffragans
d’aucun archevêché, mais font foûmis immédiatement
au faint Siège, comme celui de Québec en Canada.
Enfin il y a des pays qui ne font d’aucun évêché ±
tels que la Martinique, la Guadeloupe, la Cayenne,
Marigalande, Saint-Domingue, de autres îles fran-
çoifes de l’Amérique , qui font adminiftrées pour
le fpirituel par plufieurs religieux de divers corps ,
qui en font les pafteurs, de qui prennent leurs pouvoirs
du fiége ou de l’archevêque de Saint-Domingue
, ville fituée dans la partie qui eft aux Efpa-
gnols.
Le même concile de Nicée dont on a déjà parlé ^
porte encore que l’on doit obferver les anciennes
coûtumes établies dans l’Egypte, la L y b ié , & là
Pentapole ; enforte que l’évêque d’Aléxàndrie ait
l’autorité fur toutes ces provinces. Ce degré de ju-
rifdi&iôn attribué à certains évêchés fur plufieurs provinces
, eft ce que r on a appelle patriàrchai ou pri~
matie.
L’autorité des conciles provinciaux fuflîfoit, fui-,
vant l’ancien droit, pour l’éréâion des évêchés de des
métropoles ; mais depuis long-tems on n’eh érige
plus fans l’autorité du pape. Il faut aufli entendre
les parties intéreffées : favoir les évêques dont' ori
veut démembrer le diocèfe, le métropolitain auquel
on veut donner un nouveau fuffragant, le cierge dé
le peuple du nouveau diocèfe que fon veut former,'
le roi, & les autres feigneurs temporels. Ces nouveaux
établiffemens ne fe peuvent faire en France
fans lettres patentes du R o i, dûment enregiftréeS.
Lorfqu’un pays eft ruiné par la guerre, ou autrè
calamite, on Unit quelquefois Vévêché de ce pays à
un autre, ou bien on transféré le fiége de f évêché
dans une autre ville : ce qui doit fe faire avec les
mêmes formalités qu’une nouvelle érettion.
Il y a en France dix-huit archevêchés métropolitains
, & cent treize évêchés qui font leurs fuffragans.
Ces évêchés ne font pas partagés également entre les
métropolitains; car depuis long-tems, pour l’érection
des métropoles, on a eu égard à la dignité des
villes, plûtôt qu’au nombre dé évêchés fuffragans: i î
n’y a cependant point d’archevêché, qui n’ait plu*,
fieurs évêchés fuffragans.
Les évêchés étoient autrefois remplis par éle£Hon2
Préfentement en F rance, c’eft le Roi qui y nomme.'
Un évêque ne doit point fans caufe légitimé être
transféré déun évêché à un autre;
Voyc^ Bénéfices CCnsistoriaux, Concordat
, Election, Ev ê q u e , No m in a t io n
Royale, Pragmatique. (A ) Evêchés Alternatifs, font ceux que l’on cori-;
fere tour-à-tour à des catholiques & à des luthériens*
Il y en a en Allemagne. Quand l’évêque eft catholi-;
que, fon grand-vicaire eft proteftant ; & vice verfâ
quand l’évêque eft proteftant, fon grand-vicaire eft
catholique. évêché d’Ofnabruk eft du nombre de cés
évêchés alternatifs. (A ) Evêché Diocésain, voyei Evêque Diocésain,
§