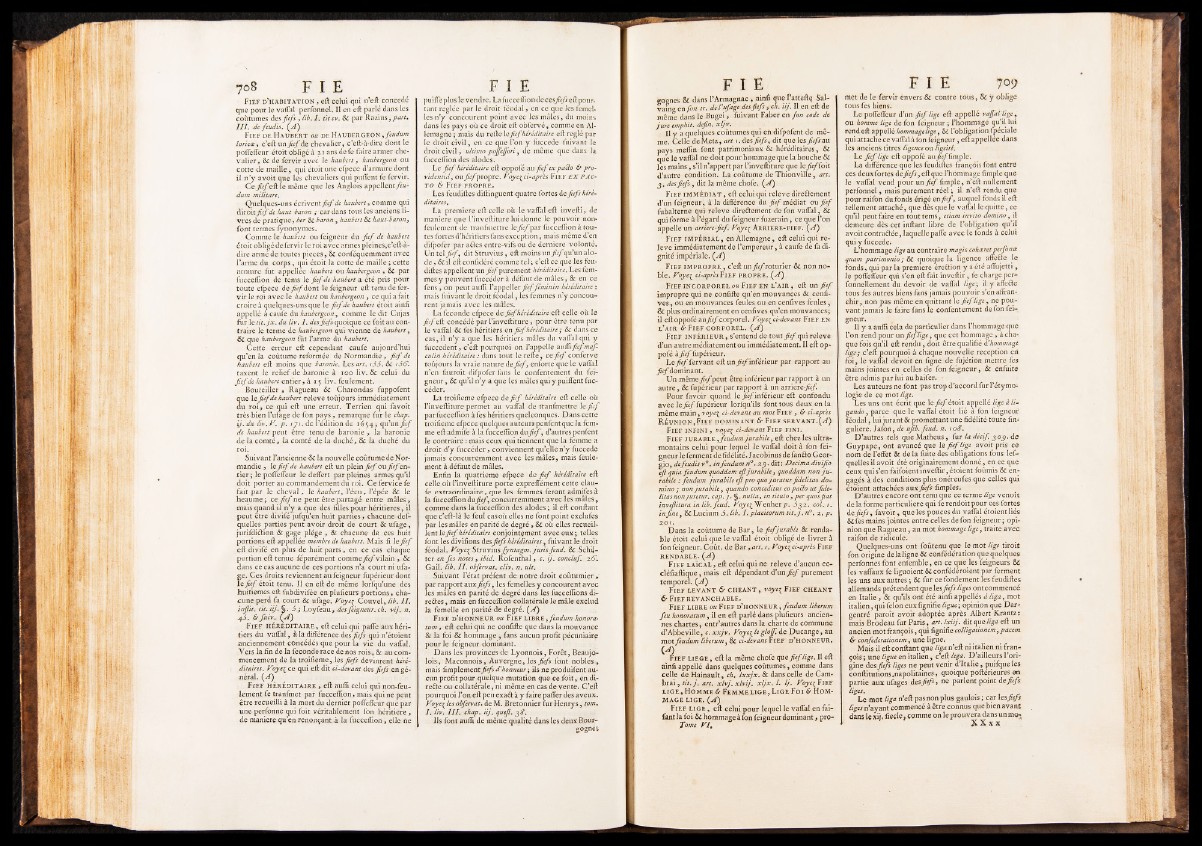
F i e f d ’ h a Ib i t à t i o n , eft celui qui n’eft concédé
que pour le vaffal perfonnel. Il en eft parlé dans les
coutumes des fiefs, lib. I . tit cv. & par Razius, part.
I II. defeudis. (A )
F i e f d e H a u b e r t ou d e H a u b e r g e o n ,./«*</h/«
lories, c’eft un fie f de chevalier, c’eft-à-dire dont le
pofleffeur étoit obligé à 2. i ans de fe faire armer chevalier,
& de fervir avec le haubert, haubergeon ou
cotte de maille, qui étoit une efpece d’armure dont
il n’y a voit que les chevaliers qui puffent fe fervir.
Ce fie f eft le même que les Anglois appellent feu-
dum militare.
Quelques-uns écrivent fief de haubert, comme qui
diroit fief de haut baron ; car dans tous les anciens livres
de pratique, ber & baron, haubert & haut-baron,
font termes fynonymes.
Comme le haubert ou feigneur du fief de haubert
ctoit obligé de fervir le roi avec armes pleines,c’eft-à-
dire armé de toutes pieces, & conféquemment avec
l’arme du corps, qui étoit la cotte de maille ; cette
armure fut appellee haubert ou haubergeon, & par
fucceffion de tems \e fief de haubert a été pris pour
toute efpece de fief dont le feigneur eft tenu de fervir
le roi avec le haubert ou haubergeon, ce qui a fait
croire à quelques-uns que le fie f de haubert étoit ainfi
appellé à caufe du haubergeon, comme ledit Cujas
fur le tït.jx. du liv. I . desfiefs quoique ce foitau contraire
le terme de haubergeon qui vienne de haubert,
& que haubergeon fût l’arme du haubert.
Cette erreur eft cependant caufe aujourd’hui
qu’en la coutume reformée de Normandie , fie f de
haubert eft moins que baronie. Les art. r55. &C iSG.
taxent le relief de baronie à 100 liv. & celui du
fie f de haubert entier , à 15 liv. feulement.
Bouteiller , Ragueau & Charondas fuppofent
que le fie f de haubert releve toû jours immédiatement
du ro i, ce qui eft une erreur. Terrien qui fa voit
très-bien l’ulage de font pays, remarque fur le chap,
ij. du liv. F. p. 171. de l’édition de 1654, qu’un fie f
de haubert peut être tenu de baronie , la baronie
de la comté, la comté de la duché, & la duché du
roi.S
uivant l’ancienne la nouvelle coutume de Normandie
, le fief de haubert eft un plein fie f ou fie f entier
; le pofleffeur le deffert par pleines armes qu’il
doit porter au commandement du roi. Cefervicefe
fait par le cheval, le haubert, l’écu, l’épée & le
heaume ; ce fie f ne peut être partagé entre mâles,
mais quand il n’y a que des filles pour héritières, il
peut être divifé jufqu’en huit parties, chacune def-
quelles parties peut avoir droit de court & ufage,
jurifdidion & gage piège , & chacune de ces huit
portions eft appellée membre de haubert. Mais fi le fie f
eft divifé en plus de huit parts , en ce cas chaque
portion eft tenue féparément comme fie f vilain, &
dans ce cas aucune de ces portions n’a court ni ufage.
Ces droits reviennent au feigneur fupérieur dont
le fief étoit tenu. Il en eft de même lorfqu’une des
huitièmes eft fubdivifée en plufieurs portions, chacune
perd fa court & ufage. Foye^ Couvel, lib. II.
infi.it. tit. iij. § . 6 j Loyfeau, des feigneur. ch. vij. n.
4-i. & fuiv. (A )
■ Fi e f h é r é d i t a i r e , eft celui qui paffe aux héritiers
du vaffal, à la différence des fiefs qui n’étôient
anciennement concédés que pour la vie du vaffal.
Vers la fin de la feconderace de nos rois, & au commencement
de la troifieme, les fiefs devinrent héréditaires.
F~>yt{ ce qui eft dit ci-devant des fiefs en général.
(A)
F i e f h é r é d i t a i r e , eft aufli celui qui non-feulement
fe tranfmet par fucceffion, mais qui ne peut
être recueilli à la mort du dernier poffeffeür que par
une perfonne qui foit véritablement fon héritière,
de maniéré qu’en renonçant, à la fucceffion, elle ne
puiffe plus le vendre. La fucceffion de cesfiefs eftpour-
tant réglée par le droit féodal, en ce que les femelles
n’y concourent point avec les males, du moins
dans les pays où ce droit eft obfervé, comme en Allemagne;
mais du relie le f i e f héréditaire eft réglé par
le droit c ivil, en ce que l’on y fuccede fuivant le
droit c ivil, ultimo poffejfori, de même que dans la
fucceffion des alodes.
Le f i e f héréditaire eft oppofé au f i e f e x paclo & pro-
v id en tid , ou f i e f propre. Foye^ ci-après F i e f E X F A C TO
& F i e f p r o p r e .
Les feudiftes diftinguent quatre fortes de fiefs héréditaires.
La premiere eft celle où le vaffal eft invefti, de
maniéré que l ’inveftiture lui donne le pouvoir non-
feulement de tranfmettre le f i e f par fucceffion à toutes
fortes d’héritiers fans exception, mais même d’en
difpofer par aêles entre-vifs ou de derniere volonté.
Un tel f i e f , dit Struvius , eft moins un f i e f qu’un a Iod
e, & il eft confidéré comme tel ; c’eft ce que les feudiftes
appellent un f i e f purement héréditaire. Les femmes
y peuvent fuccéder à défaut de mâles, & en ce
fens, on peut auffi l’appeller f i e f fém in in héréditaire :
mais fuivant le droit féodal, les femmes n’y concourent
jamais avec les mâles.
La fécondé efpece de f i e f héréditaire eft celle où le
f i e f eft concédé par l’inveftiture, pour être tenu par
le vaffal & fes héritiers en f i e f héréditaire ; & dans ce
cas, il n’y a que les héritiers mâles du vaffal qui y
fuccedent, c’eft pourquoi on l’appelle aufCifiefmaf-
eu lin héréditaire : dans tout le refte, ce f i e f conferve
toujours la vraie nature de f i e f , enforte que le vaffal
n’en fauroit difpofer fans le confentement du feigneur
, & qu’il n’y a que les mâles qui y puiffent fuccéder.
La troifieme efpece de f i e f héréditaire eft celle où
l’inveftiture permet au vaffal de tranfmettre le f i e f
par fucceffion à fes héritiers quelconques. Dans cette
troifieme efpece quelques auteurs penfentque la femme
eft admife à la fucceffion du f i e f , d’autres penfent
le contraire : mais ceux qui tiennent que la femme a
droit d’y fuccéder , conviennent qu’elle n’y fuccede
jamais concurremment avec les mâles, mais feulement
à,défaut de mâles.
Enfin la quatrième efpece de fief héréditaire eft
celle où l’inveftiture porte expreffément cette clau-
fe extraordinaire, que les femmes feront admifes à
la fucceffion dufief, concurremment avec les mâles ,
comme dans la fucceffion des alodes ; il eft confiant
que c’eft-là le feul cas où elles ne font point exclufes
par les mâles en parité de degré , & où elles recueillent
le fie f héréditaire conjointement avec eux; telles
font les divifions des fiefs héréditaires, fuivant le droit
féodal. Foye%_ Struvius fyntagm. juris feud. & Schij-
ter en fes notes , ibid. Rofenthal, c. ij. concluf. xS .
Gail. lib. II. obfervat. cliv. n. ult.
Suivant l’état préfent de notre droit coutumier ,
par rapport aux f ie f s , les femelles y concourent avec
les mâles en parité de degré dans les fucceffions di-
reêtes, mais en fucceffion collatérale le mâle exclud
la femelle en parité de degré. (A~)
F i e f d ’ h o n n e u r ou F i e f l i b r e , feu d um honora-
turn, eft celui qui ne confifte que dans la mouvance
& la foi & hommage, fans aucun profit pécuniaire
pour le feigneur dominant.
Dans les provinces de Lyonnois, Forêt, Beau jo-
lois, Maconnois, Auvergne, les fiefs font nobles ,
mais Amplement.fiefs d'honneur •, ils ne produifent aucun
profit pour quelque mutation que ce foit, en di-
refte ou collatérale, ni même en cas de vente. C’eft
pourquoi l’on eft peu exa£t à y faire paffer des aveux.
Voyc^ les obfervat. de M. Bretonnier fur Henrys, tom.
I .liv . I II. chap. iij. quefi. 38.
Ils font auffi de même qualité dans les deux Bourgognes
gognes & dans l’Armagnac , ainfi que l’atteftq Sàl-
vaing en fon tr. de l'ufage des fiefs ; ch. iij. Il en eft de
même dans le Bugei, fuivant Faber en fon code de
jure empliit. defin. xljv. • , '
Il y a quelques coûtumes qui eft difpofent de mê- •
me. Celle de Metz, art 1. des fiefs, dit que les fiefs au
pays meffin font patrimoniaux & héréditaires, &
que le vaffal ne doit pour hommage que la bouche &
les mains, s’il n’appert par l’inveftiture que le fief!bit
d’autre condition. La coutume de Thionville, art.
j , des fiefs, dit la même chofe. (A )
F i e f i m m é d i a t , eft celui qui releve dire&ement
d’un feigneur, à la différence du fief médiat ou fie f
fubalterne qui releve dire&ement de fon vaffal, &
qui forme à l’égard du feigneur fuzerain, ce que l’ôn
appelle un arriere-fief. Voye[ A r r i e r e - F I E F . (A )
F i e f i m p é r i a l , en Allemagne, eft celui qui releve
immédiatement de l’empereur, à caufe dé fa dignité
impériale. (-^)
F i e f i m p r o p r e , c ’ e f t u n fie f ro t u r i e r & n o n n o b
l e . Voyei ci-après F i e f P R O P R E . (^ )
F i e f i n c o r p o r e l ou F i e f e n l ’ a i r , eft un fie f
impropre qui ne confifte qu’en mouvances & cenfi-
v e s , ou en môuvahces feules ou en cenfives feules,
& plus ordinairement en cenfives qu’en mouvances;
il eft oppofé au fief corporel, Fôye^ ci-devant F i e f e n
l ’ a i r & F i e f c o r p o r e l . (A)
F i e f i n f é r i e u r , s ’ e n t e n d d e t o u t fie f q u i r e l e v e
d ’ u n a u t r e m é d i a t e m e n t o u im m é d i a t e m e n t . Il e f t o p p
o f é à fie f f u p é r i e u r .
Le fie f fervant eft un f ief inférieur par rapport au
fie f dominant.
Un même fie f peut être inférieur par rapport à un
autre, & fupérieur par rapport à un arriere-fief.
Pour fa voir quand le fief inférieur eft confondu
avec le fief fupérieur lorlqu’ils font tous deux en la
même main, voye^ ci-devant au mot F i e f , & ci-après
R é u n i o n , F i e f d o m i n a n t 6* F i e f s e r v a n t . (A )
F i e f i n f i n i , voye^ ci-devant F i e f f i n i .
F i e f j u r a b l e , feudum jurabile, eft chez les ultramontains
celui pour lequel le vaffal doit à fon feigneur
le ferment de fidélité. Jacobinus de fanâo Geor-
gio, defeudis v°. in feudum n°. xç). dit : Décima divijjo
ejl quia feudum quoddam ejl jurabile , quoddam non ju -
rabile : feudum jurabile eft pro qiiojuratur fidelitas domino
; non jurabile, quando conceditur eo paclo ut fidelitas
nonjuretur. cap.j. § . nulla, in titulo , per quos fiat
inveftitura in lib. feud. Foyeç Wenher p. 5$x. col. 1.
in fine, & Lucium â.lib. I . placitorum t it .j. n°. x. p.
x o i.
Dans la coutume de Bar, le fief jurable & renda-
ble étoit celui que le vaffal étoit obligé de livrer à
fon feigneur. Coût, de Bar, art. 1. Foye^ ci-après F i e f
R E N D A B L E . (A )
F i e f l a ï c a l , e f t c e l u i q u i n e r e l e v e d ’ a u c u n e c -
c l é f i a f t i q u e , m a i s e f t d é p e n d a n t d ’u n fie f p u r e m e n t
t e m p o r e l . ( A )
F i e f l e v a n t & c h e a n t , voye{ F i e f c h e a n t
& F i e f r e v a n c h a b l e .
F i e f l i b r e ou F i e f d ’ h o n n e u r , feudum liberum
feu honoratum, il en eft parlé dans plufieurs anciennes
chartes, entr’autres dans la charte de commune
d’Abbeville, c. xxjv. Voyelle gloff. de Ducange, au
mot feudum liberum, & ci-devant F i e f d ’ h o n n e u r .
F i e f l i e g e , eft la même chofe qu c fie f lige. Il eft
ainfi appellé dans quelques coûtumes, comme dans
celle de Hainault, ch. Ixxjx. & dans celle de Cambrai
, tit. j . art. xlvj.x lvij. xljx. I. Ij. Voye{ Fl EF
l i g e , H o m m e & F e m m e l i g e , L i g e F o i & H o m m
a g e l i g e . ( A )
F i e f l i g e , e f t c e l u i p o u r l e q u e l l e v a f f a l e n f a i -
fant l a f o i & h o m m a g e à I o n f e i g n e u r d o m in a n t , p r p -
Tome FI,
filet de le fervir envers & contre toüs, & y oblige
tous fes biens.
Le pofleffeur d’un fie f lige eft appellé vajfal iige,
ou homme lige de fon feigneur ; l’hommagé qu’il lui
rend eft appellé hommage lige, & l’obligation fpéciale
qui attache ce vaffal à Ion feigneur, eft appellée dans
les anciens titres ligence ou ligeité.
Le fief lige eft oppofé au fief Ample;
La différence que les feudiftes français forit ehtre
ces deux fortes Aefiefs, eft que l’hômmage fimple que
le vaffal vend pour un fief fimple, n’eft nullement
perfonnel, mais purement réel ; il n’eft rendu que
pour raifon du fonds érigé en fief, auquel fonds il eft
tellement attaché * que dès que le vaffal le quitte, ce
qu’il peut faire en tout tems, etiam invito domino, il
demeure dès cet inftant libre de l’obligation qu’il
avoit contraûée, laquelle paffe avec le fonds à celui
qui y fuccede.
L’hommage lige au contraire magis cohceret per fonce
quam patrimonio ; & quoique la ligence affeôe le
fonds, qui par la première éreftion y a été affujetti ,
le pofleffeur qui s’en eft fait inveftir, fe charge per*
fonnellement du devoir de vaffal lige ; il y affe&e
tous fes autres biens fans jamais pouvoir s’en affranchir,
non pas même en quittant le fie f lige, ne pouvant
jamais le faire fans le confentement de fon fei-,
gneur.
Il y a auffi cela de particulier dans l’hommagé que
l’on rend pour un jieflige, que cet hommage, à chaque
fois qu’il eft rendu, doit être qualifié d’hommage
lige; c’eft pourquoi à chaque nouvelle réception eri
fo i, le vaffal devoit en ligne de fujétiôn mettre fes
mains jointes en celles de fon feigneur, & enfuite
être admis par lui au baifen ■
Les auteurs ne font pas trop d’accord fur l’étymo*
logie de ce mot lige.
Les uns ont écrit que le fief étoit appellé lige à li-
gando, parce que le vaffal étoit lié à fon feigneur
féodal, lui jurant & promettant une fidélité toute fin-
guliere. Jalon, de ujib. feud. n. 10S.
D ’autres tels queMatheus, fur la décif 3 oc>. de
Guypape, ont avancé que le Jieflige avoit pris ce
nom de l’effet & de la fuite des obligations fous lef-
quelles il avoit été originairement donné., en ce que
ceux qui s’en faifoient inveftir, étoient foûmis & engagés
à des conditions plus onéreufes que celles qui
étoient attachées aux fiefs Amples.
D ’autres encore ont tenu que ce terme lige venoit
de la forme particulière qui fe rendoit pour ces forteé
de fiefs, favoir, que les pouces du vaffal étoient liés
&fes mains jointes entre celles de fon feigneur ; opinion
que Ragueau, au mot hommage lige, traite avec
raifon de ridicule.
Quelques-uns ont foûtenu que le mot lige tiroit
fon origine de la ligne & confédération que quelques
perfonnes font enfemble, en ce que les feigneurs &
les vaffaux fe liguoient & conféderoient par ferment
les uns aux autres ; & fur ce fondement les feudiftes
allemands prétendent que les fiefs liges ont commencé
en Italie, & qu’ils ont été ainfi appellés à liga, mot
italien, qui félon eux lignifie ligue ; opinion que Dar-
gentré paroît avoir adoptée après Albert Krantz :
mais Brodeau fur Paris, art. Ixiij. dit que liga. eft un
ancien mot françois, qüi lignifie colligationem, pacem
& confederationem, une ligue.
Mais il eft confiant que liga n’eft ni italien ni françois
; une ligue en italien, c’eft lega. D ’ailleurs l’origine
des fiefs liges ne peut venir d’Italie, puifque les
conftitutions,napolitaines, quoique pofterieures en
partie aux ufages des fiefs, ne parlent point de fiefs
liges.
Le mot liga n’eft pas non plus gaulois ; car les fiefs
liges n’ayant commencé à être connus que bien avant
dans le xij. fiede, comme 011 le prouvera dans un mo