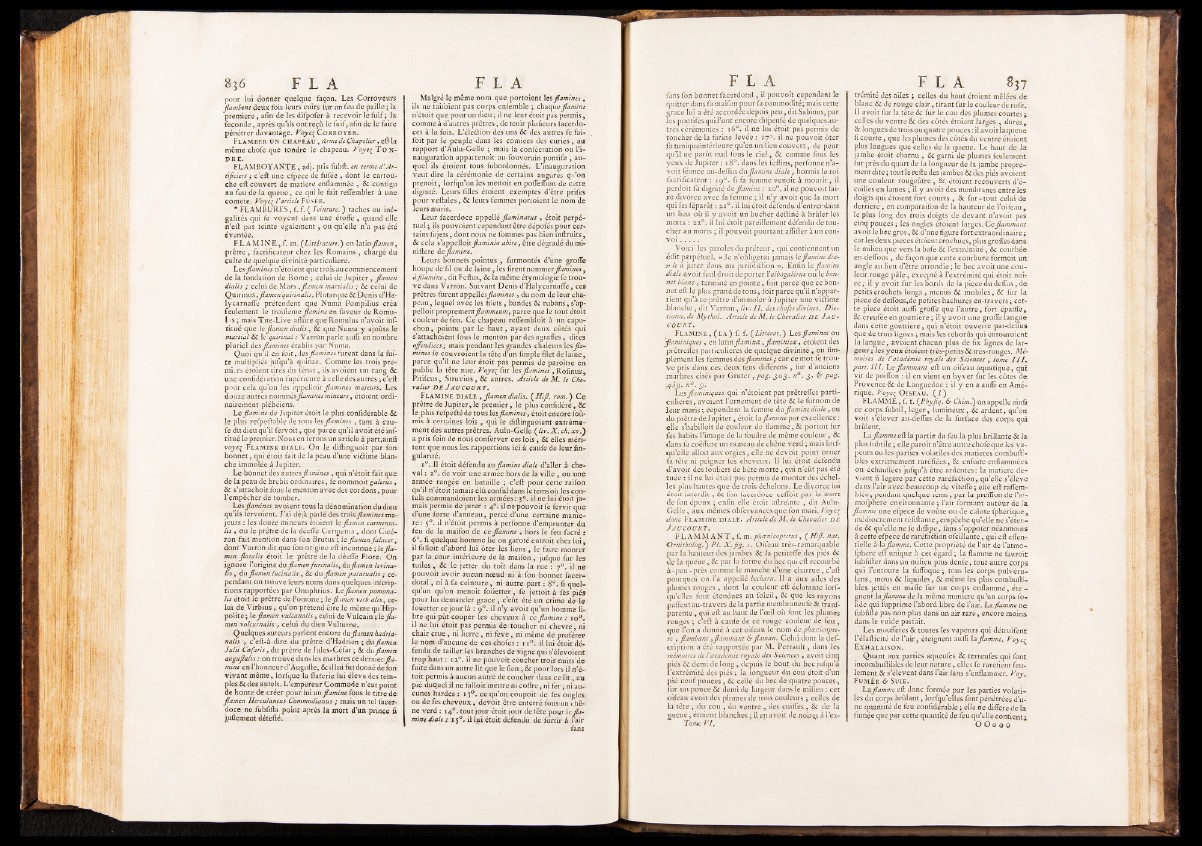
pour lui donner quelque façon. Les Corroyeurs
flambent deux fois leurs cuirs lïir un feu de paille ; la
première, afin de les difpofer à recevoir le fuif ; la
îeconde, après qu’ils ont reçu le fuif, afin de le faire
pénétrer davantage. Voye£ C o r r o y e r .
F l a m b e r u n c h a p e a u , ferme de Chapelier, eft la
même chofe que tondre le chapeau. Voye^ T o n -
PRE.
FLAMBOYANTE , a d j . p r i s f u b f t . en terme d 'A r tificiers
y c ’ e f t u n e e f p e c e d e f u f é e , d o n t l e c a r t o u c
h e e f t c o u v e r t d e m a t i è r e e n f l a m m é e , 8 c c o n t i g u
a u f e u d e l a q u e u e , c e q u i l e f a i t r e f f e m b l e r à u n e
c o m e t e . Voye£ l'article F u s é e .
* FLAMBURES, f. f. ( Teinture. ) t a c h e s o u in é g
a l i t é s q u i f e v o y e n t d a n s u n e é t o f f e , q u a n d e l l e
n ’ e f t p a s t e i n t e é g a l e m e n t , o u q u ’ e l l e n ’ a p a s é t é
é v e n t é e .
FLAM INE ,f. m. (Littérature.) en latinflamen,
prêtre, facrificateur chez les Romains , chargé du
culte de quelque divinité particulière.
Les flamines n’étoient que trois au commencement
de la fondation de Rome ; celui de Jupiter , flamen
dialis ; celui de Mars , flamen martialis ; 8c celui de
Quirinus, flamen quirinalis. Plutarque & Denis d’Ha-
lycarnaffe prétendent que Nunia Pompilius créa
feulement le troifieme flamine en faveur de Romu-
1 is ; mais Tite-Live aflure que Romulus n’avoit inf-
tiiué que \c flamen dialis, & que Numa y ajouta Je
martial & le quirinal : Varron parle aufli en nombre
pluriel des flamines établis par Numa.
Quoi qu’il en foit, les flamines furent dans la fuite
multipliés jufqu’à quinze. Comme les trois premiers
étoient tirés du fénat, ils avoient un rang 8c
une confédération fupérieure à celle des autres ; c’eft
pour cela qu’on les appelloit flamines majeurs. Les
douze autres nommés flamines mineurs, étoient ordinairement
plébéiens.
Le flamine de Jupiter étoit le plus confidérable 8c
le plus refpe&able de-tous les flamines , tant à cau-
fe du dieu qu’il fervoit, que parce qu’il avoit été inf-
titué le premier.Nous en ferons un article à part,ainfi
voyei F l a m i n e d i a l e . On le diftinguoit par fon
bonnet, qui étoit fait de la peau d’une viftime blanche
immolée à Jupiter.
Le bonnet des autres flamines , qui n’étoit fait que
de la peau de brebis ordinaires, fe nommoit galerus,
8c s’attachoit fous le menton avec des cordons , pour
l’empêcher de tomber.
Les flamines avoient tous la dénomination du dieu
qu’ils lervoient. J’ai déjà parlé des trois flamines majeurs
: les douze mineurs étoient le flamen carmenta-
lis , ou le prêtre de la déefle Carmenta , dont Cicéron
fait mention dans fon-Brutus ; \c flamen falacer,
dont Varron dit que fon origine eft inconnue ; \&flamen
floralis étoit le prêtre de la déefle Flore. On
ignore l’origine du flamen furinalis, du flamen levina-
l i s , du flamen Lucinalis, 8c du flamen palatualis ; cependant
on trouve leurs noms dans quelques inferip-
tions rapportées par Onuphrius. Le flamen pomona-
lis étoit le prêtre de Pomone ; le flamen virb.alis, celui
de Virbius, qu’on prétend être le même qu'Hip-
polite ; le flamen vulcanalis, celui de Vulcain ; ic fla men
volturnalis , celui du dieuVulturne. . -
Quelqu es auteurs parlent encore du flamen hadria-
nalis y c’èft-à-dire du prêtre d’Hadrien ; da flamen.
Julti Ccefaris, du prêtre de Jules-Céfar ; & du flamen
aùguflalis :on trouve dans les marbres ce dernier f la mine
en l’honneur d’Àugufte, 8c il lui fut donné de fon
vivant même, lorfque-la flaterie lui éleva des temples
8c des autels. L’empereur Commode n’eut point,
de honte de créer pourlulun flamine fous le titre dé
flamen Herculaneus Commodianus ; mais un tel facer-
doçe ne fubfifta point après la mort d’un prince û
juftement détefté.
Malgré le même no m que portoient les flamines fa
ils ne faifoient pas corps enfemble ; chaque flamine
n’étoit que pour un dieu ; il ne leur étoit pas permis,
comme à d’autres prêtres, de tenir plufieurs lacerdo-
ces à la fois. L’éledion des uns 8c dès autres fe fai-
foit par le peuple dans les comices des curies, au
rapport d’Aulu-Gelle ; mais la confécration ou l’inauguration
appartenoit au fouverain pontife , auquel
ils étoient tous fubordonnés. L’inauguration
veut dire la cérémonie de certains augures qu’on
prenoit, lorfqu’on les mettoit en poffeflion de cette
dignité. Leurs filles étoient exemptes d’être prifes
pour veftales, 8c leurs femmes portoient le nom de
leurs maris.
Leur facerdoce appellé flamïnatus , étoit perpétuel
; ils pouvoient cependant être dépofés pour certains
fujets, dont nous ne fommes pas bien inftruits ,
8c cela s’appelloit flaminio abire3-ètre dégradé dumi-
niftere de flamine.
Leurs bonnets pointus , furmontés d’une grofle
houpe de fil ou de laine, les firent nommer flamines ,
àfilamine, dit Feftus, 8c la même étymologie fe trouve
dans Varron. Suivant Denis d’Halycarnaffe, ces
prêtres furent appellésflamines , du nom de leur chapeau
, lequel avec les filets, bandes 8c rubans, s’appelloit
proprementflammeum, parce que le tout étoit
couleur de feu. Ce chapeau reflembloit à un capuchon
, pointu par le haut, ayant deux côtés qui
s’attachoient fous le menton par des agraffes, dites
offendices; mais pendant les grandes chaleurs les fla mines
fe couvroient la tête d’un fimple filet de laine,
parce qu’il ne leur étoit pas permis de paroître en
public la tête nue. .Voye^ fur les flamines , Rofinus,
Pitifcus, Struvius, 8c antres. Article de M . le Chevalier
DE JAJJCOURT.
F l a m i n e d i a l e , flamen dialis. ( Hifl. rom.') C e
prêtre de Jupiter, le premier, le plus confidéré, 8c
le plus refpeâé de tous lesflamines-, étoit encore fournis
à certaines lois , qui le diftinguoient extrêmement
des autres prêtres. Aulu-Gelle ( liv. X . ch. x v .)
a pris foin de nous conferver ces lois , 8c elles méritent
que nous les rapportions ici à caufe de leur Angularité.
i°. Il étoit défendu au flamine diale d’aller à cheval
: 20. de voir une armée hors de la ville , ou une
armée rangée en bataille ; c’eft pour cette raifon
qu’il n’étoit jamais élû conful dans le tems oit les con-
iuls commandoient les armées:.*.?, il ne lui étoit jamais
permis de jurer : 40: il ne pouvoir fe fervir que
d’une forte d!anneau, percé d’une certaine maniéré
: 50. il n’étoit permis à perfonne d’emprunter du
feu de la maifon de ce flamine , hors le feu facré :
6°. fi quelque homme lie ou garoté entroit chez lui,
il falloit d’abord lui ôter les liens , le faire monter
par la cour intérieure de la maifon , jufqué fur les
tuiles, 8c le jetter du toit dans la rue : y°. il ne
pouvoit avoir aucun noeud ni à fon bonnet facer-
dotal, ni à fa. ceinture , ni autre part : 8°. fi quelqu’un
qu’on menoit fouetter, fe jettoit à fes piés
pour lui demander grâce , c’eût été un crime de le
foiietter ce jour là : 9?. il n’y avoit qu’un homme libre
qui pût couper les cheveux à c e flamine : io°.
il ne lui étoit pas permis de: toucher ni chevre, ni
chair crue, ni lierre, ni feve, ni même de proférer
le nom d?aucune de ces chofes : 1 1°. il lui étoit défendu
de tailler les branches de vigne qui s’élevoient
trop haut : 120. il ne pouvoit coucher trois nuits'de
fuite dansun autre lit que le fien, 8c pour lors il n’étoit
permis à aucun autre de coucher dans ce lit, au
pié duquel.il ne falloit mettre ni coffre, ni fer, ni aucunes
hardes : 130. ce qu’on coupoit de fes ongles
ou de fes cheveux, devoit être enterré fouS'tin chêne
verd : 140. tout jour étoit jour de fête-pour leÆx-
mine diale : 1 50. il lui étoit défendu de fbrtir. à l’air
fans
fans fon bonnet facerdotal, il pouvoit cependant le
quitter dans fa maifon pour fa commodité; mais cette
grâce lui a été accordée depuis peu, dit Sabinus, par
les pontifes qui l’ont encore difpenfé de quelques autres
cérémonies : 160. il ne lui étoit pas permis de
toucher de la farine levée : 17°. il ne pouvoit ôter
fa tuniqueintérieure qu’en un lieu couvert, de peur
qu’il ne parût nud fous le ciel, 8c comme fous les.
yeux de Jupiter : 18°. dans les feftins, perfonne n’avoit
féance au-deflus du flamine diale, hormis le roi
facrificateur : 190. fi fa femme venoit à mourir, il
perdoit fa dignité de flamine : 20°. il ne pouvoit faire
divorce avec fa femme ; il n’y avoit que la mort
qui les féparât : 210. il lui étoit défendu d’entrer dans
un lieu où il y avoit un bûcher deftiné à brûler les
morts : 220. il lui étoit pareillement défendu de toucher
au morts ; il pouvoit pourtant aflifter à un con-
,Voi.........
Voici les paroles du préteur, qui contiennent un
édit perpétuel. « Je n’obligerai jamais le flamine dia-
» le à jurer dans ma jurifdiction ». Enfin le flamine
diale avoit feul droit déporter Yalbogalérus ou le bonnet
blanc, terminé en pointe, foit parce que ce bonnet
eft le plus grand de tous, foit parce qu’il n’appar-
îient qu’à ce prêtre d’immoler à Jupiter une viftime
blanche, dit Varron, liv. I I . des chofes divines. Die-
tionn. de Mythol. Article de M . le Chevalier DE J a u -
COURT.
F l a m i n e , ( l a ) f. f. (L itté ra l.) Les flamines ou
flaminiques , en lûtmflaminoe, flaminicce , étoient des
prêtrefles particulières de quelque divinité , ou Amplement
les femmes des flamines ; car ce mot fe trouve
pris dans ces deux lens differens , fur d’anciens
marbres cités par Gruter, pag. 3 o j. n° . 3 . & pag.
jS s .nQ .C ) . . . A
Le s flaminiques qui n etoient pas pretrefles particulières
, avoient l’ornement de tête 8c le furnom de
leur maris ; cependant la femme du flamine diale, ou
du prêtre de Jupiter, étoit Iz flamine par excellence :
elle s’habilloit de couleur de flamme, 8c portoit fur
fes habits l’image de la foudre de même couleur , 8c
dans fa coëffiire un rameau de chêne verd ; mais loi f-
qu’elle alloit aux orgies, elle ne devoit point orner
fa tête ni peigner fes cheveux. Il lui étoit défendu
d’avoir des fouliers de bête morte, qui n’eût pas été
tuée : il ne lui étoit pas permis de monter des échelles
plus hautes que de trois échelons. Le divorce lui
étoit interdit, 8c fon facerdoce cefloit par la mort
de fon époux ; enfin elle étoit aftreinte , dit Aulu-
Gelle , aux mêmes obfervances que fon mari. Voyez
donc F l a m i n e d i a l e . Article de M . le Chevalier d e
J AU COURT.
F L AM M A N T ,f.m .phcenicopterus, ( H ifl. nat.
Ornitholog. ) PI. X . fig. 1. Oifeau très-remarquable
par la hauteur des jambes 8c la petitefle des piés 8c
de la queue, 8c par la forme du bec qui eft recourbé
à-peu-près comme le manche d’une charrue, c’eft
pourquoi on l’a appellé becharu. Il a aux ailes des
plumes rouges , dont la couleur eft éclatante lorf-
qu’elles font étendues au foleil, 8c que les rayons
paffent au-travers de la partie membraneufe 8c tranf-
parente, qui eft au haut de l’oeil où font les plumes
rouges ; c’eft à caufe de ce rouge couleur de feu ,
que l’on a donné à cet oifeau le nom de phcejiicqpte-
re t flambant ,flammant & flaman. Celui, dont la def-
cription a été rapportée par M. Perrault, dans les
mémoires de l'académie royale des Sciences , avoit cinq
piés 8c demi de long, depuis le bout du bec jufqu’a
l ’extrémité des piés ; la longueur du cou étoit d’un
pié neuf pouces, 8c celle du bec de quatre pouces,
fur un pouce 8c demi de largeur dans le milieu : cet
oifeau avoit des plumes de trois couleurs ; celles de
la tête ; du cou , du ventre , des cuifles, 8c de la
queue, étoient blanches ; il ep avoit de noires à l’ex-
T ome VI.
trémité des ailes ; celles du haut étoient mêlées de
blanc 8c de rouge clair, tirant fur le couleur de rofe.
Il avoit fur la tête 8c fur le cou des plumes courtes ;
celles du ventre 8c des côtés étoient larges , dures ,
& longues de trois ou quatre pouces : il avoit la queue
fi courte, que les plumes des côtés du ventre étoient
plus longues que celles de la queue. Le haut de la-
jambe étoit charnu , 8c garni de plumes feulement
fur près du quart de la longueur de la jambe proprement
dite ; tout le nefte des jambes 8c des piés avoient
une /couleur rougeâtre , 8c étoient recouverts d’é-
cailles en lames ; il y avoit des membranes entre les
doigts qui étoient fort courts , 8c fur - tout celui de
derrière, en comparaifon de la hauteur de l’oifeau,
le plus long des trois doigts de devant n’avoit pas
cinq pouces ; les ongles étoient larges. Ceflammant
avoit le bec gros, 8c d’une figure fort extraordinaire ;
car les deux pièces étoient crochues, plus grofles dans
le milieu que vers la bafe 8c l’extrémité, 8c courbée
en-deflous , de façon que cette courbure formoit un
angle au lieu d’être arrondie ; le bec avoit une couleur
rouge pâle, excepté à l’extrémité qui étoit noire;
il y avoit fur les bords de la piece du defîus, de
petits crochets longs , menus 8c mobiles, 8c fur la
piece de deflous,de petites hachures en-travers ; cette
piece étoit aufli grofle que l’autre, fort épaifle,
8c creufée en gouttière ; il y avoit une grofle langue
dans cette gouttière, qui n’étoit ouveite par-defliis
que de trois lignes ; mais les rebords qui entouroient
la langue, avoient chacun plus de fix lignes de largeur
; les yeux étoient très-petits 8c très-rouges. Mémoires
de l'académie royale des Sciences , tome I I I .
part. I I I . Le flammant eft un oifeau aquatique, qui
vit de poiflon : il en vient en hyver fur les côtes de
Provence 8c de Languedoc : il y en a aufli en Amérique.
Voye^ O i s e a u . ( / )
FLAMME, f. f. (Phyflq. & Chim.) on appelle ainfî
ce corps fubtil, léger, lumineux, 8c ardent, qu’on
voit s’élever au-deflus de la furface des corps qui
brûlent.
La flamme eft la partie du feu la plus brillante 8c la
plus fubtile ; elle paroît n’être autre chofe que les vapeurs
ou les parties volatiles des matières combufti-
bles extrêmement raréfiées, 8c enfuite enflammées
ou échauffées jufqu’à être ardentes: la matière devient
fi legere par cette raréfaûion, qu’elle s’élève
dans l’air ayec beaucoup de vîtefle; elle eft raflem-
blée, pendant quelque tems, par la preflîon de l’at-
mofphere environnante ; l’air formant autour de la
flamme une efpece de voûte ou de calote fphérique ,
médiocrement réfiftante, empêche qu’elle ne s’étende
8c qu’elle ne fe diflipe, fans s’oppoler néanmoins
à cette efpece de raréfaction ofcillante, qui eft eflen-
tielle à-la flamme. Cette propriété de l’air de l’atmo-
fphere eft unique à cet égard ; la flamme ne fauroit
fubfifter dans un milieu plus denfe, tout autre corps
qui l’entoure la fuffoque ; tous les corps pulvéru-
lens, mous 8c liquides, 8c même les plus combufti-
bles jettés en malle fur un corps enflammé, éte:-
gnent la flamme de la même maniéré qu’un corps fo-
lide qui fupprime l’abord libre de l’air. La flamme ne
fubfifte pas non plus dans un air rare, encore moins
dans le vuide parfait.
Les mouffetes 8c toutes les vapeurs qui détruifent
l’élafticité de l’air, éteignent aufli la flamme. Voye£
E x h a l a i s o n .
Quant aux parties aqueufes 8c terreufes qui font
incombuftibles de leur nature, elles fe raréfient feulement
8c s’élèvent dans l’air fans s’enflammer. Foy.
F u m é e 6* S u i e .
La flamme eft donc formée par les parties volatiles
du corps brûlant, lorfqu’elles font pénétrées d’une
quantité de feu confidérable ; elle ne différé de la
fumée que par cette quantité de feu qu’elle contienti O O o o o