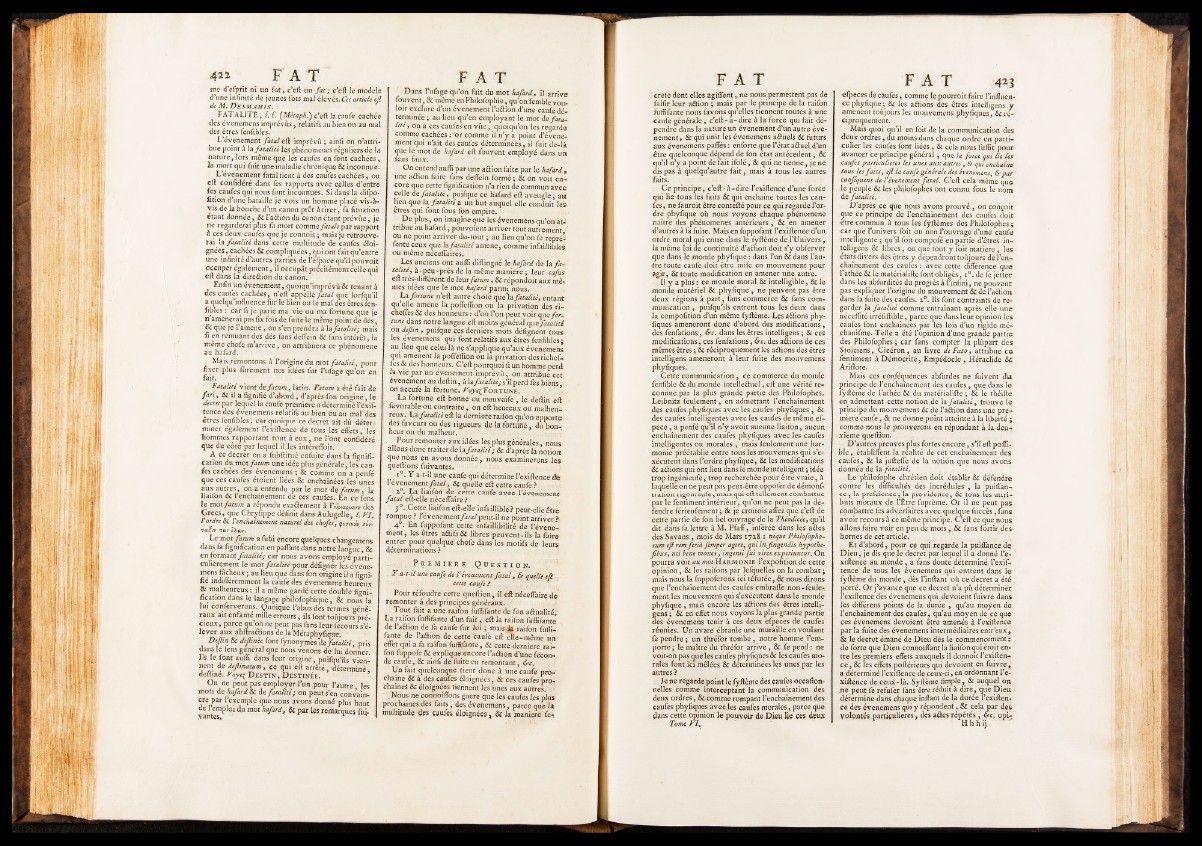
42Z F A T
me d’efprit ni un fot, c’eft un f a t ; c’eft le modèle
d’une infinité de jeunes fois mal élevés. C e t a r t ic le eft
d e M . D e s m a h i s .
FATALITÉ, f. f. (M é t a p h .) c’eft la caufe cachée
des évenemens impré vûs , relatifs au bien ou au mal
des êtres fenfibles.
L’evenement f a t a l eft imprévu ; ainfi on n’attribue
point à la f a t a l i t é les phenomenes réguliers de la
nature, lors même que les caufes en font cachées,
la mort qui fuit une maladie chronique 6 c inconnue.
L ’évenement fatal tient à des caufes cachées, ou eft confidéré dans fes rapports avec celles d’entre
fes caufes qui nous font inconnues. Si dans la difpo-
fition d’une bataille je vois un homme placé vis-à-
vis de la bouche d’un canon prêt à tirer, fa fituation
étant donnée, 6c l’aftion du canon étant prévûe, je
ne regarderai plus fa mort comme f a t a l e par rapport
à cès deux caufes que je connois ; mais je retrouverai^
la f a t a l i t é dans cette multitude de caufes éloignées
, cachées & compliquées, qui ont fait qu’entre
une infinité d’autres parties de l’efpace qu’il pouvoit
occuper également, il occupât precifément celle qui
eft dans la direérion du canon.
Enfin un événement, quoiqu’imprévû6 c tenant à
des caufes cachées, n’eft appellé fatal que Iorfqu’il i
a quelqu’influence fur le bien ou le mal des êtres fenfibles
: car fi je parie ma vie ou ma fortune que je
n’amenerai pas fix fois de fuite le même point de dés,
& que je l’amene, on s’en prendra à la fatalité; mais
fi en remuant des dés fans deffein 6 c fans intérêt, la
même chbfe m’arrive, on attribuera ce phénomène
au hafard.
Mais remontons à l’origine du mot fatalité, pour
fixer plus Jurement nos idées fur I’ufage qu’on en
fait.
Fatalité vient de fatum, latin. Fatum a été fait de
fariy & il a fignifié d’abord, d’après fon origine, le
decret par lequel la caufe première a déterminé i’exif-
tence des évenemens relatifs au bien ou au mal des
«très fenfibles; car quoique ce decret ait dû déterminer
également l’exiftence de tous les effets, les
hommes rapportant tout à eux, ne l’ont confidéré
que du côté par lequel il les intéreffoit.
A ce decret on a fubftitué enfuite dans la lignification
du mot fatum une idée plus générale, les caufes
cachées des évenemens ; & comme on a penfé
que ces caufes étoient liées & enchaînées les unes
aux autres, on a entendu par le mot de fatum, la
liaifon & l’enchaînement de ces caufes. En ce fens
le mot fatum a répondu exactement à l\1ya.fH.ty» des
Grecs, que Chryfippe définit dans Aulugeile, l.V I .
V o rd r e 6 c Y e n c h a în em e n t n a tu r e l d e s ch o f e s , çuem-év <ruv-
Le mot fatum a fubi encore quelques changemens
dans fa lignification en paffânt dans notre langue, 6 c
en formant fatalité; car nous avons employé particulièrement
le mot fatalité pour déligner tes évene-
mens fâcheux ; au lieu que dans fon origine il a lignifié
indifféremment la caufe des évenëmens heureux
& malheureux: il a même gardé cette double lignification
dans le langage philofophique, & nous la'
lui conferverons. Quoique l’abus des termes généraux
ait enfanté mille erreurs, ils font toujours précieux,
parce qu on ne peut pas fans leur fecours s'élever
aux abftraCHons de la Métaphÿfiqite.
Deftin & dejlinée font fynonymes àe fatalité t pris
dans le fens général que nous venons àë lui donner.
Ils le font aufli dans leur origine, puîfqti’rls viennent
de d e f t in a tu m , ce qui eft arrêté, déterminé
deftiné. V o y e { D e s t in , D e s t in é e .
On ne peut pas employer l ’un pour l’autre les
mots de h a fa r d 6 c de f a t a l i t é ; on peut s’en convaincre
par l’exemple que nous avons donné plus haut
de l’emploi du mot h a fa r d , 6c par les remarques fui-
F A T
Dans l’ufage qu’on fait du mot hafard, il arrive
fouvent, 6c même en Philofophie, qu’on femble vouloir
exclure d’un événement l’aérion d’une caufe déterminée
; au lieu qu’en employant le mot de fata-%
lité, on a ces caufes en v u e , quoiqu’on les regarde
comme cachées : or comme il n’y a point d’évene-
ment qui n’ait des caufes déterminées, il fuit de-là
que le mot de hafard eft fouvent employé dans un
fens faux.
On entend aufli par une aérion faite par le hafard ,
une aérion faite fans deffein. formé ; & o n voit encore
que cette lignification n’a rien de commun avec
celle de fatalité, puifque ce hafard eft aveugle, au
lieu que la fatalité a un but auquel elle conduit les
êtres qui font fous fon empire.
D e plus, on imagine que les évenemens qu’on attribue
au hafard, pouvoient arriver tout autrement
ou ne point arriver du-tout ; au lieu qu’on fe repréfente
ceux que la fatalité amene, comme infaillibles
ou même néceffaires.
Les anciens ont aufli diftingué le hafard de la fa talité,
à-peu-près de la même maniéré ; leur cafus
eft très-different de leur fatum, 6c répondoit aux mêmes
idées que le mot hafard parmi nous.
La fortune n’eft autre chofe quela fatalité, entant
qu’elle amene la poffeflion ou la privation des ri-
chefles & des honneurs : d’oii l’on pe ut voir que fortune
dans notre langue eft moins général que fatalité
ou deftin, puifque ces derniers mots délignent tous
les évenemens qui font relatifs aux êtres fenfibles;
au lieu que celui-là ne s’applique qu’aux évenemens
| qui amènent la poffeflion ou la privation des richef-
; les & des honneurs. C ’eft pourquoi fi un homme perd
la v ie par un événement imprévu, on attribue cet
événement au deftin, à la fatalité; s’il perd fes biens
on accufe la fortune. Voye^ Fo r t u n e .
La fortune eft bonne ou mauvaife , le deftin eft
favorable ou contraire, on eft heureux ou malheureux.
La fatalité eft la demiere raifon qu’on apporte
des faveurs ou des rigueurs de la fortune, du bonheur
ou du malheur.
Pour remonter aux idées les plus générales, nous
allons donc traiter de la fatalité; 6c d’après la notion
que nous en avons donnée, nous examinerons les
queftioris fuivantes.
i° . Y a-t-il une caufe qui détermine l’exiftence elfe
1 evenement fatal, & quelle eft cette caufe ?
i° . La liaifon de cette caufe avec l’évenement
fatal eft-elie néceffaire ?
3 °. Cette liaifon eft-elie infaillible ? peut-elle être
rompue ? l’évenement/W peut-il ne point arriver F
4°. En fuppofant cette infaillibilité de l’évenement,
les êtres a a ifs& libres peuvent-ils la faire
entrer pour quelque chofe dans les motifs de leurs
déterminations }
P r e m i è r e Q u e s t i o n .
Y a-t-il une caufe de Vévénement fatal, & quelle eft
cette caufe ?
Pour réfoudre cette queftion, il eft néceffaire de
remonter à des-principes généraux.
Tout fait a une raifon Juffifante de fon aéhialité*
La raifon fuffifante d’un fa it , eft la raifon fuffifante
de l’aérion de fa caufe fur lui ; mais, la raifon fuffifante
de l’aériôn de cette caufe eft elle-même un
effet qui a fa raifon fuffifante, 6c cette demiere raifon
fuppofe & explique encore l’aérion d’une fecon-,
dè caule, & ainfi de fuite en remontant, &c.
Un fait quelconque tient donc à une caufe prochaine
6c à des caufes éloignées, & ces caufespro^
chaineS 6c éloignées tiennent les unes aux autres. ■
Nous ne connoiffons guere que les caufes les plus
prochaines des faits , des évenemens, parce que la
multitude des caufes éloignées a 6c la maniéré fe-
F A T
crete dont elles agiffent, ne nous permettent pas de
faifir leur aérion ; mais par le principe de la raifon
fuffifante nous favons qu’elles tiennent toutes à une
caufe générale, c’eft-à-dire à la force qui fait dépendre
dans la nature un événement d’un autre événement,
& qui unit les évenemens aétuels 6c futurs
aux évenemens paffés : enforte que l’état aétuel d’un
être quelconque dépend de fon état antécédent, 6c
qu’il n’y a point de fait ifolé, & qui ne tienne, je ne
dis pas à quelqu’autre fait ; mais à tous les autres
faits.
Ce principe, c’eft-à-dire l’exiftence d’une force
qui lie tous les faits & qui enchaîne toutes les caufes
, ne fauroit être contefté pour ce qui regarde l’ordre
phyfique où nous voyons chaque phénomène
naître des phénomènes antérieurs, 6c en amener
d’autres à fa fuite. Mais en fuppofant l’exiftenee d’un
ordre moral qui entre dans le fyftème de l’Univers,
la même loi de continuité d’aérion doit s’y obferver
que dans le monde phyfique : dans l’un & dans l’autre
toute caufe doit être mife en mouvement pour
agir, 6c toute modification en amener une autre.
Il y a plus : ce monde moral 6c intelligible, 6c le
monde matériel 6c phyfique , ne peuvent pas être
deux régions à part, lans commerce 6c fans communication
, puifqu’ils entrent tous les deux dans
la compofition d’un même fyftème. Les aérions phy-
•fiques amèneront donc d’abord des modifications,
des fenfations, &c. dans les êtres intelligens ; & ces
modifications, ces fenfations, &c. des actions de ces
mêmes êtres ; 6c réciproquement les aérions des êtres
intelligens amèneront à leur fuite des mouvemens
phyfiques.
Cette communication , ce commerce du monde
fenfible & du monde intellectuel, eft une vérité reconnue
par la plus grande partie des Philofophes.
Leibnitz feulement, en admettant l’enchaînement
des caufes phyfiques avec les caufes phyfiques, 6c
des caufes intelligentes avec les caufes de même ef-
p ec e, a penfé qu’il n’y avoit aucune liaifon, aucun
enchaînement des caufes phyfiques avec les caufes
intelligentes ou morales , mais feulement une harmonie
préétablie entre tous les mouvemens qui s’exécutent
dans l’ordre' phyfique, 6c les modifications
6c aérions qui ont lieu dans le monde intelligent ; idée
trop ingénieufe, trop recherchée pour être/vraie, à
laquelle on ne peut pas peut-être oppofer de démonf-
tration rigoureufe, mais qui eft tellement combattue
par le fentiment intérieur, qu’on ne peut pas la défendre
férieufement ; & je croirois affez que c’eft de
cette partie de fon bel ouvrage de la Théodicée, qu’il
dit dans fa lettre à M. Pfaff, inférée dans les aéles
des Sa vans , mois de Mars 1718 : ntque Philofopho-
rum eft rem ferih femper agere, qui in fingendis hypothe-
Jibus, uti bene mones, ingenii fui vires experiuntur. On
pourra voir au mot Ha r m o n ie l’expofition de cette
opinion, 6c les raifons par lefquelies on la combat ;
mais nous la fuppoferons ici réfutée, 6c nous dirons
que l’enchaînement des caufes embraffe non-feulement
les mouvemens qui s’exécutent dans le monde
phyfique, mais encore les aérions des êtres intelligens
; 6c en effet nous voyons, la plus grande partie
des évenemens tenir à ces deux efpeces de caufes
réunies. Un avare' ébranle une muraille en voulant
fe pendre ; un thréfor tombe , notre homme l’emporte
; le maître du thréfor arrive, & fe pend : ne
voit-on pas que les caufes phyfiques & les caufes morales
font ici mêlées 6c déterminées les unes par les
autres ?
Je ne regarde point le fyftème des caufes occafion-
nelles comme interceptant la communication des
deux ordres, & comme rompant l’enchaînement des
caufes phyfiques avec les caufes morales, parce que
dans cette opinion le pouvoir de D ieu lie ces deux
Tome V f
F A T 4 2 3
efpeces de caufes, comme Iepourroit faire l’influence
phyfique ; 6c les aérions des êtres intelligens y
amènent toûjours les mouvemens phyfiques, 6c réciproquement.
Mais quoi qu’il en foit de la communication des
deux ordres, du moins dans chaque ordre en particulier
les caufes font liées , & cela nous fuffit pour
avancer ce principe général, que la force qui lie les
caufes particulières les unes aux autres, & qui enchaîne,
tous les faits, eft la caufe générale des évenemens, &pap
çonféquent de Vévénement fatal. Ç ’eft cela même que
le peuple 6c les philofophes ont connu fous le nom
de fatalité.
D ’après ce que nous avons prouvé , on conçoit
que ce principe de l’enchaînement des caufes doit
être commun à tous les fyftèmes des Philofophes ;
car que l’univers foit ou non l’ouvrage d’une caufe
intelligente ; qu’il foit compofé en partie d’êtres intelligens
6c libres, qu que tout y foit m atière, las
états divers des êtres y dépendront toûjours de l’enchaînement
des caufes : avec cette différence que
l’athée 6c le matérialifte font obligés, i° . de fe jetter
dans les abfurdités du progrès à l’infini, ne pouvant
pas expliquer l’origine du mouvement 6c de l’aérion
dans la fuite des caufes. i ° . Ils font contraints de regarder
la fatalité comme entraînant après elle une
néceflité irréfiftible, parce que dans leur opinion les
caufes font enchaînées par les lois d’un rigide mé-
.chanifme. Telle a été l’opinion d’une grande partie
des Philofophes ; car fans compter la plûpart des
Stoïciens, Cicéron , au livre de Fato, attribue ce
fentiment àDémocrite, Empédocle, Héraclide 6c
Ariftote.
Mais ces conféquences abfurdes ne fuivent du
principe de l’enchaînement des caufes, que dans le
fyftème de l ’athée 6c du matérialifte ; 6c le théifte
en admettant cette notion de la fatalité, trouve le
principe du mouvement 6c de l’aérion dans une première
caufe, & ne donne point atteinte à la liberté ;
comme nous le prouverons en répondant à la deuxieme
queftion.
D ’autres preuves plus fortes encore, s’il eft poflïr
ble, établirent la réalité de cet enchaînement des
caufes, & la jufteffe de la notion que nous avons
donnée de la fatalité.
Le philofophe chrétien doit établir 6c défendre
contre les difficultés des incrédules , la puiflan-
c e , la prefcience, la providence, 6c tous les attributs
moraux de l’Être fuprème. Or il ne peut pas
combattre fes adverfaires avec quelque fuccès, fans
avoir recours à ce même principe. C’eft ce que nous
allons faire voir en peu de mots, 6c fans fortir des
bornes de cet article.
Et d’abord, pour ce qui regarde la puiffance de
Dieu, je dis que le decret par lequel il a donné l’exiftence
au monde, a fans doute déterminé l’exiftence
de tous les évenemens qui entrent dans le
fyftème du monde, dès l’inftant où ce decret a été
porté. Or j’avance qup ce decret n’a pû détermina;
l’exiftence des évenemens qui dévoient fuivre dans
Jes différens points de la durée , qu’au moyen de
l’enchaînement des caufes, qu’au moyen de ce que
ces évenemens, dévoient être amenés à l’exiftence
par la fuite des évenemens intermédiaires entr’eux,
& le decret émané de Dieu dès le commencement;
de forte que D ieu connoiffant la liaifon qui étroit entre
les premiers effets auxquels il donnoit l’exiftence
, 6c les effets poftérieurs qui dévoient en fuivre ,
a déterminé l’exiftence de ceux-ci, en ordonnant l’exiftence
de ceux-là. Syftème fimple, & auquel on
,ne peut fe refufer fans être réduit à dire, que Dieu
détermine dans chaque inftant de la durée l’exiftence
des évenemens qui y répondent, 6c cela par des
volontés particulières, des a&es répétés , &c, opi-
H h h i j