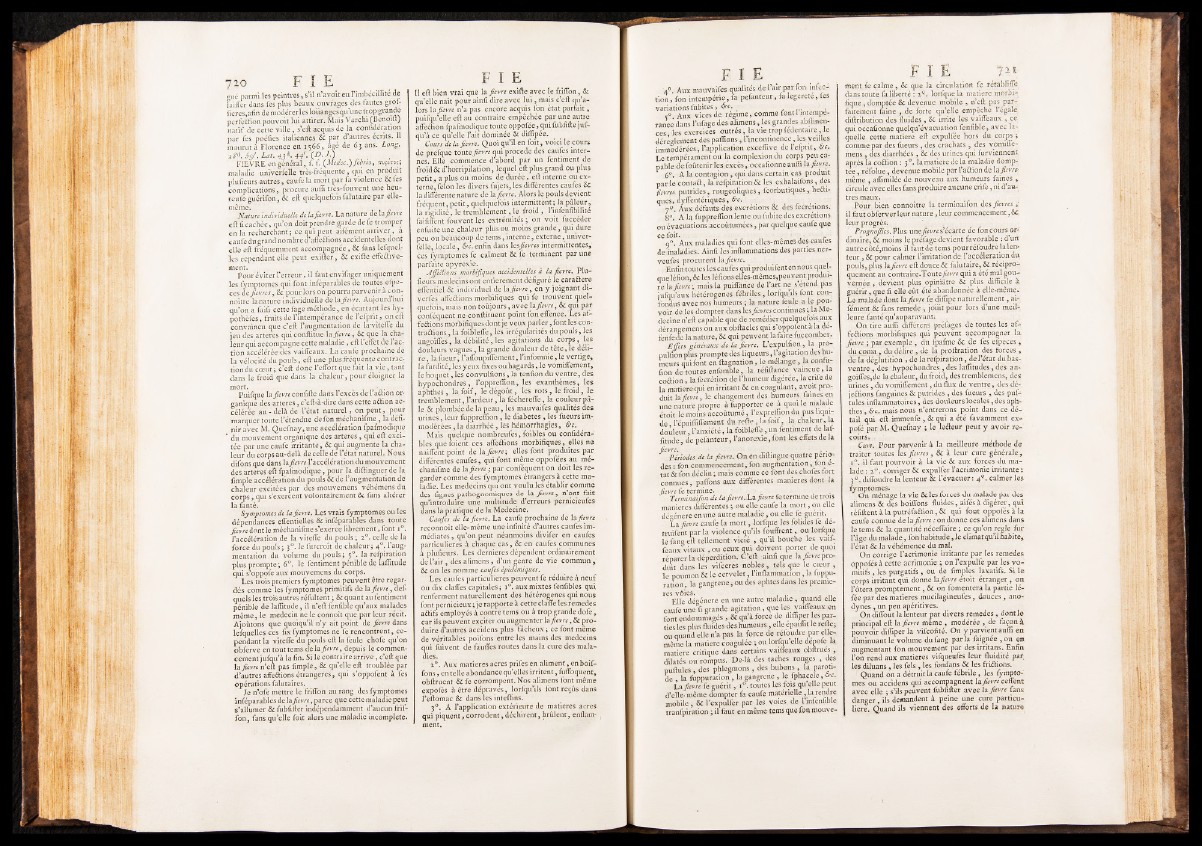
eue parmi les peintres , s’il n’avoit eu l’imbécillité de
faiffer clans fes plus beaux ouvrages des fautes grof-
fieres,afin de modérer les louanges qu’une trop grande
perfedlion pouvoit lui attirer. Mais Varchi (Benoift)
natif de cette v ille , s’eft acquis de la conficleration
par fes poéfies italiennes & par d’autres écrits. Il
mourut à Florence en 1566, âgé de 63 ans. Long.
28 A. S ç '. Lat. 4 jd. 44'. ( D -/•) ,
FIEVRE en général, f. f. (Medec.)febris, nvpt roç\
maladie univerfelle très-fréquente, qui en produit
plufieurs autres, caufe la mort par fa violence & fes
complications, procure aufli très-fouvent une heu-
reufe guérifon, & eft quelquefois falutaife par ellemême.
1 1 r
Nature individuelle de la fievre. La nature delà fievre
eft fi cachée, qu’on doit prendre garde de fe tromper
en la recherchant; ce qui peut aifé.ment arriver, à
caufe du grand nombre d’affeftions accidentelles dont
elle eft fréquemment accompagnée, & fans lefquei-
les cependant elle peut exifter, & exifte effeéhve.-
ment. . 4 '
Pour é viter l’erreur, il faut envifager uniquement
les fymptomes qui font inféparables de toutes elpè-
ces de fièvres, & pourlors.on pourra parvenir à con-
noître la nature individuelle de la fievre. Aujourd’hui
qu’on a faifi cette fage méthode, en écartant les hy-
pothèfes, fruits de l'intempérance de l’efprit, on eft
convaincu que c’eft l’augmentation de la-vîteffe du
jeu des arteres qui conftitue la fievre, & que la chaleur
qui accompagne cette maladie, eft l’effet de l’action
accélérée des vaiffeaux. La caufe prochaine de
la vélocité du pouls, eft une plus frequente contraction
du coeur; c’eft donc l’effort que fait la v ie , tant
dans le froid que dans la chaleur, pour éloigner la
mort. H H |
Puifque la fievre confifte dans l’excès de 1 aüion organique
des arteres, c’ eft-à-dire dans cett,e aâion accélérée
au - delà de l’état naturel, on peut, pour
marquer toute, l’étendue defon méchanifme , la définir
avec M. Quefnay,une accélération fpafmodique
’ du mouvement organique des arteres, qui eft excitée
par une caufe irritante, & qui augmente la chaleur
du corps au-delà de celle de l’état naturel. Nous
difons que dans lafievre l’accélération du mouvement
des arteres eft fpafmodique, pour la diftinguer de là
fimple accélération du pouls & de l’augmentation dé
chaleur excitées par des mouvemens véhémens du
corps, qui s’exercent volontairement & fans altérer
la fanté.
Symptômes de la fievre. Les vrais fymptomes ou les
dépendances effentielles & inféparables dans toute
fievre dont le méchanifme s’exerce librement, font i°.
l’accélération de la vîteffe du pouls ; 20. celle de la
force du pouls; 30. le furcroît de chaleur; 40. l’augmentation
du volume du pouls; 5°* la-refpiration
plus prompte; 6°. le fentiment pénible de lafiitude
qui s’oppofe aux mouvemens du corps.
Les trois premiers fymptomes peuvent être regardés
comme les fymptomes primitifs de la fievre, def-
quels les trois autres réfultent ; & quant au fentiment
pénible de lafiitude, il n’eft fenfibîe qu’aux malades
même, le médecin ne le connoît que par leur récit.
Ajoutons que quoiqu’il n’y ait point de fievre dans
lefquelles ces fix fymptomes ne fe rencontrent, cependant
la vîteffe du pouls eft la feule chofe qu’on
obferve en tout tems de la fievre, depuis le commencement
jufqu’à la fin. Si le contraire arrive, c’ejft que
la fievre n’eft pas fimple, & qu’elle eft troublée par
d’autres affeftions étrangères, qui s’oppofent à fes
opérations falut aires.
Je n’ofe mettre le friffon au rang des fymptomes
inféparables de la fievre, parce que cette maladie peut
s’allumer & fubfifter indépendamment d’aucun friffon,
fans qu’elle foit alors une maladie incomplète.
Il eft bien vrai que la fievre exifte avec le friffon, &
qu’elle naît pour ainfi dire avec lu i, mais c’eft qu’a-
lors la fievre n’a pas encore acquis fon état parfait ,
puifqu’eile eft au contraire empêchée par une autre
affeélion fpafmodique toute oppofée, cjui fubfifte jufqu’à
ce qu’elle l’ait dominée & diflipee.
Cours de la fievre. Quoiqu’il en foit, voici le .cours
de prefque toute fievre qui procédé des caufes internes.
Elle . commence d’abord par un fentiment de
froid & d’horripilation, lequel eft plus grand ou plus
petite a plus ou moins de durée , eft interne ou externe,
félon les divers fujets, les différentes caufes &
la différente nature de la fievre. Alors le pouls devient
fréquent,petit, quelquefois intermittent; la pâleur,
la rigidité, le tremblement, le froid , l’infenfibilité
faififfent fouvent les extrémités ; ‘ ph voit fuccéder
enfuite une,chaleur pliis ou moins grande, qui dure
peu ou beaucoup de tems, interne, externe, univerfelle,
locale, &c. enfin dans lesfievres intermittentes,'
èes, fymptomes fe calment àc fe terminent par une
parfaite apyrexie.
• Affections, morbifiques accidentelles a la fievre. Plufieurs
médecins ont entièrement défiguré le cara&ere
effentiel & individuel de la fievre, en y joignant di-
yerfes‘ affefrions morbifiques qui fe trouvent quelquefois,
mais non toujours, avec la fievre, Sc qui par
çonféquent ne conftituent point foneffencé. Les af-
feûipns morbifiques dont je veux parler, font les contrarions
, la foibleffe, les irrégularités du pouls, les
angoiffes, la débilité, les agitations du^corps, fés
douleurs vagues, la grande douleur de tete, le déliré
, la;fueur, l’affoupiffement, l’infomnie, le vertige,
la furdité, lés yeux fixes ou hagards, le vomiffement,
le hoquet, les convulfions, la tenfion du ventre, des
hypochondres, l’opprefliori, les exanthèmes , les
aphthes,'la fp if, le dégoût, les rots , le froid, le
tremblement,,l’ardeur, la féchereffe, la couleur pâle
& plombée de la peau, les mauvaises qualités des
urines, leur fuppreflion , le diabètes , les fueurs immodérées
,1a diarrhée, les hémorrhagies, &c.
Mais quelque nombreufes, foibles ou confidéra-
bles que foient ces affefrions morbifiques, elles ne
naiffent point de la fievre ; elles font produites par
différentes caufes, qui font même oppofées au méchanifme
de la fievre; par çonféquent on doit les regarder
comme des fymptomes etrangers à cette maladie.
Les médecins qui ont voulu les établir comme
des lignes pathognomiques de la fievre, n’ont fait
qu’introduire une multitude d’erreurs pernicieufes
dans la pratique de la Medecine.
Caufes de La fievre. La caufe prochaine de la fievre
reconnoît elle-même une infinité d’autres caufes immédiates
, qu’on peut néanmoins divifer en caufes
particulières à chaque cas, & en caufes communes
à plufieurs. Les dernieres dépendent ordinairement
de l’ air , des alimens, d’un genre de vie commun ,
& on les nomme caufes épidémiques.
Les caufes particulières peuvent fe réduire à neuf
ou dix claffes capitales; i° . aux mixtes fenfibles qui
renferment naturellement des hétérogènes qui nous
font pernicieux ; je rapporte à cette claffe les remedes
afrifs employés à contre tems ou à trop grande dofe,
car ils peuvent exciter ou augmenter la fievre, & produire
d’autres accidens plus fâcheux ; ce font même
de véritables poifons entre les mains des médecins
qui fuivent de fauffes routes dans la cure des maladies.
H H J
2°. Aux matières acres prifes en aliment, en boif-
fons, en telle abondance qu’elles irritent, fuffoquent,
obftruent & fe corrompent. Nos alimens font même
expofés à être dépravés, lorfqu’ils font reçûs dans
l’eftomac & dans les inteftins.
30. A l’application extérieure de matières acres
qui piquent,corrodent,déchirent, brûlent, enflamment.
4°. Aux mauvaifes qualités de l’aîr Par ^on 'n^ Q?r
tion, fon intempérie, fa pefanteur, fa legerete , fes
variations fubitesy firc. • . ,
<° Aux vices de régime > comme lorit 1 intempérance
dans l’ufage des alimens, les grandes abftinen-
ces -les exercices outrés, la vie trop fedentaire, le
déreglement des pallions, l’incontinence, les Veilles
immodérées , l’application exeeflive de l’efprit,. &c,.
Le tempérament ou la complexiondu corps peu ca^
pable.de foûtenir les/ixcès, occafionne aufli la fievre,».
6®. A la contagion , qui dans certain cas produit
par le contaél, la refpiration & les exhalaifons, des
fièvres putrides, rougeoliques, feorbutiques,; heéti-
ques, dyffentériques, d’cy;! oiEr, ' . „• înioq ' f ^ ' :
y©-. Aux défauts des excrétions & des fecretions,.
go. A lq fuppreflion lente ou fubite des excrétions
ou évacuations accoutumées, par quelque.caufe que
ce foit*...................... . t - f ;
o°. Aux maladies qui font elles-memes des cailles
de‘.maladies. Ainfi les inflammations des parties ner-
veufes procurent la,fievre. . . .
Enfin toutes les caufes qui produifenten nous quelque
léfion, & les léfions elles-mêmes,peuvent produire
la fievre-, mais la puiffance de l’art ne s’étend pas
jufqu’âux hétérogènes , fébriles, lorfqu’ils font confondus
avec nos humeurs ; la nature feule a le pouvoir
de les dompter dansle$_^evréicontinues ; la Médecine
n’eft capable que de remédier quelquefois.aux
dérangemens ou auxobftâcles qui s’oppofent à la de-
fenfe dela nature, & qui peuvent lafaire fuçcomber.
Effets généraux de la fieyre. L’expulfion, la pro-
pulfionplus prompte des liqueurs, ^agitation des humeurs
qui font en ftagnation, le mélange, la confu-
fion de toutes enfemble,. la. téfiftance^ vaincue, la
coftion , la fecrétion de l’humeur digérée, la crife de
la matière qui en irritant & èn coagulant, avoit produit
là fievre, le changement des humeurs; faines, en
une nature propre à fupporter ce à quoi le malade
étoit le moins accoûtumé, l’ expreffion du pus liquide
l’épaifliffement du refte, la fo îf, la chaleur, la
douleur, l’anxiété, la foibleffe, un fentiment de laf-
fitude, de pefanteur, l’anorexie, font les effets de la
fievre» 1 . • > .
Périodes de lu fievre. On en diftmgue quatre périodes
: fon commencement, fon augmentation, fon e-
tat & fon déclin ; mais comme ce font des.chofes fort
connues, paffons aux différentes maniérés dont la
fievre fe termine. .
Terminaifon de là fievre.l»a fievre fe termine de trois
maniérés , différentes ; ou elle caufe la mort, ou elle
dégénère en une autre m aladie, ou elle fe guérit.
La fievre caufe la mort, lorfque les folides fe dé-
truifent par la violence qu’ils fouffrent, ou lorfque
le fan® eft tellement vicié , qu’il bouche les vaiffeaux
vitaux , ou ceux qui doivent porter de quoi
réparer la déperdition. C ’eft ainfi que la fievre produit
dans les vifeerès nobles, tels que le coeur ,
le poumon & le cervelet, l’inflammation, la fuppu-
ration, la gangrené, ou des aphtes dans les premie-
^EAfé dégénéré en une autre maladie , quand elle
caufe une°fi grande agitation, que les vaiflèaux en
font endommagés , èt qu’à force de dilfiper les parties
les plus fluides des humeurs, elle epaiflit le refte;
ou quand elle n’a pas la force de réfoudre par elle-
même la matière coagulée ; ou lorfqu elle depoie la
matière critique dans certains vaiffeaux obftrues ,
dilatés ou rompus. De-ià des taches rouges , des
pullules, des phlegmons , des bubons , là parotide
, la fuppuration, la gangrené , le fphacele, ù-c.
La fievre fe guérit, 1®. toutes les fois qu elle peut
d’elle- même dompter fa caufe materielle ,1a rendre
mobile, & l ’expulfer par les voies de l’infenfible
tranfpiration ; il faut en même tems que fon mouvement
fé calme, & que la circulation fe rétabliffe
dans toute fa liberté : 2Q. lorfque la matière morbifique
, domptée & devenue mobile , n’eft pas parfaitement
faine , de .forte qu’elle empêche l’égale
diftributipn des fluides , & irrite les vaiffeaux , ce
qui occafionne quelqu’évacuation fenfibîe, avec laquelle
cette matière eft expulfée hors du corps ;
comme par des fueurs , des crachats , des vomiffe-
mens , des diarrhéés , & des urines qui furviennent
après la coftion : 30. la matière de la maladie domptée
,.réfolue , devenue mobile par l’a&ion de la fievre-
même ; aflimilée de nouveau aux humeurs faines ,
circule avec elles fans produire aucune crife, ni d’autres
maux;
Pour bien connoître la terminaifon des fièvres ;
il faut obferver leur nature, leur commencement ,6c
leur progrès;
Prognofiics. Plus une fievre s*écàf te de fon tours ordinaire,
& moins le préfage devient favorable : d’un
autre coté,moins il faut dé tems pour réfoudre la lenteur
, & pour calmer l’irritation de l’ accélération du
pouls, plus lafievre eft doiice & falutaire, & réciproquement
au contraire.Toutefievre qui a été mal gouvernée
, devient plus opiniâtre & plus difficile à
guérir, que fi elle eût été abandonnée à elle-même»
Le jmalade dont la fievre fe diffipe naturellement, ai-,
fémènt fie fans remede , jéiiit pour lors d’une meil-,
leure fanté qu’auparayant;
On tire aufli diffërens préfàges de toutes les af-
fe&ions morbifiques qui peuvent accompagner la
fievre ; par exemple , du fpafme & de fes efpeces ;
du .coma, du délire , de la proftration des forces ,
de la déglutition , de la refjpiration, de l’état du bas-
ventre , des hypochondres , des laffitudes, des angoiffes,
de la chaleur, du froid, des tremblemens, des
urines ,.du vomiffement, du flux de ventre, des dé-,
jestions fanguines & putrides , des fueurs , des puf-
tules inflammatoires, des douleurs locales, des aphthes
, &c. mais nous n’entrerons point dans ce détail
qui eft immenfe , & qui a été fàvamment ex-
ppfé par M. Quefnay ; le leéleur peut y avoir recours.
,
Cure. Pour parvenir à la meilleure méthode de
traiter toutes les fievres, & à leur cure générale,
i° . il faut pourvoir à la vie & aux forces du malade
; 2°. corriger & expulfer l’acrimonie irritante t
3e . diffoudre la lenteur & l’évacuer: 49. calmer les
fymptomes^
Ôn ménage ia v ie & le s forces du malade par des
alimens & des boiffons fluides, aifésà digérer, qui
réfiftent à la putréfaûion, & qui fout oppofés à la
caufe connue de la fievre : on donne ces alimens dans
le tems & la quantité néceffaire ; ce qu’on réglé fur
l’âge du malade, foii habitude, le climat qu’il habite,
l’état & la véhémence du mal.
On corrige l’acrimonie irritante par les remedes
Oppofés à cette acrimonie ; on l’expulfe par les v o mitifs
, les purgatifs , ou de Amples laxatifs. Si le
corps irritant qui donne lafievre étoit étranger, on
l’ôtera promptement, & on fomentera la partie lé-
fée par des matières mucilagineufes, douces , ano-
dynes, un peu apéritives.
On diffout la lenteur par divers remedes, dont le
principal eft la fievre meme , modérée , de façon à
pouvoir difliper la vifcôfité. On y parvient aufli en
diminuant le volume dufang parla faignee , ou en
augmentant fon mouvement par des irritans. Enfin
l’on rend aux matières vifqueufes leur fluidité par
les diluans, les fels , les fondans & lés friilions.
Quand on a détruit la caufe fébrile, les fymptomes
ou accidens qui accompagnent la fievre ceffent
avec elle ; s’ils peuvent fubfifter avec la fievre fans
danger, ils demandent à peine uné cure particulière.
Quand ils viennent des efforts de la nature