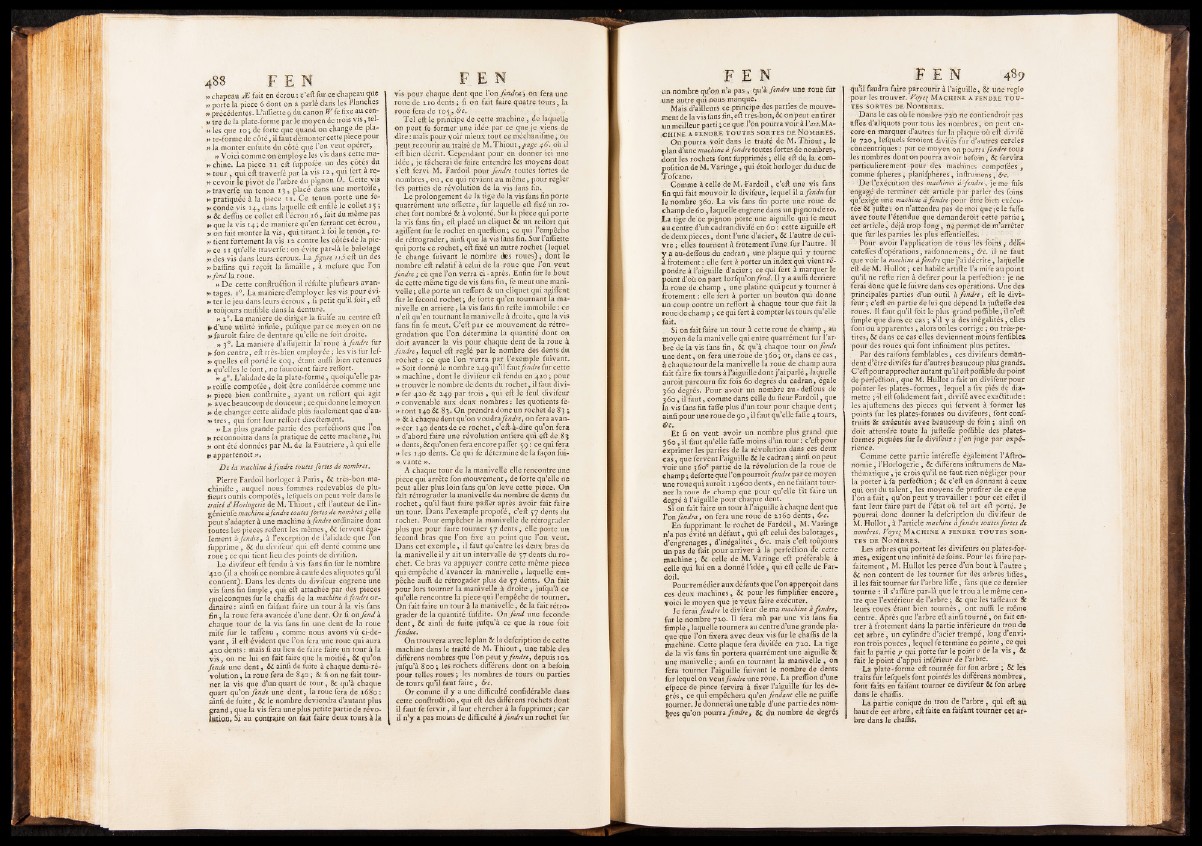
» chapeau Æ fait en écrou : c’eft fur ce chapeau que
» porte la piece 6 dont on a parlé dans les Planches
» précédentes. L’afliette 9 du canon W fe fixe au cén-
» tre de la plate-forme par le moyen de trois v is, tel-
» les que 10 ; de forte que quand on change de pla-
» te-forme de côté, il faut démonter cette piece pour
f> la monter enfuite du côté que l’on veut operer,
» Voici comme on employé, les vis dans cette ma-
t> chine. La piece 11 eft iùppoiee un de? potes du
» tour , qui eft traverfé par la vis 12 , qui fert à re-
» cevoir le pivot de l’arbre du pignon O. Cette vis
»traverfe un tenon 13 , placé dans une mortoue,
w pratiquée à la piece 1 1. Ce tenon porte une fe-
» çonde.vis 14, dans laquelle eft enfilé le collet 15 ;
» ôc deffiis ce collet eft l’écrou. 16 ,.fait du meme pas
*> que la vis 14; de maniéré qu’en ferrant cet ecrou,
on fait monter la v is , qui tirant à foi je tenon, re-
» tient fortement la vis 12 contre les côtés dè la pie-
» ce 11 qu’elle traverfe : on évite par-là le balotage
» des vis dans leurs écroux. La figure //3 eft un des
» ballins qui reçoit la limaille , à mefure que 1 on
»fend la roue.
» De cette conftruCtion il réfulte plufieurs avan-
» tages. i° . La maniéré d’employer les vis pour évi-
» ter le jeu dans leurs écroux , fi petit qu’il foit, eft
*> toujours nuifible dans la denture.
» z°< La maniéré de diriger la fraife au centre eft
b d’une utilité infinie, puil'que par ce moyen on ne
» fauroit faire de denture qu’elle ne foit droite.
» 30. La maniéré d’affujettir la roue à fendre fur
» fon centre, eft très-bien employée ; les vis fur lef-
» quelles eft porté le coq, étant aufli bien retenues
» qu’elles le font, ne fauroient faire reflort.
» 40. L’alidade de la plate-forme, quoiqu’elle pa-
» roiffe compofée, doit être confidéree comme une
» piece bien conftruite, ayant un reflort qui agit
» avec beaucoup de douceur ; ce qui donne le moyen
» de changer cette alidade plus facilement que d’au-
» très, qui font leur reflort directement.
» La plus grande partie des perfections que l’on
» réconnoîtra dans la pratique de cette machine, lui
» ont été données par M. de la Fautriere, à qui elle
t» âppartenoit ».
De la machine à fendre foutes fortes de nombres.
Pierre Fardoil horloger à Paris, & très-bon ma-
■ chinifte, auquel nous fommes redevables de plufieurs
outils compofés, lefquels on peut voir dans le
traité £ Horlogerie de M. Thiout, eft l’auteur de l’in-
génieufe machine à fendre toutes fortes de nombres ; elle
peut s’adapter à une machine à fendre ordinaire dont
toutes les-pièces relient les mêmes, & fervent également
à fendre, à l’exception de l’alidade que l’on
fupprime, & du divifeur qui eft denté comme une
roue ; ce qui tient lieu des points de divifion.
Le divifeur eft fendu à vis fans fin fur le nombre
410 (il a choifi ce nombre à caufe des aliquotes qu’il
contient). Dans les dents du divifeur engrene une
vis fans fin fimple , qui eft attachée par des pièces
quelconques fur le chaflis de la machine à fendre ordinaire
: ainfi en faifant faire un tour à la vis fans
fin, la roue fêta avancée d’une dent. Or fi on fend à
chaque tour de la vis fans fin une dent de la roue
mife fur le taffeau , comme nous avons vû ci-devant
, il eft évident que l’on fera une roue qui aura
410 dents : mais fi au lieu de faire faire un tour à la
v i s , on ne lui en fait faire que la moitié, & qu’on
fende une dent, & ainfi de fuite à chaque demi-révolution
, la roue fera de 840 ; & fi on ne fait tourner
la vis que d’un quart de tour, & qu’à chaque
quart qu’on fende une dent, la roue fera de 1680:
ainfi de fuite, & le nombre deviendra d’autant plus
grand, que la vis fera une plus petite partie de révolution,
Si au contraire on fait faire deux tours à la
vis pour chaque dent que l’on fendra | on fera une
roue de 210 dents ; fi oh fait faire quatre tours, la
roue fera de 105,6’c.
Tel eft le principe d,e cette machine^ tie laquelle
on peut fe former une idée par ce que.je viens de
dire : mais pour voir mieux tout ce méch&nifme ;.on
peut recourir au traité de M. Thiout, page 46. où il
eft bien décrit. Cependant pour en donner ici une
idée, je tâcherai de faire entendre les moyens dont
s’eft.fervi M. Fardoil pour fendre toutes fortes de
nombres, o u , ce qui revient.au même, pour regler
ie's parties de révolution de la. vis fans fin.
Le prolongement de la tige de la vis fans fin porte
quarrément urie afliette, für laquelle eft fixé un ro-
çhet fort nombré & à volonté. Sur la piece qui porte
la vis fâns fin, eft placé un cliquet & un reflort qui
agiflent fur le rochet en queftion; ce qu.i l'empêche
de rétrograder, ainfi que la vis fans fin. Sur l’afliette
qui porte ce rochet,.eft fixé un autre rochet (lequel
fe change fuivant le nombre ctes roues) , dont le
nombre eft relatif à celui de la-roue que l’on veut
fendre ; ce que l’on verra ci - après. Enfin fur le bout
de cette même tige de vis fans fin, fe meut une manivelle
; elle porte ùn reflort & un cliquet qui agiflent
fur le fécond rochet ; de forte qu’en tournant la manivelle
en arriéré, la vis fans fin refte immobile : ce
n’eft qu’en tournant là manivelle à droite -, que la vis
fans fin fe meut, C ’eft par ce mouvement de rétrogradation
que l’on détermine la quantité dont on
doit avancer la vis pour chaque dent de la roue à
fendre, lequel eft réglé par le nombre des dents du
rochet : ce que l’on verra par l’exemple fuivant.
» Soit donné le nombre 249 qu’il fautfendre fur cette
» machine, dont le divifeur eft fendu en 420 ; pour
» trouver le nombre de dents du rochet, il faut divi-
» fer 420 & 249 par trois , qui eft le feul divifeur
» convenable aux deux nombres : les quotients fe-
» ront 140& 83. On prendra donc un rochet de 83 ;
» & à chaque dent qu’on voudra fendre, on fera avan-
»•cer 140 dents de ce rochet, c’eft-à-dire qu’on fera
» d’abord faire une révolution entière qui eft de 85
» dents, & qu’on en fera encore pafler 59 : ce qui fera
» les 140 dents. Ce qui fe détermine de la façon fui-
», vante ».
A chaque tour de la manivelle elle rencontre une
piece qui arrête fon mouvément, de forte qu’elle ne
peut aller plus loin fans qu’on leve cette piece. On
fait rétrograder la manivelle du nombre de dents du
rochet, qu’il faut faire pafler après avoir fait faire
un tour. Dans l’exemple propofé, c’eft 57 dents du
rochet. Pour empêcher la manivelle de rétrograder
plus que pour faire tourner 57 dents , elle porte un
fécond bras que l’on fixe au point que l’on veut.
Dans cet exemple, il faut qu’entre les deux bras de
la manivelle il y ait un intervalle de 57 dents du rochet.
Ce bras va appuyer contre cette même piece
qui empêche d’avancer la manivelle, laquelle empêche
aufli de rétrogader plus de 57 dents. On fait
pour lors tourner la manivelle à droite > jufqu’à ce
qu’elle rencontre là piece qui l’empêche de tourner.
On fait faire un tour à la manivelle, & la fait rétrograder
de la quantité fufdite. On fend une fécondé-
dent, & ainfi de fuite jufqu’à ce que la roue foit
fendue.
On trouvera avec le plan & la defeription de cette
machine dans le traité de M. Thiou t, une table des
différens nombres que l’on peut y fendre, depuis 102
jufqu’à 800; les rôchets différens dont on a befoin
pour telles roues ; les nombres de tours ou parties
de tours qu’il faut faire, &c.
Or comme il y a une difficulté confidérable dans
cette conftruCtion, qui eft des différens rochets dont
il faut fe fervir, il faut chercher à la fupprimer; car
il n’y a pas moins de difficulté i fendre un rochet fur
un nombre qlfon. n’a p a s q u ’à fendre une roué für
une autre qui jipus manque.
Mais d’ailleürS ce principe des parties, de mouvement
de la vis fans fin, eft très-bon, & on peut en tirer
un meilleur.parti i ce que l’pn pourra yoir.à IW .M a-
-CHINE A FENDRE TOUTES SORTES DE NOMBRES.
On pourra ÿo.îr dans le traité de M. Thiout, le
plan d’une machine à fendre toutes fortes de.nombres>
dont les rochets foht.fupprimés ; elle eftd^la com-
pofition de M. Varinge, qui étoit horloger du duc de
Tofcane.
Comme à celle de M.-Fardoil, e’eft une vis fans
fin qui fait mouvoir, le divifeur, lequel il a fendu fur
le nombre 360. La vis fans fin porte une roue de
champ de 60 , laquelle engrene dans un pignon dè 10.
La tige de’ce pignon pôrte Une aiguille qui fe meut
au centre d’un cadran.dïvifé eh 60 : cette aiguille eft
de deux pièces, dont l’une d’acier, & l ’autre de cuivré
; elles tournent à frôlement l’une fur l ’autre. Il
y a au-deffous du cadran, une plaque qui y tourne
à frotement : elle fert à porter un index qui vient répondre
à l’aiguille d’acier ; ce qui fert à marquer le
point d’où on part lorfqù’on^«^. Il y a aufli derrière
la roue de champ , une platine qui peut y tourner à
frotement : elle fert à. porter un bouton qui donne
un coup contre un reflort à chaque tour que fait la
roue de champ ; ce qui fert à compter lés tours qu’elle
fait.
Si on fait faire un tour à cette roue de champ, au
moyen de la manivelle qui entre quarrément fur l’arbre
de la vis fans fin, & qu’à chaque tour On fende
une dent, on fera une robe de 3 66 ; or, dans ce cas,
à chaque tour de la manivelle la roue de champ aura
fait faire fix tours à l’aiguille dont j’ai parlé, laquelle
auroit parcouru fix fois 60 degrés du cadran, égalé
360 degrés. Pour avoir un nombre au-deflous de
360, il faut, comme dans celle du fieur Fardoil, que
la vis fans fin faffe plus d’un tour pour chaque dent ;
ainfi pour une roue de 90, il faut qu’elle faffe 4 tours,
&c.E
t fi on veut avoir un nombre plus grand que
360, il faut qu’elle faffe moins d’un tour ; c ’eft pour
exprimer les parties de la révolution dans ces deux
ca s , que fervent l’aiguille & le cadran ; ainfi on peut
voir une 360e partie de la révolution de la roue de
champ ; deforte que l’on pourroit fendre par ce moyen
une roue qui auroit 129600 dents, en ne faifant tourner
la roue de champ que pour qu’elle fît faire un
degré à l’aiguille pour chaque dent.
-Si on fait faire un tour à l’aiguille à chaque dent que
l’on fendra, on fera une roue de 2160 dents, &c.
En fupprimant le rochet de Fardoil, M. Varinge
n’a pas évité un défaut, qui eft celui des balotages,
d’engrenages , d’inégalités, &c. mais c’eft toujours
Un pas de fait pour arriver à la perfection de cette
machine; & celle de M. Varinge eft préférable à
celle qui lui en a donné l ’idée, qui eft celle de Fardoil.
Pourremédier aux défauts que l’on apperçoit dans
Ces deux machines, & pour les Amplifier encore,
yoici le moyen que je veux faire exécuter. ^
Je ferai fendre le divifeur de ma machine à fendre,
fur le nombre 720. Il fera mû par une vis fans fin
fimple, laquelle tournera au centre d’une grande plaque
qùe l’on fixera avec deux viseur le chaflis de la
machine. Cette plaque fera divifée en 720. La tige
de la vis fans fin portera quarrément une aiguille &
une manivelle ; ainfi en tournant la manivelle , on
fera tourner l’aiguille fuivant le nombre de dents
fur lequel on veut fendre une roue. La preflion d’une
éfpece de pince fervira à fixer l’aiguille fur les degrés
, ce qui empêchera qu’en fendant elle ne puiffe
tourner. Je donnerai une table d’une partie des nombres
qu’on pourra fendre, de du nombre de degrés
q u i l fa u d r a fa i r e p a r c o u r i r à l ’a i g u i l le , & Une r é g lé
p o u r lè s t r o u v e r . V cÿe^ M a c i î i n e à T e n d r e t o u t
e s s o r t e s d e N o m b r e s .
Dans le cas où lé nombre 72O rte Contiendroit pâs
affez d’aliquots pour tous les nombres , ôn peut encore
en marquer d’autres fur la plaque où eft divifé
le 720, lefquels feroient divifés fur d’autres cercles
cbncentriques : par eè moyeu onpoiirra fen d re tous
-les nombres dont on pourra avoir befoin, & fervira
particulièrement ppür des machines compofées ,
comme fpherés, planifpheres, inftrumens, 5*e.
D ë T e x é c u t io n 'âéS- 'machih'es 'à-fendre , '^ me fu is
e n g a g é d e te rm in e r c ô t a r t ic le pàr; p a r le r des fo in s
q u ’e x ig e u h e m ach in ea fendre p o u r ê t r e b ie n e x é cu t
é e '& - ju fté : o n n’ a t ten d r a p a s d e m o i q u e je le fa ffe
a v e c fo u t e l ’é te n d u e q u e d em ah d ë fô v t c è t tê p a r tie ;
c ë t âTti’c l ë , ' d é jà t ro p l o n g , n e p e r h ie td e m ’a r r ê te r
q u e fu r lé s p a r t ie s le s p lu s e f fe n t iè llè s .
Pour avoir Fapplic-atiofi dë tduà 'lës-ioihs, déli»'
xateffes d’opérations, raifonnemens, &e. i l ne faut
que voir la machine à fendre que j’ai décritè, laquelle
elbdeM. Hullot; cet habile àrtifte l’a mife au point
qu’ il ne refte rien à defiref pour la perfection : je ne
ferai donc que le fuivre dans ces opérations. Une des
principales parties d’un outil à fe n d re , eft le divifeur
; c’eft en partie de lui que dépend la jufteffe des
roues, Il faut qu’il foit le plus grandpoflible , il n’eft
fimple que dans ce cas ; s’il y a des inégalités, elles
font ou apparentes , alors on les corrige ; ou très-petites,
& dans ce cas elles deviennent moins fenfibies
pôur des roues qui font infiniment plus petites.
Par des raifons femblables, ces divifeurs demandent
d’être divifés fur d’autres beaucoup plus grands.
G’eft pour approcher autant qü’il eft poflible dupoint
de perfection , que M. Hullot a fait un divifeur pour
pointer les plates-formes, lequel a fix pies de diamètre
;-il eft folidement fait, divifé avec exactitude :
les ajuftemens des pièces qui fervent à former les
points fur les plates-formes ou divifeurs, font conf*
truits & exécutés avec beaucoup de foin ; ainfi on
doit attendre toute la jufteffe poflible des plates-
formes piquées fur le divifeur : j ’en jugé par expérience.
Gomme cette partie intéreffe également l’Aftro-;
nomie, l’Horlogerie , & différens inftrumens de Mathématique
, je crois qu’ il ne faut rien négliger pour
la porter à fa perfection ; & c’eft en donnant à ceux
qui ont du talent, les moyens de profiter de ce que
l’on a fait, qu’on peut y travailler : pôur cet effet il
faut leur faire part de l’état où tel art eft porté. Je
pourrai donc donner la defeription du divifeur de
M. H ullot, à l’articl t machine a fendre ioutês fortes de
nombres. Tfoye^ MACHINE A FENDRE TOUTES SORTES
de N ombres.
Les arbres qui portent les divifeurs ou plates-formes,
exigent une infinité de foins. Pour les faire parfaitement
, M. Hullot les perce d’un bout à l’autre ;
6c non content de les tourner fur des arbres.liffes,
il les fait tourner fur l’arbre liffe, fans que ce dernier
tourne : il s’affûre par-là que letrôu.a le même centre
que l’extérieur de l’arbre ; & que les tàffeaux &
leurs roues étant bien tournés , ont aufli le même
centre. Après que l’arbre eft ainfi tourné, on fait entrer
à frotement dans la partie inférieure du trpu de
cet arbre , un cylindre d’acier trempé, long d’environ
trôis pouces, lequel fe termine en pointe, ce qui
fait la partie p qui porte fur le point 0 de la v is , Sc
fait le point d’appui inférieur de l’arbre.
La plate-forme eft tournée fur fon arbre ; & les
traits fur lefquels font pointés les différens nombres,
font faits en faifant tourner ce divifeur & fon arbre
dans le chaflis. .
La partie conique du trou de l’arbre, qui eft au
haut de cet arbre, eft faite en faifant tourner cet arbre
dans le chaflis.