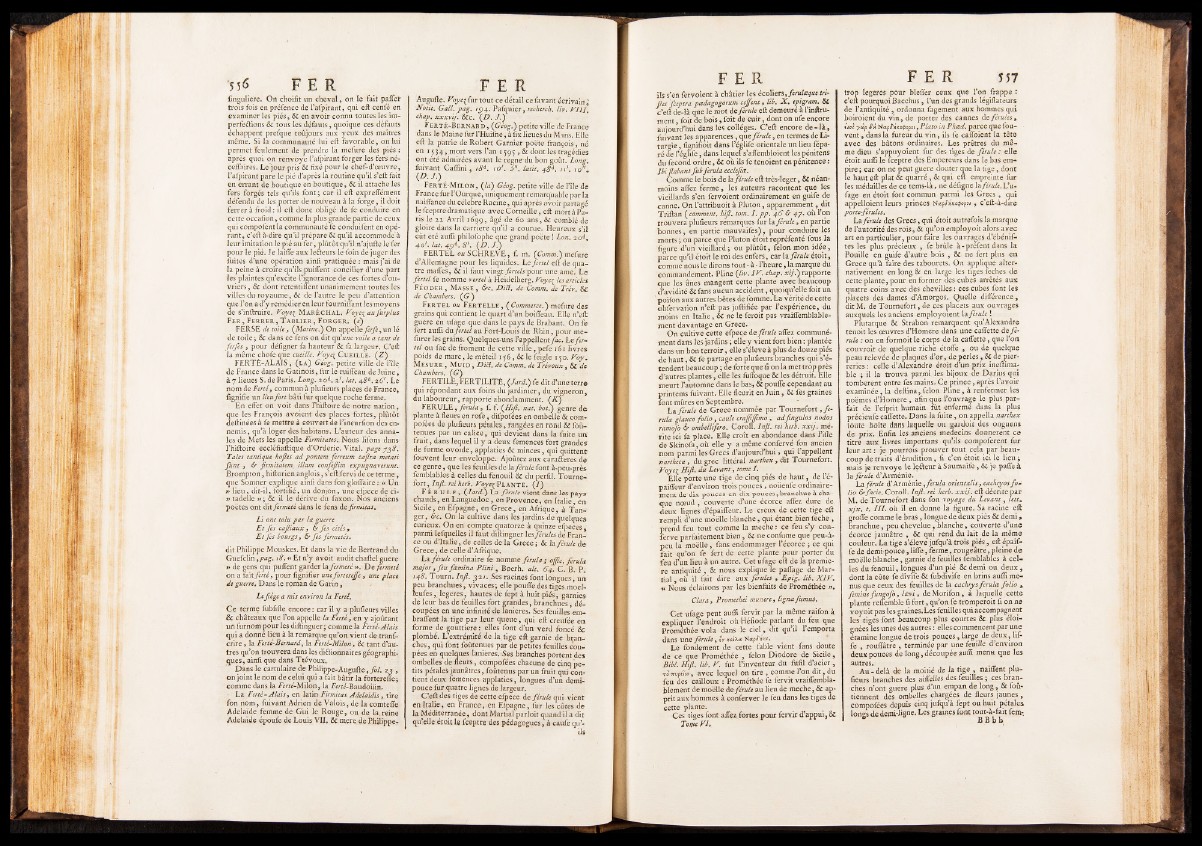
finguliere. On choifit un cheval, on le fait palTef
trois fois en préfence de l’afpirant, qui eft cenfé en
examiner les pies, en avoir connu toutes les imperfections
& tous les défauts, quoique ces défauts
échappent prefque toujours aux yeux des maîtres
même. Si la communauté lui eft favorable, on lui
permet feulement de prendre la mefure des piés :
après quoi on renvoyé l’afpirant forger les fers né-
ceffaires. Le jour pris & fixé pour le chef-d’oeuvre,
l’afpirant pare le pié d’après la routine qu’il s’eft fait
en errant de boutique en boutique, & il attache les
fers forgés tels qu’ils font; car il eft expreffément
défendu de les porter de nouveau à la forge, il doit
ferrer à froid : il eft donc obligé de fe conduire en
cette occafion, comme laplus grande partie de ceux
qui compofent la communauté fe conduifent en opérant,
c’eft à-dire qu’il prépare & qu’il accommode'à
leur imitation le pié au fer, plutôt qu’il n’ajufte le fer
pour le pié. Je laiffe aux lefteurs le foin de juger des
fuites d’une opération ainfi pratiquée : mais j’ai de
la peine à croire qu’ils puiffent concilier d’une part
les plaintes qu’excite l’ignorance de ces fortes d’ouvriers
, & dont retentiffent unanimement toutes les
villes du royaume, & de l’autre le peu d’attention
que l’on a d’y remédier en leur fourniffant les moyens
de s’inftruire. V o y e { Ma r é ch a l . Voye^ au fur plus
Fe r , Ferr er, T a b l ie r , Forger, (e)
FERSE de toile , (Marine.') On appelle ferfe, un lé
de toile ; & dans ce fens on dit qu"‘une voile a tant de
ferfes, pour défigner fa hauteur & fa largeur. C ’eft
la même chofeque cueille. Voye^ C ueille. (Z )
FERTÉ-ALAIS, (la) Géog. petite ville de l’île
de France dans le Gatinois, fur le ruiffeau de Juine,
à 7 lieues S. de Paris. Long. 2od. 2!. lat. 48*. 261’. Le
nom de Ferté, commun à plufieurs places de France,
lignifie un lieu fort bâti fur quelque roche ferme.
En effet on voit dans l’hiftoire de notre nation,
que les François avoient des places fortes, plutôt
deftinées à fe mettre à couvert de l’incurfion des ennemis,
qu’à loger des habitans. L’auteur des annales
de Mets les appelle Firmitates., Nous lifons dans
l’hiftoire eccléfiaftique d’Orderic. Vital, page 738.
Taies tantique hojles ad pontem ferreum cajlra metati
funt-, & frmiiatem. illam confejlim expugnaverunt.
Brompton, hiftorien.anglois, s’eftfervi de ce terme,
que Somner explique ainfi dans fon gloffaire : « Un
» lieu, dit-il, fortifié, un donjon, une efpece de ci-
» tadelle » ; 8c il le dérive du faxon. Nos anciens
poètes ont dit fermeté dans le fens de firmitas.
Li ont tolu par la guerre
E t fes cajliaux y & fes cités ,
E t fes bourgs , & fes fermetés.
dit Philippe Mouskes. Et dans la vie de Bertrand du
Guefclin ,pag. 18. « Et n’y avoit audit chaftel guere
»> de gens qui puffent garder la fermeté ». De fermeté
on a fait ferté, pour lignifier une fortereffe ., une plau
de guerre. Dans le roman de Gàrin,
Le Jiége a mis environ la Ferté.
Ge terme fubfifte encore : car il y a plufieurs villes
& châteaux que l’on appelle la Ferté., en y ajoutant
lin furnom pour les diftinguer ; comme la Ferté- A lais
qui a donne lieu à la remarque qu’on vient de transcrire
, la Ferté-Bernard, la Ferté-Milon, & tant d’autres
qu’on trouvera dans les di&ionnaires géographiques,
ainfi que dans Trévoux.
Dans le cartulaire de Philippe-Augufte, fol. 23 ,
on joint le nom de celui qui a fait bâtir la fortereffe;
comme dans la Ferté-Milon, la FW-Baudomn.
La Ferté-Alais, en latin Firmitas Adelaidis, tire
fon nom, fuivant Adrien de Valois, de la comteffe
Adélaïde femme de Gui le Rouge, ou de la. reine
Adélaïde époufe de Louis VII, & mere de Philippe-
Augufte. Foyei fur tout ce détail ce favartt écrivain,
Notit. G ail. pag. 1^4. Pafquier, recher ch. liy. FU I .
chap. xxxvij. & c . (D . J.)
F e r t é - B e r n a r d , (Géog.) petite ville de France
dans le Maine fur I’Huifne, à fix lieues du Mans. Elle
eft la patrie de Robert Garnier poète françois * né
en 1534, mort vers l’an 1595 , & dont les tragédies
ont été admirées avant le regne*du bon goût. Long.
fuivant Caflini, i8d. io 1. 5". latit. 48d. id . /o".
(Z>. / .) -
F e r t é -M i l o n , (la) Géog. petite ville de l’île d e
France fur l’Ourque, uniquement remarquable par la
naiffance du célébré Racine, qui après avoir partagé
le fceptre dramatique avec Corneille, eft mort à Paris
le i l Avril 1699, âgé de 60 ans, & comblé de
gloire dans la carrière qu’il a courue. Heureux s’il
eût été aufli philofophe que grand poète \ Lon. 2od.
4'oh lat. 4_9d. 8'. (D . J .)
FERTEL okSCHREVE, f. m. (Comm.) mefure
d’Allemagne pour les liquides. Le fertel eft de quatre
maffes, & il faut vingtfertels pour une ame. Le
fertel fe nomme ver tel à Heidelberg. Voye^ les articles
F é o d e r , M a s s e , & c. Dicl. de Comm. de Trév. 8e
de Chambers. (G )
F e r t e l ou F e r t e l l e , (Commerce.) mefure des
grains qui contient le quart d’un boiffeau. Elle n’eft
guere en ufage que dans le pays de Brabant. On fe
fert aufli du fertel au Fort-Louis du Rhin, pour me-
furer les grains. Quelques-uns l’-appellentyâc. Lefer-
tel ou fac de froment de cette v ille , pefe 161 livres
poids de marc, le méteil 156, & le feigle 150. Voy,
M e s u r e , M u i d , Dicl. de Comm. de Trévoux, 8c de
Chambers, (G)
FERTILE, FERTILITÉ, (Tard.) fe dit d’une terr©
qui répondant aux foins du jardinier, du vigneron,
du laboureur, rapporte'abondamment. (K )
FERULE, ferula, f. f. (Hiß. nat. botj) genre de
plante à fleurs en rofe, difpofées en ombelle & com-
pofées de plufieurs pétales, rangées en rond 8c foû-
tenues par un calice, qui devient dans la fuite un
fruit, dans lequel il y a deux femences fort grandes
de forme ovoïde, applaties 8c minces, qui quittent
fouvent leur enveloppe. Ajoûtez aux cara&eres de
ce genre, que les feuilles de la férule font à-peu-près
femblables à celles du fenouil 8c du perfil. Tourne-
fort, Inß. rei herb. Voyeç P l a n t e . (J)
F é r u l e ,- (Jard.) La férule vient dans les pays
chauds, en Languedoc > en P rovence, en Italie en
Sicile, en Efpagne, en Grece, en Afrique, à Tanger,
&c. On la cultive-dans les jardins de quelques
curieux. On en compte quatorze à quinze efpeces
parmi lefquelles il faut diftinguer les férules de France
ou d’Italie, de celles de la Grece ; & h. férule de
Grece, de celle d’Afrique.
La férule ordinaire le nomme ferula ; offic. ferula
major, feu foemina Plini , Boerh. alt. G4. C . B. P.
148. Tourn. Inß. 32/. Ses racines font longues, un
peu branchues, vivaces; elle pouffe des tiges moel-
teufes,; legeres, hautes de fept à huit piés, garnies
de leur bas de feuilles fort grandes, branchues , découpées
en une infinité de lanières. Ses feuilles em-
braffent la tige par leur queue, qui eft creufée en
forme de gouttière : elles font d’un verd foncé 8c
plombé. L’extréjnité de la tige eft garnie de branches,
qui font foiitenues par de petites feuilles coupées
en quelques lanières. Ses branches portent des
ombelles de fleurs, compofées chacune de cinq petits
pétales jaunâtres, foûtenus par un fruit qui contient
deux femences applaties, longues d’un demi-
pouce fur quatre lignes de largeur.
C ’eft des tiges de cette efpece de férule qui vient
en Italie, en France, en Elpagne, fur les.côtes de
la Méditerranée, dont Martial parloit quand il a dit
qu’elle éto.it le fceptre des pédagogues, à caufe qu’-
ils
ils s’en fervoient à châtier les écoliers, ferulaque trilles
feeptra pcedagogorum cejfent, lib. X . epigram. 8c
c’eft de-là que le mot de férule eft demeuré à l’inftru-
ment foit de bois, foit de cuir, dont on ufe encore
aujourd’hui dans les collèges. C’eft encore d e - là ,
fuivant les apparences, que férule, en termes de Liturgie
, fignifioit dans l’églife orientale un lieu fépa-
ré de l’éghfe, dans lequel s’affembloient les pénitens
du fécond o rdre, 8c où ils fe tenoient en pénitence :
lbi Jlabant fub ferula ecclefia.
Comme le bois de la férule eft très-leger, 8c néanmoins
affez ferme, les auteurs racontent que les
vieillards s’en fervoient ordinairement en guife de
canne. On l’attribuoit à Pluton, apparemment, dit
Triftan (comment, hijl. tom. I . pp. 4 6 & 4 j . où l’on
trouvera plufieurs remarques fur la férule, en partie
bonnes, en partie mauvaifes), pour conduire les
morts ; ou parce que Pluton étoit repréfenté fous la
figure d’un vieillard ; ou plutôt, félon mon idée,
parce qu’il étoit le roi des enfers, car la férule étoit,
comme nous le dirons tout - à - l’heure, la marque du
commandement. Pline (liv. I F ■ chap. x ij.) rapporte
que les ânes mangent cette plante avec beaucoup
d’avidité 8c fans aucun accident, quoiqu’elle foit un
poifon aux autres bêtes de fbmme. La vérité de cette
observation n’eft pas juftifiée par l’expérience, du
moins en Italie, & ne le feroit pas vraiffemblable-
ment davantage en Grece.
On cultive cette efpec.e de férule affez communément
dans les jardins ; elle y vient fort bien : plantée
dans un bon terroir, elle s’élève à plus de douze piés
de h aut, & fe partage en plufieurs branches qui s’étendent
beaucoup ; de forte que fi on la met trop près
d ’autres plantes, elle les fuffoque & les détruit. Elle
meurt l’automne dans le bas, & pouffe cependant au
printems fuivant. Elle fleurit en Juin, & fes graines
font mûres en Septembre.
La férule de Grece nommée par Tournefort ,fe -
Tula glauco folio , caule crajjîjjîmo, ad. fingulos nodos
ramofo & ombèllifero. Coroll. Inft. rei herb. xxij. mérite
ici fa place. Elle croît en abondance dans l’ifle
de Skinofa, où elle y a même confervé fon ancien
nom parmi les Grecs d’aujourd’hui, qui 1 appellent
nartheca , du grec littéral narthex , dit Tournefort.
Foyei Hijl. du Levant, tome I.
Elle porte une tige de cinq piés de haut, de l’é-
paiffeur d’environ trois pouces , noiieufe ordinairement
de* dix pouces en dix pouces, branchue à chaque
noeud , couverte d’une écorce affez dure de.
deux lignes d’épaiffeur. Le creux de cette tige eft
rempli d’une moelle blanche, qui étant bien feche ,
prend feu tout comme la meche : ce feu s’y con-
ferve parfaitement bien, & ne confume que peu-à-
peu la moëlle, fans endommager l’écorce ; ce qui
fait qu’on fe fert de cette plante pour porter du
feu d’un lieu à un autre. Cet ufage eft de la première
antiquité , & nous explique le paffage de Martial
, où il fait dire aux ferules , Epig. lib. X IV .
« Nous éclairons par les bienfaits de Prométhée ».
Clara, Prometkei munere, ligna fumus.
Cet ufage peut aufli fervir par la meme raifon à
expliquer l’endroit où Héfiode parlant du feu que
Promethée vola dans le ciel, dit qu’il l’emporta
dans une férule, tv xo/x*
Le fondement de cette fable vient fans doute
de ce que Prométhée , félon Diodore de Sicile,
Bibl. Hijl. lib. V. fut l’inventeur du fufil d’ac ier,
to 7mfuov, avec lequel on tire , comme l’on dit, du
feu des cailloux : Prométhée fe fervit vraisemblablement
de moëlle de férule au lieu de meche, & apprit
aux hommes à conferver le feu dans les tiges de
cette plante. ^ •
Ces tiges font affez fortes pour fervir d’appui, Ôc
Tome V I.
trop legeres pour blefièr ceux que l’on frappe :
c’eft pourquoi Bacchus, l’un des grands légiflateurs
de l’antiquité , ordonna fagement aux hommes qui
boiroient du v in , de porter des cannes dq férules,
t iui •yeip ƒ■ » N«tpJs>|jcoçopo/, P lato in Phced. parce que fou- •
v en t, dans la fureur du v in , ils fe caffoient la tête
avec des bâtons ordinaires. Les prêtres du même
dieu s’appuyoient fur des tiges de férule : elle
étoit aufli le fceptre des Empereurs dans le bas empire
; car on ne peut guere douter que la tige, dont
le haut eft plat &: quarré, & qui eft empreinte fur
les médailles de ce tems-là, ne défigne la férule. L’u-
fage eh étoit fort commun parmi les Grecs , qui
appelloient leurs princes NupS'nKoçopoi, c’eft-à-dire
porte-férules.
La férule des Grecs, qui étoit autrefois la marque
de l’autorité des rois, & qu’on employoit alors avec
art en particulier, pour faire les ouvrages d’ébénif-
tes les plus précieux , fe brûle à-prefent dans la
Pouille en guife d’autre bois , ôc ne fert plus en
Grece qu’à faire des tabourets. On applique alternativement
en long & en large les tiges léchés de
cette plante, pour en former des cubes arrêtés aux
quatre coins avec des chevilles : ces cubes font les
placets des dames d’Amorgos. Quelle différence,
dit M. de Tournefort, de ces placets aux ouvrages
auxquels les anciens employoient la férule !
Plutarque & Strabon remarquent qu’Alexandre
tenoit les oeuvres d’Homere dans une caffette de fé rule
: on en formoit le corps de la caffette, que l’on
couvroit de quelque riche étoffe , ou de quelque
peau relevée de plaques d’o r , de perles, & de pierreries
: celle d’Alexandre étoit d’un prix ineftima-
ble ; il la trouva parmi les bijoux ae Darius qui
tombèrent entre fes mains. C e prince, après l’avoir
examinée, la deftina, félon Pline, à renfermer les
poèmes d’Homere , afin que l’ouvrage le plus parfait
de l’efprit humain fut enferme dans la plus
précieufe caffette. Dans la fuite, on appella narthex
toute boîte dans laquelle on gardoit des onguens
de prix. Enfin les anciens médecins donnèrent ce
titre aux livres importans qu’ils compoferent fur
leur art : je pourrois prouver tout cela par beaucoup
de traits d’érudition, fi c’en étoit ici le lieu ;
mais je renvoyé le lutteur à Saumaife, & je paffe à
la férule d’Arménie.
La férule d’Arménie, ferula orientalis , cachryos fo lio
& fade. Coroll. Injl. rei herb. x x ij. eft décrite par
M. de Tournefort dans fon voyage du Levant, letu
x jx . t. I II. où il en donne la figure. Sa racine eft
groffe comme le bras, longue de deux piés & demi,
branchue, peu chevelue, blanche, couverte d’une
écorce jaunâtre , & qui rend du lait de la même
couleur. La tige s’élève jufqu’à trois piés, eft épaif-
fe de demi-pouce, liffe, ferme, rougeâtre, pleine de
moëlle blanche, garnie de feuilles femblables à celles
du fenouil, longues d’un pié & demi ou deux ,
dont la côte fe divife & fubdivjfe en brins aufli menus
que ceux des feuilles de la cachry s ferula folio ,
femine fungofo, lavi , deMorifon, à laquelle cette
plante reffemble fi fort, qu’on fe tromperoit fi on ne
voyoit pas les graines. Les feuilles qui accompagnent
les tiges font beaucoup plus courtes & plus éloignées
les unes des autres : elles commencent par une
etamine longue de trois pouces, large de deux, liffe
, rouffâtre , terminée par une feuille d’environ
deux pouces de long, découpée aufli menu que les
autres. . .
A u -d e là de la moitié de la tige , naiffent plufieurs
branches des aiffelles des feuilles ; ces branches
n’ont guere plus d’un empan de long, & foû-
tiennent des ombelles chargées de fleurs jaunes,
compofées depuis cinq jufqu’à fept ou huit pétales
longs de demi-ligne* Les graines font tout-à-fait fem-.
1 I R R K K