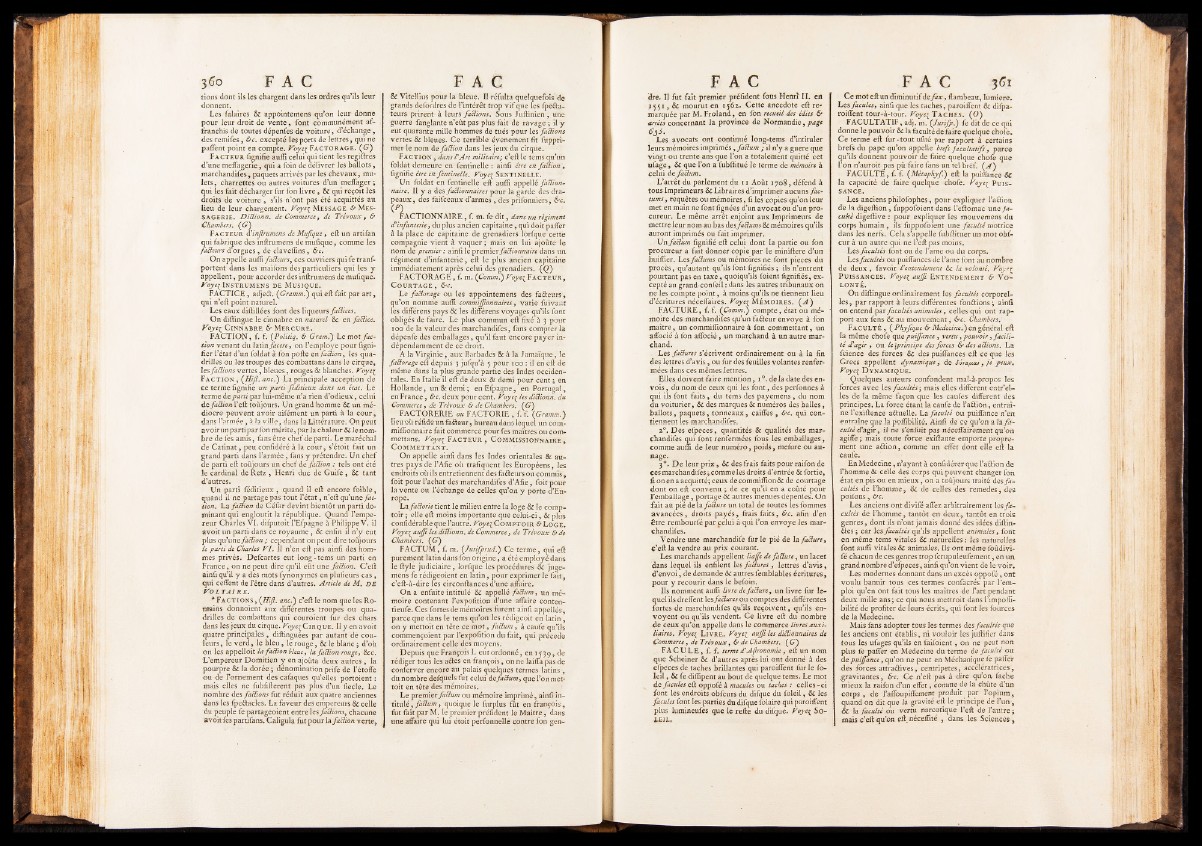
tions dont ils les chargent dans les ordres qu’ils leur
■ donnent.
Les falaires & appointemens qu’on leur donne
pour leur droit de vente, font communément affranchis
de toutes dépenfes de voiture, d’échange,
des remifes, &c. excepté les ports de lettres, qui ne
paffent point en compte. Voye^ Factorage. (G ) Facteur lignifie aufli celui qui tient les regiftres
d ’une meffagerie, qui a foin de délivrer les ballots,
marchandifes, paquets arrivés par les chevaux* mulets
, charrettes ou autres voitures d’un meffager ;
ui les fait décharger fur fon liv re , & qui reçoit les
roits de voiture , s’ils n’ont pas été acquittés au
lieu de leur chargement. Voye^ Message & Messagerie.
Dictionn. de Commerce, de Trévoux, &
'Chambers. (G') Facteur à'infirumens de Mufique , eft un artifan
qui fabrique des inftrumens de mufique* comme les
facteurs d’orgues , de claveflins, &c.
On appelle aufli facteurs, ces ouvriers qui fe tranf-
portent dans les maifons des particuliers qui les y
appellent, pour accorder des inftrumens de mufique.
ÿoye^INSTRUMENS DE MUSIQUE.
F A C T IC E , adjeéh (Gramm.) qui eft fait par art,
qui n’eft point naturel.
Les eaux diftillées font des liqueurs factices.
On diftingue le cinnabre en naturel S>c en factice.
Voyei Cinnabre & Mercure.
FACTION , f. f. (Politiq. & Gram.') Le mot faction
venant du latin facere, on l’employe pour lignifier
l’état d’un foldat à fon pofte en faction, les qua-
drilles ou les troupes des combattans dans le cirque,
les factions vertes, bleues, rouges & blanches. Voye^ Faction, (Hifl.anc.) La principale acception de
ce terme fignifie un parti féditieux dans un état. Le
terme de parti par lui-même n’a rien d’odieux, celui
de faction l’eft toujours. Un grand homme & un médiocre
peuvent avoir aifément un parti à la cour,
dans l’armée, à la ville, dans la Littérature. On peut
avoir un parti par fon mérite, par la chaleur & le nombre
de fes amis, fans être chef de parti. Le maréchal
de Catinat, peu confidéré à la cour, s’étoit fait un
grand parti dans l’armée, fans y prétendre. Un chef
de parti eft toujours un chef de faction : tels ont été
le cardinal de Retz , Henri duc de Guife , & tant
d’autres.
Un parti féditieux, quand il eft encore foible,
quand il ne partage pas tout l’é ta t , n’eft qu’une faction.
La faction de Céfar devint bientôt un parti dominant
qui engloutit la république. Quand l’empereur
Charles VI. difputoit l’Efpagne à Philippe V. il
avoit un parti dans ce royaume, & enfin il n’y eut
plus qu’une faction ; cependant on peut dire toûjours
le parti de Charles VI. Il n’en eft pas ainfi des hommes
privés. Defcartes eut long-tems un parti en
France, on ne peut dire qu’il eût une faction. C’eft
ainfi qu’il y a des mots fynonymes en plufieurs cas ,
qui ceffent de l’être dans d’autres. Article de M. d e
Vo l t a ir e .
* Factions , {Hiß. ancA c’eft le nom que les Romains
donnoient aux differentes troupes ou quadrilles
de combattans qui couroient fur des enars
dans les jeux du cirque. Voye{ Cirque. Il y en avoit
quatre principales , diftinguées par autant dè couleurs,
le verd , le bleu, le rouge, & le blanc ; d’où
on les appelloit la faction bleue, la faction rouge, &c.
L ’empereur Domitien y en ajouta deux autres , la
pourpre & la dorée ; dénomination prife de l’étoffe
ou de l’ornement des cafaques qu’elles portoient :
mais elles ne fubfifterent pas plus d’un fiecle. Le
nombre des factions fut réduit aux quatre anciennes
dans les fpeftacles. La faveur des empereurs & celle
du peuple fe partageoient entre les factions, chacune
avoit fes partifàns. Caligula fut pour la faction verte,
& Vitellius pour la bleue. Il réfulta quelquefois de
grands defordres de l’intérêt trop v i f que les fpetta-
teurs prirent à leurs factions. Sous Juftinien, une
guerre fanglante n’eût pas plus fait de ravage ; il y
eut quarante mille hommes de tués pour les factions
vertes & bleues. Ce terrible événement fit fuppri-
mer le nom de faction dans les jeux du cirque.
F a c t io n , dans l'Art militaire; c’eft le tems qu’un
foldat demeure en fentinelle : ainfi être en faction ,
fignifie être en fentinelle. Voyei SENTINELLE.
Un foldat en fentinelle eft aufli appellé factionnaire.
Il y a des factionnaires pour la garde des drapeaux
, des faifeeaux d’armes , des prifonniérs, &c.
(/>) .
FACTIONNAIRE, f. m. fe dit, dans un régiment
d>infanterie, du plus ancien capitaine, qui doit paffer
à la place de capitaine de grenadiers lôrfque cette
compagnie vient à vaquer ; mais on lui ajoûte le
nom de premier : ainfi le premier factionnaire dans un
régiment d’infanterie, eft le plus ancien capitaine
immédiatement après celui des grenadiers. (Q)
FA CTOR AGE , f. m. (Comm.) Voye^F a c t e u r ,
C o u r t a g e , &c.
Le factorage ou les appointemens des fafteurs,
qu’on nomme aufli commissionnaires, varie fuivant
les différens pays & les différens voyages qu’ils font
obligés de faire'. Le plus commun eft fixé à 3 pour
100 de la valeur des marchandifes, fans compter la
dépenfe des emballages, qu’il faut encore payer indépendamment
de ce droit.
A la Virginie, aux Barbades & à la Jamaïque, le
factorage eft depuis 3 jufqu’à 5 pour 100 : il en eft de
même dans la plus grande partie des Indes occidentales.
En Italie il eft de deux & demi pour, cent ; en
Hollande, un & demi ; en Efpagne, en Portugal,
en France, &c. deux pour cent. Voye^ les dictionn. du
Commerce , de Trévoux & de Chambers. (G)
FACTORERIE ou FACTORIE , f. f. (Gramm.)
lieuoù réfide un faôeur, bureau dans lequel un com-
miflïonnaire fait commerce pour fes maîtres ou com*
mettans. Voye^ Fa c t e u r , COMMISSIONNAIRE,
C o m m e t t a n t .
On appelle ainfi dans les Indes orientales & autres
pays de l’Afie où trafiquent les Européens, les
endroits où ils entretiennent des faéleurs ou commis,
foit pour l’achat des marchandifes d’Afie, foït pour
la vente ou l’échange de celles qu’on y porte d’Europe.
La factorie tient le milieu entre la loge & le comptoir
; elle eft moins importante que celui-ci, & plus
confidérable que l’autre. Voye^ C o m p t o ir & L o g e .
Vyye^ aufji les dictionn, de Commerce , de Trévoux & de
Chambers. (G)
FA CTUM, f. m. (Junfprud.) Ce terme, qui eft
purement latin dans fon origine, a été employé dans
le ftyle judiciaire, lorfque les procédures & juge-
mens fe rédigeoient en latin, pour exprimer le fait,
c’eft-à-dire les circonftances d’une affaire.
On a enfuite intitulé & appellé factum, un mémoire
contenant l’expofition d’une affaire conten-
tieufe. Ces fortes de mémoires furent ainfi appellés,
parce que dans le tems qu’on les rédigeoit en latin,
on y mettoit en tête ce mot, factum, à caufe qu’ils
commençoient par l’expofition du fait, qui précédé
ordinairement celle des moyens.
Depuis que François I. eut ordonné, en 1539, de
rédiger tous les a&es en François, on ne laifla pas de
conferver encore au palais quelques termes latins ,
du nombre defquels fut celui de factum, que l’on mettoit
en tête des mémoires.
Le premier factum ou mémoire imprimé, ainfi intitulé
, factum, quoique le furplus fût en françois ,
fut fait par M. le premier préfident le Maitre, dans
une affaire qui lui étoit perfonnelle contre fon gendre.
Il fut fait premier préfident fous HenrîTI. en
,1551, & mourut en 1561. Cette anecdote eft remarquée
par M. Frolana, en fon recueil des édits &
arrêts concernant la province de Normandie, page
(>$5.
Les avocats ont continué long-tems d’intituler
leurs mémoires imprimés, factum ; il n’y a guere que
vingt ou trente ans que l’on a totalement quitté cet
ufage, & que l’on a fubftitué le terme de mémoire à
celui de factum.
L’arrêt du parlement du 11 Août 1708, défend à
tous Imprimeurs & Libraires d’imprimer aucuns fac-
tums, requêtes ou mémoires, fi les copies qu’on leur
met en main ne font lignées d’un avocat ou d’un procureur.
Le même arrêt enjoint aux Imprimeurs de
mettre leur nom au bas des faclums ôc mémoires qu’ils
auront imprimés ou fait imprimer.
. Un factum lignifié eft celui dont la partie ou fon
procureur a fait donner copie par le miniftere d’un
huiflier. Les faclums ou mémoires ne font pièces du
procès, qu’autant qu’ils font lignifiés ; ils n’entrent
pourtant pas en taxe, quoiqu’ils l’oient lignifiés, excepté
au grand-confeil : dans les autres tribunaux on
pe les compte point, à moins qu’ils ne tiennent lieu
d’écritures néceffaires. Voye^ Mémoires. ( A )
FA CTU R E, f. f. (Comm.) compte, état ou mémoire
des marchandifes qu’un faéteur envoyé à fon
maître, un commifîionnaire à fon commettant, un
affocié à fon affocié, un marchand à un autre marchand.
Les factures s’écrivent ordinairement ou à la fin
des lettres d’a v is , ou fur des feuilles volantes renfermées
dans ces mêmes lettres.
Elles doivent faire mention, 1 °. de la date des envois
, du nom de ceux qui les fon t, des perfonnes à
qui ils font faits, du tems des payemens, du nom
du voiturier, & des marques & numéros des balles,
ballots, paquets, tonneaux, cailles , &c. qui contiennent
les marchandifes.
z°. Des efpeces, quantités & qualités des marchandifes
qui font renfermées fous les emballages,
comme aufli de leur numéro, poids , mefure ou aunage,
30. De leur p rix, & des frais faits pour raifon de
ces marchandifes ; comme les droits d’entrée & fortie,
fi on en a acquitté; ceux de commiflion& de courtage
dont on eft convenu ; de ce qu’il en a coûté pour
l ’emballage, portage ôc autres menues dépenfes. On
fait aù pié de la faÙure un total de toutes les fommes
avancées, droits payés, frais faits, &c. afin d’en
être rembourfé par celui à qui l’on envoyé les marchandifes.
Vendre une marchandife fur le pié de la facture,
c ’eft la vendre au prix courant.
Les marchands appellent liaffe de facture, un lacet
dans lequel ils enfilent les factures , lettres d’av is,
d’envoi, de demande & autres femblables écritures,
pour y recourir dans le befoin.
Ils nomment aufli livre de facture, un livre fur lequel
ils dreffent les factures ou comptes des différentes
fortes de marchandifes qu’ils reçoivent, qu’ils en-
voyent ou qu’ils vendent. Ce livre eft du nombre
de ceux qu’on appelle dans le commerce livres auxiliaires.
Voye^ Livre. Voye{ aufji les dictionnaires de
Commerce, de Trévoux, & de Chambers, (G)
FACULE, f. f. terme d'Afironomie, eft un nom
que Scheiner & d’autres après lui ont donné à des
efpeces de taches brillantes qui paroiffent fur le fo-
le i l , & fe diflipent au bout de quelque tems. Le mot
de facules eft oppofé à macules ou taches : celles - ci
font les endroits obfcurs du difque du foleil, & les
facules font les parties du difque folaire qui paroiffent
plus lumineufes que le r e f t e du difque. Voye^ S o l
e i l .
Ce mot eft un diminutif de fa x , flambeau, lumière.
"Les facules, ainfi roiffent tour-à-toquur.e les taches, paroiffent & difpa- Voye^ Taches. (O)
FACULTATIF, adj. m. (Jurifpf) fe dit de ce qui
donne le pouvoir & la faculté de faire quelque chofe.
Ce terme eft fur-tout ufité par rapport à certains
brefs du pape qu’on appelle brefs facultatifs, parce
qu’ils donnent pouvoir de faire quelque chofe que
l’on n’auroit pas pû faire fans un tel bref. (A )
la FcAapCaUciLtéT Éde, ff. afi.r eÇ Mquéetalqphuyef ,!c) heoffte l.a puiffance & Voye^ Puissance.
Les anciens philofophes, pour expliquer l’a&ion
de la digeftion, fuppofoient dans L’eftomac une faculté
digeftive : pour expliquer les mouvemens du
corps humain , ils fuppofoient une faculté motrice
dans les nerfs. Cela s’appelle fubftituer un mot obf*
cur à un autre qui ne l’eft pas moins.
Les facultés font ou de l’ame ou du corps.
Les facultés ou puiffances de l’ame font au nombre
de deux , favoir l'entendement & la volonté. Voyez ; Puissances. Voye£ aufji Entendement & Volonté.
On diftingue ordinairement les facultés corporelles
, par rapport à leurs différentes fondions ; ainfi
on entend par facultés animales, celles qui ont rapport
aux fens tk. au mouvement, &c. Chambers. Faculté , ( Phyfique & Medecinei) en général eft
la même chofe que puiffance , vertu, pouvoir, facilité
d'agir , ou le \principe des forces & des actions. La
fcience des forces & des puiffances eft ce que les
Grecs appellent dynamique, de Sùva.y.a.1, je peux.
Voye1 Dynamique.
Quelques auteurs confondent mal-à-propos les
forces avec les facultés ; mais elles different entr’el-
les de la même façon que les caufes different des
principes. La force étant la caufe de l’a&ion, entraîne
l’exiftencé aduelle. La faculté ou puiffance n’en
entraîne que là poflibilité. Ainfi de ce qu’on a la fa culté
d’agir, il ne s’enfuit pas néceffairement qu’on
agiffe ; mais toute force exiftante emporte proprement
une a&ion, comme un effet dont elle eft la
caufe.
En Medecine, n’ayant à confidérer que l’a&ion de
l’homme & celle des corps qui peuvent changer fon
état en pis ou en mieux, on a toûjours traité des facultés
de l’homme, & de celles des remedes, des
poifons, &c.
Les anciens ont divifé afléz arbitrairement les facultés
de l’homme, tantôt en deux, tantôt en trois
genres, dont ils n’ont jamais donné des idées diftin-
des ; car les facultés qu’ils appellent animales , font
en même tems vitales & naturelles : les naturelles
font aufli vitales & animales. Ils ont même foûdivi-
fé chacun de ces genres trop fcrupuleufement, en un
grand nombre d’efpeces, ainfi qu’on vient de le voir.
Les modernes donnant dans un excès oppofé, ont
voulu bannir tous ces termes confacrés par l ’emploi
qu’en ont fait tous les maîtres de l’art pendant
deux mille ans ; ce qui nous mettroit dans l ’impofli-
bilité de profiter de leurs écrits , qui font les fo lire es
de la Medecine.
Mais fans adopter tous les termes des facultés que
les anciens ont établis, ni vouloir les juftifier dans
tous les ufages qu’ils en faifoient, on ne peut non
plus fe paffer en Medecine du terme de faculté ou
de puiffance, qu’on ne peut en Méchanique fe paffer
des forces attra&ives, centripètes, accélératrices,
.gravitantes, &c. Ce n’eft pas à dire qu’on fâche
mieux la raifon d’un effet, comme de la chûte d’un
corps , de l’affoupiffement produit par l’opium,
quand on dit que la gravité eft le principe de l’u n ,
& la faculté ou vertu narcotique l’eft de l’autre ;
I mais c’eft qu’on eft.nécefîité , dans les Sciences,
'I lîï