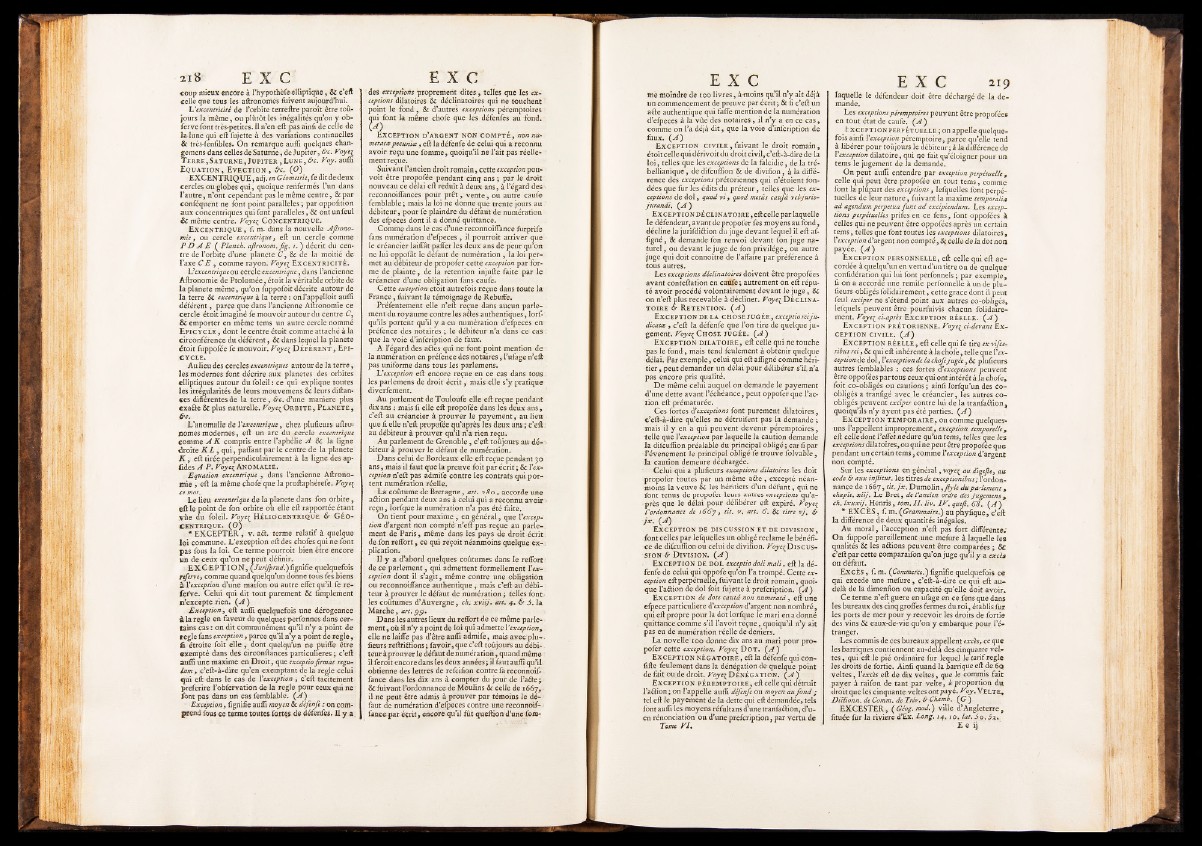
HP E X C coup mieux encore à rhypothèfe-elliptiqùe, & c’eft
celle que tous les aftrononiéis fuirent aujourd’hui.
Uexcentricité de l’orbite terreftre paroît être tou- >
jours la même, ou plutôt les inégalités qu’on y ob-
ferve font très-petites. Il n’en eft pas ainfi de celle de
la lune qui eft fujette à des variations continuelles
& très-fenfibles. On remarque auffi quelques chan-
gemens dans celles de Saturne, de Jupiter, &c. Foye^ Terre,Saturne, Jupiter , Lune,£ c. Foy. auffi Equation, Evegtiôn , &c. m i
EXCENTRIQUE, adj. en Geometru, fè dit de deux
cercles ou globes qui, quoique renfermés l’un dans
l’autre, n’ont conféquent nec feopnetn pdoanint tp paasr lael lmèlêems ;e pcaern otrpep,o &fitpioanr aux concentriques qui font parallèles, & ont unfeul
& Emême centre. Foye^ Concentrique. xcentrique , f. m. dans la nouvelle Agronomie
, ou cercle excentrique, eft un cercle comme
P D A E ( Planch. afironom. fig. /.. ) décrit du centlr’aex
dee l’orbite d’une planete C , & de la moitié de C E , comme rayon. Foye^ Excentricité.
Uexcentrique ou cercle excentrique, dans l’ancienne
Âftronomie de Ptolomée, étoit la véritable orbite de
la planete meme, qu’on fuppofoit décrite autour de
la terre & excentrique à la terre : on l’appelloit auffi
déférent, parce que dans l’ancienne Aftronomie ce
cercle étoit imaginé fe mouvoir autour du centre C,
ôc emporter en même tems un autre cercle nommé Epi cycle , dont le centre étoit comme attaché à la
circonférence du déférent, & dans lequel la planete
étoit füppofée fe mouvoir. Voyeç Déférent , Epi-
cycle.
Au lieu des cercles excentriques autour de la terre,
les modernes font décrire aux planètes des orbites
elliptiques autour du foleil : ce qui explique toutes
les irrégularités de leurs mouvemens &c leurs diftan-
ces différentes de la terre, &c. d’une maniéré plus
exaûe & plus naturelle. Foye^Orbite, Planete,
&c.L
’anomalie de Pexcentrique, chez plusieurs aftro- jiomes modernes, eft un arc du ,cercle excentrique
comme A K compris entre l’aphélie A & la ligne
droite K L , qui, paffant par le centre de la planete
K , eft tirée perpendiculairement à la ligne des ap-
fides A P. Foye{ Anomalie.
Equation excentrique , dans l’ancienne Aftrono-
mie » eft la même chofe que la proftaphérefe. Foye^
ce mot.
Le lieu excentrique de la planete dans fon orbite,
eft le point de fon orbite où elle eft rapportée étant
,yûe du foleil. Foye^ Héliôgentrique & Geo-
CENTRIQUE. (O )
* EX C E P TER , v . a&. terme relatif à quelque
lo i commune. L’exception eft des chofes qui ne font
pas fous la loi. Ce terme pourroit bien être encore
un de ceiix qu’on ne peut définir.
E X C E P T IO N , ÇJurijprud.)fignifie quelquefois
referve, comme quand quelqu’un donne tous fes biens
à l’exception d’une maifon ou autre effet qu’il fe re-
ferve. Celui qui dit tout purement & fimplement
n’excepte rien. (A )
Exception, eft auffi quelquefois une dérogeance
à la réglé en faveur de quelques perfonnes dans certains
cas : on dit communément qu’il n’y a point de
réglé fans exception , parce qu’il n’y a point de réglé,
f i étroite foit e lle , dont quelqu’un ne puiffe être
exempté dans des circonftances particulières ; c’eft
auffi une maxime en D roit, que exceptiofirmat regu-
Lam y c’eft-à-dire qu’en exemptant de la réglé celui
qui eft dans le cas de l’exception, c’eft tacitement
preferire l’obfervation de la réglé pour ceux qui ne
»ont pas dans un cas femblable. (A )
Exception , lignifie auffi moyen & défenfe : on comprend
fous ce terme toutes forte? de défenfes» Il y a .
E X C
des exceptions proprement dites , telles que les ex-
ceptions dilatoires &: déclinatoires qui ne touchent
point le fon d, & d’autres exceptions péremptoires
qui font la même chofe que les défenfes au fond.
mException d’argent non compté, non nu*
mer ata pecunia, eft la défenfe de celui qui a reconnu
avoir reçu une fomme, quoiqu’il ne l ’ait pas réelle*»
mentreçue.
Suivant l’ancien droit romain, cette exception pou-'
voit être propofée pendant cinq ans ; par le droit
nouveau ce delai eft réduit à deux ans, à l’égard des .
reconnoiffances pour p rêt, vente, ou autre caufe
femblable ; mais la loi ne donne que trente jours au
débiteur, pour fe plaindre du défaut de numération
des efpeces dont il a donné quittance.
Comme dans le cas d’une reconnoiffance furprife
fans numération d’efpeces , il pourroit arriver que
le créancier laiffât paffer les deux ans dè peur qu’on
ne lui oppofât le défaut de numération , la loi permet
au débiteur de propofer cette exception par forme
de plainte, de la rétention injufte faite par le
créancier d’une obligation fans caufe.
Cette exception etoit autrefois reçue dans toute la
France, fuivant le témoignage de Rebuffe.
Préfentement elle n’eft reçue dans aucun parlement
du royaume contre les aûes authentiques, lorf-
qu’ils portent qu’il y a eu numération d’efpeces en
préfence des notaires ; le débiteur n’a dans ce cas
que la voie d’infcrfption de faux.
A l’égard des aâes qui ne font point mention de
la numération en préfence des notaires, l’ufage n’eft
pas uniforme dans tous les parlemens.
AJ exception eft encore reçue en ce cas dans tous
les parlemens de droit éc r it, mais elle s’ÿ pratique
diverfement.
Au parlement de Touloüfe elle eft reçue pendant
dix ans : mais fi elle eft propofée dans les deux ans,
c’eft au créancier à prouver le payement, au lieu
que fi elle n’eft propofée qu’après les deux ans ; c’eft.
au débiteur à prouver qu’il n’a rien reçu.
Au parlement de Grenoble , c’eft toûjours au débiteur
à prouver le défaut de numération.
Dans celui de Bordeaux elle eft reçue pendant 30
ans, mais il faut que la preuve foit par écrit ; & Vexception
n’eft pas admife contre les contrats qui portent
numération réelle.
La coutume de Bretagne, art. 2 8 0 , accorde une
aéfion pendant deux ans à celui qui a reconnu avoir
reçu, lorfque la numération n’a pas été faite.
On tient pour maxime , en général, que Vexception
d’argent non compté n’eft pas reçue au parle-,
ment de Paris, même dans les pays de droit écrit
de.fon reffort, ce qui reçoit néanmoins quelque ex-:
plication.
Il y a d’abord quelques coûtumes dans le reffort
de ce parlement, qui admettent formellement l’cr-
ception dont il s’agit, même contre une obligation
ou reconnoiffance authentique, mais c’eft au débiteur
à prouver le défaut de numération ; telles font;
les coûtumes d’Auvergne, ch. xviij. art. 4. & 5. la
Marche, art. g g .
Dans les autres lieux du reffort de ce même parlement,
où il n’y a point de loi qui admette Y exception,
elle ne laiffe pas d’être auffi admife, mais avec plu-1
fieurs reftriéhons; favoir,que c’eft toûjours au débiteur
à prouver le défaut de numération, quand même
il feroit encore dans les deux années ; il faut auffi qu’il
obtienne des lettres de refeifion contre fa reconnoiffance
dans les dix ans à compter du jour de l’a â e ;
& fuivant l’ordonnance de Moulins & celle de 1667,
il.ne peut être admis à prouver par témoins le defaut
de numération d’efpeces contre une reconnoif- -
fance par éçrit, encore qu’il fût queftion d’une font-
E X C
umne c momoimndernec deem 1e0n0t dliev preresu, và.e- mpoairn és cqruit’i;l &n’ yfi ac’iet fdt éujnà
a&e authentique qui faffe mention de la numération
cdo’emfpmecee os nà ll’aa vdéûjeà ddeist ,n qoutea ilrae sv,o iile n d’y’in af eernip ctieo nc adse,
faux.Exception ÇA) civile , fuivant le droit romain,
élotoi,i tt ceellleles qquuie d léersi voit du droit d dee civil,l ad ifvalicfiiodnie, c’eft-à-dire de la bellianique, de diefexucefpfitoionn &s , àd ela l ad itfrféé
rence des exceptions prétoriennes qui n’étoient fondées
que fur les édits du préteur, telles que les exceptions
de dol, quod vi, quod metûs caufâ vtbjuris-
jurandi. ( A ) leE dxécfeenpdteiuor,n a dvaénctl dien parotpooirfeer, feefst cmeollyee pnasr a lauq fuoenldle,
ldiégcnlién, e& la d juemrifadnidâeio fno nd ur ejnugveo id edveavnatn lte fqoune lj uilg eef tn aafi
jtuugreel q, uoiu d doeitv caonnt nleo îjtureg ed dee l ’faoffna iprrei vpialrè gperé, foéure naucetr eà
tous autres.
Les exceptions déclinatoires doivent être propofées
avant conteftation en caüfe ; autrement on eft réputé
avoir procédé volontairement devant le juge, &
on n’eft plus recevable à décliner. Voye^ DéclinatoEire
& Retention. (A ) xception de la chose jugée, exceptioreiju dicata
, c’eft la défenfe que l’on tire de quelque jugemEent.
Foye^ Chose jugée. (A ) xception dilatoire, eft celle qui ne touche
pas le fond, mais tend feulement à obtenir quelque
délai. Par exemple, celui qui eft affigné comme heritier
, peut demander un délai pour délibérer s’il, n’a
pas encore pris qualité.
De même celui auquel on demande le payement
d’une dette avant l’échéance, peut oppofer que l’action
eft prématurée.
Ces fortes d'exceptions font purement dilatoires,
c’eft-à-dire qu’elles ne détruifent pas la demande ;
mais il y en a qui peuvent devenir péremptoires,
telle que Yexception par laquelle la caution demande
la dileuffion préalable du principal obligé; car fi par
l’évenement le principal obligé fe trçuve folvable ,
la caution demeure déchargée.
Celui qui a plufieurs exceptions dilatoires les doit
propofer toutes par un même a&e , excepté néanmoins
la veuve & les héritiers d’un défunt, qui ne
font tenus de propofer leurs autres exceptions qu’a-
HE -près que le délai pour délibérer eft expiré. Foye^
Vordonnance de i6 6 y > tit. v, art. 6. Abc titre vj, 6 ixAc)fcoen dt ec edlilfeesu eption pffaior nle ofquu de ceellleusi discussion udne doibvliiugéo et nre.clame de division,le bénéfiFoyefDiscvs
sion & Division. ( A )
Exception de dol exceptio doli mali, eft la défenfe
de celui qui oppofe qu’on l’a trompé. Cette exception
eft perpétuelle, fuivant le droit romain, quoique
i’aâion de dol foit fu jette à prefeription. (A ) efpEeXceC pEaPrTtiIcOuNli èdree dote cautâ non numeratâ, eft une 8 exception d’argent non nombré,
qquuiit etaftn pcreo cporme pmoeu sr’ illa ld’aovto loitr rfeqçuue el,e qmuaoriiq eun’i la nd’oyn aniét pas eu de numération réelle de deniers.
La novelle 100 donne dix ans au mari pour propofer
cette exception. Foye1 D o t . (A ) fiftEe xfecuelpemtieonnt dnaéngs alat doéinréeg ,a etifot nla d deé qfueneflqe uqeu ip cooinn-t de fait OU de droit. Foye{ DÉNÉGATION. ÇA ) l’aéEfixocn e; opnt ilo’anp ppeéllree amufpfit oire, eft celle qui détruit défenfe ou moyen au fond ; fteoln et fatu lfef ip leasy- memoeynetn ds eré lfau dlteatntes dq’uuin eef ttr daenmfaa'ânidoéne, ,d t’eul-s
en rénonciation ou d’une prefeription, par vertu de
Tome F l.
E X C 219
lmaqaunedlel.e le défendeur doit être déchargé de la deLes
exceptions péremptoires peuvent être propofée?
en tout état de caufe. (A ) Exception perpétuelle ; on appelle quelquefois
ainfi Y exception péremptoire, parce qu’elle tend
à libérer pour toûjours le débiteur ; à la différence de
tYe emxcse pleti ojung deimlaetonti rdee, qlau id qeem faanidt eq.u’éloigner pour un
On peut auffi entendre par exception perpétuelle,
celle qui peut être propofée en tout tems, comme
font la plûpart des exceptions , lefquelles font perpétuelles
de leur nature, fuivant la maxime temporalia
ad agendum perpétua funt ad excipiendum. Les exceptions
perpétuelles prifes en ce fens, font oppofées à
celles qui ne peuvent être oppofées après un certain
tems, telles que font toutes les exceptions dilatoires,
Y exception d’argent non compté, Æg celle de la dot non
payée. ÇA') Exception personnelle, eft celle qui eft accordée
à quelqu’un en vertu d’un titre ou de quelque
confidération qui lui font perfonnels ; par exemple,
fi on a accorde une remile perfonnelle à un de plufieurs
obligés folidairement, cette grace dont il peut
feul exciper ne s’étend point aux autres cô-obligés,
lefquels peuvent être pourfuivis chacun folidairement.
Foyt{ ci-après Exception réelle. ÇA) Exception prétorienne. Foye^ ci-devant Exception
civile. ÇA) Exception réelle, eft celle qui fe tire exvifce-
ribus rei , & qui eft inhérente à la chofe, telle que Yexception
de dol, Y exception de la chofejugée, & plufieurs
autres femblables : ces fortes d*exceptions peuvent
être oppofées par tous ceux qui ont intérêt à la chofe,
foit co-obligés ou cautions ; ainfi lorfqu’un des coobligés
a tranfigé avec le créancier, les autres coobligés
peuvent exciper contre lui de la tranfa&ion,
quoiqu’ils n’y ayent pas été parties. ÇA) unsE xl’acpeppetllieonnt i mtepmropporremaiernet,, ou comme quelques- exception temporelle, eft celle dont l'effet ne dure qu’un tems, telles que les
exceptions dilatoires, ou qui ne peut être propofée que
npoennd caonmt upnté c.ertain tems, comme Y exception d’argent
Sur les exceptions en général, voyc^ au digejle, an
code & aux injiitut. les titres de exceptionibus; l’ordonnance
de 1667, tit.jx . Dumolin ,ftyle du parlement,
chapit. xiij. Le Bref , de l'ancien ordre des jugemens ,
ch. Ixxxij. Henris, tom. II. liv. IF . quejl. 68. ÇA )
* EX C ÈS, f. m. ÇGrammaire.) au phyfique, c’eft
la différence de deux quantités inégales.
Au moral, l’acception n’eft pas fort différente.’
On fuppofe pareillement une mefure à laquelle les
qualités & les aétions peuvent être comparées ; &
c’eft par cette comparaifon qu’on juge qu’il y a excès
ou defaut. quEi xexccèesd e, fu.n me . mÇCeofmurren,e tcce’e.)f lti-gàn-difiiree q cuee lqquuie feofti sa cue- delà de la dimenfion ou capacité qu’elle doit avoir.
Ce terme n’eft guere en ufage en ce fens que dans
les bureaux des cinq groffes fermes du roi, établis fur
les ports de mer pour y recevoir les droits de fortie
des vins & eaux-de-vie qu’on y embarque pour l’étranger.
Les commis de ces bureaux appellent excès, ce que
les barriques contiennent au-delà des cinquante vel-
tes, qui eft le pié ordinaire fur lequel le tarif regie
les droits de fortie. Ainfi quand la barrique eft de 6q
veltes, Yexcès eft de dix veltes, que le commis fait
payer à raifon de tant par velte, à proportion du
droit que les cinquante veltes ont payé. Foy. Velte,
Diclionn. de Comm. de Trév. & Chamb. ÇGj
EXC ESTER, ( Géog. mod. ) ville d’Angleterre ,
fituée fur la riviere d’Ex. Long. 14,10. lat. 5o .5z .
E e ij