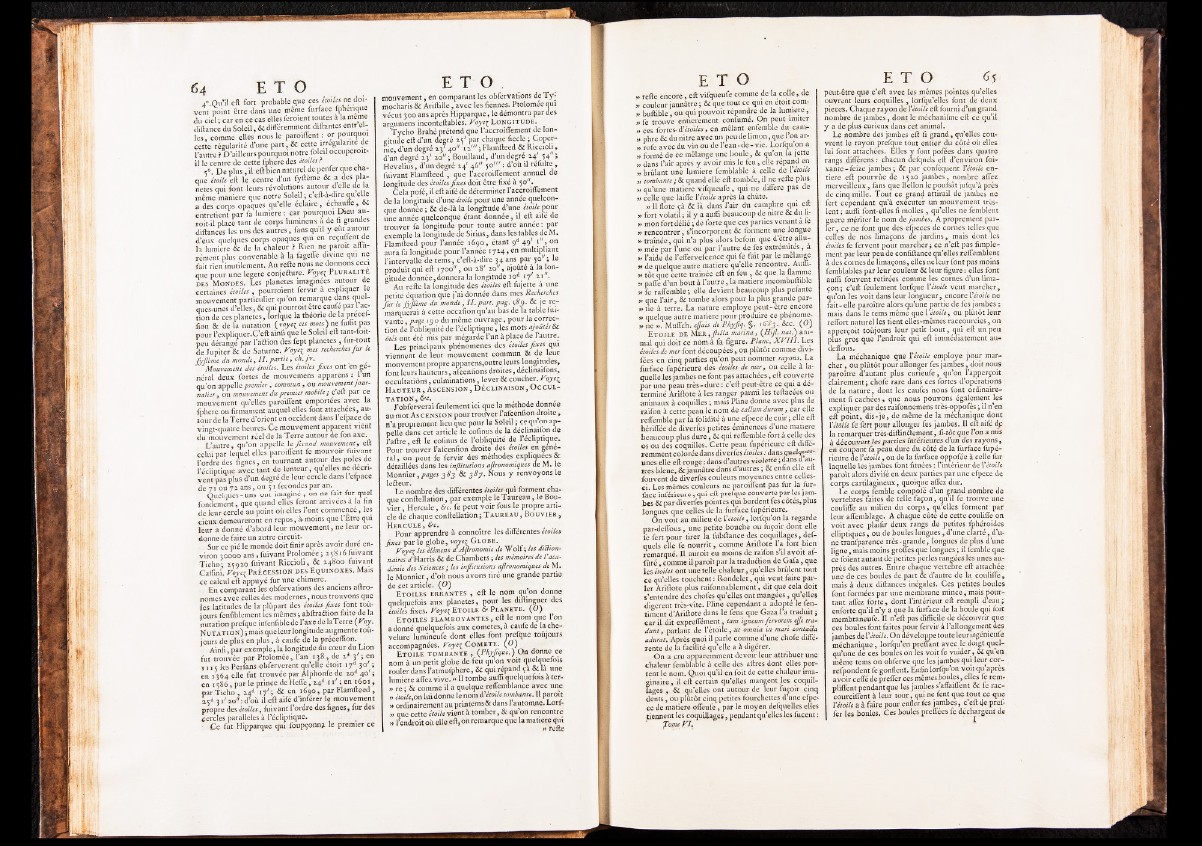
m m eft fort probable que ces étoiles ne doivent
point être dans une même furface fpherique
<lu ciel ; car en ce cas elles feraient toutes a la meme
diftance du Soleil, & différemment diftantes emr elle
s, comme elles nous le paroiffent: or pourquoi
cette régularité d’une part, & cette irrégularité de
l’autre ? D ’ailleurs pourquoi notre foleil occuperoitr
il le centre de cette fphere des
D é p lu s ,il eftbien naturel de pcnler que chaque
étoile eft le centre d’un fyftème & a des planètes
qui font leurs révolutions autour delle de la
même maniéré que notre Soleil ; c’ eft-à-dire qu elle
a des corps opaques qu’elle éclaire, echaufte, 6c
entretient.par l'a lumière: car pourquoi Dieu au-
roit-il placé tant de corps lumineux à: de il grandes
diftances les uns des* autres, fans qu’il y eut autour
d’eux ''quelques corps opaques qui en reçulientde
la lumière 8c de la chaleur ? Rien ne paraît aflu-
rément plus convenable à la fageffe divine qui ne
fait rien inutilement. Au relie nous ne donnons cect
que pour une légère conjeaure. « g ! Pluraiite des Mondes. Les planètes imaginées autour de
certaines étoiles , pourraient fervir à expliquer le •
mouvement particulier qu’on remarque dans quelques
unes d’elles, Si qui pourrait être caufé par l action
de ces planètes, lorfque la théorie de la precel-
fidn St de la nutation ( r o n ces mots ) ne fuffit pas
pour l’expliquer.G’eft ainft que le Soleil eft tant-loit-
pett dérange par l'action des fept planètes , fur-tout
de Jupiter 8c de Saturne. V~oye^ mes recherches fur le
f y fïéme du mondé, 11. partie, ch.jv. f
Mouvement désétoiles. Les étoiles fixes.ont ‘engénéral
deux fortes de mouvemens apparéns : l’un
qu’on appelle premier , commun , ou mouvement joiir-
nalier, ou mouvement du premier mobile; c eft par ce
mouvement qu’elles paroiffent emportées avec la
jphere ou firmament auquel elles font attachées , autour
de la T erre d’orient en occident dans 1 efpace de
vingt-quatre heures. Ce mouvement apparent vient
du mouvement réel de la Terre autour de fon axe.
L’autre, qu’on appelle le fécond mouvement, eft
celui par lequel elles paroiffent fe mouvoir fuivant
l’ordre des lignes, en tournant autour des pôles de
l’écliptique avec tant de lenteur, qu’el es ne décrivent
pas plus d’un degré de leur cercle dans 1 efpace
de 71 ou 71 ans, ou 51 fécondés par an.
Quelques-uns ont imagine , on ne fait lur quel
fondement, que quand elles feront arrivées à la fin
de leur cercle au point oii elles l’ont commence, les
d e u x demeureront en repos, à. moins que 1 Etre qui
leur à donné d’abord leur mouvement, ne leur ordonne
de faire un autre circuit. ,
Sur ce pié le monde doit finir apres avoir dure environ
30000 ans, fuivant Ptolomée ; 25816 fuivant
Ticho; 25920 fuivant Riccioli, & 24800 fuivant
Caffini. Voye{ Précession des Equinoxes. Mais
c e calcul eft appuyé fur une chimère.
En comparant les obfervations des anciens aftro-
nomes avec celles des modernes, nous trouvons que
les latitudes de la plupart des étoiles fixes font toujours
fenfiblement les mêmes ; abftraftion faite de la
nutation prefque infenfiblede l’axe de laTerre (Voy. Nutation) ; mais que leur longitude augmente toujours
de plus en plus, à caufe de la préceflion.
Ainfi, par exemple, la longitude du coeur du Lion
fut trouvée par Ptolomée, l’an 138, de 2d 3 '; en
1115 les Perfans obferverent qu’elle étoit i7 d 30' ;
en 1364 elle fut trouvée par Alphonfe de 20d 40';
en 1586, par le prince de Heffe, 24d 11/ ; en 1601,
par T icho , 24d 1 7 '; & en 1690, par Flamfteed,
a5d 3 20" : d’où il eft aifé d’inférer le mouvement
propre des étoiles, fuivant l’ordre des fignes, fur des
cercles parallèles à l’écliptique. ' <
• Ce fut Hipparque qui foupçonna le premier ce
mouvement, en comparant les obfervations de Ty-
mocharis & A riftille, avec les fiennes. Ptolomée qui
vécut 300 ans après Hipparque, le démontra par des
ar^umens inconteftables. Voyeç Longitude.
^Tycho Brahé prétend que l ’accroiffement de longitude
eft d’un degré 25' par chaque fiecle ; Copernic,
d’un degré 23' 40” 1 i l " ; Flamfteed & R iccioli,
d’un degré 23' 20" ; Bouillaud, d’un degré 24' 54";
Hevelius, d’undegré 24' 46" 5q/// : d’où il refulte ,
fuivant Flamfteed , que l’accroiffement annuel de
longitude des étoiles fixes doit être fixé à 50 .
Cela pofé, il eft aifé de déterminer l’accroiffement
de la longitude d’une étoile pour une année quelconque
donnée; & de-là la longitude d’une étoile pour
une année quelconque étant donnée, il eft ailé de
trouver fa longitude pour toute autre année : par
exemple la longitude de Sirius, dans les tables de M.
Flamfteed pour l’année 1690, étant 9d 49' 1 " , on
aura fa longitude pour l’année 1724, en multipliant
l’intervalle de tems, c’eft-à-dire 34 ans par 50 ; le
produit qui eft i-joo", ou 28' 20", ajouté à la lon-
i gitude donnée,donnera la longitude iod 17' 21".
1 Au refte la longitude des étoiles eft fujette a une
petite équation que j’ai donnée dans mes Recherches
fur le fyfiime du monde, I I . part. pag. 1,89. & je remarquerai
à cette occafion qu’au bas de la table buvante
, page 19 o du même ouvrage, pour la correction
de l’obliquité de l’écliptique, les mots ajoutes &
ôtés ont été mis par mégarde l’un à place de 1 autre.
Les principaux phénomènes des étoiles fixes qui
viennent de leur mouvement commun & de leur
mouvement propre apparéns,outre leurs longitudes,
font leurs hauteurs, afeenfions droites, déclinaifons,
occultatiôns, culminations, lever & coucher. Voyeç Hauteur , Ascension , Déclinaison , Occultation,
^ .
J’obferverai feulement ici que la methode donnee
au mot Ascension pour troitver l’afeenfion droite ,
n’a proprement lieu que pour le Soleil ; ce qu on appelle
dans cet article le cofinus de la déclinaifon de
l’aftre, eft le cofinus de l’obliquité de 1 écliptique.
Pour trouver l’afeenfion droite des étoiles en général
, on -peut fe fervir des methodes expliquées &c
détaillées dans les inflitutions afironomiques de M. le
Monnier, pages 3 £3 & 3 £7. Nous y renvoyons le
le&eur.
Le nombre des différentes étoiles qui forment chaque
conftellation, par exemple le Taureau, le Bouvier
, Hercule, &c. fe peut voir fous le propre article
de chaque conftellation ; Taureau , Bouvier ,
HeProcuur lapep, rendre à connoître les differentes é,toiles
fixes par le globe, voye[ Globe. Voyer les èlémens d'Aftronomie de "Wolf ; les dictionnaires
Harris & de Chambers ; les mémoires de l'académie
des Sciences; les inflitutions afironomiques de M.
le Monnier, d’où nous avons tiré une grande partie
de cet article. (O) quEeltqoueilfoeiss eaurxr apnlatneèst e,s ,e fpt oluer nloesm d tijfuti nognu dero ndnees
- étoEiles fixes. Voye{ Etoile & Planete. (O) toiles flamboyantes, eft le nom que Ion
a donné quelquefois aux cometes, à caufe de la chevelure
lumineufe dont elles font prefque toujours
accompagnées. Voye1 Comete. (O ) Etoile tombante , (Phyfique.) On donne ce
nom à un petit globe de feu qu’on voit quelquefois
rouler dans l’atmofphere, & qui répand çà & là une
lumière affez vive. « H tombe aufli quelquefois à ter-
» re ; & comme il a quelque reffemblance avec une
» étoile,on lui donne le nom d’étoile tombante. Il paroît
» ordinairement au printems& dans l’automne. Lorf-
„ que cette étoile vient à tomber, & qu’on rencontre
» l’endroit où elle eft, on remarque que la matière qui
» refte
I refte encore, eft vifqueufe comme de la colle, de », couleur jaunâtre ; & que tout ce qui en étoit com-
», buftible, ou qui pouvoit répandre de la lumière,
»»,, fcee st rfoourtvees , edntièrement confumé. On peut imiter », phre & du n'iéttroei laevse, ce nu nm pêelua ndte elinmfeomnb, lqeu ed ul’ ocna naxr--
»»,, froofrem aév deec cdeu m véinla onug ed ue nl’ee abuo-udlee,- v&ie q. uL’oonrf qlau ’joentt ea
»„, bdarûnlsa ln’at iur naep rlèusm yi èaryeo fier mmbisla lbel ef eàu ,c eellllee rdépe and en Vétoile », tombante ; & quand elle eft tombée, il ne refte plus
», qu’une matière vifqueufe, qui ne différé pas de
», celle que laiffe X étoile après là chute. #
» Il flote çà & là dans l’air du camphre qui eft
», fort volatil; il y a aufli beaucoup de nitre & du li-
», mon fort délié ; de forte que ces parties venant a fe
», rencontrer , s’incorporent & forment une longue
» traînée, qui n’a plus alors befoin que d’être allu-
», mée par l’une ou par l’autre de fes extrémités, à
», l’aide de l’effervefcence qui fe fait par le mêlante
» de quelque autre matière qu’elle rencontre. Aufli-
», tôt que cette traînée eft en feu , & que la flamme
», .paffe d’un bout à l’autre, la matière incombuftible
», fe raffemble; elle devient beaucoup plus pefante
» que l’air, & tombe alors pour la plus grande par-
»,tie à terre. La nature employé peut-être encore
» quelque autre matière pour produire ce phénome- -
» ne »JMuffch. effais de PJtyfy. § . » & c . (O ) Etoile de Me r ,fitlla marina, (Hjfl. nat.) animal
qui doit ce nom.à fa figure. Plane. X V I I I . Les
étoiles de mer font découpées, ou plutôt comme divi-
fées en cinq parties qu’on peut nommer rayons. La
furface fupérieure des étoiles de mer, ou celle à laquelle
les jambes ne font pas attachées, eft couverte
par une peau très-dure : c’eft peut-etre ce qui a déterminé
Ariftote à les ranger parmi les teftacées ou
animaux à coquilles ; mais Pline donne avec plus de
raifon à cette peau le nom de callum durum, car elle
reffemble par fa folidité à une efpece de cuir ; elle eft
hériffée de diverfes petites eminences d’une matière
beaucoup plus dure, & qui reffemble fort a celle des
os ou des coquilles. Cette peau fupérieure eft différemment
colorée dans diverfes étoiles : dans quelques-
unes elle eft rouge : dans d’autres violette ; dansd autres
bleue, & jaunâtre dans d’autres ; & enfin elle elt
fouvent de diverfes couleurs moyennes entre celles-
ci. Les mêmes couleurs ne paroiffent pas fur la fur-
face inférieure, qui eft prefque couverte par les jambes
& par diverfes pointes qui bordent fes côtés, plus
longues que celles de la furface fuperieure.
On voit au milieu de Xétoile, lorfqu’on la regarde
par-deffous, une petite bouche ou i'uçoir dont elle
le fert pour tirer la fubftance des coquillages, desquels
elle fe nourrit, comme Ariftote Pa fort bien
remarqué. Il auroit eu moins de raifon s’ il avoit af-
lu ré , comme il paroît par la traduèfion de Gafa, que
les étoiles ont une telle chaleur, qu’elles brûlent tout
ce qu’elles touchent : Rondelet, qui veut faire parler
Ariftote plus raifonnablement, dit que cela doit
s’entendre des chofes qu’elles ont mangees, qu’elles
digèrent très-vîte. Pline cependant a adopté le fen-
timent d’Ariftote dans le fens que Gaza l’a traduit ;
car iL dit expreffément, tam igneum fervoum efie tra-
dunt, parlant de l’étoile, ut omnia in mari contacta
adurat. Après quoi il parle comme d’une choie différente
de la facilité qu’elle a à digérer.
On a cru apparemment devoirleur attribuer une
chaleur femblable à celle des aftres dont elles portent
le nom. Quoi qu’il en foit de cette chaleur imaginaire
, il eft certain qu’elles mangent les coquillages
, & qu’elles ont autour de leur luçoir cinq
dents, ou plutôt cinq petites fourchettes d’une efpe-
ce de matière offeufe, par le moyen defquelles elles
tiennent les coquillages, pendant qu’elles les fucent :
S J om K l,
peut-être que c’eft avec les mêmes pointes qu’elles
ouvrent leurs coquilles, lorfqu’elles font de deux
pièces. Chaque rayon de Xétoile eft fourni d’un grand
nombre de jambes, dont le méchanifme eft ce qu’il
y a de plus curieux dans cet animal.
Le nombre des jambes eft fi grand, qu’elles couvrent
le rayon prefque tout entier du côté où elles
lui font attachées. Elles y font pofées dans quatre
rangs différens : chacun defquels eft d’environ foi-
xante-feize jambes; & par conféquent Xétoile entière
eft pourvue de 1520 jambes, nombre affez
merveilleux, fans que Bellon le poulsât jufqu’à près
de cinq mille. Tout ce grand attirail de jambes ne
fert cependant qu’à exécuter un mouvement très-
lent ; aufli font-elles fi molles , qu’elles ne femblent
juere mériter le nom de jambes. A proprement parler,
ce ne font que des efpeces de cornes telles que
celles de nos limaçons de jardins, mais dont les
étoiles fe fervent pour marcher ; ce n’eft pas Amplement
par leur peu de confiftance qu’elles reflemblent
à des cornes de limaçons, elles ne leur font pas moins
femblables par leur couleur & leur figure : elles font
aufli fouvent retirées comme les cornes d’un limaçon;
c’eft feulement lorfque Xétoile veut marcher,
qu’on les voit dans leur longueur, encore Xétoile ne
fait-elle paroître alors qu’une partie de fes jambes :
mais dans le tems même que Xétoile, ou plutôt leur
reffort naturel les tient elles-mêmes raccourcies, on
apperçoit toujours leur petit bout, qui eft un peu
plus gros que l’endroit qui eft immédiatement au-
deffous.
La méchanique que l'étoile employé pour marcher
, ou plutôt pour allonger fes jambes, doit nous
paroître d’autant plus curieufe, qu’on l’apperçoit
clairement; chofe rare dans ces fortes d’opérations
j de la nature, dont les caufes nous font ordinairement
fi cachées, que nous pouvons également les
expliquer par des raifonnemens très-oppofés ; il n’en
eft point, dis-je, de même de la méchanique dont
Xétoile fe fert pour allonger fes jambes. Il eft aifé dp
la remarquer très-diftinftement, û-tôt que l’on a mis
à découvert les parties intérieures d’un des rayons,
en coupant fa peau dure du côté de la furface fupérieure
de Xétoile, ou de la furface oppofée à celle fur
laquelle les jambes font fituées : l’intérieur de Xétoile
paroît alors divifé en deux parties par une efpece de
corps cartilagineux, quoique affez dur.
Le corps femble compofé d’un grand nombre de
vertèbres faites de telle façon, qu’il fe trouve une
couliffe au milieu du corps, qirelles forment par
leur affemblage. A chaque côté de cette couliffe on
voit avec plaifir deux rangs de petites fphéroïdes
elliptiques, ou de boules longues, d’une clarté, d’une
tranfparence très-grande, longues de plus d’une
ligne, mais moins groffes que longues ; il lèmble que
ce foient autant de petites perles rangées les unes auprès
des autres. Entre chaque vertebre eft attachée
une de ces boules de part & d’autre de la couliffe ,
mais à deux diftances inégales. Ces petites boules
font formées par une membrane mince, mais pourtant
affez forte, dont l’intérieur eft rempli d’eau ;
enforte qu’il n’y a que la furface de la boule qui foit
membraneufe. Il n’eft pas difficile de découvrir que
ces boules font faites pour fervir à l’allongement des
jambes de Xétoile. On développe toute leur ingénieufe
méchanique, lorfqu’en preffant avec le doigt quelqu’une
de ces boules on les voit fe vuider, & qu’en
même tems on obferve que les jambes qui leur cor-
refpondent fe gonflent. Enfin lorfqu’on voit qu’après
avoir ceffé de preffer .ces mêmes boules, elles fe rem-
pliffent pendant que les jambes s’affaiffent & fe rac-
courciffent à leur tour, qui ne fent que tout ce que
Xétoile a à faire pour enfler fes jambes, c’eft 4e preffer
les boules. Ces boules preffées fe déchargent de