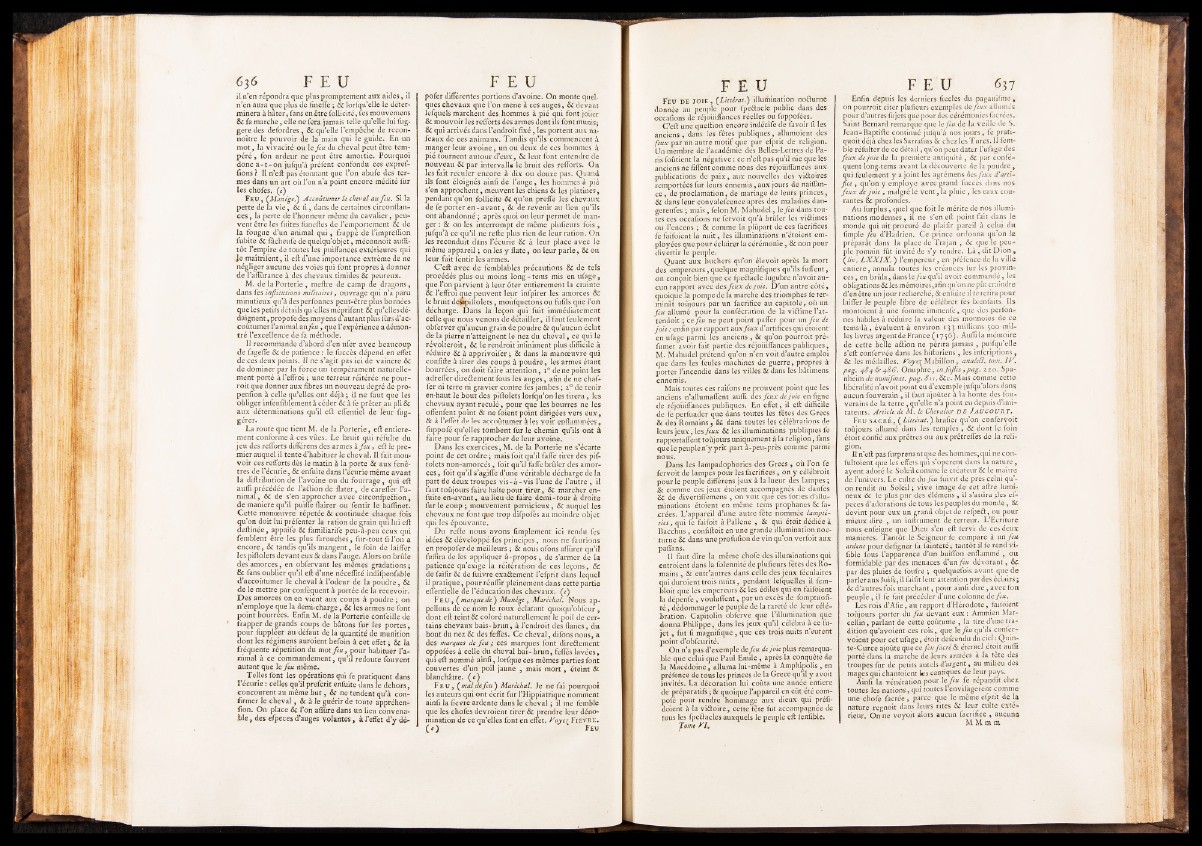
il n’en répondra que plus promptement aux aides, il
n’en aura que plus de fineffe ; 6c lorfqu’elle le déterminera
à hâter, fans en être follicité, les mouvemens
6c fa marche, elle ne fera jamais telle qu’elle lui fug-
gere des defordres, 6c qu’elle l’empêche de recon-
noître le pouvoir de la main qui le guide. En un
mot, la vivacité ou le feu du cheval peut être tempéré
, fon ardeur ne peut être amortie. Pourquoi
donc a - t - o n jufqu’à préfent confondu ces expref-
lions ? Il n’eft pas étonnant que l’on abufe des termes
dans un art oit l’on n’a point encore médité fur
les chofes, (e)
F e u , (M a n è g e .) Accoutumer U cheval au feu. Si la
perte de la v ie , 6c f i , dans de certaines circonftan-
ce s , la perte de l’honneur même du cavalier, peuvent
être les fuites funeftes de l’emportement 6c de
la fougue d’un animal q u i, frappé de l’impreilion
fubite 6c fâcheufe de quelqu’objet, méconnoît auffi-
tôt l’empire de toutes les puiffances extérieures qui
Je maîtrifent, il eft d’une importance extrême de ne
négliger aucune des voies qui font propres à donner
de l ’aflurance à des chevaux timides & peureux.
M. de la Porterie , mettre de camp de dragons,
dans fes injlituùons militaires, ouvrage qui n’a paru
minutieux qu’à des perfonnes peut-être plus bornées
ue les petits détails qu’elles méprifent 6c qu’elles dé-
aignent, propofe des moyens d’autant plus fûrs d’ac-
coûtumer l’animal nu fe u , que l’expérience a démontré
l’excellence de fa méthode.
Il recommande d’abord d’en ufer avec beaucoup
de fageffe 6c de patience : le fuccès dépend en effet
de ces deux points. Il ne s’agit pas ici de vaincre &
de dominer par la force un tempérament naturellement
porté à l’effroi ; une terreur réitérée ne pourrait
que donner aux fibres un nouveau degré de pro-
pentton à celle qu’elles ont déjà ; il ne faut que les
obliger infenfiblement à céder 6c à fe prêter au pli 6c
aux déterminations qu’il eft effentiel de leur fug-
gérer.
La route que tient M. de la Porterie, eft entièrement
conforme à ces vûes. Le bruit qui réfulte du
jeu des refforts différens des armes à feu , eft le premier
auquel il tente d’habituer le cheval. Il fait mouvoir
ces refforts dès le matin à la porte & aux fenêtres
de l’écurie, 6c enfuite dans l’écurie même avant
la diftribution de l’avoine ou du fourrage , qui eft
auffi précédée de l’attion de flater, de careffer l’animal
, 6c de s’en approcher avec circonfpeélion,
de maniéré qu’il puifle flairer ou fentir le baffinet.
Cette manoeuvre répétée 8c continuée chaque fois
qu’on doit lui préfenter la ration de grain qui lui eft
deftinée, appaife 6c familiarife peu-à-peu ceux qui
femblent être les plus farouches, fur-tout fi l’on a
encore, 6c tandis qu’ils mangent, le foin de Iaiffer
les piftolets devant eux & dans l’auge. Alors on brûle
des amorces, en obfervant les mêmes gradations ;
& fans oublier qu’il eft d’une néceflité indifpenfable
d’accoutumer le cheval à l’odeur de la poudre, 6c
de le mettre par conféquent à portée de la recevoir.
Des amorces on en vient aux coups à poudre ; on
n’employe que la demi-charge, & les armes ne font
point bourrées. Enfin M. de la Porterie confeille de
frapper de grands coups de bâtons fur les portes,
pour fuppléer au défaut de la quantité de munition
dont les régimens auraient befoin à cet effet ; 6c la
fréquente répétition du mot feu, pour habituer l’animal
à ce commandement, qu’il redoute fouvent
autant que le feu même.
Telles font les opérations qui fe pratiquent dans
l’écurie : celles qu’il preferit enfuite dans le dehors,
concourent au même b u t , 6c ne tendent qu’à confirmer
le ch eval, 6c à le guérir de toute appréhen-
fion. On place 6c l’on affure dans un lieu convenable
, des efpeces d’auges volantes, à l’effet d’y dépofer
différentes portions d’avoine. On monte quelques
chevaux que l ’on mene à ces auges, 6c devant
lefquels marchent des hommes à pié qui font jouer
6c mouvoir les refforts des armes dont ils font munis;
6c qui arrivés dans l’endroit f ix é , les portent aux na-
feaux de ces animaux. Tandis qu’ils commencent à
manger leur a vo in e , un ou deux de ces hommes à
pié tournent autour d’e u x , 6c leur font entendre de
nouveau 6c par intervalle le bruit des refforts. On
les fait reculer encore à dix ou douze pas. Quand
ils font éloignés ainfi de l’auge, les hommes à pié
s’en approchent, meuvent les chiens 8t les platines,
pendant qu’on follicité 6c qu’on prefle les chevaux
de fe porter e n -a v a n t , 8c de revenir au lieu qu’ils
ont abandonné ; après quoi on leur permet de manger
: 8c on les interrompt de même plufieurs fo is ,
jufqu’à ce q u ’il ne refte plus rien de leur ration. On
les reconduit dans l’écurie 6c à leur place avec le
même appareil ; on les y flate, on leur p a rle , 6c on
leur fait ièntir les armes.
C ’eft avec de femblables précautions 6c de tels
procédés plus ou moins long - tems mis en ufage,
que l ’on parvient à leur ôter entièrement la crainte
6c l ’effroi que peuvent leur infpirer les amorces 6c
le b ruit deâpiftolets, moufquetons ou fufils que l ’on
décharge. Dan s la leçon qui fuit immédiatement
celle que nous venons de détailler, i l faut feulement
obferver qu’aucun grain de poudre & qu’aucun éclat
de la pierre n’atteignent le nez du ch e va l, ce qui le
ré vo ltera it, 6c le rendrait infiniment plus difficile à
réduire 6c à apprivoifer ; & dans la manoeuvre qui
confifte à tirer des coups à poudre, les armes étant
bourrées, on doit faire attention, i° de ne point les
adreffer directement fous les auges, afin de ne chaf-
fer ni terre ni gravier contre fes jambes ; z° de tenir
en-haut le bout des piftolets lorfqu’on les t ire ra , les
chevaux ayant re cu lé , pour que les bourres ne les
offenfent point 8c ne foient point dirigées vers e u x ,
8c à l’effet de les accoutumer à les v o ir enflammées,
fuppofé qu’elles tombent fur le chemin qu’ils ont à
faire pour fe rapprocher de leur avoine.
D ans les exercices, M. de la Porterie ne s’écarte
point de cet ordre ; mais foit qu’i l faffe tirer des piftolets
non-amorcés, foit qu’i l faffe brûler des amorces
, foit qu’il s’agiffe d’une véritable décharge de la
part de deux troupes v is - à - v i s l ’une de l ’autre , il
faut toûjours faire halte pour t ire r , 6c marcher en-
fuite en-avant, au lie u de faire demi-tour à droite
fur le coup ; mouvement pernicieux , & auquel les
chevaux ne font que trop difpofés au moindre objet
qui les épouvante.
D u refte nous avons fimplement ic i rendu fes
idées 6c développé fes principes, nous ne faurions
en propofer de meilleurs ; 8c nous ofons affûrer qu’i l
fuffira de les appliquer à-propos , de s’armer de la
patience qu’exige la réitération de ces leçon s, 6c
de faifir 6c de fuivre exactement l ’efprit dans lequel
i l pratique, pour réuffir pleinement dans cette partie
effentielle de l ’éducation des chevaux, (e)
F E U , ( marque de ) Manège , Maréchal. Nous appelions
de ce nom le roux éclatant quoiqu’ob fcu r,
dont eft teint & coloré naturellement le poil de certains
chevaux b a is-b ru n , à l ’endroit des flancs, du
bout du nez 6c des feffes. Ce cheval, difons nous, a
des marques de feu ; ces marques font directement
oppofées à celle du cheval b a i-b ru n , feffés lavées,
qui eft nommé a in fi, lo rfque ces mêmes parties font
couvertes d’un poil jaune , mais m o r t , éteint 8c
blanchâtre, ( e )
F e u y (mal de feu) Maréchal. Je ne fai pourquoi
les auteurs qui ont écrit fur l’Hippiatrique nomment
ainfi la fievre ardente dans le cheval ; il me femble
que les chofes devraient tirer & prendre leur dénomination
de ce qu’elles font en effet, Voye^ Fievre.
( O F eu
F e u d e j o i e , (L itté ra l.) illumination noCturne
donnée au peuple pour fpeCtacle public dans des
occafions de réjoiiiffances réelles ou fuppofees.
C ’eft une quettion encore indécife de favoir fi les
anciens , dans les fêtes publiques, allumoient des
feux par un autre motif que par efprit de religion.
Un membre de l ’académie des Belles-Lettres de Paris
foûtient la négative : ce n’eft pas qu’il nie que les
anciens ne fiffent comme nous des réjoiiiffances aux
publications de p a ix , aux nouvelles des victoires
remportées fur leurs ennemis, aux jours de naiffan-
c e , de proclamation, de mariage de leurs princes,
6c dans leur convalescence après des maladies dan-
gereufes ; mais, félon M . Mahudel, le feu< dans toutes
ces occafions ne fervoit qu’ à brûler les victimes
ou l ’encens ; 8t comme la plûpart de ces facrifices
fe faifoient la n u it , les illuminations n’étoient employées
que pour éclairer la cérémonie, 6c non pour -
d ivertir le peuple.
Quant aux bûchers qu’on élevoit après la mort
des empereurs, quelque magnifique s qu’ils fuffent,
on conçoit bien que ce fpeCtacle lugubre n’avoit aucun
rapport avec des feux de joie. D ’un autre côté,
quoique la pompe de la marche des triomphes fe terminât
toûjours par un facrifice au capitole, où un
feu allumé pour la confécration de la viCtime l ’at-
tendoit ; ce feu ne peut point palier pour un feu de
joie : enfin par rapport aux feux d’artifices qui étoient
en ufage parmi les anciens , 8c qu’on pourrait préfumer
avoir fait partie des réjoiiiffances publiques,
M . Mahudel prétend qu’on n’en vo it d’autre emploi
que dans les feules machines de guerre, propres à
porter l’incendie dans les v ille s 8c dans les bâtimens
ennemis.
Mais toutes ces raifons ne prouvent point que les
anciens n’allumaflent auffi des feux de joie enfigne
de réjoiiiffances publiques. En effet, il eft difficile
de fe perfuader que dans toùtes les fêtes des Grecs
8c des Romains , 6c dans toutes les célébrations de
leurs je u x , les feux 6c les illuminations publiques fe
rapportaffent toûjoiirs uniquement à la religion, fans
que le peuple n’y prît part à-peu-près comme parmi
nous.
Dans les Iampadophories des Grecs , où l ’on fe
fervoit de lampes pour les facrifices, on y célébroit
pou r le peuple différens jeux à la lueur des lampes;
8c comme ces jeux étoient accompagnés de danfes
6c de divertiffemens , on vo it que ces fortes d’illu minations
étoient en même tems prophanes 6c famées.
L ’appareil d’une autre fête nommée lamptè-
ries, qui fe faifoit à Pallene , 8c qui étoit dédiée à
Bacchus , confiftoit en une grande illumination nocturne
& dans une profufion de v in qu’on verfoit aux
paffans.
I l faut dire la même chofe des illuminations qui
entraient dans la folennité de plufieurs fêtes des Romains
, 8c entr’autres dans celle des jeux féculaires
qui duraient trois n uits, pendant lefquelles il fem-
bloit que les empereurs & les édiles qui en faifoient
la dépenfe, vouluffent, par un excès de fomptuofi-
î é , dédommager le peuple de la rarete de leur célébration.
Capitolin obferve que l’illumination que
donna Philippe, dans les jeux qu’il célébra à ce fu-
je t , fut fi magnifique, que ces trois nuits n’eurent
point d’obfcurité.
On n’a pas d’exemple de feu de joie plus remarquable
que celui que Paul Emile , après la conquête de
la Macédoine, alluma lui-même à Amphipolis , en
préfence de tous les princes de la G rece qu’i l y avoit
invités. La décoration lui coûta une année entière
de préparatifs ; 8c quoique l’appareil en eût été compote
pour rendre hommage aux dieux qui préfi-
doient à la v ir io ire , cette fête fut accompagnée de
tous les fpeélacles auxquels le peuple eft lenfible.
Tome V f
Enfin depuis les derniers fiecles du paganifme,
on pourrait citer plufieurs exemples de feux allumés
pour d’autres fujets que pour des cérémonies facrées.
Saint Bernard remarque que le feu de la ve ille de S.
Jean-Baptifte continué jufqu’à nos jo u r s , fe prati-
quoit déjà chez les Sarrafins 8c chez les T urc s. I l femble
réfulter de ce détail, qu’on peut dater l ’ufage des
feux de joie de la première antiquité , 6c par conféquent
long-tems avant la découverte de la poudre,
qui feulement y a joint les agrémens des feux d'artifice
, qu’on y employé avec grand fuccès dans nos
feux de joie , malgré le v e n t , la p lu ie , les eaux courantes
6c profondes.
Au fu rp lu s , quel que foit le mérite de nos illuminations
modernes, i l ne s’en eft point fait dans le
monde qui ait procuré de plaifir pareil à celui du
fimple feu d’Hadrien. C e prince ordonna qu’on le
préparât dans la place de Trajan , 6c que le peuple
romain fût invité de s’y rendre. L à , dit D io n ,
(liv. LXXIX. ) l ’empereur, en préfence de la v ille
entière, annula toutes fes créances fur les provinces
, en b rû la, dans le feu qu’il avoit commandé, les
obligations 6c les mémoires,afin qu’on ne pût craindre
d’en être un jo u r recherché, & enfuite il fe retira pour
Iaiffer le peuple libre de célébrer fes bienfaits. Ils
montoient à une fomme immenfe, que des perlon-
nes habiles à réduire la valeur des monnoies de ce
tems-là, évaluent à environ 133 millions 5 0 am illes
livres argent de France (1 7 5 6 ) . Auffi la mémoire
de cette belle aûion ne périra jamais , puifqu’elle
s’eft confervée dans les hiftoriens , les inscriptions,
6c les médailles. Voyeç Mab illo n , analecl. tom. IV,
pag. 484 & 48G. Onuphre, in fafiis , pag. 220. Spa-
nheim de numifmat. pag. 811.6cc. Mais comme cette
libéralité n’avoit point eu d’exemple jufqu’alors dans
' aucun fouverain , il faut ajoûter à la honte des fou-
verains de la terre , qu’elle n’a point eu depuis d’imitateurs.
Article de M. le Chevalier DE JAU COU RT.
F e u S A C R É , (Littéral.) b r a f i e r q u ’ o n c o n f e r V o i t
t o û j o u r s a l lu m é d a n s l e s t em p l e s , 6c d o n t l e f o i n
é t o i t c o n f i é a u x p r ê t r e s o u a u x p r ê t r e f f e s d e l a r e l i -
g i o n .
I l n’eft pas furprenantque des hommes, qui ne con-
fultoient que les effets qui s’opèrent dans la nature ,
ayent adoré le Soleil comme le créateur 8c le maître
de l’univers. Le culte du feu fu ivit de près celui qu’on
rendit au Soleil ; v iv e image de cet aftre lumineux
6c le plus pur des élémens , il s’attira /les efpeces
d’adorations de tous les peuples du monde, 8c
devint pour eux un grand objet de refpe&, ou pour
mieux dire , un infiniment de terreur. L ’Ecriture
nous enfeigne que D ie u s’en eft fervi de ces deux
maniérés. Tantôt le Seigneur fe compare à un feu
ardent pour defigner fa fainteté ; tantôt il fe rend vi-
fible fous l ’apparence d’un buiffon enflammé , ou
formidable par des menaces d’un feu dévorant, 6c
par des pluies de foufre ; quelquefois avant que de
parler aux Juifs, i l faifit leur attention par dés éclairs ;
6c d ’autres fois marchant, pour ainfi d ire , avec fon
peuple, il fe fait précéder d’une colonne de feu.
Les rois d’Afie, au rapport d’Hérodote, faifoient
toûjours porter du feu devant eux : Ammien Marcellin
, parlant de cette coûtume , la tire d’une tradition
qu’avoient ces ro is , que le feu qu’ils confer-
voient pour cet ufage, étoit defeendu du ciel : Quin-
te-Curce ajoûte que ce feu façré & éternel etoit auffi
porté dans la marche de .leurs armées à la tete des
troupes fur de petits autels d’argent, au milieu des
mages qui chantoient les cantiques de leur pays.
Ainfi la vénération pour le feu fe répandit chez
toutes les nations, qui toutes l ’envifagerent cpmme
une chofe facrée , parce que le même efprit de la
nature regnoit dans leurs rites 6c leur culte extérieur.
On ne voyoit alors aucun facrifiçe , aucune
M M m m