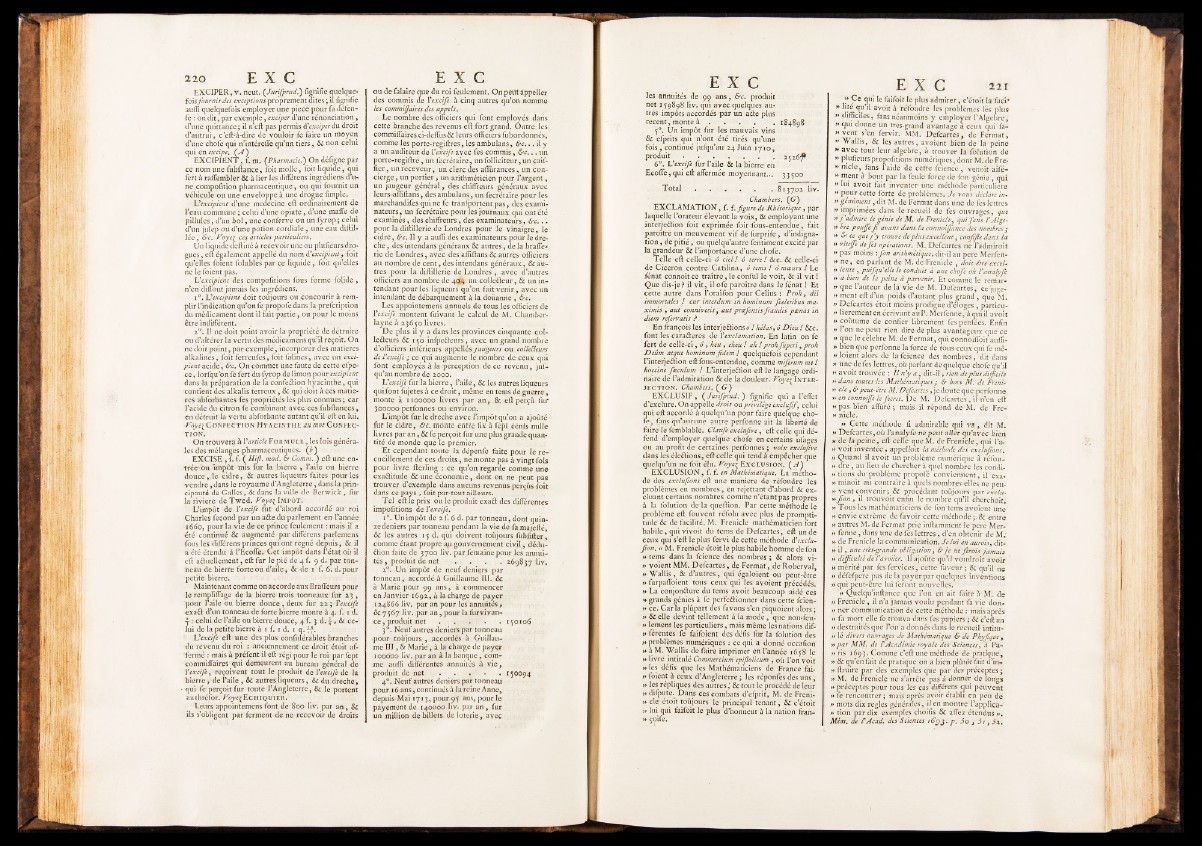
EXCIPER, v . neut. ('Jurifprud.) fignifie quelquefois
fournir des exceptions proprement dites ; il lignine
auffi quelquefois employer une piece pour fa défen-
fe : on dit, par exemple, exciper d’une rénonciation,
d’une quittance; il n’eft pas permis # exciper du droit
d’autrui, c ’eft-à-dire de vouloir fe faire un moyen
d’une chofe qui n’intéreffe qu’un tiers, & non celui
qui en excipe. (A )
EXCIPIENT, f. m. (Pharmacie.) On défigne par
ce nom une fubftance, foit molle, foit liquide, qui
fert à raffembler & à lier les différens ingrediens d’une
compofition pharmaceutique, ou qui fournit un
véhicule ou une enveloppe à une drogue fimple.
Vexcipient d’une medecine eft ordinairement de
l’eau commune ; celui d’une opiate, d’une maffe de
pillules, d’un b o l, une conferve ou un fyrop ; celui
d’un julep ou d’une potion cordiale, une eau diftil-
lé e , &c. Voye%_ ces, articles particuliers.
Un liquide deftiné à recevoir une ou plufieurs drogues
, eft également appellé du nom d’excipient, foit
qu’elles foient folubles par ce liquide, foit qu’elles
ne le foient pas.
L’excipient des compositions fous forme folide ,
n’en diflout jamais les ingrédiens.
i° . Vexcipient doit toûjours ou concourir à remplir
l’indication qu’on fe propofe dans la prefcription
du médicament dont il fait partie, ou pour le moins
être indifférent.
2°. Il ne doit point avoir la propriété de détruire
ou d’altérer la vertu des médicamens qu’il reçoit. On
ne doit point, par exemple, incorporer des matières
alkalines, foit ferreufes, foit falines, avec un excipient
acide, &c. On commet une faute de cette efpe-
c e , lorfqu’on fe fert du fyrop de limon pour excipient
dans la préparation de la confettion hyacinthe, qui
•contient des alkalis terreux, & qui doit à ces matières
abforb'antes fes propriétés les plus connues ; car
l’acide du citron fe combinant avec ces fubftances,
en détruit là vertu abforbante autant qu’il eft en lui.
'Voye^ C o n f e c t io n Hy a c in t h e au mot C o n f e c t
io n .
On trouvera à 1’'article Fo r m u l e , les lois générales
des mélanges pharmaceutiques. (b)
EX C ISE , f. f. ( Hijl. mod. & Comm..) eft une entrée’ou
Impôt mis îur la bierre 9 l’aile ou bierre
douce, le cidre, & autres liqueurs faiies pour les
vendre, dans le royaume d’Angleterre, dans la principauté
de Galles, dedans la ville de Berwick, fur
la rivière de Twed. Voye^ Im p ô t .
L’impôt de Vexcife fut d’abord accordé au roi
Charles fécond par un atte du parlement en l’année
ii66o, pour la v ie de ce prince feulement : mais il a
oté continué & augmenté par différens parlemens
fous les différens princes qui ont régné depuis, & il
à été étendu à l’Ecoffe.' Cet impôt dans l’état où il
eft attuellement, eft fur le pié de 4 f. 9 d. par tombeau
de bierre forte où d’aile, & de 1 f. 6. d.pour
petite bierre.
Maintenant comme on accorde aux Braffeurs pour
le rempliffage de la bierre trois tonneaux fur 13 ,
pour l’aile ou bierre douce, deux fur 22 ; Vexcife
exatt d’un tonneau de forte bierre monte à 4. f. 1 d.
- : celui de l’aile ou bierre douce, 4 f. 3 d* \ * & celui
de la petite bierre à 1 f. 1 d. 1 q. f£.
Vexcife eft une des plus confidérables branches
du revenu du roi : anciennement ce droit étoit affermé
: mais à préfent il eft régi pour le roi par fept
commiffaires qui demeurent au bureau général de
Vexcife 9 reçoivent tout le produit de Vexcife de la
b ie r r e d e l’a ile , & autres liqueurs, 8c du dreche,
qui fe perçoit fur toute l’Angleterre, 8c le portent
authréfor. Voye^E c h iq u i e r .
Leurs appointemens font de 800 liv. par an , &
ils s’obligent par ferment de ne recevoir de droits
ou de falaire que du roi feulement. On petit âppeller
des commis de Vexcife à cinq autres qu’on nomme
les commijjaires des appels.
Le nombre des officiers qui font employés dans
cette branche des revenus eft fort grand. Outre les
commiffaires ci-deffus 8c leurs officiers fubordonnés,
comme les porte-regiftres, les ambulans, &c. . . il y
a un auditeur de Vexcife avec fes commis, & c .. . un
porte-regiftre, un fecrétaire, un folliciteur, un caif-
fier , un receveur, un clerc des affûrances, un concierge
, un portier , un arithméticien pour l’argent,
un jaugeur général, des chiffreurs généraux avec
leurs «affiftans, des ambulans, un fecrétaire pour les
marchandifes qui ne fe tranfportent pas, des examinateurs,
un fecrétaire pour les journaux qui ont été
examinés, des chiffreurs, des examinateurs, &c. . .
pour la diftillerie de Londres pour le vinaigre, le
cidre, &c. Il y a auffi des examinateurs pour le dre-
che, des intendans généraux 8c autres, de la braffe-
rie de Londres, avec des affiftans 8c autres officiers
au nombre de cent, des intendans généraux, 8c autres
pour la diftillerie de Londres , avec d’autres
officiers au nombre de 40^ un colletteur, & un intendant
pour les liqueurs qu’on fait v en ir , avec un
intendant de débarquement à la doiianne , &c.
Les appointemens annuels de tous les officiers de
Vexcife montent fuivant le calcul de M. Chamber-
layne à 23650 livres.
De plus il y a dans les provinces cinquante col-
lefteurs ôc 150 infpetteurs, avec un grand nombre
d’officiers inférieurs appellés jaugeurs ou collecteurs
de Vexcife ; ce qui augmente le nombre de ceux qui
font employés à la perception de ce revenu, juf-
qu’au nombre de 2000.
Vexcife fur la b ierre, l’aile, & les autres liqueurs
qui font fujetes à ce d roit, même en tems de guerre,
monte à 1100000 livres par an, & eft perçu fuf
300000 perfonnes ou environ.
L’impôt fur le dreche avec l’impôt qu’on a ajouté
fur le cidre, &c. monte entre lix à fept cents mille
livres par an , & fe perçoit fur une plus grande quantité
de monde que le premier.
Et cependant toute la dépenfe faite pour le recueillement
de ces droits, ne monte pas à vingt fols
pour livre ftérling : ce qu’on regarde comme une
exattitude & une économie, dont on ne peut pas
trouver d’exemple dans aucuns revenus perçûs foit
dans ce pa ys* foit par-tout ailleurs.
Tel eft le prix ou le produit exatt des différentes
impofitions de Vexcife.
i°. Un impôt de 2 f. 6 d. par tonneau, dont quinze
deniers par tonneau pendant la vie de fa majefté
& les autres 15 d. qui doivent toûjours fubfifter,
comme étant propre an gouvernement c iv il, dédu-
ttion faite de 3700 liv. par femaine pour les annui-
.tés, produit de net . . , . 269837 liv .
29-. Un impôt de neuf deniers par
tonneau, accordé à Guillaume III. 8c
à Marie pour 99 ans, à commencer
en Janvier 1692, à la charge de payer
124866 liv. par an pour les annuités*
& 7567 liv. par an, pour la furvivan- ce, produit net . . 150106
3 0. Neuf autres deniers par tonneau
-pour toûjours , accordés à Guillaume
III, & Marie ; à la charge de payçr
iooqoo liv. par an à la banque, comme
auffi différentes annuités à v ie ,
prodûit de n e t .................................150094
40. Neuf autres deniers par tonneau
pour 16 ans, continués à la reine Anne,
depuis Mai 1713, pour 9 5 ans, pour le
payement de , 140000 liv« par an , fur
un million de billets de loterie, avec
les annuités de 99 ans, &c. produit
net 159898 liv. qui avec quelques autres
impôts accordés par un atte plus
recent, monte à . . . . . 184898
50. Un impôt fur les mauvais vins
& efprits qui n’ont été tirés qu’une
fois , continué jufqu’au 24 Juin 1710 ,
produit . . . . . . . i 52
6°. Vexcife fur l’aile & la bierre en
Ecoffe, qui eft affermée moyennant... 33 500
Total . . . . . . 813702 liv.
Chambers. (G)
EXCLAMATION, f. f. figure de Rhétorique, par
laquelle l’orateur élevant la voix, & employant une
interjettion paroître un mfooitu veexmpreinmt évei ff odiet ffuorupsr-iefnet,e ndd’iuned,i gfnaait
tion , de pitié, ou quèlqu’autre fentiment excité par
la grandeur 8c l’importance d’une chofe.
Telle eft celle-ci' d ciel! 6 terre! &c. & celle-ci
de Cicéron contre Catilina, ô tems ! ô moeurs ! Le
fénat connoît ce traître, le conful le voit, & il vit !
Que dis-je ? il v it, il ofe paroître dans le fénat ! Et
cette autre dans l’oraifon pour Celius : Proh, dii
immortales ! cur interdum in. hominum feeleribus ma-
ximis , aut connivetisf aut prafentis fraudis panas in
diem refervatis ?
En françois les iriterjettions 0 ! hélas, ô Dieu ! 8cc.
font les caratteres de Vexclamation. En latin on fe
fert de celle-ci, ô , heu, ch tu ! ah ! proh fuperi, proh
Deûm atque hominum fidem ! quelquefois cependant
l’interjettion eft fous-entendue, comme miferum me !
hoccine fceculum ! L’interjettion eft le langage ordinaire
de l’admiration & de la douleur. Koyeç Interje
c t io n . Chambers. ( G )
d’eExcXlCurLeU. OSInF a p, p(e lJleu rifprud. ) lignifie qui a l’effet droit ou privilège exclufif, celui
qui eft accordé à quelqu’un pour faire quelque choffaei,
r ef alnes f eqmu’baluacbulen.e autre perfonne ait la liberté de Claufe exclufive, eft celle qui défoeun
da ud ’permofpitl odyee rc eqrutaeilnqeuse pcehrofofen neens ;c ertains ufages voix exclufive qduaneslq lues’u énl enteti ofonist ,é eluft. celle qui tend à empêcher que Voye^ Exclusion. ( A )
EXCLUSION, f. f. en Mathématique. La méthode
des exclufions éft une maniéré de' réfoudre les
problèmes en nombres, en rejettant d’abord & excluant
certains nombres comme n’étant pas propres
à la folution de la queftion. Par cette méthode le
problème eft fouvent réfolu avec plus de promptitude
8c de facilité. M. Frenicle mathématicien fort
habile, qui v ivoit du tems de Defcartes, eft un de
ceux qui s’eft le plus fervi de cette méthode d’exclu-
fion. « M. Frenicle étoit le plus habile homme de fon
» tems dans la fcience des nombres ; & alors vi-
» voient MM. Defcartes, de Fermât, de Roberval,
» Wallis , & d’autres, qui égaloient ou peut-être
» furpaffoient tous ceux qui les avoient précédés.
» La conjonfture du tems avoit beaucoup aidé ces
» grands génies à fe perfettionner dans cette feien-
» ce. Caria plûpart des favans s’en piquoient alors ;
» 8c elle devint tellement à la mode, que non-feu-
» lement les particuliers, mais même les nations dif-
» férentes fe faifoient des défis fur la folution des
» problèmes numériques : ce qui a donné occafion
» à M. Wallis de faire imprimer en l’année 1658 le
» livré intitulé Commercium epiflolicum , où l’on voit
» les défis que les Mathématiciens de France fai-
» foient à ceux d’Angleterre ; les réponfes des uns,
» les répliques des autres ÿ 8c tout le procédé de leur
» difpute. Dans ces combats d’efprit, M. de Freni-
» ele étoit toûjours le principal tenant, & c’étoit
» lui qui faifoit le plus d’honneur à la nation fran-
» çoife.
f , S11* *e feifoit le plus admirer, c’étoit la faci-*
» Iité qu’il avoit à refondre les problèmes les plus
» difficiles, fans néanmoins y employer l’Algebre,
» qui donne un très-grand avantage à ceux qui fa-
» vent Ven fervir. MM. Defcartes, de Fermât,
» Wallis, & les autres, avoient bien de la peine
» avec tout leur algèbre, à trouver la folution de
» plufieurspropofitions numériques, dont M. de Fre-
« nicle, fans l’aide de cette feiencè , ■ venoit aifé-
» ment à bout par la feule force de fon génie , qui
» lui avoit fait inventer une méthode particulière
>> pour cette forte de problèmes. Je vous déclare in-
» genument, dit M. de Fermât dans une de fes lettres
»imprimées dans le recueil de fes ouvrages, que
»j'admire le génie de M. de Frenicle, qui fans l'Alge-
» bre pouffe fit avant dans la Connoiffance des nombres;
» o- ce que j 'y trouve de plus excellent, conjijle dans la
» vîteffe de fes opérations. M. Defcartes ne l’admiroit
» pas moins : fon arithmétique, dit-il au pere Mèrfen-
» n e , en parlant de M. de Frenicle , doit être excel-
» lente , ptiifqu'elle le conduit à une chofe où l'analyfe
» a bien de la peine à parvenir. Et comme le remar-
» que l’auteur de la vie de M. Defcartes , Ce juge-
» ment eft d’un poids d’autant plus grand, que M.
» Defcartes étoit moins prodigue d’éloges , particu-
» lierement en écrivant au P. Merfenne, à qui il avoit
» coûtume de confier librement fes penfées. Enfin
» l’on ne peut rien dire de plus avantageux que ce
» que le célébré M. de Fermât, qui connoiffoit auffi-
» bien que perfonne la force de tous ceux qui fe mê-
» loient alors de la fcience des nombrès, dit dans'
» line de fes lettres, où parlant de quelque choie qu’il
» avoit trouvée : I l n'y a , dit-il, rien de plus difficile
» dans toutes les Mathématiques ; & hors M. de Freni-
» cle, & peut-être M. Defcartes, je doute que perfonne
» en connoiffe le fecret. De M. Defcartes, il n’en eft
» pas bien affûré ; mais il répond de M. de Fre-
» nicle.
» Cette méthode fi admirable qui v a , dit M.
» Defcartes, où l’analyfe ne peut aller qu’avec bien
h de la p eine, eft celle que M. de Frènicle, qui l’a-
» voit inventée , appelloit la méthode des exclufions.
» Quand il avoit un problème numérique à réfou-
» dre, au lieu de chercher à quel nombre les condi-
» tions du problème propofé conviennent, il exa-
» minoit au contraire à quels nombres elles ne peu-
» vent convenir; & procédant toujours par exclu.
» fion , il trouvoit enfin le nombre qu’il cherchoit,
» Tous les mathématiciens de fon tems avoient une
» envie extrême de favoir cette méthode entre
» autres M. de Fermât prie inftamment le pere Mer*
» fenne, dans une de fes lettres, d’en obtenir de M;
» de Frenicle la communication. Je lui en durois, dit-
» i l , une très-grande obligation, & je ne fitrois jamais
» difficulté de Vavoiier. Il ajoûte qu’il vôudroit avoir
» mérité par fes fervices, cette faveur ; & qu’il ne
» défefpere pas de la payer par quelques inventions
» qui peut-être lui feront nouvelles.
» Quelqu’inftance que l’on en ait faitè à M. de
» Frenicle , il n’a jamais voulu pendant fa vie don-
» ner communication de cette méthode : mais après
» fa mort elle fe trouva dans fes papiers ; & c’en un
» destraités que l’on a donnés dans le recueil intitu-
» lé divers ouvrages de Mathématique & de Pkyfique ,
» par MM. de VAcadémie royale des Sciences, d Pa-
» ris 1693. Comme c’eft une méthode de pratique,
» & qu’en fait de pratique on a bien plutôt fait d’in»
» ftruire par des exemples que par des préceptes ;
» M. de Frenicle ne s’arrête pas à donner de longs
» préceptes pour tous les cas différens qui peuvent
» fe rencontrer ; mais après avoir établi en peu de
» mots dix réglés générales, il en montre l’applica-
» tion par dix exemples choifis & affez étendus ».
Mém. de l'Acad. des Sciences 1C93. p. 5o , 51 , S%.