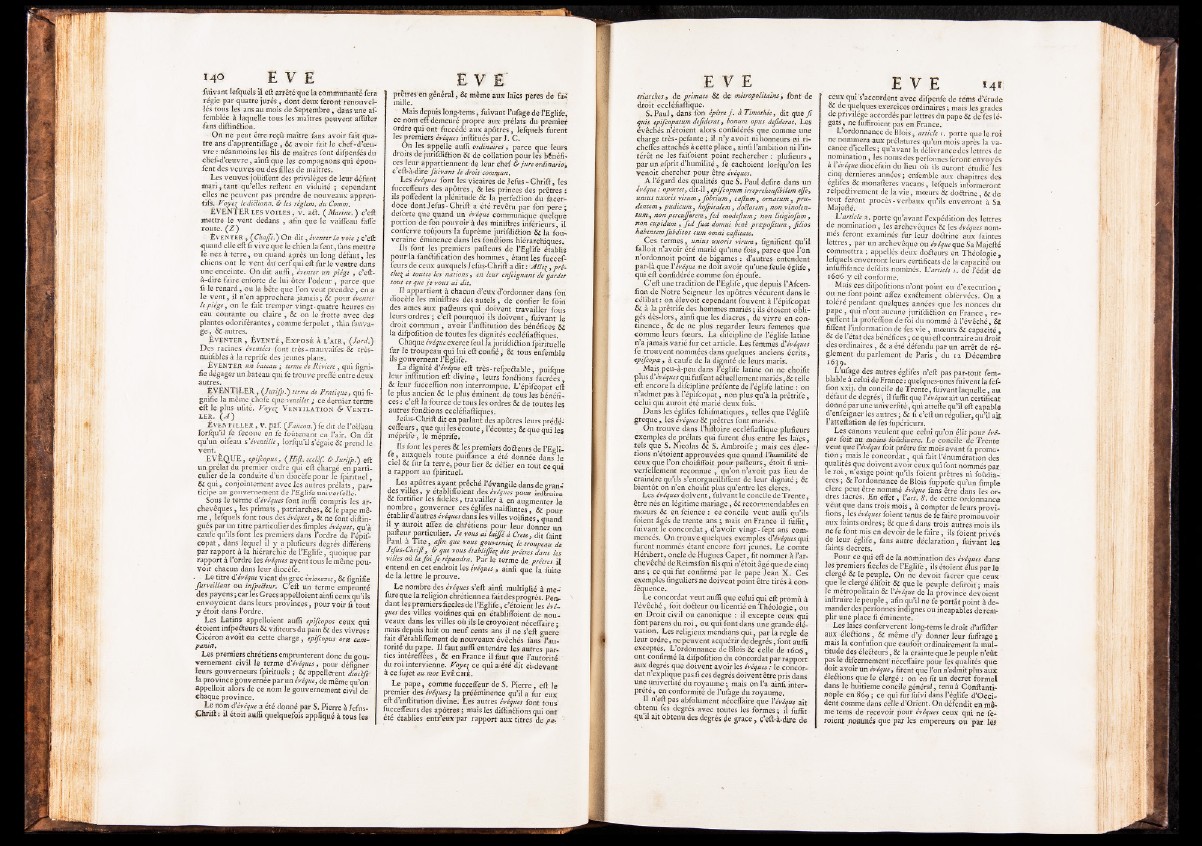
fuivant lefquels il eft arrêté que la communauté fera
régie par quatre ju rés, dont deux feront renouvela
lés tous les ans au mois de Septembre, dans une af-
femblée à laquelle tous les maîtres peuvent aflifter
fans diftinâion.
On ne peut être reçû maître fans avoir fait quatre
ans d’apprentiflage , avoir fait le chef-d'oeuvre:
néanmoins les fils de maîtres font difpenfés du
chef-d’oe uv re, ainfi que les compagnons qui épou-
fent des veuves ou des filles de maîtres.
Les veuves joüilfent des privilèges de leur défunt
mari, tant qu’elles relient en viduité ; cependant
elles ne peuvent pas prendre de nouveaux appren-
tifs. Voyt7^ ledictionn, & les réglem. du Comm.
ÉVENTER les voiles, v . a â . (Marine.) c’eft
mettre le vent dedans , afin que le vaiffeau faffe
route. ( Z )
É Éventer , ( Chaffe.) On dit, éventer la voie ; c ’eft'
•quand elle eft fi vive que le chien la fent,fans mettre
le nez à terre, ou quand après un long défaut, les
chiens ont le vent dif cerf qui eft fur le ventre dans
une enceinte. On dit aufii, éventer un piège , c’eft-
à-dire faire enforte de lui ôter l’odeur , parce que
fi le renard, ou la -bête que l’on veut prendre, en a
le vent, il n’en approchera jamais ; & pour éventer
le piège, on le fait tremper vingt-quatre heures en
eau courante ou claire , & on le frotte avec des
plantes odoriférantes , comme ferpolet, thin fauVa-
ge , & autres.
ÉVENTER , ÉVENTÉ , EXPOSÉ À l ’à IR, (Jard.)
Des racines éventéesfont très - mauvaifes 8c très-
nuifibles à la reprife des jeunes plans.
ÉVENTER un bateau ; terme de Riviere , qui figni-
fie dégager un bateau qui fe trouve preffé entre deux
autres.
ÉVENTILER, (Jurifp.) terme de Pratique, qui lignifie
la mêmechofe qu e-ventiler ; ce. dernier terme
eft le plus ufité, Voyez Ventilation & Ventiler.
(A )
Ê V ÏN TH 1E E , V. paf. ( P m c o n . ) fe < & de l ’oifeau
lorfqu’il fe fecoue en fe lôûtenant en l’air. On dit
qii’un oifeau s ’èventille, lorfqu’il s’égaie 8c prend le;
vent.
EVÊQUE , epifcopus, (Hiß. ecclèf. & Jurifp.) eft |
un, prélat du premier ordre qui eft chargé en particulier
de la conduite d’iin diocèfe pour le fpirituel, j
& qui, conjointement avec les autres prélats, participe
au gouvernement de YEglife univerfelle.
Sous le terme dé évêques font auffi compris les archevêques
, les primats, patriarches, 8c le pape même
, lefquels font tous des évêques , & ne font diftin-
gués par un titre particulier des finiples évêques, qu’à
calife qu’ils font les premiers dans l’ordre de l’épif-
copat, dans lequel il y a plufieurs degrés différens
par rapport à la hiérarchie de l’Eglife, quoique par
rapport à l’ordre les évêques ayent tous le même pouvoir
chacun dans leur diocèfe.
. Le titre $ évêque vient du grec imtrzowoc, & lignifie
furveillant ou infpecleur. C ’eft un terme emprunté
des payens ; car les Grecs appelloient ainfi ceux qu’ils
envoyoient dans leurs provinces, pour voir fi tout
y étoit dans l’ordre.
Les Latins appelloient aufii epifcopos ceux qui
étoient infpeâeurs 8c vifiteurs du pain 8c des vivres :
Cicéron avoit eu cette charge, epifcopus orce cam-
panice.
Les premiers chrétiens empruntèrent donc du gouvernement
civil le terme d’évêques, pour défigner
leurs gouverneurs fpfrituels ; 8c appellerez diocèfe'
la province gouvernée par un évêque, de même qu’on
appelloit alors de ce nom le gouvernement civil de
chaque province.
n°m déèvêque a été donné par S. Pierre à Jefus-
„Chrift : il étoit aufii quelquefois appliqué à tous les
; prêtres en gênerai, & même aux laïcs pères de fa*
mille.
Mais depuis long-tems, fuivant I’ufage de fEglife,
ce nom eft demeuré propre aux prélats du premier
ordre qui ont fuccédé aux apôtres, lefquels furent
les premiers évêques inftituéspar J. C.
On les appelle aufii ordinaires, parce que leurs
droits de jurifdiâion 8c de collation pour les bénéfices
leur appartiennent de leur chef & jure ordinario,
c efbà-dire fuivant le droit commun.
Les évêques font les vicaires dé Jefus-Chrift, les
fuccèfleurs des- apôtres, & les princes des prêtres i
ils pofledent la plénitude 8c la perfection du facer-
doce dont Jefus-Ghrift a été revêtu par fon pere ;
deforte que quand un évêque communique quelque
portion de fon pouvoir^à des miniftres inférieurs, il
conferve toujours la fuprème jurifdiâion & la foui
veraine éminence dans les fonctions hiérarchiques.
Ils font les premiers pafteurs de l’Eglife établis
pour la. fanâification des hommes, étant les fuccef-
feurs de ceux auxquels Jefùs-Chrift a dit : Allez, prêchez
à toutes les nations, en leur enfeignant de garder
tout ce que je vous ai dit.
Il appartient à chacun d’eux d’ordonner dans fon
diocèfe les miniftres des autels , de confier le foin
des âmes aux pafteurs qui doivent travailler fous
leurs ordres ; c’eft pourquoi ils doivent, fuivant le
droit commun, avoir FinftitutiOn dès bénéfices 8c
la difpofition de toutes les dignités eccléfiaftiqties.
Chaque évêque exerce feul la jurifdiâion fpirituelle
fur le troupeau qui lui eft confié, 8c tous enfemble
ils gouvernent l ’Eglife.
La dignité déèvêque eft très-refpeâable, puifque
leur inftitution eft divine, leurs fondions facrées ,
& leur fucceflion non interrompue. L ’épifcopat eft
le plus ancien 8c le plus éminent,de tous les bénéfices
: c’eft la fource de tous les ordres 8c de toutes les
autres fondions eccléfiaftiqiies;
Jefus-Chrift dit en parlant des apôtres leurs prédé-
ceffeifrs, que qui les écoute, l’écoute ; 8c que qui les
meprife , le méprife.
Ils font lés pere's & les premiers dofteurs de l’E d i-
| ? alix3u®is ■ "«te puiffance a été donnée dans le
ciel oc fur la terr è, pour lier 8c délier en tout ce qui
a rapport au fpirituel. n
Les apôtres ayant prêché l ’évangile dans de grandes
villes, y etabliffoient des évêques pour inftruire
& fortifier les fideles, travailler à en augmenter le
nombre, gouverner ceséglifesnaiflantes, & pour
établir d’autres évêques dans les villes voifines, quand
il y auroit affez de chrétiens pour leur donner un
pafteur particulier. Je vous ai laijfé à Crete, dit faint
Paul à Tite , afin que vous gouverniez le troupeau do
Jefus-Chrift, & que vous êtablijjie{ des prêtres dans les
villes ou la fo i fe-répandra. Par le terme de. prêtres il
entend en cet endroit les , ainfi que la fuite
de la lettre le prouve.
Le nombre des évêques s’eft ainfi multiplié à me-
fure que la religion chrétienne a fait des progrès. Pendant
les premiers fiecles de l’Eglife, c’étoient les évêques
des villes voifines qui en établifloient de nouveaux
dans les v illes oii ils le croyoient néceflaire *
mais depuis huit ou neuf cents ans il ne s’eft guere
fait d’établiflement de nouveaux évêchés fans l’autorité
du pape. Il faut aufii entendre les autres parties
intéreflees, & en France il faut que l’autorité
du roi intervienne. Voye^ ce qui a été dit ci-devant à ce fujet au mot Evêché.
Le pape, comme fuccefleur de S. Pierre, eft le
premier des évêques i la préëiriinence qu’il a fur eux
eft d’inftitution divine. Les autres évêques font tous'
fuccefleurs des apôtres ; mais les diftin&ions qui ont
été établies entr’eux par rapport aux titres de patriarches
, de primais & de métropolitains, font de
droit eccléfiaftique.
S. P aul, dans fon èpître j . àTimothée, dit que f i
quis epifeopatum defiderat, bonum opus defiderat. Les
évêchés n’étoient alors confidérés que comme une
charge très-pefante ; il n’y avoit ni honneurs ni ri-
chefles attachés à cette place, ainfi l’ambition ni l’intérêt
ne les faifoient point rechercher : plufieurs ,
p„ar un efprit d’humilité, fe cachoient lorfqu’on les
yenoit chercher pour être évêques.
À l’égard des qualités que S. Paul defire dans un
évêque : oportet, dit-il, epifeopum irreprehenfibilem ejfe,
unius uxoris virum , fobrium, caftum , ornatum, pru-
dentem, pudicum, hofpitalem, doclorem , non vinolen-
tum, non pereufforem , fed modeftum j non litigiofum,
non cupidum, fed fuce domui benè proepofitum, filios
habentem fubditos cum omni caftitate.
Ces termes, unius uxoris virum, lignifient qu’il
falloit n’avoir été marié qu’une fois, parce que l’on
n’ordonnoit point de bigames : d’autres entendent
par-là que Y évêque ne doit avoir qu’une feule égiife,
qui eft çonfidérée comme fon époufe.
C ’eft une tradition de l’Eglife, que depuis l’Afcen-
fion de Notre Seigneur les apôtres vécurent dans le
célibat : on élevoit cependant fouvent à l’épifcopat
& à la prêtrife des hommes mariés ; ils étoient obligés
dès-lors, ainfi que les diacres, de vivre en continence
, & de ne plus regarder leurs femmes que
comme leurs foeurs. La difeipline de l’églife latine
n’a jamais-varié fur cet article. Les femmes d'évêques
fé trouvent nommées dans quelques anciens écrits,
tpifcopte, à caufe de la dignité de leurs maris.
Mais peu-à-peu dans l’églife latine on ne choifit
plus dû évêques qui fuflent afruellement mariés, & telle
eft encore la difeipline préfente de l’églife latine : on
n’admet pas à l’épifçopat, non plus qu’à la p rêtrife,
celui qui auroit été marié deux fois. '
Dans les églifes fehifmatiques, telles que l’églife
greque, les évêques & prêtres font mariés.
On trouve dans l’hiftoire eccléfiaftique plufieurs
exemples de prélats qui frirent élus entre les laïcs,
tels que S. Nicolas & S. Ambroife ; mais ces élee- ■
tions n’étoient approuvées que quand l’humilité de
ceux que l’on choififloit pour pafteurs, étoit fi universellement
reconnue , qu’on n’avoit pas lieu de
craindre qu’ils s’enorgueilliflent de leur dignité ; ôc
bientôt on n’en choifit plus qu’entre les clercs.
Les évêques doivent, fuivant le concile de Trente,
être nés en légitime mariage, 8c recommendables en
moeurs & en fcience : ce concile veut auffi ou’ils
foient âgés de trente ans ; mais en France il fuffit,
fuivant le concordat, d’avoir vingt -fept ans commencés.
On trouve quelques exemples dé évêques qui
frirent nommés étant encore fort jeunes. Le comte
Héribert, oncle de Hugues C apet, fit nommer à l’archevêché
de Reims fon fils qui n’étoit âgé que de cinq
ans ; ce qui fut confirmé par le pape Jean X . Ces
exemples finguliers ne doivent point être tirés à con- j
fréquence..
Le concordat veut auffi que celui qui eft promû à !
l’évêché, foit dofreur ou licentié en Théologie, ou j
en Droit civil ou canonique : il excepte ceux qui
font parens du ro i, ou qui font dans une grande élévation.
Les religieux mendians qui, par la réglé de
leur ordre, ne peuvent acquérir de degrés ; font auffi
exceptés. L ’ordonnance de Blois & celle de 1606
ont confirmé la difpofition du concordat par rapport
aux degrés que doivent avoir les évêques : le concor- -
dat n’explique pas fi ces degrés doivent être pris dans
une univerfité du royaume ; mais on l’a ainfi interprète,^
en conformité de l’ufage du royaume.
Il n.eft pas abfolument néceflaire que Y évêque ait
obtenu fes degrés avec toutes les formes ; il fuffit
qu’il ait obtenu des degrés de grâce, c’eft-à-dire de
ceux qui s’accordent avec difpenfe de tems d’étude
& de quelques exercices ordinaires ; mais les grades
de privilège accordés par lettres dû pape 8c de fes légats
, ne fuffiroient pas en France.
L ordonnance de Blois, article 1. porte que le rot
ne nommera aux prélatures qu’un mois après la vacance
d icelles ; qu’avant la délivrance des lettres de
a ’ \es l101115 des perfonnes feront envoyés
a l evêque diocèfain du lieu oii ils auront étudié les
cinq dernieres années ; enfemble aux chapitres des
eglifes & monafteres vacans, lefquels informeront
refpeâivement de la v ie , moeurs 8c do&rine, & de
tout feront procès-verbaux qu’ils enverront à Sa
Majefté.
Varticle z . porte qu’avant l’expédition des lettres
de nomination, les archevêques 8c les évêques nommes
feront examinés fur leur dodrine aux faintes
lettres, par un archevêque ou évêque que Sa Majefté
commettra ; appeliés deux dodleurS en Théologie,
lelquels: enverront leurs certificats de la capacité ou
infuffifance defdits nommés. Varticle t. de l’édit de
1606 y eft conforme.
Mais ces difpofitions n’ont point eu d’éxecution
ou ne font point allez exactement obfèrvées. On a
toléré pendant quelques années que les nonces du
pape, qui n’ont aucune jurifdiâion en France, re-
çuflent la prôfeffion de foi du nommé à l’évêché, 8c
^ 'ent ^/n^ormatjon de fes v i e , moeurs 8c capacité ,
8c de l’etat des bénéfices ; ce qui eft contraire au droit
des ordinaires, & a été défendu par un arrêt de réglement
du parlement de Paris, du 1 z Décembre
^ 39-
L ’ufage des autres églifes n’eft pas par-tout fem-
blable à celui de France : quelques-unes fiiivent la fel-
fion xxij. du concile de Trente, fuivant laquelle, au
defaut de degrés.^ il fuffit que Y évêque ait un certificat
donné par une univerfité, qui attelle qu’il eft capable
d’enfeigner les autres ; 8c fi c’eft un régulier, qu’il a it
l’atteftation de fes fupérieurs.
Les canons veulent que celui qu’on élit pour évêque
foit au moins foûdiacre. Le concilè de Trente
veut que Y évêque foit prêtre fix mois avant fa promotion
j mais le concordat, qui fait l’énumération des
qualités que doivent avoir ceux qui font nommés par,
le r o i, n’exige point qu’ils foient prêtres ni foûdia-’
cres ; & l’ordonnance de Blois fuppofe qu’un fimple
clerc peut etre nommé évêque lans être dans les ordres
facrés. En effet, Yart. 8. de cette ordonnance
vèut que dans trois mois, à compter de leurs provi-
fions, les évêques foient tenus de fe faire promouvoir
aux faints ordres ; 8c que fi dans trois autres mois ils
ne fe font mis en devoir de le faire j ils foient privés
de leur égiife, fans autre déclaration, fuivant les
faints decrets.
Pour ce qui eft de la nomination des évêques dans
les premiers fiecles de l’Eglife, ils étoient élus par lê
cierge & le peuple. On ne devoit facrer que ceux
que le clerge élifoit & que le peuple defiroit ; mais
le métropolitain 8c Y évêque de la province dévoient
inftruire le peuplé, afin qu’il né fe portât point à demander
des perlonnes indignes ou incapables de remplir
une place fi éminente.
Les laïcs conferverént long-tems le droit d’affifter
aux eleâionS , 8c même d’y donner leur fufiragé ;
mais la confufion que caufoit ordinairement la multitude
des eleâeurs, 8c la crainte que le peuple n’eut
pas le difeernemenf néceflaire pour les qualités que
doit avoir un évêque , firent que l’on n’admitplus aux
eleâions que le Clergé : on en fit un decret formel
dans le huitième concile général, tenu à Confiant!*
nople en 869 ; ce qui fut fuivi dans l’églife d’Occi-
dent comme dans celle d’Orient. On défendit en même
tems de recevoir pour évêques ceux qui ne feroient
nommés que par les empereurs ou par les