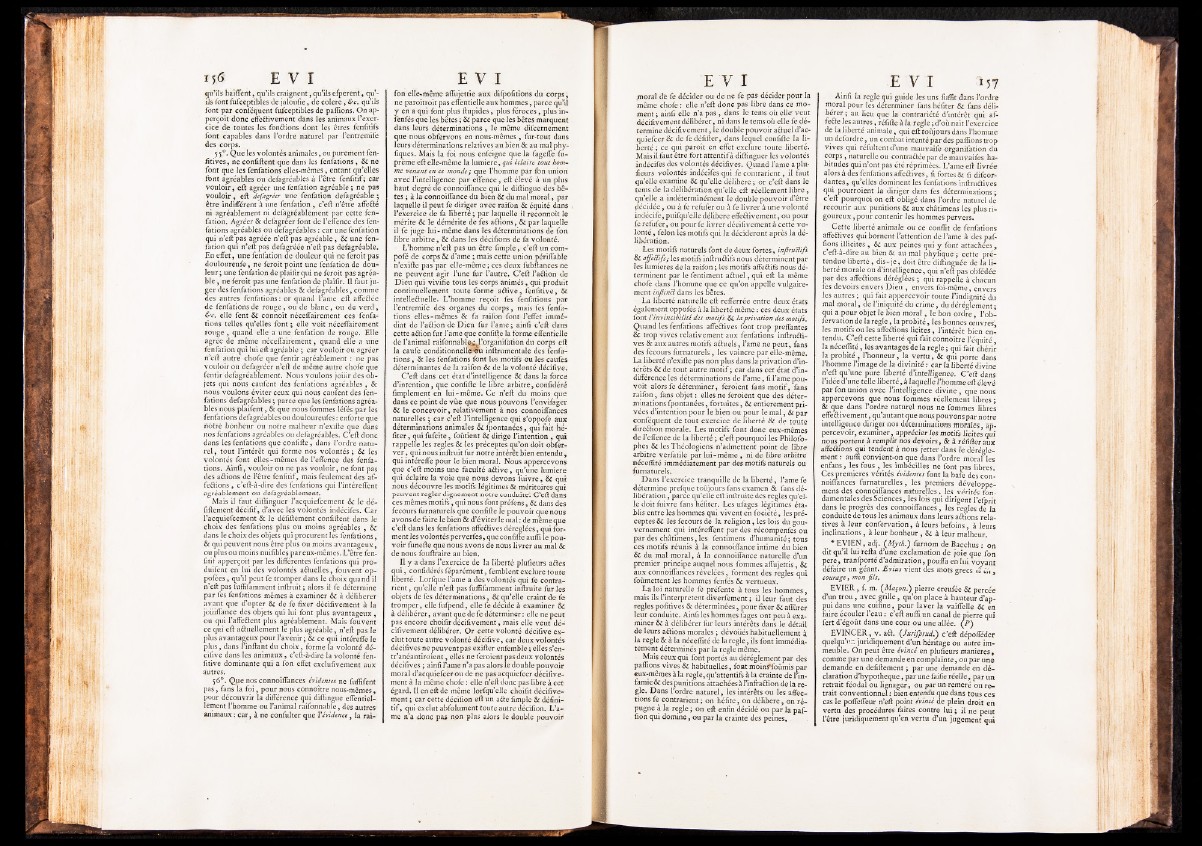
qu’ils haïffent, qu’ils craignent, qu’ils efperent, qu’ils
font fufceptibles de jaloufie, de colere, &c. qu’ils
font par confétjuent fufceptibles de paflions. On ap-
perçoit donc effectivement dans les animaux l’exercice
de toutes les fondions dont les êtres fenfitifs
font capables dans l ’ordre naturel par l’entremife
des corps.
51°. Que les volontés animales, ou purement fen-
fitives, ne confiftent que dans les fenfations, & ne
font que les fenfations elles-mêmes, entant qu’elles
font agréables ou defagréables à l’être fenfitif ; car
vouloir, eft agréer une fenfation agréable ; ne pas
Vouloir, eft defagréer une fenfation defagréable ;
être indifférent à une fenfation , c’eft n’être affedé
ni agréablement ni defagréablement par cette fenfation.
Agréer & defagréer font de l’effence des fenfations
agréables ou defagréables : car une fenfation
qui n’eft pas agréée n’eft pas agréable, & une fenfation
qui n’eu pas defagréée n’eft pas defagréable.
En effet, une fenfation de douleur qui ne feroit pas
douloureufe, ne feroit point une fenfation de douleur
; une fenfation de plaifir qui ne feroit pas agréable
, ne feroit pas une fenfation de plaifir. Il faut juger
des fenfations agréables & defagréables, comme
des autres fenfations : or quand l’ame eft affedée
de fenfations de rouge, ou de blanc, ou de verd,
&c. elle fent Si connoît néceflairement ces fenfations
telles qu’elles font ; elle voit néceflairement
rouge , quand elle a une fenfation de rouge. Elle
agrée de même néceflairement, quand elle a une
fenfation qui lui eft agréable ; car vouloir ou agréer
n’eft autre chofe que fentir agréablement : ne pas
vouloir ou defagréer n’eft de même autre chofe que
fentir defagréablement. Nous voulons joiiir des objets
qui nous caufent des fenfations agréables, &
nous voulons éviter ceux qui nous caulent des fenfations
defagréables ; parce que les fenfations agréables
nous plaifent, & que nous fommes léfés par les
fenfations defagréables ou douloureufes : enforte que
notre bonheur ou notre malheur n’exifte que dans
nos fenfations agréables ou defagréables. C ’eft donc
dans les fenfations que confifte, dans l’ordre naturel
, tout l’intérêt qui forme nos volontés ; Si les
volontés font elles-mêmes de l’effence des fenfations.
Ainfi, vouloir ou ne pas vouloir, ne font pas
des aftions de Eêtre fenfitif, mais feulement des affedions
, c’eft-à-dire des fenfations qui l’intéreffent
agréablement ou defagréablement.
Mais il faut diftinguer l’acquiefcement & le défilement
décifif, d’avec les volontés indécifes. Car
l’acquiefcement & le défiftement confiftent dans le
choix des fenfations plus ou moins agréables , &
dans le choix des objets qui procurent les fenfations,
& qui peuvent nous être plus ou moins avantageux,
ou plus ou moins nuifibles par eux-mêmes. L’être fenfitif
apperçoit par les différentes fenfations qui pro-
duifent en lui des volontés aCtuelles, fouvent op-
pofées, qu’il peut fe tromper dans le choix quand il
n’eft pas luflifamment inftruit ; alors il fe détermine
par fes fenfations mêmes à examiner Si à délibérer
avant que d’opter Si de fe fixer décifivement à la
joiiiflance des objets qui lui font plus avantageux ,
ou qui l’affedent plus agréablement. Mais fouvent
ce qui eft actuellement le plus agréable, n’eft pas le
plus avantageux pour l’avenir; & ce qui intérefle le
plus, dans l’inftant du choix, forme la volonté dé-
cifive dans les animaux, c’eft-à-dire la volonté fen-
fitive dominante qui a fon effet exclufivement aux
autres.
56°. Qjie nos connoiflances évidentes ne fuffifent
pas, fans la fo i, pour nous connoître nous-mêmes,
pour découvrir la différence qui diftingue effentiel-
lement l’homme ou l’animal raifonnable, des autres
animaux : car, à ne confulter que Vévidence f la raifon
elle-même affujettie aux difpofitions du corps,
ne paroîtroit pas effentielle aux hommes, parce qu’il
y en a qui font plus ftupides, plus féroces, plus in-
fenfés que les bêtes ; Si parce que les bêtes marquent
dans leurs déterminations, le même difeernement
que nous obfervons en nous-mêmes , fur-tout dans
leurs déterminations relatives au bien & au mal phy-
fiques. Mais la foi nous enfeigne que la fageffe fu-
prème eft elle-même la lumière, qui éclaire tout homme
venant en ce monde y que l’homme par fon union
avec l’intelligence par eflence, eft élevé à un plus
haut degré de connoiflance qui le diftingue des bêtes
; à la connoiflance du bien & du mal moral, par
laquelle il peut fe diriger avec raifon & équité dans
l’exercice de fa liberté ; par laquelle il reconnoît le
mérite Si le démérite de fes adions, Si par laquelle
il fe juge lui - même dans les déterminations de fon
libre arbitre, & dans les décifions de fa volonté.
L’homme n’eft pas un être fimple, c’eft un com-
pofé de corps & d’ame ; mais cette union périffable
n’exifte pas par elle-même; ces deux fubftances ne
ne peuvent agir l’une fur l’autre. C ’eft l’adion de
Dieu qui vivifie tous les corps animés, qui produit
continuellement toute forme aCHve, fenlitive, &
intellectuelle. L’homme reçoit fes fenfations par
l’entremife des organes du corps, mais fes fenfations
elles-mêmes & fa raifon font l’effet immédiat
de l’adion de Dieu fur l’ame; ainfi c’eft dans
cette aftion fur l’ame que confifte la forme effentielle
de l’animal raifonnable^l’organifation du corps eft
la caufe conditionnellerou inftrumentale des fenfations
, & les fenfations font les motifs ou les caüfes
déterminantes de la raifon & de la volonté décifive.
C ’eft dans cet état d’intelligence & dans la force
d’intention, que confifte le libre arbitre, confidéré
Amplement en lui-même. Ce n’eft du moins que
dans ce point de vue que nous pouvons l’envifager
& le concevoir, relativement à nos connoiflances
naturelles ; car c’eft l ’intelligence qui s’oppofe aux
déterminations animales Si fpontanées, qui fait hé-
fiter, qui fufeite, foûtient Si dirige l’intention , qui
rappelle les réglés & les préceptes qu’on doit obfer-
v e r , qui nous inftruit fur notre intérêt bien entendu ,
qui intérefle pour le bien moral. Nous appercevons
que c’eft moins une faculté aCtive, qu’une lumière
qui éclaire la voie que nous devons fuivre, Si qui
nous découvre les motifs légitimes & méritoires qui
peuvent regler dignement notre conduite'. C’eft dans
ces mêmes motifs, qui nous font préfens, Si dans des
fecours furnaturels que confifte le pouvoir que nous
avons de faire le bien & d’éviter le mal : de même que
c’eft dans les fenfations affedives déréglées, qui forment
les volontés perverfes, que confifte aufli le pouvoir
funefte que nous avons de nous livrer au mal &
de nous fouftr'aire au bien.
Il y a dans l’exercice de la liberté plufieurs ades
q ui, confidérés féparément, femblent exclure toute
liberté. Lorfque l’ame a des volontés qui fe contrarient
, qu’elle n’eft pas fuffifamment inftruite fur les
objets de fes déterminations, & qu’elle craint de fe
tromper, elle fufpend, elle fe décide à examiner Si
à délibérer, avant que de fe déterminer : elle ne peut
pas encore choifir décifivement, mais elle veut décifivement
délibérer. Or cette volonté décifive exclut
toute autre volonté décifive, car deux volontés
décifives ne peuvent pas exifter enfemble ; elles s’en-
tr’anéantiroient, elles ne feroient pas deux volontés
décifives ; ainfi l’ame n’a pas alors le double pouvoir
moral d’acquiefcer ou de ne pas acquiefcer décifivement
à la même chofe : elle n’eft donc pas libre à cet
égard. Il en eft de même lorfqu’elle choifit décifivement
; car cette décifion eft un ade fimple & définit
if, qui exclut abfolument toute autre décifion. L’ame
n’a donc pas npn plus alors le double pouvoir-
.moral dé fe décider ou de ne fe pas décider pour la
même chofe : elle n’eft donc pas libre dans ce moment
; ainfi elle n’a pa s, dans le tems où e lle veut
décifivement délibérer, ni dans le tems où elle fe détermine
décifivement, le double pouvoir aduel d’acquiefcer
Si de fe défifter, dans lequel confifte la liberté
; ce qui paroît en effet exclure toute liberté.
Mais il faut être fort attentif à diftinguer les volontés
indécifes des volontés décifives. Quand l’ame a plu-
fieurs volontés indécifes qui fe contrarient, il faut
qu’elle examine Si qu’elle délibéré ; or c’eft dans le
tems de la délibération qu’elle eft réellement libre,
qu’elle a indéterminément le double pouvoir d’être
décidée, ou à fe refufer ou à fe livrer à une volonté
indécife, puifqu’elle délibéré effedivement, ou pour
fe refufer, ou pour fe livrer décifivement à cette v o lonté
, félon les motifs qui la décideront après la délibération.
. Les motifs naturels font de deux fortes, injlruclifs
Si affectifs; les motifs inftrudifs nous déterminent par
les lumières de la raifon; les motifs affedifs nous déterminent
par le fentiment ad u e l, qui eft la même
chofe dans l’homme que ce qu’on appelle vulgairement
inflinct dans les bêtes.
La liberté naturelle eft refferrée entre deux états
également oppofés à la liberté même : ces deux états
font l'invincibilité des motifs Si la privation des motifs.
Quand les fenfations affedives font trop preffantes
Si trop vives relativement aux fenfations inftrudi-
ves & aux autres motifs aduels, l’ame ne peut, fans
des fecours furnaturels, les vaincre par elle-même.
La liberté n’exifte pas non plus dans la privation d’intérêts
Si de tout autre motif ; car dans cet état d’indifférence
les déterminations de l’ame, fi l’ame pou-
voit alors fe déterminer, feroient fans motif, fans
raifon, fans objet : elles ne feroient que des déterminations
fpontanées, fortuites, & entièrement privées
d’intention pour le bien ou pour le mal, & par
conféquent de tout exercice de liberté Si de toute
diredion morale. Les motifs font donc eux-mêmes
de l’effence de la liberté ; c’eft pourquoi les Philofo-
phes Si les Théologiens n’admettent point de libre
arbitre verfatile par lui-même , ni de libre arbitre
néceflîté immédiatement par des motifs naturels ou
furnaturels.
Dans l’exercice tranquille de la liberté, l’ame fe
détermine prefque toujours fans examen & fans délibération
, parce qu’elle eft inftruite des réglés qu’elle
doit fuivre fans héfiter. Les ulages légitimes établis
entre les hommes qui vivent en fociété, les préceptes
Si les fecours de la religion, les lois du gouvernement
qui intéreffent par des récompenfes ou
par des châtimens, les fentimens d’humanité ; tous
ces motifs réunis à la connoiflance intime du bien
Si du mal moral, à la connoiflance naturelle d’un
premier principe auquel nous fommes affujettis, Si
aux connoiflances révélées, forment des réglés qui
foûmettent les hommes fenfés Si vertueux.
La loi naturelle fe préfente à tous les hommes,
mais ils l’interpretent diverfement ; il leur faut des
réglés pofitives & déterminées, pour fixer & affurer
leur conduite. Ainfi les hommes fages ont peu à examiner
Si à délibérer fur leurs intérêts dans le détail
de leurs adions morales ; dévoilés habituellement à
la réglé & à la néceflité de la réglé, ils font immédiatement
déterminés par la réglé même.
Mais ceux qui font portés au déréglement par des
paflions vives Si habituelles, foat moinÿfoûmis par
eux-mêmes à la réglé, qu’attentifs à la crainte de l’infamie
& des punitions attachées à l’infradion de la réglé.
Dans l’ordre naturel, les intérêts ou les affections
fe contrarient ; on héfite, on délibéré, on répugne
à la réglé ; on eft enfin décidé ou par la paf-
fion qui domine, ou par la crainte des peines..
Ainfi la réglé qui guide les uns fuffit dans l’ordre
moral pour les déterminer fans héfiter Si fans délibérer
; au lieu que la contrariété d’intérêt qui af-
feûe les autres, réfifte à la réglé ; d’où naît l’exercice
de la liberté animale, qui eft toujours dans l’homme
un defordre, un combat intenté par des paflions trop
vives qui refultent d’une mauvaife organifation du
corps, naturelle ou contractée par de mauvaifes ha<-
bitudes qui n’ont pas été réprimées. L’ame eft livrée
alors à des fenfations affedives, fi fortes & fi difeor-
dantes, qu’elles dominent les fenfations inftrudives
qui pourroient la diriger dans fes déterminations ;
c’eft pourquoi on eft obligé dans l’ordre naturel de
recourir aux punitions Si aux châtimens les plus rigoureux
, pour contenir les hommes pervers.
Cette liberté animale ou ce conflit de fenfations
affedives qui bornent l’attention de l’ame à des paf-
fions illicites , Si aux peines qui y font attachées ,
c’eft-à-dire au bien & au mal phyfique ; cette prétendue
liberté, dis-je, doit être diftinguée de la liberté
morale ou d’intelligence, qui n’eft pas obfédée
par des affedions déréglées ; qui rappelle à chacun
fes devoirs envers Dieu , envers foi-même, envers
les autres ; qui fait appercevoir toute l ’indignité du
mal moral, de l’iniquité du crime, du déréglement •
qui a pour objet le bien moral, le bon ordre, l’ob^
fervationde la réglé, la probité, les bonnes oeuvres'
les motifs ou les affedions licites, l’intérêt bien entendu.
C ’eft cette liberté qui fait connoître l’équité,
la néceflité, les avantages de la réglé ; qui fait chérir
la probité , l’honneur, la vertu, & qui porte dans
l’homme l’image de la divinité : car la liberté divine
n’eft qu’une pure liberté d’intelligence. C ’eft dans
l’idée d’une telle liberté, à laquelle l’homme eft élevé
par fon union avec l’intelligence divine , que nous
appercevons que nous fommes réellement libres ;
& que dans l’ordre naturel nous ne fommes libres
effedivement, qu’autant que nous pouvons par notre
intelligence diriger nos déterminations morales, appercevoir,
examiner, apprécier les motifs licites qui
nous portent à remplir nos devoirs, & à réfifter aux
affedions qui tendent à nous jette r dans le déréglement
: auffi convient-on que dans l’ordre moral les
enfans, les fous , les imbécilles ne font pas libres;
Ces premières vérités évidentes font la bafe des con-
noiffances furnaturelles, les premiers développe-
mens des connoiflances naturelles * les vérités fondamentales
des Sciences, les lois qui dirigent l’efprit
dans le progrès des connoiflances, les réglés de la
conduite de tous les animaux dans leurs adions relatives
à leur confervation, à leurs befoins, à leurs
inclinations, à leur bonheur, Si à leur malheur.
* EVIEN, adj. (Myth.) furnom de Bacchus : on
dit qu’il lui refta d’une exclamation de joie que fon
pere, tranfporté d’admiration, pouffa en lui voyant
défaire un géant. Evius vient des mots grecs tZ CU ,
courage, mon f is .
EVIER, f. m. (Maçon.) pierre creufée Si percée
d’un trou, avec grille, qu’on place à hauteur d’appui
dans une cuifine, pour laver la vaiffelle Si en
faire écouler l’eau : c’eft aufli un canal de pierre qui
fert d’égoût dans une cour ou une allée. (P)
EVINCER, v . ad. (Jurifprud.) c ’eft dépofféder
quelqu'un juridiquement d’un héritage ou autre immeuble.
On peut être évincé en plufieurs maniérés f
comme par une demande en complainte, ou par une
demande en defiftement ; par une demande en déclaration
d’hypotheque, par une faifie réelle, par un
retrait féodal ou lignager, ou par un réméré ou retrait
conventionnel : bien entendu que dans tous ces
cas le poffeffeur n’eft point évincé de plein droit en
vertu des procédures faites contre lui ; il ne peut
l’être juridiquement qu’en vertu d’un jugement qui