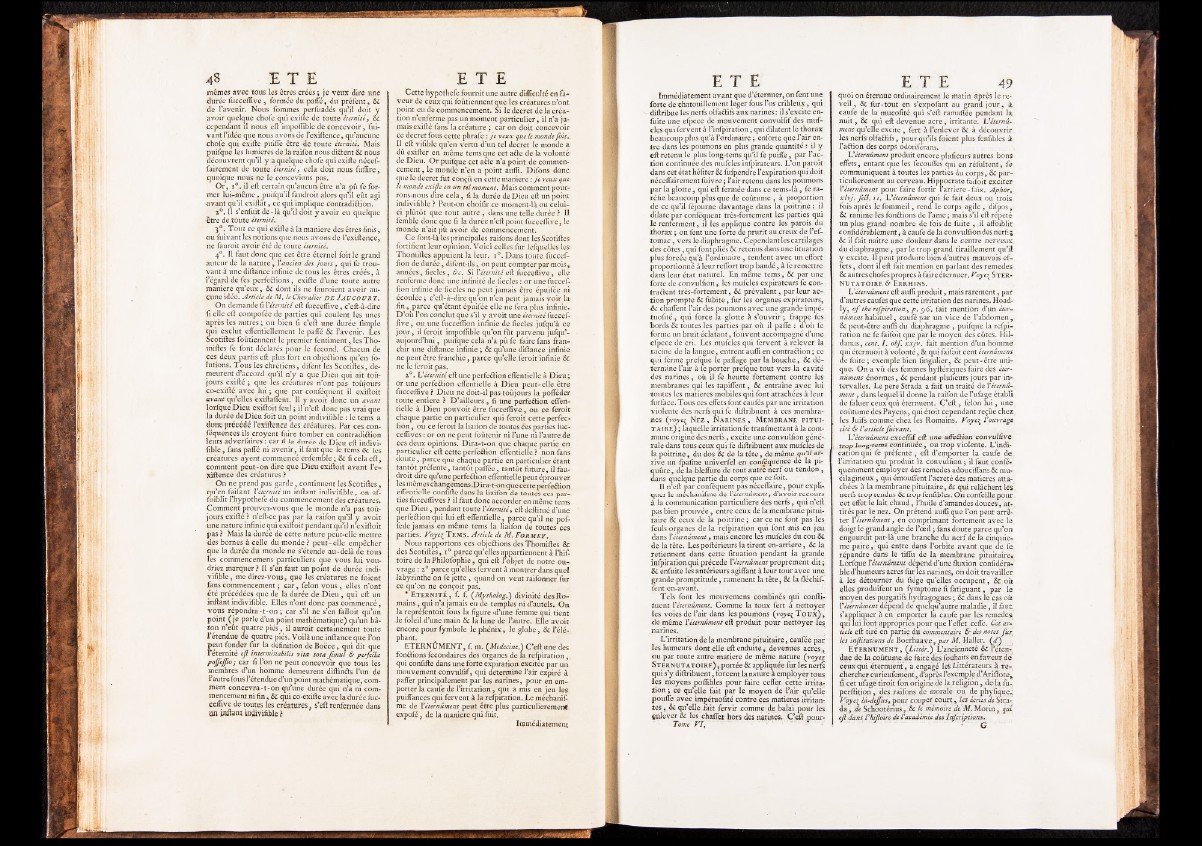
I
48 E T E
mêmes avec tous les êtres créés ; je veux dire une
durée fucceflive, formée du pafle, du préfent, &
de l’avenir. Nous fournies perfuadés qu’il doit y
avoir quelque chofe qui exifte de toute éternité, oc
fcependant fl nous eft impoflible de concevoir, fuivant
l’idée qiie nous avons de l’e&iftence, qu’aucune
chofe qui exifte puifle être de toute éternité. Mais
puifque les lumières de là raifon nous di&ent & nôus
découvrent'qu’il y a quelque chofe qui exille nécef-
fairement de toute éternité, cela doit nous fuffire,
quoique nous ne le Concevions pas.
O r, i° . il eft certain qu’aucun, être n’a pu fe former
lui-même, puifqu’il faudroit alors qu’il eût agi
avant qu’il exiftât, ce qui implique contradiôion.
2°. Il s’enfuit de-là qu’il doit y avoir eu quelque
•être de toute éternité.
3Ô. Tout ce qui exifte à la maniéré des êtres finis,
ou fuivant les notions que nous avons de l’exiftence,
ne fauroit avoir été de toute éternité.
4°. Il faut donc que cet être éternel foit le grand
auteur de la nature, Y ancien des jours, qui fe trouvant
à une diftance infinie de tous les êtres créés, à
l’égard de fes perfections, exifte d’une toute autre
maniéré qu’eux, & dont ils ne fauroient avoir aucune
idée. Article de M. le Chevalier D E J a i / C O U R T .
On demande fi Y éternité eft fucceflive, c’eft-à-dire
fi elle eft compofée de parties qui coulent les unes
après les autres ; ou bien fi c’eft une durée fimple
qui exclut effentiellement le pafle & l’avenir. Les
Scotiftes foûtiennent le premier fentiment, les Tho-
miftes fe font déclarés pour le fécond. Chacun de
ces deux partis eft plus fort en objections qu’en fo-
lutions. Tous les chrétiens, difent les Scotiftes, demeurent
d’accord qu’il n’y a que Dieu qui ait toujours
exifte ; que les créatures n’ont pas toujours
co-exifté avec lui ; que par conféquent il exiftoit
avant qu’elles èxiftaffent. Il y avoit donc un avant
loffque Dieu exiftoit foui ; il n’ëft donc pas vrai que
la durée de Dieu foit un point indivifible : le tems a
donc précédé l’exiftence des créatures. Par ces conséquences
ils croyent faire tomber en contradiction
leurs adverfaires : car fî la durée de Dieu eft indivifible
, Sans pafle ni avenir, il faut que le tems ôc les
créatures ayent commencé enfemble ; & fi cela eft,
comment peut-on dire que Dieu exiftoit avant l’exiftence
des créatures ?
On ne prend pas garde, continuent les Scotiftes,
qu’en failànt Y éternité un inftant indivifible, on af-
foiblit l’hypothefe du commencement des créatures.
Comment prouvez-vous que le monde n’a pas toujours
exifte } n’eft-ce pas par la raifon qu’il y avoit
une.nature infinie qui exiftoit pendant qu’il n’exiftoit
pas ? Mais la durée de cette nature peut-elle mettre
des bornes à celle du monde ? peut - elle empêcher
que la durée du monde ne s’étende au-delà de tous
les commencemens particuliers que vous lui voudriez
marquer ? Il s’en faut un point de durée indivifible,
me direz-vous, que les créatures ne foient
fans commencement ; ca r , félon v ou s , elles n’ont
été précédées que de la durée de D ie u , qui eft un
inftant indivifible. Elles n’ont donc pas commencé,
vous répondra-t-on ; car s’il ne s’en falloit qu’un
point ( je parle d’un point mathématique) qu’un bâton
n’eût quatre piés, il auroit certainement toute
l’etendue de quatre piés. Voilà une inftance que l’on
peut fonder fur la définition de Boëce, qui dit que
l’ éternité eft interminabilis vita tota ftmul & perfecta
pofteftiQ; car fi l’on ne peut concevoir que tous lès
membres d’un homme demeurent diftin&s l’un de
l’autre fous l’étendue d’un point mathématique, comment
concevra-t-on qu’une durée qui n’a ni commencement
ni fin, & qui co-exifte avec la durée fucceflive
de toutes les créatures ? s’eft renfermée dans
un inftant indivifible ?
E T E
Cette hypothefe fournit une autre difficulté en fa*
veur de ceux qui foûtiennent que les créatures n’ont
point eu de commencement. Si le decret de la création
n’enferme pas un moment particulier, il n’a ja-
malsexifte fans la créature ; car on doit concevoir
Ce decret fous cette phrafe : je veux que le monde foit.
Il eft vifible qu’en vertu d’un tel decret le monde a
dû exifter en même tems que cet aéfe de la volonté
de Dieu. Or puifque cet aéte n’a point, de commencement
, le monde n’en a point aufli. Difons donc
que le decret fut conçû en cette maniéré : je veux que,
le-monde exifte en ùn tel moment. Mais comment pourrons
nous dire cela, fi la durée de Dieu eft un point
indivifible ? Peut-on choifir ce moment-là ou celui-
ci plûtôt que tout autre, dans une telle durée ? Il
femble donc que fi la durée n’eft point fucceflive, le
monde n’ait pû avoir de commencement.
Ce font-là les principales raifons dont les Scotiftes
fortifient leur opinion. Voici celles fur lefquelles les
Thomiftes appuient la leur. i° . Dans toute fuccef-
fion de durée, difent-ils, on peut compter par mois,
années, fiecles, &c. Si Y éternité eft fucceflive -, elle
renferme donc une infinité de fiecles : or une fuccef-
fion infinie de fiecles ne peut jamais être épuifée ni
écoulée ; c’eft-à-dire qu’on n’en peut jamais voir la
fin, parce qu’étant épuifée elle ne fera plus infinie.
D ’oii l’on conclut que s’il y avoit une éternité fuccef-
five , ou. une fucceflîon infinie de fiecles jufqu’à ce
jour, il feroit impoflible qu’on fût parvenu jufqu’-
aujourd’h u i, puifque cela n’a pû fe faire fans franchir
une diftance infinie ; & qu’une diftance infinie
ne peut être franchie, parce qu’elle feroit infinie 6c
ne le feroit pas.
z°. L’éternité eft une perfection eflentielle à D ieu ;
or une perfection eflëntielle à Dieu peut-elle être
fucceflive ? Dieu ne doit-il pas toûjours la pofleder
toute entière ? D ’ailleurs , fi une perfection effen-
tielle à Dieu pouvoit être fucceflive, ou ce feroit
chaque partie en particulier qui feroit cette perfection
, ou ce feroit la liaifon de toutes des parties fuc-
ceflives : or on ne peut foûtenir ni l’une ni l’autre de
ces deux opinions. Dira-t-on que chaque partie en
particulier eft cette perfection eflentielle ? non fans
doute, parce que chaque partie en particulier étant
tantôt prefente, tantôt paffée, tantôt future, il faudroit
dire qu’une perfection eflentielle peut éprouver
les mêmes changemens .Dira-t-on que cette perfection
eflentielle connfte dans la liaifon de toutes ces parties
fucceflives ? il faut donc accorder en même tems
que D ie u , pendant toute Y éternité, eft deftitué d’une
perfection qui lui eft eflentielle, parce qu’il ne pof-
lede jamais en même tems la liaifon de toutes ces
parties. Voye^ T ems. Article de M. Formey.
Nous rapportons ces objections des Thomiftes &
des Scotiftes, i ° parce qu’elles appartiennent à l’hif-
toire de la Philofophie, qui eft robjet de notre ouvrage
: z° parce qu’elles fervent à montrer dans quel
labyrinthe on fe je tte, quand on veut raifonner fur
ce qu’on ne conçoit pas.
* Eternité , f. f, (Mytkolog.'i divinité des Romains
, qui n’a jamais eu de temples ni d’autels. On
la représentait fous la figure «d’une femme qui tient
•le foleil d’une main & la lune de l’autre. Elle avoit
encore pour fymbole le phénix, le globe, & l’éléphant.
ETERNÛMENT, f. m. ( Medecinej\ C ’eft une des
fonctions fecondaires des organes de la refpiration,
qui confifte dans une forte expiration excitée par un
mouvement convulfif, qui détermine l’air expiré à
paffer principalement par les narines, pour en emporter
la caufe de l’irritation, qui a mis en jeu les
puiffances qui fervent à la refpiration. Le méchanif-
me de Yéternument peut être plus particulièrement
expofé, de la maniéré qui fuit,
Immédiatement
E T E
Immédiatement avant que d’éternuer, on font uhe
forte de'chatouillement leger fous l’os cribleux, qui
diftribue les nerfs olfaCtifs aux narines : il s’excite en-
fuite une efpece de mouvement convulfif des muf-
cles qui fervent à l’infpiration, qui dilatent le thorax
beaucoup plus qu’à l’ordinaire ; enforte que l’air entre
dans les poumons en plus grande quantité : il y
eft retenu le plus long-tems qu’il fe puifle, par l’action
continuée des mufcles infpirateurs. L’on paroît
dans cet état héfiter & fufpendre l’expiration qui doit
néceffairement fuivre ; l’air retenu dans les poumons
par la g lotte, qui eft fermée dans ce tems-là, fe raréfie
beaucoup plus que de coûtume , à proportion
de ce qu’il féjourne davantage dans la poitrine : il
dilate par conféquent très-fortement les parties qui
le renferment, il les applique contre les parois du
thorax ; on fent une forte de prurit au creux de l’ef-
tomac, vers le diaphragme. Cependant les cartilages
des côtes, qui font pliés & retenus dans une fituation
plus forcée qu’à l’ordinaire , tendent avec un effort
proportionne à leur reflort trop bandé, à fe remettre
dans leur état naturel. En même tems, & par une,
forte de convulfion, les mufcles expirateurs fe contractent
très-fortement, & prévalent, parleur action
prompte & fubite, fur les organes expirateurs,
& chaflënt l’air des poumons avec une grande impé-
tuofité, qui force la glotte à s’ouvrir ; frappe fes
bords éc toutes les parties par oii il pafle : d’oii fe
forme un bruit éclatant, fouvent accompagné d’une.
efpece de cri. Les mufcles qui fervent à relever la
racine de la langue, entrent aufli en contraction ; ce
qui ferme prefque le paffage par la bouche, & détermine
l’air à le porter prefque tout vers la cavité
des narines, oit il fe heurte fortement contre les
membranes qui les tapiffent, & entraîne avec lui
toutes les matières mobiles qui font attachées à leur
flirta ce. Tous ces effets font caufés par une irritation
violente des nerfs qui fe dillribuent à ces membranes
(voyei Nez , Narines , Membrane pitui-.
taire) ;• laquelle irritation fe tranfmettant à la commune
origine des nerfs, excite une convulfion générale
dans tous ceux qui fe diftribuent aux mufcles de
la poitrine, du dos & de la tête, de même qu’H arrive
un fpafme univerfel en con/equence de la pi-
quûre, de la bleflure de tout autre nerf ou tendon,
dans quelque partie du corps que ce foit.
Il n*eft par conféquent pas néceffaire, pour expli-,
quer le méchanifme de Yéternument, d’avoir recours
à la communication particulière des nerfs, qui n’eft
pas bien prouvée, entre ceux de la membrane pituitaire
& ceux de la poitrine ; car ce ne font pas les
fouis organes de la refpiration qui font mis en jeu
dans Yéternument, mais encore les mufcles du cou &C
de la tête. Les poftérieurs la tirent en-arriere, & la
retiennent dans cette fituation pendant la grande
infpiration qui précédé Yéternument proprement dit ;
& enfuite les antérieurs agiffant à leur tour avec une
grande promptitude, ramènent la tête, & la fléchif-
lènt en-avant.
Tels font les mouvemens combinés qui confti-
tuent Yéternument. Comme la toux fort à nettoyer
les voies de l’air dans les poumons (yoyeç T o u x ) ,
de même Yéternument eft produit pour nettoyer les
narines.
L ’irritation de la membrane pituitaire, caufée par
les humeurs dont elle eft enduite, devenues acres,,
ou par toute autre matière de même nature (yoye^ Sternutatoire) , portée & appliquée fur les nerfs
qui s’y diftribuent, forcent la nature a employer tous
les moyens poflibles pour faire ceffer cette irritation
; cé qu’elle fait par le moyen de l’air qu’elle
pouffe avec impétuofité contre ces matières irritantes
& qu’elle fait foryir commede balai pour les
enlever & les chaffer hors des narines, C ’eft ,pour-
Tome VI
E T E 49 quoi on éternue ordinairement le matin après le réveil
, & fur-tout en s’expofant au grand jour, à
caufe de la mucofité qui s’eft ramaffée pendant la
nuit, & qui eft devenue acre, irritante. Véternû-
ment qu’elle excite , fort à l’enlever & à découvrir
les nerfs olfaétifs, pour qu’ils foient plus fenfibles à
l’aétion des corps odoriferans.
L’éternûment produit encore plufieurs autres bons
effets, entant que les fecouffes qui en réfultent, fe
communiquent à toutes les parties du corps, & particulièrement
au cerveau. Hippocrate faifoit exciter
Yéternument pour faire fortir l’arriere-faix. Aphor,
xlvj. fecl. u . L ’éternûment qui fe fait deux ou trois
fois après le.fonjmeil, rend le corps agile, difpos ,
& ranime les fondions de l’ame ; mais s’il eft répété
un plus grand nombre de fois de fuite , il affoibiit
confidérablement, à caufe de la convulfion des nerfs;
& il fait naître une douleur dans le centre nerveux,
du diaphragme, par le trop grand tiraillement qu’il
y excite. Il peut produire bien d’autres mauvais effets
, dont il eft fait mention en parlant des remedes
& autres chofes propres à faire éternuer.NUTATOIRE Voye^ S ter- & ERRHINS.
L ’éternûment eft aufli produit, mais rarement, par
d’autres caufes que cette irritation des narines. Hoad-
ly, o f the refpiration, p. ÿC. fait mention d’un éternûment
habituel, caufépar un vice de l’abdomen,
& peut-être aufli du diaphragme , puifque la refpi- ,
ration ne fe faifoit que par le moyen des côtes. Hil-
danus, cent. I . obf. xxjv. fait mention d’un homme
qui éternuoit à Volonté, & qui faifoit cent éternutnens
de fuite ; exemple bien fingulier, &c peut-être unique.
On a vû des femmes hyftériques faire des éter-
nûmens énormes, & pendant pluueurs jours par intervalles.
Le pere Strada a fait un traité de Yéternû- :
ment, dans lequel il donne la raifon de l’ufage établi
de faluer ceux qui éternuent. Ç’e f t , félon lu i , une
coûtume des Payens, qui étoit cependant reçûe chez,
les Juifs comme chez les Romains. Voye^ l'ouvrage
cité & l'article fuivant.
L’éternûment exceflif eft une affe&ion convuhive
trop long-tems Continuée, ou trop violente. L’indication
qui fe préfente , eft d’emporter la caufe de
l’irritation qui produit la convulfion ; il faut confé-
quemment employer des remedes adouciffans & mu-
cilagineux, qui émouffent l’acreté des matières attachées
à la membrane pituitaire, & qui relâchent lés
nerfs trop tendus & trop fenfibles. On confoille pour
cet effet le lait chaud, l’huile d’amandes douces, attirés
par le nez. On prétend aufli que l’on peut arrêter
Y éternûment, en comprimant fortement avec le
doigt le grand angle de l’oeil ; fans doute parce qu’on
engourdit par-là une branche du nerf de la cinquième
paire,: qui. entre dans l’orbite avant que de fe
répandre dans lè tiffu de la. membrane pituitaire*
Lorfque Yéternument dépend d’une fluxion confidéra-
ble d’humeurs acres fur les narines* on doit travailler
à les détourner du fiége qu’elles occupent, ôc oh
elles produifent un lymptome fi fatiguant, par le
moyen des purgatifs nydragogues ; & dans le cas oit
Yéternûment dépend de quelqu’autre maladie, il faut
s’appliquer ^ en emporter la caufe par les remedes,
qui lui font appropriés pour,que l’effet, ceflè. Cet article
eft tiré en partie du commentaire & des notes fur,
les inftitutions <& Boerhaave, par M. Haller. (</) Eternûment, ([Littér.) L’ancienneté & retendue
de la cpfitume.de faire dès fouhaits enfaveur de
ceux qui éternuent, a engagé lei Littérateurs à rechercher
curieufement, d’après l’exemple d’Ariftote,
fi çet ufagé tiroit fon origine de la,religion, delà, fu-
perftition, des.raifons de morale ;ôu de phyfique.j
Voye%_ là-dejfus, pour couper court, les écrits de $trà-;
da , de Schooténus,,& M mémoire fte M. M orin, qui
eft dans, l'hiftoire de l'académie des lnfcriptions.