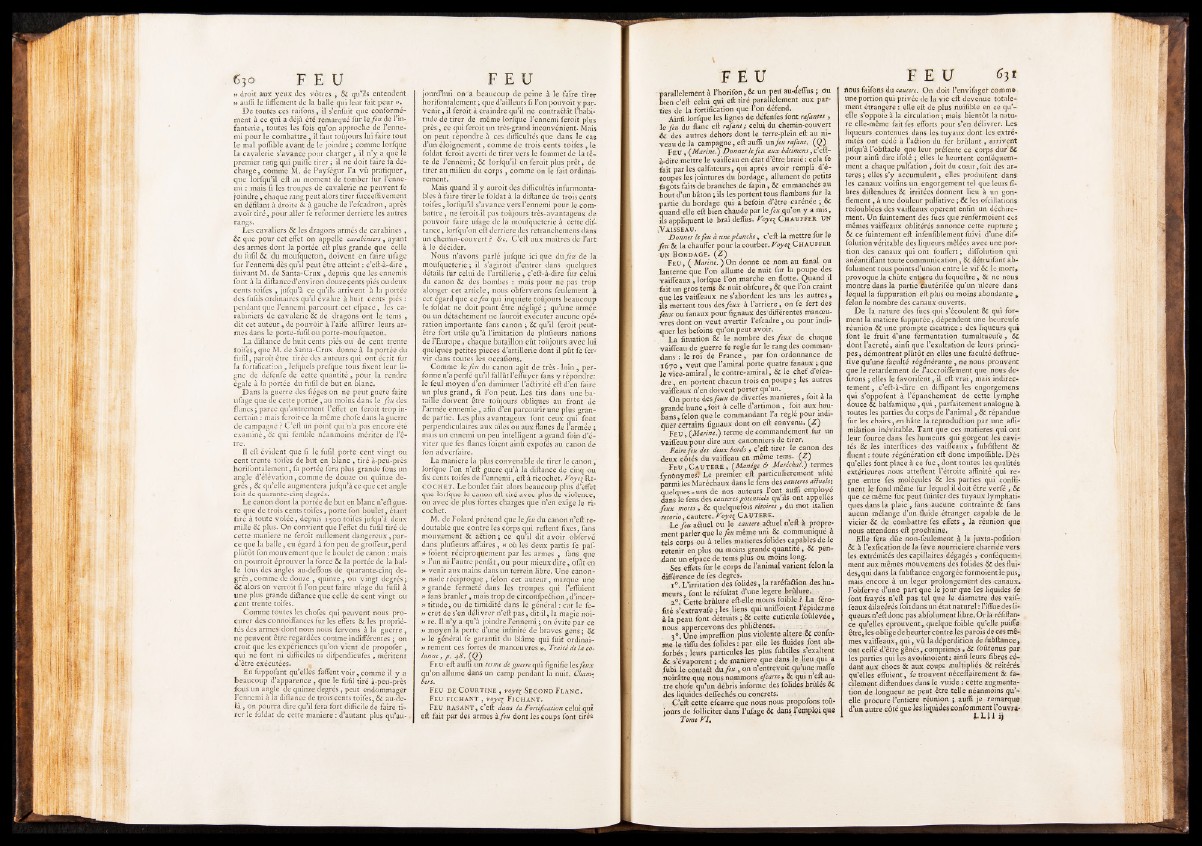
» droit aux yeux des vôtres , Si qu’ils entendent
» aufli le fixement de la balle qui leur fait peur ».
De toutes ces raifons, il s’enfuit que conformément
à ce qui a déjà été remarqué fur le Jeu de l’infanterie
, toutes les fois qu’on approche de l’ennemi
pour le combattre, il faut toujours lui faire tout
le mal poffible avant de le joindre ; comme lorfque
la cavalerie s’avance pour charger » il n’y a que le
premier rang qui puifle tirer ; il ne doit faire fa décharge
, comme M. de Puyfégur l’a vu pratiquer,
que lorfqu’il eft au moment de tomber fur l’ennemi
: mais fi les troupes de cavalerie ne peuvent fe
joindre, chaque rang peut alors tirer fuccefiîvement
en défilant à droite & à gauche de l’efcadron, après
avoir tiré, pour aller fe reformer derrière les autres
rangs.
Les cavaliers & les dragons armés de carabines ,
& que pour cet effet on appelle carabiniers, ayant
des armes dont la portée eu plus grande que celle
du fufil 6c du moufqueton, doivent en faire ufage
fur l’ennemi dès qu’il peut être atteint : c’eft-àrdire ,
fuivant M. de Santa-Crux , depuis que les ennemis
font à la diftance d’environ douze cents piés ou deux
cents toifes , jufqu’à ce qu’ils arrivent à la portée
des fufils ordinaires qu’il évalué à huit cents piés :
pendant que l’ennemi parcourt cet efpace, les carabiniers
de cavalerie & de dragons ont le tems ,
dit cet auteur, de pouvoir,à l’aile afïïirer leurs armes
dans le porte-fufil ou porte-moufqueton.
La diftance de huit cents piés ou de cent trente
toifes, que M. de Santa-Crux donne à la portée du
fufil, paroît être tirée des auteurs qui ont écrit f u r
la fortification , lefquels prefque tous fixent leur ligne
de défenfe de cette quantité, pour la rendre
égalé à la portée du fufil de but en blanc.
Dans la guerre des fiéges Ort ne peut guère faire
ufage que de cette portée, au moins dans le f e u des
flancs ; parce qu’autrement l’effet en feroit trop incertain
: mais feroit-ce la même chofe dans la guerre
de campagne ? C ’eft un point qui n’a pas encore été
examiné, 6c qui femble neanmoins mériter de l’être.
Il eft évident que fi le fufil porte cent vingt ou
cent trente toifes de but en blanc , tiré à-peu-près
horifontalement, fa portée fera plus grande fous un
angle d’élévation, comme de douze ou quinze degrés
, 6c qu’elle augmentera jufqu’à ce que cet angle
loit de quarante-cinq degrés.
Le canon dont la portée de but en blanc n’eft guère
que de trois cents toifes, porte fon boulet, étant
tiré à toute vo lé e, depuis 1 500 toifes jufqu’à deux
mille 6c plus. On convient que l’effet du fufil tiré de
cette maniéré ne feroit nullement dangereux, parce
que la balle, eu égard à fon peu de groffeur,perd
plutôt fon mouvement que le boulet de canon : mais
on pourrait éprouver la force 6c la portée de la balle
fous des angles au-deffous de quatantercinq de*
grés, comme de douze , quinze , ou vingt degrés;
6c alors on verroit fi l’on peut faire ufage du fufil à
une plus grande diftance que celle de cent vingt ou
cent trente toifes.
Comme toutes les chofes qui peuvent nous procurer
des connoiffances fur les effets & les propriétés
des armes dont nous nous fervons à la guerre ,
ne peuvent être regardées comme indifférentes ; on
croit que les expériences qu’on vient de propofer ,
qui ne font ni difficiles ni difpendieufes , méritent
d’être exécutées.
En fuppofant qu’elles faffent v o ir , comme il y a
beaucoup d’apparence , que le fufil tiré à-peu-près
fous un angle de quinze degrés, peut endommager
l’ennemi à la diftance de trois cents toifes, & au-delà
, on pourra dire qu’il fera fort difficile de faire tirer
le foldat de cette maniéré : d’autant plus qu’au- .
jourd’hui biv'à beaucoup de peine à le fafre tirer
horifontalement ; que d’ailleurs fi l’on pouvoit y parvenir
, il feroit à craindre qu’il ne contrariât l’habitude
de tirer de même lorfque l’ennemi feroit plus
près, ce qui feroit un très-grand inconvénient. Mais
on peut répondre à ces difficultés que dans le cas
d’un éloignement, comme de trois cents toifes , le
foldat feroit averti de tirer vers le fommet de la tête
de l ’ennemi; 6c lorfqu’il en feroit plus prêt, de
tirer au milieu du corps , comme on le fait ordinairement.
Mais quand il y auroit des difficultés infurmonta-
bles à faire tirer le foldat à la diftance de trois cents
toifes, lorfqu’il s’avance vers l’ennemi pour le combattre
, ne lëroit-il pas toujours très-avantageux de
pouvoir faire ufage de la moufqiieterie à cette diftance
, lorfqu’on eft derrière des retranchemens dans
un chemin-couvert ? &c. C ’eft aux maîtres de l’art
à le décider.
Nous n’avons parlé jufque ici que du feu de la
moufqueterie ; il s’agiroit d’entrer dans quelques
détails fur celui de l’artillerie, c’eft-à-dire liir celui
du canon & des bombes : mais pour ne pas trop
alonger cet article, nous obferverons feulement à
cet égard que ce feu qui inquiété toujours beaucoup
le foldat ne doit point être négligé ; qu’une armée
ou un détachement ne fauroit executer aucune opé*
ration importante fans canon ; 6c qu’il feroit peut-
être fort utile qu’à l’imitation de plufieurs nations
de l’Europechaque bataillon eût toujours avec lui
quelques petites pièces d’artillerie dont il pût fe fer-
vir dans toutes les occafiohs.
Comme le feu du canon agit de très-loin , per-
fonne n’a penfé qu’il fallût l’effuyer fans y répondre:
le feul moyen d’en diminuer l’aûivité eft d’en faire
un plus grand, fi l’on peut. LeS tirs dans une bataille
doivent être toûjours obliques au front dé
l’armée ennemie, afin d’en parcourir une plus gran-=
de partie. Les plus avantageux font ceux qui font
perpendiculaires aux aîles ou aux flancs de l’armée ;
mais un ennemi un peu intelligent a grand foin d’é*
viter que fes flancs foient ainfi expofés au canon de
fon adverfaire.
La maniéré la plus convenable de tirer le canon,
lorfque l’on n’eft guere qu’à la diftance de cinq ou
fix cents toifes de l’ennemi, eft à ricochet. Voyeç R i c
o c h e t . Le boulet fait alors beaucoup plus d’effet
que lorfque le canon eft tiré avec plus de violence,
ou avec de plus fortes charges que n’en exige le ricochet.
M. de Folard prétend que le feu du canon n’eft redoutable
que contré les corps qui relient fixes, fans
mouvement & aétion ; ce qu’il dit avoir obfervé
dans plufieurs affaires, « oii lés deux partis fe paf-
» foient réciproquement- par les armes , fans que
» l’un ni l’autre penfât, ou pour mieux dire, ofât en
» venir auxmains dans un terrein libre. Une canon-
» nade réciproque , félon cet auteur, marque une
» grande fermeté dans les troupes qui l’efluient
» fans branler, mais trop de circonfpeélion, d’incer*
» titude, ou de timidité dans lé général : car le fe-
» cret de s’en délivrer n’eft pas, dit-il, la magie noi-
» re. Il n’y a qu’à joindre l’ennemi ; on évite par ce
» moyeh la perte d’une infinité de braves gens ; 6c
» le général fe garantit du blâme qui fuit ordinai-
» rement ces fortes de manoeuvres ». Traité de la colonne
, p. 48. (Q.)
F e u e f t a u f f i u n terme de guerre q u i f i g n i f i e l e s feux
q u ’ o n a l lu m e d a n s u n c a m p p e n d a n t l a n u i t . Chain-
Sers.
F e u d e C o u r t i n e , voye^ S e c o n d F l a n c .
Feu f ich an t , voye1 Fich an t .
F e u R A S A N T , c ’ e f t dans la Fortification c e lu i q u i
eft f a i t p a r d e s a rm e s h feu d o n t l e s c o u p s f o n t t i r é s
parallèlement à l’horifon, & un peit au-efeffus ; ou
bien c’eft celui qui eft tiré parallèlement aux parties
de la fortification que l’on défend.
Ainfi lorfque les lignes de défenfes font rafantes ,
le feu du flanc eft rafant; cehq du chemin-couvert
6c des autres dehors dont le terre-plein eft au niveau
de la campagne, eft aufli un feu rafant. (Q)
Feu , (Marine.') Donner le feu aux bâtimens, c’eft-
à-dire mettre le vaifleau en état d’être braié: cela fe
fait par les calfateurs, qui après avoir rempli d’é-
toupes les jointures-du bordage, allument de petits
fagots faits de branches de fapin, & emmanchés au
bout d’un bâton ; ils les portent tous flambans far la
partie du bordage qui a befoin d’être carenee ; &
quand elle eft bien chaude par le/èajqu’on y a mis, 3s appliquent le brai deffus. Foyei C hauffer un
.Vaisseau.
Donner le feu à une planché, c’eft la mettre lur le
feu & la chauffer pour la courber. Voye^ C hauffer
un Bo rd ag e. (Z )
F e u , ( Marine.) On donne ce nom au fanal ou
lanterne que l’on allume de nuit fur la poupe des
vaifleaux, lorfque l’on marche en flotte. Quand il
fait un gros tems 6c nuit obfcure, & que l’on craint
que les vaifleaux ne s’abordent les uns les autres,
3s mettent tous des feux à l’arriere, on fe fert des
feux ou fanaux pour fignaux des'différentes manoeuvres
dont on veut avertir l’efeadre, ou pour indiquer
les befoins qu’on peut avoir.
La fituation 6c le nombre des feux de chaque
vaifleau de guerre fe réglé fur le rang des comman-
dans : le roi de France, par fon ordonnance de
11670 , veut que l’amiral porte quatre fanaux ; mie
le vice-amiral, le contre-amiral, 6c le chef d elca-
dre, en portent chacun trois en poupe ; les autres
.vaifleaux n’en doivent porter qu’um
On porte des feux de diverfes maniérés, foit à la
grande hune,foit à celle d’artimon, foit aux haubans,
félon que le commandant l’a réglé pour indi*
quer certains fignaux dont on eft convenu. (Z )
F e u , (Marine.) terme de commandement fur un
vaifleau pour dire aux canonniers de tirer.
Faire feu des deux bords , c’eft tirer le canon des
deux côtés du vaifleau en meme tems. (Z )
Feu , C a ut ere y. (Manège & Maréchal J t e rm e s
. f y n ô n y m e ^ Le p r e m i e r e f t p a r t i c u l i è r e m e n t u f i t e
p a rm i l e s M a r é c h a u x d a n s l e l e n s d e s cautères actuels:
q u e l q u e s - u n s d e n o s a u t e u r s l ’ o n t a u f l i e m p l o y é
d a n s l e f e n s d e s cautères potentiels q u ’ i l s o n t a p p e l l e s
feux morts , 6c q u e l q u e f o i s rctoires , d u m o t i t a l i e n
retorio, c a u t e r e . Vjye{ C A U T E R E .
Le feu aâuel ou le cautere aétuel n’eft à proprement
parler que le feu même uni 6c communique à
tels corps ou à telles matières fdlides capables de le
retenir en plus ou moins grande quantité, 6c pendant
un efpace de tems plus ou moins long.
Ses effets fur le corps de l’animal varient félon la
différence de fes degres. • ^p -
i° . L’irritation des foltdes, la raréfaction des humeurs,
font le réfultat d’une legere M i gfcW H
2,°. Cette brûlure eft-elle moins foible.?. La féro-
fité s’extravafe ; les liens qui unifloient l’épiderme
à la peau font détruits ; 6c cette cuticule, foûlevée,
nous appercevonsdesphliften.es. -
30. Une impreflion plus violente altéré ,8c conlu-
me lé tiflii des fofides : par elle les fluides , font ab-
forbés ; leurs particules les plus fubtiles s exaltent
j6c s’éyaporent ; de maniéré que dans le lieu .qui a
fubi le contaft du feu , on n’entrevoit qu’imç mafle
noirâtre-que nous nommons efearre-, 6ç qui n eft autre
chofe qu’un débris informe des folides brûles 6c
des liquides deflechés ou concrets.
C ’eft cette efearre que nous nous propofons toujours
de folliciter dans l’uiage 6c dans l’emploi que
Tome VS,
nous faifons du cautere. On doit l’envifagef comme
une portion qui privée de la vie eft devenue totalement
étrangère : elle eft de plus nuifible en ce qu’elle
s’oppolè à la circulation ; mais bientôt la nature
elle-même fait fes efforts pour s’en délivrer* Les
liqueurs contenues dans les tuyaux dont les extrémités
ont cédé à l’aftion du fer brûlant, arrivent
jufqu’à l’obftacle que leur préfente ce corps dur’ÔC
pour ainfi dire ifolé ; elles le heurtent conféquem-
ment a chaque pulfation, foit du coeur, foit des artères
; elles s’y accumulent, elles produifent dans
les canaux voifins un engorgement tel que leurs fibres
diftendues 6c irritées donnent lieu à un gonflement
, à une doüleur pulfative ; 6c les ofcillations
redoublées des vaifleaux opèrent enfin un déchirement.
Un fuintement des fucs que renfermoient ces
mêmes vaifleaux oblitérés annonce cette rupture ;
6c ce fuintement eft infenfiblemënt filivi d’une dif-
folution véritable des liqueurs mêlées avec une portion
des canaux qui ont fouffert ; diffolution qui
anéantiffant toute communication, 6c détruifant ab-
folument tous points d’union entre le v if 6c le mort»
provoque la chute entière du fequeftre, & ne nous
montre dans la partie eautérifée qu’un ulcéré dans
lequel la fuppuration eft plus ou moins abondante ,
félon le nombre des canaux ouverts*
De la nature des fucs qui s’écoulent 6c qui forment
la matière fuppurée, dépendent une heureufe
réunion 6c une prompte cicatrice : des liqueurs qui
font le fruit d’une fermentation tumultueufe, 6c
dont l’acreté, ainfi que l’exaltation de leurs principes,
démontrent plutôt en elles une faculté deftruc-
tive qu’une faculté régénérante, ne nous prouvent
que le retardement de l’accroiflement que nous de*
firons ; elles le favorifent, il eft v ra i, mais indirectement
, c’eft-à-dire en diflipant les engorgemens
qui s’oppofent à l’épanchement de çette lymphe
douce 6c balfamique, q ui, parfaitement analogue à
toutes les parties du corps de l’animal, 6c répandue
fur les chairs, en hâte la reproduction par une alfi-
milation inévitable. Tant qùe ces matières qui ont
leur fource dans les huipeurs qui gorgent les cavités
6c les interftices des vaifleaux , fubfiftent 6c
fluent : toute régénération eft donc impoflible. Dès
qu’elles font place à ce fu c , dont toutes les qualités
extérieures nous attellent l’étroite affinité qui régné
entre fes molécules 6c les parties qui.confti-
tuent le fond même fur lequel il doit être v erfé, 6c
que ce même fuc peut fuinter des tuyaux lymphatiques
dans la plaie , fans -aucune contrainte & fans
aucun mélange d’un fluide étranger capable de le
vicier 6c de,combattre;fes effets , la réunion que
nous attendons eft prochaine.
Elle fera dûe non-feulement à la juxta-pofition
& à l’exfication de la feve nourricière charriée vers
les extrémités des capillaires dégagés , conféquem-;
ment aux mêmes mouvemens des folides 6c des fluides,
qui dans la fubftance engorgée forrhoient le pus,
mais encore à un leger prolongement des canaux*
j J’obferve d’une part que le jour que les liquides fe
font frayés n’eft pas tel que le diamètre des vaif?
féaux dilacérés foit dans un état naturel : l’iffue des liqueurs
n’eft donc pas abfolument libre. Or là-réfiftan*
ce qu’elles éprouvent» quelque foible qu’elle puiffe
être, les oblige de heurter contre,les parois de ces mêmes
vaifleaux, qui, vû la déperdition de fubftance »,
ont cefle d’être gênés, comprimés, 6c foûtenus par
les parties qui les avoifinoient ; ainfi. leurs fibres cédant
aux chocs & aux coups multiplies 6c réitérés
qu’elles efluient, fe trouvent néceffairement & facilement
diftendues dans le vuide : cette augmentation
de longueur ne peut être telle néanmoins qu’elle
procure l’entiere réunion ; aufli je remarque
d’un autre côté que les liquides confomment l’ouvra-
S M S