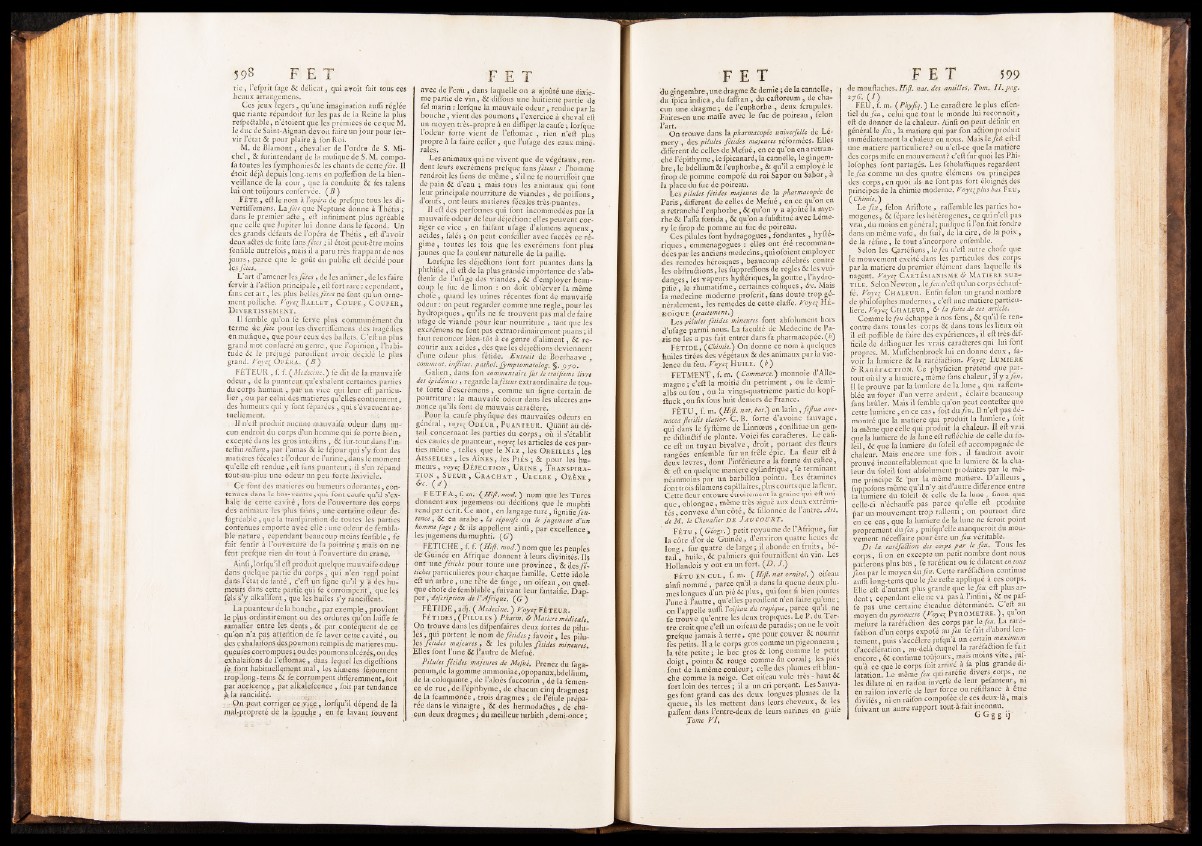
r ie , l’efprit fage & délicat, qui aroit fait tous ces
beaux arrangemens.
Ces jeux légers, qu’une imagination aufli réglée
que riante répandoit fur les pas de .la Reine la plus
refpe&able, n’étoient que les prémices de ce que M.
le duc de Saint-Aignan devoit faire un jour pour fér-
vir l’état & pour plaire à fon Roi.
M. de Blamont, chevalier de l ’ordre de S. Michel
, & furintendant de la mulique de S. M. compo-
fa toutes les fymphoniesôc les chants de cette fête. Il
étoit déjà depuis long-tems en pojféfiion de la bienveillance
de la cour , que fa conduite & fes talens
lui ont toûjours confervée. ( B )
F ê t e , eft le nom à F'opéra de prefque tous les di-
vertiffemens. Va fête que Neptune donne à Thétis ;
dans le premier aéle , eft infiniment plus agréable
que celle que Jupiter lui donne dans le fécond. Un
des grands défauts de l’opéra de Thétis , eft d’avoir
deux a£teS de fuite fans fêtes ; il étoit peut-être moins
fenfible autrefois, mais il a paru très frappant de nos
jours, parce que le goût du public eft décidé pour
\esfêtes,c:.'
L ’art d’amener les fêtes, de les animer, de les faire
fervir à l’aâion principale, eft fort rare ; cependant ,
fans cet a rt, les plus belles fêtes ne font qu’un ornement
poftiche. F 'o y g ç B a l l e t , C o u p e , C o u p e r ,
D i v e r t i s s e m e n t .
Il femble qu’on fe ferve plus communément du
terme de fête pour les diverfiffemens des tragédies
en mufique, que pour ceux des ballets. C ’eft un plus
grand mot confacré au genre, que l’opinion, l’habitude
& le préjugé paroiflent avoir décidé le plus
grand. Poye^ O p é r a . ( B )
FÉTEUR , f. f. ( Medecine..) fe dit de là mauvaife
odeur, de la puanteur qu’exhalent certaines parties
du corps humain * par un vice qui leur eft particulier
, ou par celui des matières qu’elles contiennent, I
des humeurs qui y font féparées , qui s’évacuent actuellement.
Il n’eft produit aucune mauvaife odeur dans au-'
cun endroit du corps d’un homme qui fe porte b ien,
excepté dans les gros inteftins , & fur-tout dans l’in-
teftinra?«/7z, par l’amas & le féjour qui s’y-Font des
matières fécales .îdiodeur de l’urine, dans le moment
qu’elle eft rendue, eft fans puanteur ; il s’en répand
tout-au-plus une odeur un peu forte lixiviele.
■ C e font des matières ou humeurs odorantes, contenues
dans le bas-ventre,qui font caufe qu’il s’exhale
de cette cavité , lors de l’ouverture des corps
des animaux les 'plus fa-ins, une certaine odeur de-
fagréalrie , que la tranfpiration de toutes les parties
contenues emporte avec elle : une odeur de fembla-.
Me nature, cependant beaucoup moins fénfible, fé
fait féntir à l’ouvert dre de la poitrine ; mais on ne-
ferïl prefque rien du tout à l’ouyerture du crâne.
. Ainfi ,lorfqu’il eft produit quelque mauvaife odeur
dans quelque partie dii cofps , qui n’en rend point
dafis.l’état de fanté , ç’eft un figne qu’il y a des.hu-
meurs dans cette partie qui fe corrompent', que les
fols s’ÿ alkalifent, que lés huiles s’y ranCiffent.
La puanteur de la bouche., par exemple, provient
le plus ordinairement ou des ordures qu’on laifle fe {
ïamaffer entre les. dents, & par conséquent de ce I
qu’qn n’a pa? attention, de fe laver cette ca vité, ou ,
dos exhalaifons despoumons remplis de matières mu-
qup,ufes corrompues, jjpu des poumons ulcérés, oit des
exhalaifons de l’eftom^ç, dans lequel les digeftions
fo. fqnt habituellqrqent mal, les alimens féjournent .
trop long-tems & fe corrompent différemment,foit !
par acefcençp, par alkafofcence , .foit .par tendance 1
à. la rancidité.
On peut corriger. y jç g , lprfqu’il dépend de la
malpropreté de la J^puc^e , en le lavant fouvent r
avec de l’eau , dans laquelle on a ajoûté une dixième
partie de v in , & diflous une huitième partie de
fél marin : lorfque la.mauvaife odeur, rendue par la
bouche, vient des poumons, l’exercice à cheval eft
un moyen très-propre à en difliper la caufe ; lorfque
rôdeur forte vient de l’eftomac , rien n’eft plus
propre à la faire ceffer, que l’ufage des eaux minérales.
Les animaux qui ne vivent que de végétaux, rendent
leurs excrémens prefque fans féteur : l’homme
rendroit les liens de même , s’il ne le nourrilfoit que
de pain & d’eau ; mais tous les animaux qui font
leur principale nourriture de viandes , de poilfons,
d’oe ufs, ont leurs matières fécales très-puantes.
Il eft des perfonnes qui font incommodées par la
mauvaife odeur de leur déje&ion : elles peuvent corriger
ce vice , en faifant ufage d’alimens aqueux,
acides, falés ; on peut confeiller avec fuccès ce régime
, toutes les fois que les excrémens font plus
jaunes que la couleur naturelle de la paille.
Lorfque les déjeûions font fort puantes dans la
phthifie , il eft de la plus grande importance de s’ab-
llenir de l’ufage des viandes , & d’employer beaucoup
le fuc de. limon : on doit obferver la même
chofe ÿ quand les urines récentes font de mauvaife
odeur .••on peut regarder comme une réglé, pour les
hydropiques , qu’ils ne fe trouvent pas mal de fairç
ufage de viande pour leur nourriture , tant que les
excrémens ne font pas extraordinairement puans'; il
faut renoncer bien-tôt à ce genre d’aliment, & recourir
aux acides, dès que les déjeôions deviennent
d’unq odeur plus fétide. Extrait de Boerhaave ,
comment, injlitut. pathol. Jymptpmatolog. § . ÿ j o .
Galien, dans f o n commentaire fur le troifieme livre
des épidémies, regarde la féteur extraordinaire de toute
forte d’excrémens , comme un figne certain de
pourriture : la mauvaife odeur dans les ulcérés annonce
qu’ils font de mauvais caraâere.
- Pour la caufe phyfique des mauvaifes odeurs en
général, voye^ O d e u r , P u a n t e u r . Quant au détail
concernant les parties du corps, où il s’établit
çîes caufes de puanteur, voyc{ les articles de ces parties
même , tellesque le N e z , les O r e i l l e s , les
A i s s e l l e s , les A i n e s , les P i e s ; & pour les humeurs
, yoyei D é j e c t i o n , U r i n e , T r a n s p i r a t
i o n , S u e u r , C r a c h a t , U l c é r é , O z é n e ,
^ . ( d )
F E T F A , f. m. (Hift. mod. ) nom que les Turcs
donnent aux jugèmens oU décifions que le muphti
rend par écrit. Ce mot, en langage turc, fignifie feh-
tence, & en arabe , la reponfe ou le jugement d'un
homme fage ; & ils appellent ainfi, par excellence,
les jugemens du muphti. (G)
> f* f’ (Hift- mod.') nom que les peuples
de'Guinée en Afrique donnent à leurs divinités. Ils
ont' une fétiche pour toute une provincé , & des ƒ«-
ricA« particulières pour chaque famille. Cette idole
ëft un arbre , une tête de linge, un oifeau , ou quelque
chofe de femblable, fuivant leur fantaifie. D ap-
per ydefeription de l'Afrique. (G )
FÉTIDE , adj. ( Médecine. ) Fpye[ FÉTEUR.
FÉTIDES, ( P ilu le s ) Pharm. & Matière médicale.
On trouve dans les difpenfaires deux fortes de pilu-
Jés , 'cjui portent le nom de fétides ; fovoir, les pilule?
fendes majeures , & les pilules fétides mineures.
jEHes font l’une & l’autre de Mefué.
. Pilules fétides majeures de Mefué. Prenez du faga-
penum,de la gomme ammoniac,opopanax,bdelIium,
de la, coloquinte, de l’aloès fuccotrin , de la fémen-
ce de rue ,de l’éphhyme, de chacun cinq dragmes;
de la feammonée , trois dragmes ; de l’éfule préparée
dans le vinaigre , & des hermoda&es , de chacun
deux dragmes ; du meilleur turbith, demi-once ;
du gingembre, line dragme & demie ; de la cannelle,
du lpica indica, du faffran , du caftoreum , de chacun
une dragme ; de l’euphorbe , deux fcrupules.
Faites-en une maffe avec le fuc de poireau, félon
l ’art. , f j t '
On trouve dans la p h a rm a co p é e u n iv e r fe lle de Le-
mery , des p i l u l e s f é t i d e s m a je u r e s réformées. Elles
différent de celles de Mefué, en ce qu’on en a retranché
l’épithyme, le fpicanard, la cannelle, le gingembre
, le bdellium& l’euphorbe, & qu’il a employé le
firop dè pomme compofé du roi Sapor ou Sabor, à
la place du fuc de poireau.
Les p i l u l e s f é t id e s m a je u r e s de la p h a rm a c o p é e de
Paris, different de celles, de Mefué, en ce qu’on en
a retranché l’euphorbe, & qu’on y a ajoute la myrrhe
& l’afla foetida, & qu’on a fubftitue avec Leme-
r y le firop. de pomme au fuc de poireau. t
Ce s pilules font hydragogues, fondantes , hyfte-
riques, emmenagogues : elles ont été recommandées
par les anciens médecins, quiofoient employer
des remedes héroïques, beaucoup célébrés contre
les obftruftions, les fuppreflions de réglés & les vui-
danges, les vapeurs hyftériques, la goutte, l’hydrq-
pifie, le rhumatifme, certaines coliques, & c . Mais
la medecine moderne proferit, fans doute trop généralement,
les remedes de cette claffe. V o y e .j Hér
o ï q u e ( tr a it em e n t .)
Les p i l u l e s f é t id e s m in eu r e s font abfolument hors
d’ufage parmi nous. La faculté de Medecine de Paris
ne les a pas fait entrer dans fa pharmacopée. (b)
FÉTIDE, ( C h im ie ,) On donne ce nom à quelques
huiles tirées des végétaux & des animaux parla violence
du feu. V o y e i H u i l e , { h )
FETMENT, f. m. ( C o m m e r c e .) monnoie d’Allemagne
; c’eft la moitié du petriment , ou le demi-
albs ou fou , ou la vingt-quatrieme partie du kopf-
ftu ck , ou fix fous huit deniers de France.
FÉ TU , f. m. ( H i ß . n a t . b o t . ) en latin, f i f i u a a v e -
n a c e a f i e r i l i s e la t io r . C. B. forte d’avoine lauvage,
qui dans le fyftème de Linnoeus , conftitue un genre
diftinftif de plante. Voici fes carafteres. Le calice
eft un tuyau b ivalve, droit, portant des fleurs
rangées enfemble fur un freie epic. La fleur eft à
deux levres, dont l’inférieure a la forme du calice,
& eft en quelque maniéré cylindrique, fe terminant
néanmoins par un barbillon pointu. Les étamines
font trois filamens capillaires, plus courts que la fleur.
Cette fleur entoure étroitement la graine qui eft unique
, oblongue, même très-aiguë aux deux extrémité
s , convexe d’un côté, fillonnee de 1 autre. A r t .
d e M . l e C h e v a lie r D E J A U C O U R T .
F é t u , ( G é o g r . ) petit royaume de l’Afrique, fur
la côte d’or de Guinee, d’environ quatre lieues de
long, fur quatre de large ; il abonde en fruits, bétail
huile, & palmiers qui fourniflent du vin. Les
Hollandois y ont eu un fort. (D . J.)
FÉTU EN CUL, f. m. ( H i ß . n a t o r n i io l . ) oifeau
ainfi nommé, parce qu’il a dans la queue deux plumes
longues d’un pié & plus, qui font fi bien jointes
l’une à l’autre, qu’elles paroiflent n’en faire qu’une ;
on l’appelle aufli Vo ife a u d u tr o p iq u e , parce qu il ne
fe trouve qu’entre les deux tropiques. Le P. du T ertre
croit que c’eft un oifeau de paradis \ on ne le voit
prefque jamais à terre, que pour couver & nourrir
fes petits. Il a le corps gros comme un pigeonneau ;
la tête petite ; le bec gros & long comme le peüt
doigt, pointu &c rouge comme du corail ; les pies
. font de la même couleur ; celle des plumes eft blanche
comme la neige. Cet oifeau vole très - haut &
fort loin des terres ; il a un cri perçant. Les Sauvages
font grand cas. des deux longues plumes de la
queue, ils les mettent dans leurs cheveux, & les
caftent dans l’entre-deux de leurs narines en guife
T om e F I t
de mouftaches. Hijl. nat. des antilles.- Tom. I I . pag.
( I )
FEU, f. m. (Phyfiq.) Le caraûere le plus effen-
tiel du feu, celui que tout le monde lui reconnoît,
eft de donner de la chaleur. Ainfi on peut définir en
général le feu, la matière qui par fon action produit
immédiatement la chaleur en nous. Mais lefeii eft-il
une matière particulière? ou n’eft-ce que la matière
des corps mife en mouvement? c’ eft fur quoi les Phi-
lofophes font partagés. Les fçholaftiques regardent
le feu comme un des quatre élémens ou principes
des corps, en quoi ils ne font pas fort éloigné§des
principes de la chimie moderne. Poye^plus bas F e u ,
( Chimie. )
Le feu , félon Ariftote , raffemble les parties homogènes,
& fépare les hétérogènes, ce qui n’eft pas
vrai, du moins en général ;puifque fi l’on fait fondre
dans un même vafé, du fuif, de la cire, de la p o ix ,
de la réfine , le tout s’incorpore enfemble.
Selon les Çartéfiens, le feu n’eft autre chofe que
le mouvement excité dans les particules des corps
par la matière du premier élément dans laquelle ils
nagent. Voye^ C a r t é s i a n i s m e & M a t i è r e s u b t
i l e . Selon Newton, le feu n’eft qu’un corps échauffé.
Foyei C h a l e u r . Enfin félon un grand nombre
de philofophes modernes, c’eft une matière particulière.
Voyei C h a l e u r , & là fuite de cet article.
Comme le feu échappe à nos féns, & qu’il fe rencontre
dans tous les corps & dans tous les lieux où
il eft poflible de faire des expériences, il eft très-difficile
de diftinguer les vrais cara&eres qui lui font
propres. M. Muffchenbroek lui en donne deux , fa-
voir la lumière & la raréfa&ion. Foye[ L u m i è r e
& R a r é f a c t i o n . Ce phyficien prétend que partout
où il y a lumière, même fans chaleur, il y a feu.
Il le prouve par la lumière de la lune!? qui raffem-
blée au foyer d’un verre ardent, éclaire beaucoup
fans brûler. Mais il femble qu’on peut contefter que
cette lumière, en ce cas, foit du jfeu. Il n eft pas démontré
que la matière qui produit la lumière, foit
la même que celle qui produit la chaleur. Il eft vrai
que la lumière de la lune eft refléchie de celle du fo-
leil, & que la lumière.du foleil eft accompagnée de
chaleur. Mais encore une fois, il faudroit avoir
prouvé inconteftablement que la lumière & la chaleur
du foleil font abfolument produites par le même
principe & par la même matière. D ’ailleurs ,
fuppofons même qu’il n’y ait d’autre différence entre
. la lumière du foleil & celle de la lune , finon que
celle-ci n’échauffe pas parce qu’elle eft produite
par un mouvement trop rallenti ; on pourroit dire
en ce cas, que la lumière de la lune ne feroit point
proprement du feu , puifqu’elle manqueroit du mou-
- vement néceffaire pour être un feu véritable.
De la raréfaction des corps par le feu. Tous les
corps, fi on en excepte un petit nombre dont nous
parlerons plus bas, fe raréfient ou Je dilatent en tout
fens par le moyen du feu. Cette raréfaûion continue
aufli long-tems que le feu refte appliqué à ces corps.
Elle eft d’autant plus grande que le feu eft plus ardent
; cependant elle ne va pas a l’infini, & ne paf-
fé pas une certaine etendue determinee. C eft^au
moyen du pyrometre ( Foye{ PYROMETRE. ) , qu’on
mefure la raréfaâion des corps par le feu. La rare-
fa&ion d’un corps expofé au feu fe fait d’abord lentement,
puis s’accélère jufqu’à un certain maximum
d’accélération, au-delà duquel la raréfaction le lait
encore, & continue toûjours, mais moins v ite , jul-
quà ce que le corps foit arrivé à fa plus grande dilatation.
Le même feu qui raréfié divers corps, ne
les dilate ni en raifon inverfe de leur pefanteur, ni
en raifon inverfe de leur force cm refiftance à etre
divifés, ni en raifon compofee de ces deux-là, mais
fuivant’ un autre rapport tout-à-fait inconnu. ^ G G g g ij