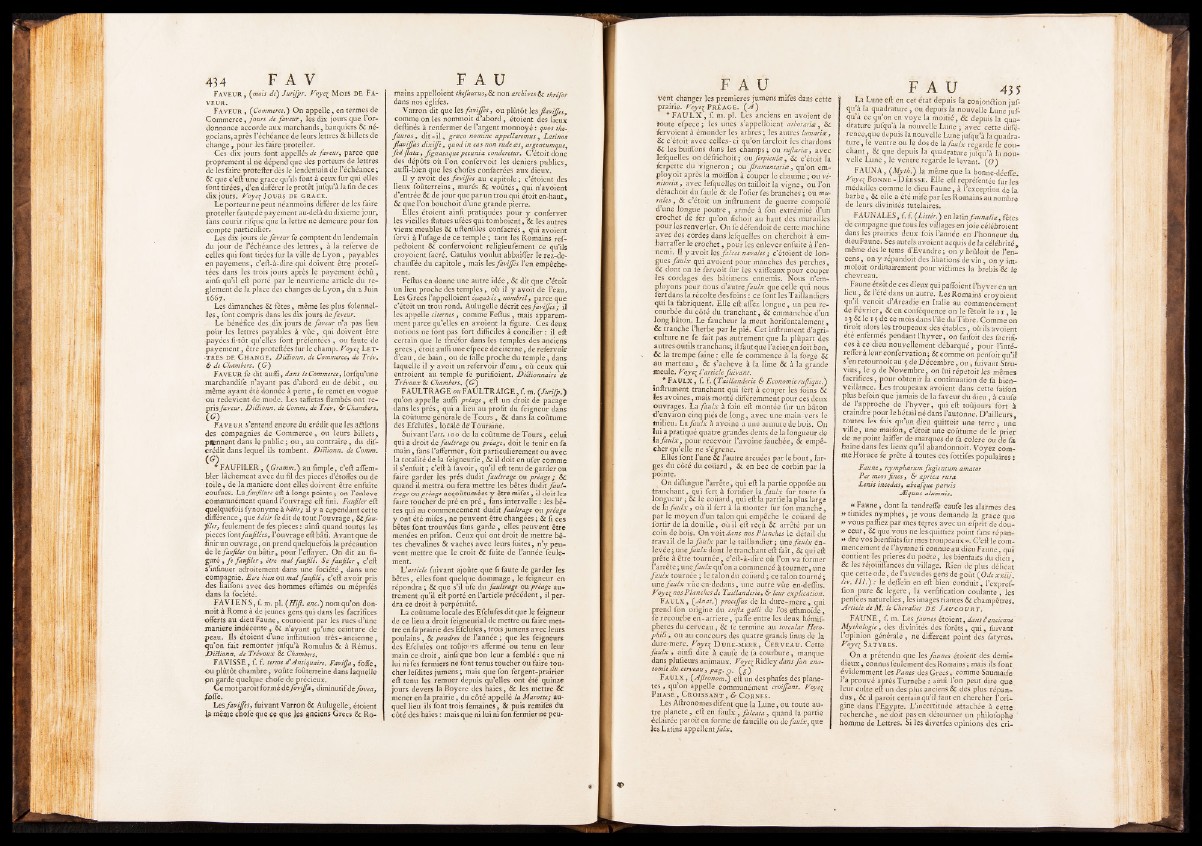
434 F A V Fa v e u r , (mois de) Jurifpr. Voyt{ Mois d e Fa v
e u r .
Fa v e u r , (Commerce.') On appelle, en termes de
Commerce, jours de faveur, les dix jours que l’ordonnance
accorde aux marchands, banquiers & ne-
gocians, après l’échéance de leurs lettres & billets de
change, pour les faire protefter.
Ces dix jours font appellés de faveur, parce que
proprement il ne dépend que des porteurs de lettres
de les faire protefter dès le lendemain de l’échéance ;
& que c’eft une grâce qu’ils font à ceux fur qui elles
font tirées, d’en différer le protêt jufqu’à la fin de ces
dix jours. Voyez Jo u r s d e g r â c e .
Le porteur ne peut néanmoins différer de les faire
protefter faute de payement au-delà du dixième jour,
fans courir rifque que la lettre ne demeure pour fon
compte particulier.
Les dix jours de faveur fe comptent du lendemain
du jour de l’échéance des lettres, à la referve de
celles qui font tirées fur la ville de L y o n , payables
en payemens, c’eft-à-dire qui doivent êtrç protef-
tées dans les trois jours après le payement échû,
ainfi qu’il eft porté par le neuvième article du reglement
de la place des changes de L y on , du 2 Juin
.1667.
Les dimanches & fêtes, même les plus folennel-
le s , font compris dans les dix jours de faveur.
Le bénéfice des dix jours de faveur n’a pas lieu
pour les lettres payables à v u e , qui doivent être
payées fi-tôt qu’elles font préfentées , ou faute de
payement, être proteftées lur le champ. Voyeç L e t t
r e s d e C h a n g e . Diclionn. de Commerce, de Trév.
& de Chambers. (G)
Fa v e u r fe dit aufli, dans le Commerce, Iorfqu’une
marchandise n’ayant pas d’abord eu de débit, ou
même ayant été donnée à p erte, fe remet en vogue
ou redevient de mode. Les taffetas flambés ont repris
faveur. Diclionn. de Comm. de Trév. & Chambers.
CG) ........................
Fa v e u r s entend encore du credit que les a étions
des compagnies de Commerce, ou leurs billets,
prennent dans le public ; ou , au contraire , du discrédit
dans lequel ils tombent. Diclionn. de Comm.
(G)
* FAUFILER, (Gramm.) au fimple, c’eft affem-
bler lâchement avec du fil des pièces d’étoffes ou de
toile , de la maniéré dont elles doivent être enfuite
coufues, hafaufilure eft à longs points ; on l’enleve
communément quand l’ouvrage eft fini. Faufiler eft
quelquefois fynonyme à bâtir; il y a cependant cette
différence, que bâtir fe dit de tout l’ouvrage, & faufiler,
feulement de fes pièces : ainfi quand toutes les
pièces font faufilées 9 l’ouvrage eft bâti. Avant que de
finir un ouvrage, on prend quelquefois la précaution
de le faufiler ou bâtir, pour l’effayer. On dit au figuré
, fe faufiler , être mal faufilé. Se faufiler , c’eft
s’infinuer adroitement dans une fociété, dans une
compagnie. Etre bien ou mal faufilé, c’eft avoir pris
des liaifons avec des hommes eftimés ou méprifés
dans la fociété.
F AV I E N S , f. m. pl. (Hiß. anc.) nom qu’on don-
noit à Rome à de jeunes gens qui dans les Sacrifices
offerts au dieu Faune, couroient par les rues d’une
maniéré indécente, & n’ayant qu’une ceinture de
peau. Ils étoient d’une inftitution très - ancienne, 2u’on fait remonter jufqu’à Romulus & à Rémus.
diclionn. de Trévoux & Chambers.
FAVISSE, f. f. terme d'Antiquaire. Favißa, foffe,
o u plutôt chambre, voûte foûterreine dans laquelle
pn garde quelque chofe de précieux.
Ce mot paroît formé de foviffa, diminutif defovea,
foffe.
Les faviffes, Suivant Varron & Aulugelle, étoient
la même chofe que ce que fes anciens Grecs ôc Romains
appelaient ihefauruSy Sc non archives & thréfor
dans nos églifes. ,
Varron dit que les favijfes , ou plutôt les fiavijfes,
comme on les nommoit d’abord, étoient des lieux
deftinés à renfermer de l’argent monnoyé : quos the-
fauros , dit - i l , groeco nomine appellaremus, Latinos
fiavijfas dixiffe , quod in eas non rude as, argentumque,
fed flata , Jignataque pecunia conderetur. C’étoit donc
des dépôts oii l’on confervoit les deniers publics,
aufli-bien que les chofes confacrées aux dieux.
Il y avoit des faviJJ'es au capitole; c’étoient des
lieux foûterreins, murés & voûtés, qui n’avoient
d’entrée & de jour que par un trou qui étoit en-haut,
& que l’on bouchoit d’une grande pierre.
Elles étoient ainfi pratiquées pour y conferver
.. les vieilles ftatues ufées qui tomboient, & les autres
vieux meubles 8c uftenfiles confacrés , qui avoient
fervi à l’ufage de ce temple ; tant les Romains ref-
peéfoient 8c confervoient religieufement ce qu’ils
croyoient facré. Gatulus voulut abbaiffer le rez-de-
chauffée du capitole, mais les favijfes l’en empêchèrent.
Feftus en donne une autre idée ,•& dit que c’étoit
tin lieu proche des temples, où il y avoit de l’eau.
Les Grecs l’appelloient êptpaXog, nombril, parce que
c’étoit un trou rond. Aulugelle décrit ces favijfes ; il
les appelle citernes, comme Feftus, mais apparemment
parce qu’elles en avoient la figure. Ces deux
notions ne font pas fort difficiles à concilier : il eft
certain que le thréfor dans les temples des anciens
grecs , étoit auffi une efpece de citerne, de refervoir
d’eau , de bain, ou de falle proche du temple, dans
laquelle il y avoit un refervoir d’eau, où ceux qui
entroient au temple fe purifioient. Dictionnaire de
Trévoux & Chambers. (G)
FAULTRAGE ou FAULTRAIGE, f. m. (Jurifp.)
qu’on appelle auffi prèage, eft un droit de pacage
dans les prés, qui a lieu au profit du feigneur dans
la coûtume générale de Tours , 8c dans la coûtume
des Efclufes, locale deTouraine.
Suivant Y art. 100 de la coûtume de Tours, celui
qui a droit de faultrage ou préage, doit le tenir en fa
main, fans l’affermer, foit particulièrement ou avec
la totalité de la feigneurie, 8c il doit en ufer comme
il s’enfuit ; c’eft à lavoir, qu’il eft tenu de garder ou
faire garder les prés dudit faultrage ou préage ; &
quand il mettra ou fera mettre les bêtes dudit faultrage
ou préage acçoûtumées y être mifes, il doit les
faire toucher de pré en p ré, fans intervalle : les bêtes
qui au commencement dudit faultrage ou préage
y ont été mifes, ne peuvent être changées ; & fi ces
bêtes font trouvées fans garde , elles peuvent être
menées en prifon. Ceux qui ont droit de mettre bêtes
chevalines & vaches avec leurs fuites, n’y peuvent
mettre que le croît 8c fuite de l’année feulement.
Uarticle fuivant ajoûte que fi faute de garder les
bêtes, elles font quelque dommage, le feigneur en
répondra ; 8c que s’il ufe du faultrage ou préage autrement
qu’il eft porté en l’article précédent, il perdra
ce droit à perpétuité.
La coûtume locale des Efclufes dit que le feigneur
de ce lieu a droit feigneurial de mettre ou faire mettre
en fa prairie des Efclufes, trois jumens avec leurs
poulains, & poudres de l’année ; que les feigneurs
des Efclufes ont toûjonrs affermé ou tenu en leur
main ce droit, ainfi que bon leur a femblé : que ni
lui ni fes fermiers ne font tenus toucher ou faire toucher
lefdites jumens ; mais que fon fergent-prairier
eft tenu les remuer depuis qu’elles ont été quinze
jours devers la Boyere des haies, & les mettre 8c
mener en la prairie, du côté appellé la Marotte; auquel
lieu ils font trois femaines, & puis remifes du
côté des haies : mais que ni lui ni fon fermier ne peu-
Vent changer les premières jumens mifes dans cette
prairie. Voyez P r é a g e . ( A )
* F A U L X , f. m. pl. Les anciens en avoient de
toute efpece ; les unes s'appelaient arboraria, 8c
forvoient à émonder les arbres ; les autres lumarice ,
8c c’étoit avec celles-ci qu’on farcloit les chardons
8c les buiflons dans les champs ; ou rujlariæ, avec
lefquelles on défrichoit ; ou ferpiculoe, 8c c’étoit la
ferpette du vigneron ; ou Jlramcntarice, qu’on em-
ployoit après la moiffon à couper le chaume ; ou vi-
■ nitoria, avec lefquelles on tailloit la vigne, ou l’on
detachoit du faille & de l’ofier fes branches ; ou murales
, & c’étoit un inftrument de guerre compofé
d ’une longue poutre, armée à fon extrémité d’un
crochet de fer qu’on fichoit au haut des murailles
pour les renverfer. On fe défendoit de cette machine
avec des cordes dans lefquelles on cherchoit à em-
barraffer le crochet, pour les enlever enfuite à l’ennemi.
Il y avoit les falces navales c’étoient de longues
fauïx qui avoient pour manches des perches,
& dont on fe fervoit fur les vaiffeaux pour couper
les cordages des bâtimens ennemis. Nous n’employons
pour nous d’autre faulx que celle qui nous
fort dans la récolte des foins : ce font les Taillandiers
qui la fabriquent. Elle eft affez longue, un peu recourbée
du côté du tranchant, 8c emmanchée d’un
long bâton. Le faucheur la meut horifontalement,
& tranche l’herbe par le pié. Cet inftrument d’agriculture
ne fe fait pas autrement que la plûpart des
autres outils tranchans; il faut que l’acier^en foit bon,
& la trempe faine : elle fe commence à la forge 8c
au marteau , 8c s’acheve à la lime & à la grande
meule. Vyye{ l'article fuivant.
* F a u l x , f. f. (Taillanderie & Economie rujîique.)
inftrument tranchant qui fort à couper les foins 8c
les avoines, mais monté différemment pour ces deux
ouvrages. La faulx à foin eft montée fur un bâton
•d’environ cinq piés de long, avec une main vers le
milieu. Isa faulx à avoine a une armure de bois. On
lui a pratiqué quatre grandes dents de la longueur de
la fau lx , pour recevoir l’avoine fauchée, & empêcher
qu’elle ne s’égrène.
Elles font l’une 8c l’autre ârcuées par le bout, larges
du côté du coiiard, & en bec de corbin par la
pointe.
On diftingue l’arrête, qui eft la partie ôppofée au
tranchant, qui fort à fortifier la faulx fur toute fa
longueur ; 8c le coiiard, qui eft la partie la plus large
de la fa u lx , où il fort à la monter fur fon manche,
par le moyen d’un talon qui empêche le coiiard de
lortir de la douille, où il eft reçû 8c arrêté par un
coin de bois. On voit dans nos Planches le détail du
travail de la faulx par le taillandier ; une faulx én-
levée ; une faulx dont le tranchant eft fait, 8c qui eft
prête à être tournée, c’eft-à-dire où l’on va former
l’arrête ; un & faulx qu’on a commencé à tourner, une
faulx tournée ; le talon du coiiard ; ce talon tourné;
une faulx vûe en-dedans, une autre vûe cn-deffus.
Vjye^nos Planches de Taillanderie, & leur explication.
F a u l x , (Anat.) procejfus de la dure-mere, qui
prend fon origine du crifia galli de l’os ethmoïde,
fo recourbe en-arriéré, paffe entre les deux hémif-
pheres du cerveau, 8c fe termine au torcular Hero-
phili y ou au concours des quatre grands finus de la
dure-mere. Voyez D u r e -m e r e , C e r v e a u . Cette
faulx , ainfi dite à caufe de fa courbure, manque
dans plufieurs animaux. Voyez Ridley dans fon anatomie
du cerveau y pag. a. (g )
F a u l x , (Aflronom.) eft un desphafos des planètes
, qu’on appelle communément croijfant. Voyez
P h a s e , C r o i s s a n t , & C o r n e s .
Les Aftronomes difont que la Lune, ou toute autre
planete, eft en faulx, falcata, quand la partie
éclairée paroît en forme de faucille ou &e faulx, que
les Latins appellent faix, ■
La Lune eft en cet état depuis là cônjonftion jufqu’à
la quadrature -, ou depuis la nouvelle Lune jufqu’à
ce qu’on en voye la moitié, êc depuis la quadrature
jufqu a la nouvelle Lune ; avec cette différence,
que depuis la nouvelle Lune jufqu’à la quadrature
, lé ventre ou le dos de la faulx regarde le couchant,
8c que depuis la quadrature jufqu’à la nouvelle
Lune, le ventre regarde le levant. (O )
FAUNA, (Myth.) la même que la bonne-déefle.
V y e { B o n n e - D é e s s e . Elle eft repréfentée fur les
médailles comme le dieu Faune, à l’exception de la
barbe, 8c elle a été mife par les Romains au nombre
de leurs divinités tutélaires. ,
FAUNALES, f. f. (Littér.) en latin faunalia, fêtes
de campagne que tous les villages en joie célébroient
dans les prairies deux fois l’annee en l’honneur du
dieuFaune. Ses autels avoient acquis de la célébrité,
meme des le teins d’Evandre ; on y brûloit de l’encens
, on y répandoit des libations de v in , on y im-
moloit ordinairement pour viftimes la brebis 8c le
chevreau.
Faune étoit de ces dieux qui paffoient l’hyver en un
lieu , & 1 ete dans un autre. Les Romains croyoient
qu il venoit d’Arcadie en Italie au commencement
de Février, & en conféquence on le fêtoit le 1 1 , le
13 & le 15 de ce mois dans l’île du Tibre. Comme on
tiroit alors les troupeaux des étables, où ils avoient
été enfermés pendant l’hyver, on faifoit des facrifi-
ces à ce dieu nouvellement débarqué, pour l’inté-
reffer à leur conforvation; & comme on penfoit qu’il
s’en retournoit au 5: de Décembre, ou -, fui vaut Stru-
vius, le $ de Novembre, on lui répetoit les mêmes
faerifices, pour obtenir la continuation de fa bienveillance.
Les troupeaux avoient dans cette faifon
plus befoin que jamais de la faveur du dieu, à caufe
de l’approche de l’hyver, qui eft toûjours fort à
craindre pour le bétail né dans l’autonne. D ’ailleurs*
toutes les fois qu’un dieu quittoit une terre, une
ville , une maifon, c’étoit une coûtume de le prier
de ne point laiffer de marques de fa colere ou de fa
haine dans les lieux qu’il abandonnoit. V oyez comme
Horace fe prête à toutes ces fottifes populaires :
Faune, nymphafum fugientum amator
Permeos fines, & aprica rurtt
Lenis incedas, abeafque parvis
Æquus alumnis.
w Faune, dont la tendreffe caufe les alarmes des
» timides nymphes, je vous demande la grâce que
» vous palliez par mes terres avec un efprit de dou-
» ceur, & que vous ne les quittiez point fans répan-
» dre vos bienfaits fur mes troupeaux ». C ’eft le commencement
de l’hymne fi connue au dieu Faune, qui
contient les prières du poëte, les bienfaits du dieu ■
& les réjoiiiffances du village; Rien de plus délicat
que cette ode, de l’aveu des gens de goût (Ode xx\ij.
liv. I I I .) : le deffein en eft bien conduit, l’expref-
fion pure & legere, la verfification coulante, les
penfées naturelles, les images riantes & champêtres.
Article fie M. le Chevalier DE J AU COURT.
F A U N E ,f m. Les faunes étoient, dans!ancienne
Mythologie, des divinités des forêts, q ui, fuivant
l’opinion générale , ne different point des fatyres-.
Voye^ S a t y r e s .
On a prétendu que les faunes étoient des demi-
dieux , connus feulement des Romains ; mais ils font
évidemment les Panes des Grecs, comme Saumaifo
l’a prouvé après Turnebe : ainfi l’on peut dire que
leur culte eft un des plus anciens & dés plus répandus
, & il paroît certain qu’il faut en chercher l’origine
dans l’Egypte. L’incertitude attachée à cette
recherche, ne doit pas en détourner un philofophe
homme de Lettres. Si les diverfes opinions des cri