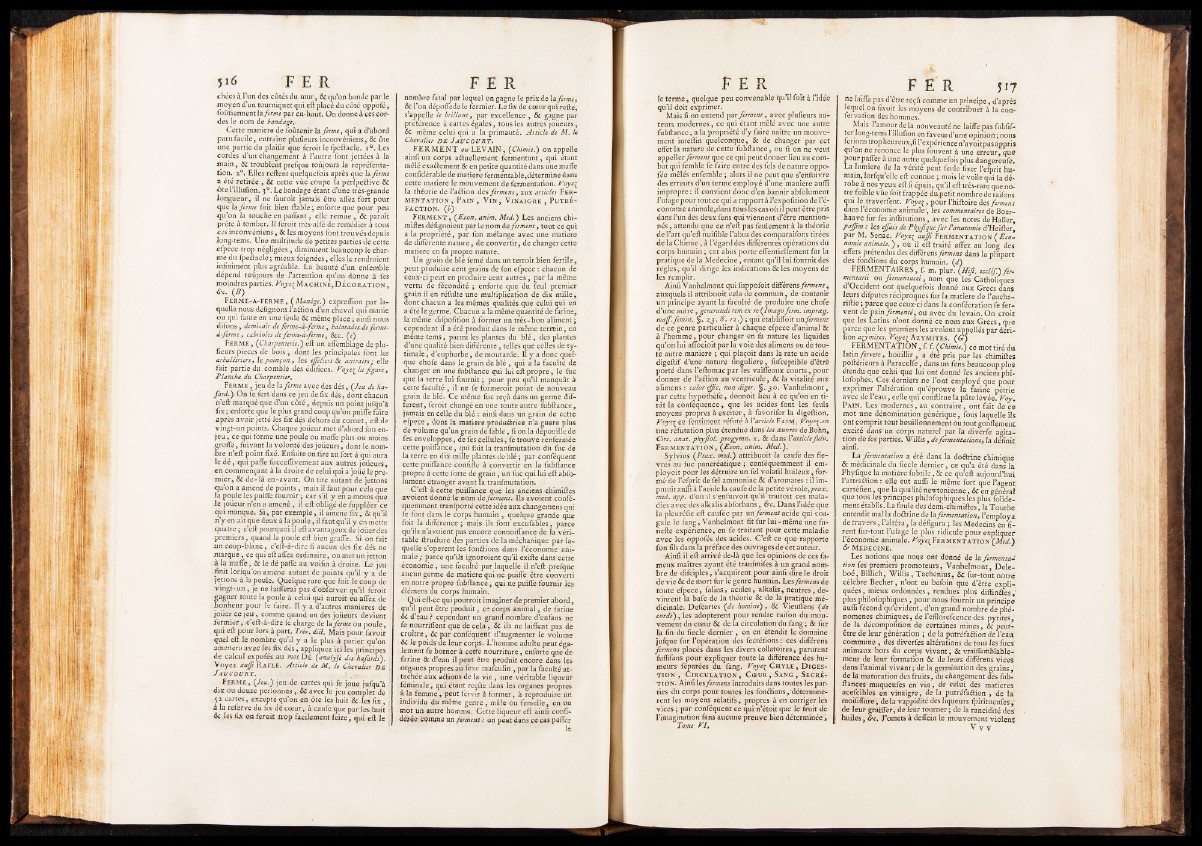
chées à l’un des côtés du mur, & qu’on bande par le
moyen d’un tourniquet qui eft placé du côté oppofé,
Soutiennent la ferme par en-haut. On donne à ces cordes
le nom de bandage..
Cette maniera de loûtenir la ferme, qui a d’abord
paru facile, entraîne plufieurs inconvéniens, & ôte
une partie du plaifir que feroit le fpedacle. iQ. Les
cordes d’un changement à l’autre font jettées à la
main, &c troublent prefque toujours la repréfenta-
iion. 2°. Elles relient quelquefois après que la ferme
a été retirée , & cette vue coupe la perfpedive &
©tel’illufion. 30. Le bandage étant d’une très-grande
longueur, il ne fauroit jamais être affez fort pour
que la ferme foit bien ftable; enforte que pour peu
qu’on la touche en paffant, elle remue , & paroît
prête à tombe*. Il feroit très-aifé de remédier à tous
ces inconvéniens, & les moyens font trouvés depuis
long-tems. Une multitude de petites parties de cette
efpece trop négligées, diminuent beaucoup le charme
du fpedacle ; mieux foignées, elles le rendroient
infiniment plus agréable. La beauté d’un enfemble
dépend toûjours de l’attention qu’on donne à fes
moindres parties. Vover Ma c h in e ,D é c o r a t io n ,
6c. gB)
F e rm e -A-FERME , ( Manège.) exprelfion par laquelle
nous défignons l’adion d’un cheval qui manie
ou qui faute en une feule & même place ; ainli nous
difons, demi-air de ferme-à-ferme , balotades de ferme-
à-ferme , cabrioles de ferme-à-ferme, &c. (e)
Fe rm e , (Charpenterie.) eft un affemblage de plufieurs
pièces de bois , dont les principales, font les
arbalétriers, le poinçon , les ejfeliers & antraits; elle
fait partie du comble des édifices. Foye^ la figure,
Planche du Charpentier.
Fe rm e , jeu de la ferme avec des dés, (Jeu de ha-
fard.) On fe fert dans ce jeu de fix dés, dont chacun
n’eft marqué que d’un côté, depuis un point jufqu’à
fix ; enforte que le plus grand coup qu’on puiffe faire
après avoir jetté les fix dés dehors du cornet, eft de
yingt-un points. Chaque joiieur met d’abord fon enjeu
, ce qui forme une poule ou maffe plus ou moins
.grofle, fuivant la volonté des joueurs, dont le nombre
n’eft point fixé. Enfuite on tire au fort à qui aura
le dé, qui paffe fuccelfivement aux autres joiieurs,
en commençant à la droite de celui qui a joiié le premier,
& de-là en-avant. On tire autant de jettons
qu’on a amené de points , mais il faut pour cela que
la poule les puiffe fournir ; car s’il y en a moins que
le joiieur n’en a amené , il eft obligé de fuppléer ce
qui manque. Si, par exemple, il amene fix, & qu’il
n’y en ait que deux à la poule, il faut qu’il y en mette
quatre ; e’eft pourquoi il eft avantageux de joiier des
premiers, quand la poule eft bien graffe. Si on fait
un coup-blanc, c’eft-à-dire fi aucun des fix dés ne
marque, ce qui eft affez ordinaire, on met un jetton
à la maffe, & le dé paffe au voifin à droite. Le jeu
.finit lorfqu’on amene autant de points qu’il. y a de
jettons.'à.la poule. Quelque rare que foit le coup de
vingt-un, je ne laifferai pas d’obferver qu’il feroit
gagner toute la poule à celui qui auroit eu affez de
bonheur .pour le faire. Il y a d’autres maniérés de
joiier ce jeu , comme quand un des joiiéiirs devient
fermier, c’eft-à-dire fe charge de la ferme ou poule, !
qui eft pour lors à part. Trév. dicl. Mais pour favoir
quel eft le nombre qu’il y a le plus à parier qu’on
amènera avec les fix dés, appliquez ici les principes
de. calcul expofés au mot, DÉ (anàlyfe des-, ha fards).
V o y e z aujfi R a f l e . Article de M . le Chevalier D E ,
J AVCQURT. ' \
F e rm e , (/««,) jeu de cariés qui. fe joue jufqü’à ;
dix ou douze peribnnes , & avec le jeu complet de
52 cartes, excepté qu’on en ôte les huit &c les fix
à la referve du fix de coeur, à caufe. que par les huit \
& les fix on feroit .trop facilement feize, qui eft le
nombre fatal par lequel on gagne le prix de la ferme,
& l’on dépoffede le fermier. Le fix de coeur qui refte,
s’appelle le brillant, par excellence , & gagne par
préférence à cartes égales, tous les autres joiieurs,
& même celui qui a la primauté. Article de M. le
Chevalier D E J A V CO U R T .
F E RM EN T ou LEVAIN, (Chimie.) on appelle
ainfi un corps aduellement fermentant, qui étant
mêlé exadement & en petite quantité dans une maffe
confidérable de maîiere fermentable,détermine dans
cette matière le mouvement de fermentation..Foye^
la théorie de l’adion des fer mens, aux articles Fer m
e n t a t io n , P a in , V i n , V in a ig r e , P u t r é f
a c t io n . (b)
Fe r m e n t , (E.con. anim. Med.) Les anciens chi-
miftes défignoient par le nom de ferment, tout ce qui
a la propriété, par fon mélange avec une matière
de différente nature, de convertir, de changer cette
matière en fa propre nature.
Un grain de blé femé dans un terroir bien fertile,
peut produire cent grains de fon efpece : chacun de
ceux-ci peut en produire cent autres, par la même
vertu de fécondité ; enforte que du ieul premier
grain il en réfulte une multiplication de dix mille ,
dont chacun a les mêmes qualités que celui qui en
a été le germe. Chacun a la même quantité de farine,
la même difpofition à former un très-bon aliment ;
cependant il a été produit dans le même terrein, en
même tems, parmi les plantes du b lé , des plantes
d’une qualité bien différente, telles que celles de ty-
timale, d’euphorbe, de moutarde. Il y a donc quelque
chofe dans le grain de blé , qui a la faculté de
changer en une fubftance qui lui eft p ropre, le fuc
que la terre lui fournit ; pour peu qu’il manquât à
cette faculté , il ne fe formeroit point de nouveau
grain de blé. Ce même fuc reçu dans un germe different,
feroit changé en une toute autre fubftance,
jamais en celle du blé : ainfi dans un grain de cette
efpece, dont la matière productrice n’a guere plus
de volume qu’un grain de fable, fi on la dépouille de
fes enveloppes, de fes cellules, fe trouve renfermée
cette puiffance, qui fait la tranfmutation du fuc de
la terre en dix mille plantes de blé ; par conféquent
cette puiffance confifte à convertir en la fubftance
propre à cette forte de grain, un fuc qui lui eft abfo-
lument étranger avant la tranfmutation.
C ’eft à cette puiffance que les anciens chimiftes
avoient donné le nom de ferment. Ils avoient confé-
quemment tranfporté cette idée aux changemens qui
fe font dans le corps humain , quelque grande que
foit la'différence ; mais ils font excufables, parce
qu’ils n’avoient pas encore connoiffance de la véritable
ftrudure des parties de la méçhanique par laquelle
s’opèrent les fondions dans l’économie animale
i parce qu’ils ignoroient qu’il exifte dans cette
économie, une faculté par laquelle il n’eft prefque
aucun germe de matière qui ne puiffe être converti
en notre propre fubftance, qui ne puiffe fournir les
élémens du corps humain.
Qui eft-ce qui pourroit imaginer de premier abord,
qu’il peut être produit, ce corps animal, de farine
& d’eau ? cependant un grand nombre d’enfans ne
fe nourriffent que de cela , & ils ne laiffent pas de
croître, & par conféquent d’augmenter le volume
& le poids de leur corps. L’homme adulte peut également
fe borner à cette nourriture, enforte que de
farine & d’eau il peut' être produit encore dans les
organes propres au fexe mafeulin , par la faculté attachée
aux adions de la vie , une véritable liqueur
. féminale, qui étant reçue dans les organes propres
à la femme, peut fervir à former, à reproduire un
individu du même genre, mâle ou femelle, en un
mot un autre homme. Cette liqueur eft ainfi confi-
dérée comme un ferment : on peut dans ce cas paffer
le
le terme, quelque peu convenable tyu’il foit à l’idée
qu’il doit exprimer.
Mais fi on entend par ferment, avec plufieurs auteurs
modernes, ce qui étant mêlé avec une autre
fubftance, a la propriété d’y faire naître un mouvement
inreftin quelconque, & de changer par cet
effet la nature de cette fubftance, ou fi on ne veut
appeller ferment que ce qui peut donner lieu au combat
qui femble fe faire entre des fels de nature oppo-
fée mêlés enfemble ; alors il ne peut que s’enfuivre
des erreurs d’un terme employé d’une maniéré aufli
impropre : il convient donc d’en bannir abfolument
l’ufage pour tout ce qui a rapport à Texpofition de l’économie
animale,dans tous les cas où il peut être pris
dans l’un des deux fens qui viennent d’être mentionnés
, attendu que ce n’eft pas feulement à la théorie
de l’art qu’eft nuifible l’abus des comparaifons tirées
de la Chimie, à l’égard des différentes opérations du
corps humain ; cet abus porte effentiellement fur la
pratique de la Medecine, entant qu’il lui fournit des
réglés, qu’il dirige les indications & les moyens de
les remplir.
Ainfi Vanhelmont qui fuppofoit différens fermtns,
auxquels il attribuoit cela de commun, de contenir
lin principe ayant la faculté de produire une chofe
d’une autre, generandi rem ex re (Imago ferm. imprceg.
maff. femin. § . 2 3 . 8 . 12.) ; qui établiffoit un ferment
de ce genre particulier à chaque efpece d’animal &
à l’homme, pour changer en fa nature les liquides
qu’on lui affocioit par la voie des alimens ou de toute
autre maniéré ; qui plaçoit dans la rate un acide
digeftif d’une nature finguliere, fufceptible d’êtrê
porté dans l’eftomac par les vaiffeaux courts, pour
donner de l’adion au ventricule, & la vitalité aux
alimens : calorejfic. non diger. §.30. Vanhelmont,
par cette hypothèfe, donnoit lieu à ce qu’on en tirât
la conféquènce, que les acides font les feuls
moyens propres à exciter, à favorifer la digeftion.
Foye^ ce fentiment réfuté à l’article Fa im . Foye^-en
une réfutation plus étendue dans les oeuvres de Bohn,
Cire. anat. phyfiol. progymn. x . & dans l’article fuiv.
Fe r m e n t a t io n , (Econ. anim. Med.).
Sylvius (Prax. med.) attribuoit la caufe des fièvres
au fuc pancréatique ; conféquemment il em-
ployoit pour les détruire un fel volatil huileux, formé
de Tefprit de fel ammoniac & d’aromates : il im-
putoit aufli à l’acide la caufe de la petite vérole,prax.
med. app. d’où il s’çnfuivoit qu’il traitoit ces maladies
avec des alkalis abforbanS, 6rc. Dans l’idée que
la pleuréfie eft caufée par un ferment acide qui coagule
le fang, Vanhelmont fit fur lui-même une fu-
nefte expérience, en fe traitant pour cette maladie
avec les oppofés des acides. C’eft ce que rapporte
fon fils dans la préface des ouvrages de cet auteur.
Ainfi il eft arrivé de-là que les opinions de ces fameux
maîtres ayant été tranfmifes à un grand nombre
de difciples, s’acquirent pour ainfi dire le droit
de vie & de mort fur le genre humain. Les fermens dé
toute efpece, falins, acides, alkalis, neutres, devinrent
la bafe de la théorie & de la pratique médicinale.
Defcartes (de homine), & Vieuflèns (de
corde), les adoptèrent pour rendre raifon du mouvement
du coeur & de la circulation du fang ; & fur
la fin du fiede dernier , on en étendit le domaine
jufque fur l’opération des fecrétioiis ; ces différens
fermens placés dans les divers collatoires, parurent
fuftifans pour expliquer toute la différence des humeurs
féparées du fang. Foye^ C h y l e , D ig e s t
io n , C i r c u l a t i o n , C oe u r , S a n g , S e c r é t
io n . Ainfi les fermens introduits dans toutes les parties
du corps pour toutes les fondions,'déterminèrent
les moyens relatifs, propres à en corriger les
vices ; par conféquent ce qui n’étoit que le fruit de
l’imagination fans aucune preuve bien déterminée >
Tome F L
ne laiffa pas d’être reçu comme un principe, d’après
lequel on fîxoit les moyens de contribuer à la con-
fervation des hommes.
Mais l’amour de la nouveauté fte laiffe pas fubfif»
ter long-tems Tillufion en faveur d’une opinion ; nous
ferions trop heureux,fi l’expérience n’avoit pas appris
qu on ne renonce le plus fouvent à une efreur, que
pour paffer à une autre quelquefois plus dangereufe.
La lumière de la vérité peut feule fixer Tefprit humain,
Iorfqu’elie eft connue ; mais le voile qui la dérobe
à nos yeux eft fi épais, qu’il eft très-rare que notre
foible vûe foit frappée dtipetit nombre de raifons
qui te ttaverfent. F ô y e pour l’hiftoire des ferment
dans l’économie animale’, les commentaires de Boer-
haave fur fes inftitutions, avec tes notes de Haller,
pajfim : les ejfais de Phyfique fur Canatomie d’Heifter,
par M. Senac. Foye^ aujfi Fermentation ( Eco-
nomie animale. ) , où il eft traité affez au long des
effets prétendus des différens fermens dans la plupart
des fondions du corps humain, (d)
FERMENTAIRES, f. m. plur. (Hift. ecclif.) fer-
mentarii ou fermentacèi, nom que les Catholiques
d Occident ont quelquefois donné aüx Grecs dans
leurs difputes réciproques fur la matière de l’eucha-
riftie ; parce que ceux-ci dans la confécration fe fervent
de pain fermenté, ou avêc du levain. On croit
que tes Latins n’ont donné ce nom aux Grecs, que
parce que les premiers tes avoient appellés par déri-
fion a^ymites. Foye[ A z ym iTES. (G)
FERMENTATION, f.'f. (Chimie.) ce mot tiré du
latin fervere, bouillir , a été pris par tes chimiftes
Çoftérieurs à Paracelfe, dans un fens beaucoup plus
étendu que celui que lui ont donné les anciens phi-
lofophes. Ces derniers ne l’ont employé que pour
exprimer l’altération qu’éprouve la farine pétrie
avec de l’eau, celte qui conftitue la pâte levée. Foy.
Pain. Les modernes, au contraire, ont fait de ce
mot une dénomination générique, fous laquelle ils
ont compris tout bouillonnement ou tout gonflement
excité dans un corps naturel par la diverfe agitation
de fes parties. W illis, de fermentationé, la définit
ainfi.
La fermentation a été dans la dodrine chimique
& médicinale du fiecle dernier, ce qu’ a été dans la
Phyfique la matière fubtile, & ce qu’eft aujourd’hui
l’attradion : elle eut aufli 1e même fort que l’agent
cartéfien, que la qualité newtonienne, & en général
que tous les principes philofophiques tes plus folide-
ment établis. La foute des demi-chimiftes, la Tourbe
entendit mal la dodrine de la fermentation, l’employa
de travers, l’altéra, la défigura ; tes Médecins en firent
fur-tout l’ufage 1e plus ridicule pour expliquer
l’économie animale. Foye^ Ferm entat io n (Med.)
& MEDECINE*
Les notions que nous ont donné de la fermentation
fes premiers promoteurs, Vanhelmont, Dele-
boé, Billich, Willis, Tachenius, & fur-tout notre
célébré Becher, n’ont eu befoin que d’être expliquées
, mieux Ordonnées, rendues plus diftindes '
plus philofophiques , pour nous fournir un principe
aufli fécond qu’évident, d’un grand nombre de phénomènes
chimiques, de l’efflorefcence des pyrites,
de la décompofition de certaines mines, & peut-
être de leur génération ; de la putréfadion de l ’eau
commune , des diverfes altérations de tous les fucs1
animaux hors du corps v ivant, & vraiffemblable-
ment de leur formation & de leurs différens vices
dans l’animal vivant ; de la germination des grains
de la maturation des fruits , du changement des fub-
ftances muqueufes en v in , de celui des matières
acefcibles en vinaigre, de la putréfadion , de la
moififfure , delà vappidité des liqueurs fpiritueufes
de leur grailler, de leur tourner; de la rancidité des
huiles, &c. J’omets à deffein 1e mouvement violent y w