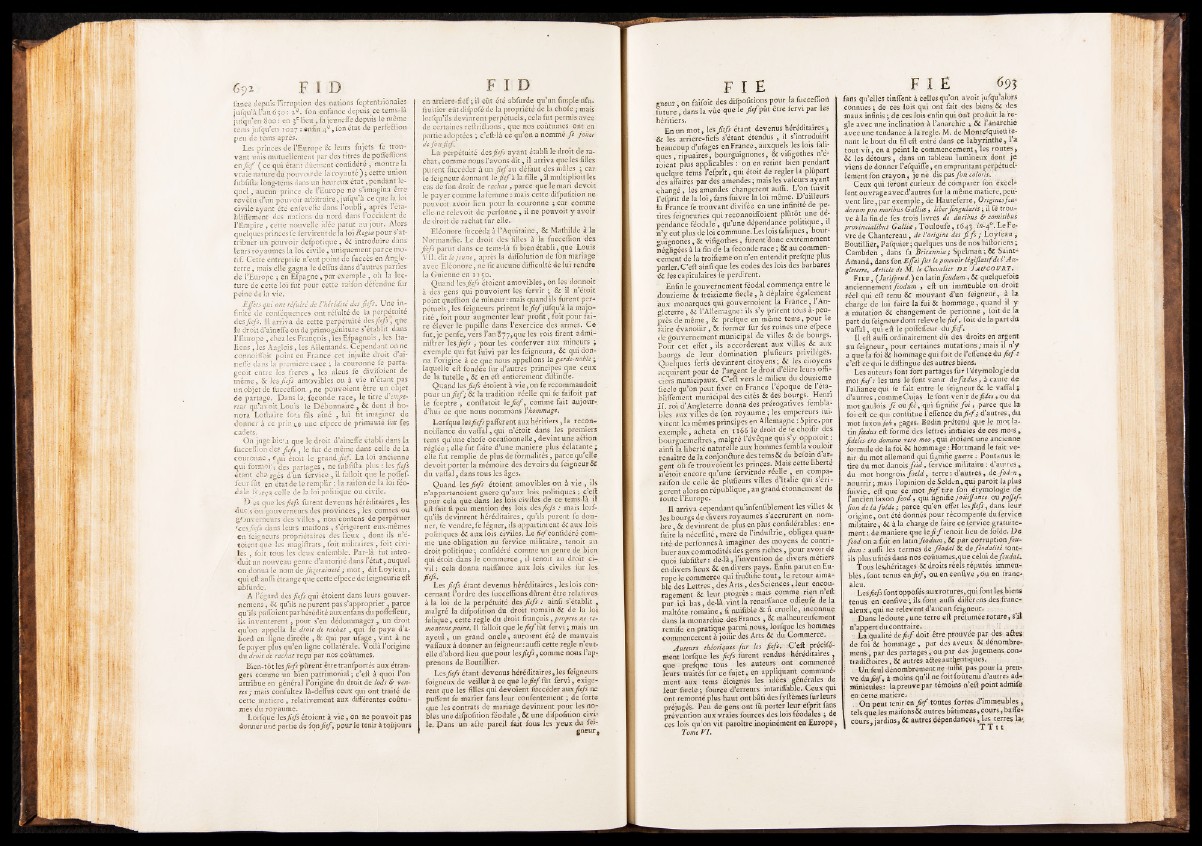
fance depuis l’irruption des nations feptentrionales
jufqu’à l’an 650: zQ. fon enfance depuis ce tems-là
jufqu’en 800 : en 3e lieu , fa jeuneffe depuis le même
tems jufqu’en 1027 : enfin 4 ° , fon état de perfeétion
peu de tems après. : v
Les princes de l’Europe & leurs fujets fe trouvant
unis mutuellement par des titres de poflefîions
en f i e f ( ce qui étant dûement confidere , montre la
vraie nature du pouvoir de la royauté ) ; cette union
fubfifta long-tems dans un heureux é tat, pendant lequel
, aucun prince de l’Europe ne s’imagina etre
revêtu d’un pouvoir arbitraire, jufqu’ à ce que la loi
civile ayant été enfevelie dans l’oubli, après l’eta-
bliffement des nations du nord dans l’occident de
l’Empire , cette nouvelle idée parut au jour. Alors
quelques princes fe fèrvirentdela lolRegia pour s’attribuer
un pouvoir defpotique, &c introduire dans
leurs royaumes la loi civile, uniquement par ce motif.
Cette entreprife n’eut point de fuccès en Angle- .
terre, mais elle gagna le deffus dans d’autres parties
de l’Europe ; en E fpagne, par exemple , oii la lecture
de cette loi fut pour cette raifon défendue fur
peine de la vie. .
E f f e t s q u i o n t r é fu l t é d e L 'h é r é d ité d e s f i e f s . Un e infinité
de coniéquences ont réfulté de la perpétuité
des f i e f s . 11 arriva de cette perpétuité à z s f i e f s , que
le droit d’aînefife où de prïmogéniture s’établit dans
l’Europe , chez les François, les Efpagnols , les Italiens
, les Anglois j les Allemands. Cependant on ne
cohnoifloit point en France cet injufte droit d ai-
nefîe dans la première race ; la couronne fe parta-
geoit entre les freres , les aleus fe divifoient de
même, & les f i e f s amovibles ou à vie n’ étant pas
un objet de fucceflion , ne pouvoient être un objet
de partage. Dans la. fécondé race, le titre d5'emper
eu r qu’avoit.Louis/ le Débonnaire , & dont il honora
Lothaire for,4 fils aîné , lui fit imaginer de
donner à ce prip.ee une efpece de primauté fur fes
cadets.
On juge bieM que le droit d’aînefle établi dans la
fucceflion d es f i e f s , le fut de même dans celle de la
couronne , r^ui étoit le grand f i e f . La loi ancienne
qui formohi des partages , ne fubfifta plus : les f i e f s
étant cha/rgés d’un fervice , il falloit que le poffef-
feur fût en état de le remplir : la raifon de la loi féodale
forç a celle de la loi politique ou civile.
D/és que les f i e f s furent devenus héréditaires, les
du<Xs ou gouverneurs des provinces , les comtes ou
gouverneurs des villes , non' contens de perpétuer
feesf i e f s dans leurs maifons , s’érigèrent eux-mêmes
en feigneurs propriétaires dés lieux , dont ils n’é-
toient que les magiftrars, foit militaires , foit civiles
, foit tous les deux enfemble. Par-là fut introduit
un nouveau genre d’autorité dans l’état, auquel
on donna le nom de fu ^ e r a in e t é ; mot, dit Loyfeau,
qui eft aufli étrange que cette efpece de feigneurie eft
abfurde..
A l’égard des f i e f s qui étoient dans leurs gouver-
nemens, & qu’ils ne purent pas s’approprier , parce
qu’ils pafloient par hérédité auxenfans du pofleffeur,
ils inventèrent, pour s’en dédommager, un droit
qu’on appella le d r o it de r a c h a t , qui fe paya d’abord
en ligne direfte , & qui par ufage , vint à ne
fe payer plus qu’en ligne collatérale. Voilà l’origine
du d r o i t d e r a c h a t reçu par nos coûtumes.
Bien-tôt les f i e f s purent être tranfportés aux étrangers
comme un bien patrimonial ; c’eft à quoi l’on
attribue en général l’origine du droit de lo d s & v e n t
e s ; mais confultez là-deflus ceux qui ont traité de
cette.matière , relativement aux différentes coûtumes
du royaume.
Lorfque les f i e f s étoient à v ie , on ne pouvoit pas
donner une partie de f o n f i e f , pour le tenir à toujours
en arrière-fief ; il eût été abfurde qu’un Ample lifii-
fruitier eût difpofé de la propriété de la choie ; mais
lorfqu’ils devinrent perpétuels , cela fut permis avec
de certaines reftriûions , que nos coûtumes ont en
partie adoptées ; c’eft-là ce qu’on a nommé fe jouer
de fon f i e f , V '
La perpétuité d es fiefs ayant établi le droit de rachat
, comme nous l’avons d it, il arriva que les filles
purent fuccéder à un fie f au défaut des mâles ; car.
le feigneur donnant le fie f à la fille , il multiplioit les
cas de fon droit de rachat, parce que le mari devoit:
le payer comme la femme : mais, cette difpofition ne
pouvoit avoir lieu pour laicouronne ; car comme
elle-ne relevoit de perfonne, il ne pouvoit y avoir
de droit de rachat fur elle.
Eléonore fuccéda à l’Aquitaine, & Mathilde à la
Normandie. Le droit des filles à la fucceflion des
fiefs parut dans ce tems-là fi bien établi, que Louis
VII. dit Le jeune, après la diffolution de fon mariage
avec Eléonore, ne fit aucune difficulté de lui rendre
la Guienne en 1150.
Quand les fiefs étoient amovibles, on les donnoit
à des gens qui pouvoient les fervir ; & il n’étoit
point queftion de mineur : mais quand ils furent perpétuels,
les feigneurs prirent le fie f jufqu’à la majorité
§ foit pour augmenter leur profit, foit pour faire
élever le pupille dans l’exercice des armes. Ce
fiât, je penfe, vers l ’an 877,que les rois firent admi-
niftrer les fiefs , pour lès conferver aux mineurs ;
exemple qui fut fuivi par les feigneurs, & qui donna
l’origine à ce que nous .appelions la garde-noble ;
laquelle eft fondée fur d’autres 'principes que ceux
de la tutelle , & en eft entièrement diftinûe.
Quand les fiefs étoient à v ie , on fe recommaadoit
pour un fief; & la tradition réelle qui.fe faifoit par
le feeptre , conftatoit le fie f, comme fait au jour»,
d’hui ce que nous nommons Yhommage.
Lorfque les fiefs pafferent aux héritiers, la recon-
noiffance du vaffal, qui n’étoit dans les premiers
tems qu’une chofe occafionnelle, devint une action
réglée ; elle fut faite d’une maniéré plus éclatante ;
elle fut remplie de plus de formalités, parce qu’elle.
devoit porter la mémoire des devoirs du feigneur 6C
du vafîal, dans tous les âges.
Quand les fiefs étoient amovibles ou à vie , ils
n’appartenoient guere qu’aux lois politiques ; c’eft
pour cela que dans les lois civiles de ce tems-là il
eft fait li peu mention des lois des fiefs : mais lorfqu’ils
devinrent héréditaires , qu’ils purent fe donner,
fe vendre, fe léguer, ils appartinrent & aux lois
politiques & aux lois civiles. Le fief confidéré comme
une obligation au fervice militaire, tenoit au
droit politique; confidéré comme un genre de bien
qui étoit dans le commerce, il tenoit au droit civil
: cela donna naiffance aux lois civiles fur les
fitfs. WÊÊj I
Les fiefs étant devenus héréditaires, les lois concernant
l’ordre des fucceffions durent être relatives
à la loi de la perpétuité des fiefs : ainfi s’établit ,
malgré la difpofition du droit romain & de la loi
falique, cette réglé du droit françois, propres ne remontent
point. Il falloit que le fie f fût fervi ; mais un
a y eu l, un grand oncle, auroient été de mauvais
vaffaux à donner au feigneur:aufli cette réglé n’eut-
elle d’abord lieu que pour les fiefs, comme nous l’apprenons
de Boutillier.
Les fiefs étant devenus héréditaires, les feigneurs
foigneux de veiller à ce que le fie f fût fervi, exigèrent
que les filles qui dévoient fuccéder aux fiefs ne
pufîent fe marier fans leur confentement ; de forte
que les contrats de mariage devinrent pour les nobles
une difpofition féodale, & une difpofition civile,
Dans un aûe pareil fait fous les yeux du fei-
gneur9
»neuf : bti faifoit des difpofitions poWr h fucceffloB
future, dans la vue que le f a f put etre lervi par les
héritiers.
En un fnot, IeS fiefs étant devenus héréditaires ;
& les arriere-fiefs s’étant étendus , il s'introduit
beaucoup d’ufages en France, auxquels les lois folique
s, ripuaires, bourguignones, &vifigothes n’é*
toient plus applicables : on en retint bien pendant
quelque tems l’efprît, qui étoit de régler la plupart
des affaires par des amendes; mais les valeurs ayant
changé, les amendes changèrent aufli. L’on fui vit
l’efprit de la lo i, fans fuivre la loi même. D’ailléurs
la France fe trouvant divifée en une infinité de petites
feigneuries qui reconnoiffoient plûtôt une dépendance
féodale , qu’une dépendance politique, il
n’y eut plus de loi commune. îles lois foliques, bour-
guignones, & vifigothes, furent donc extrêmement
négligées à la fin de la féconde race ; & au commencement
de la troifieme on n’en entendit prefque plus
parler. C ’eft ainfi que les codes des lois des barbares
Ôc les capitulaires fe perdirent.
Enfin le gouvernement féodal commença entre le
douzième & treizième fied e , à déplaire egalement
aux monarques qui gôuVernoient la France, 1 Angleterre
, & l’Allemagne î ils s’y prirent tous à-peu-
près de même, & prefque en même tems, pour le
faire évanouir, & former fur fes ruines une efpece
de gouvernement municipal de villes & de boiirgs.
Four cet effet , ils accordèrent aux villes & aux:
bourgs de leur domination plufieurs privilèges.
Quelques ferfs devinrent citoyens ; & les citoyens
acquirent pour de l’areent le droit d’élire leurs officiers
municipaux. Ç ’elt vers lé milieu du douzième
fiecle qu’on peut fixer en France l’époque de 1 eta-
bliflement municipal des cités & des bourgs. Henri
II. roi d’Angleterre donna des prérogatives fembla-
bles aux villes de fon royaume ; les empereurs lui-
virent les mêmes principes en Allemagne : Spire, par
exemple, acheta en 1166 le droit de le c h o ir des
bourguemeftres, malgré l’évêque qui s'y oppoloit. :
ainfi la liberté naturelle aux hommes fembla vouloir
renaître de la conjonâure des tems & du befôin d argent
où fe trouvoient les princes. Mais cette liberté
n’étoit encore qu’une fervitude reelle , en compa-
faifon de celle de plufieurs villes d’ Italie qui S’érigèrent
alors en république, au grand etonnement de
toute l’Europe.
Il arriva cependant qu’infenfiblement ies villes &
les bôiuvs de divers royaumes s’accrurent en nombre
, & cTevinrent de plus en plus confidérables : en-
fuite la néceflité, mere de l’induftrie, obligea quantité
de perfonnes à imaginer des moyens de contribuer
aux commodités des gens riches, pour avoir de
quoi fubfifter : de-là, l’invention; divers métiers
en divers lieux & en divers pays. Enfin parut en Europe
le commerce qui fruàifie tout., le retour aimable
des Lettres, des Arts ., des Sciences, leur encouragement
& leur progrès : mais comme rien n’eft
pur ici b as , de-là .vint la renaiffance odieufe de la
maltôte romaine, fi nuifible & fi cruelle, inconnue
dans la monarchie des Francs , ôc malheureufement
remife en pratique parmi nous, lorfque les hommes
commencèrent à joiiir des Arts & du, Commerce.
Auteurs théoriques fur les fiefs. C'eQi precife-
ment lorfque les fiefs furent rendus héréditaires ,
que prefque tous les auteurs ont commence
leurs traités fur ce fujet, en appliquant communément
aux tems éloignés les idées générales de
leur fiecle ; fource d’erreurs intariffable. Ceux qui
ont remonté plus haut ont bâti des fyftèmes fur leurs
préjugés. Peu de gens ont lu porter leur éfprit fans
prévention aux vraies fources des lois féodales ; de
ces lois qu’on vit paroître inopinément en Europe ?
Tome V I .
lans qu’elles tinflent à celles qu’on a voit jufqu’alors
connues ; de ces lois qui ont fait des biens; ôc des
maux infinis ; de ces lois énfin qui ont produit là te-
gle avec une inclinàtion à l’anarchie « & l’ànarehiè
avec une tendance à là réglé-. M. de MQntefquieÜ tenant
le bout du fil eft entré dans ce labyrinthe > l’a
tout v û , en a peint le commencement, les routes,
i & lés détours , dans un tableau lumineux dont jé
viens de donner lWquiffe, en empruntant perpétuellement
fon crayon ; je nè dis pas fon coloris-. •
Ceux qiii feront curieux dé comparer Ion excellent
ouvrage avec d’autres Fur là même matière^ peuvent
lire, par exempiè ; de Hauteferré, Origines feu-
dorum pro moribus G allia , liberJihgularïs ; il fé trouve
à la fin de fes trois livres de ducibus & çomitibus
provinciàlibus G allia, Touloufe, 1643 -tfi-rf. Le F e-
Vre de Chantereaü, de l'ôrigine des f i f s ; Loÿfeau ,
BoUtillier, Pafquier ; quelques uns de nos hiftorièns ;
Cambden , dans fa Britanhiaj Spelman ; & Saint*1
Amand, dans fon E fa i fur le pouvoir légiflatifdU'Angleterre.
Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
F i e f , (Jurifprud.') en latinfeudum, & quelquefois
anciennement feoduth , eft uh' immeuble 'ou droit
réel qui eft tenu Sc mouvant d’un feigneür, à la
charge de lui faire la foi & hommage , quand il y
a mutation & changement de perfonne -, foit de la
part du feigneur dont relevé le fief,- foit de la part du
valfal, qui eft lé poflefleür du fieft .
Il eft aufli ordinairement dû des droits ért atgent
au feigneur, pour certaines mutations ; mais il n’y
a que la foi & hommage qui foit de l’eflence du fie f :
c’eft ce qui le diftingue des autres biens*
Les auteurs font fort partagés fur l’étymOlogié du
mot fie f : lés Uns le foftt venir defeedus, à caufe de
l’alliance qui fe fait entre le feigneur & le valfal ;
d’autres, comme Giijàs le font ven:r defides, ou du
mot gaulois fé où fié , qui fignifie f o i , parce que la
foi eu ce qui conftitue î’effence du fief; d’autres, du
mot faxon feh, gages. Bodin prétend que le mot latin
feedus eft forme des lettres initiales de ces mots ,
fidelis eto domino vero meo, qui étoient une ancienne
formule de la foi & hommage : Hottmand le fait venir
du mot allemand qui fignifie guerre : Pontanus le
tire du mot danois feid, fervice militaire : d’autres ,
du mot hongrois foeld, terre : d’autres, de foden ,
nourrir; mais l ’opinion de Selden, qui paroît la plus
fuivie, eft que ce mot fie f tire fon étymologie de
l’ancien laxon feod , qui fignifie joiiijfance ou pofief-
fion de la folde; parce, qu’en effet les fiefs, dans leur
origine, ont été donnés pour récompenfe du fervice
militaire , & à la charge de faire çe lervice gratuitement
de maniéré que lé ƒ ƒ tenoit lieu de lolde* De
feod on a fait en latin feodum, & par corruption feudum
: auflî les termes de féodal & dz féodalité lont-
ils plus ufités dans nos coûtumes,que cèltii defeudal.
Tous les#héritageS & droits réels réputés immeubles
> font tenus Qii fief, ou en cenliye, ou en franc-
aleu. . * : < v
Les fiefs font oppôfés aux rotures, qui font lesbiens
tenus en cenfive ; ils,font aufli differens desfranc-
aïeux;, qui ne relevant d’aucun feigneur. : -
Dans ledoute, une terre eft préfyméeroture, s’il
n’appert du contraire* ; .
La qualité d e f i f doit être prouvée par des aftes
de foi & hommage , par des aveux: & dénombre-
, mens, par des partages <ou par des .jugemens con-*
tradiftoires, & autres adesauthentiques.
; : Un feul dénombrement ne luflk pas pour la preu-
| v e dufiéf, à moins qu’il ne foitfoutenu d’autres ad*
: rainicules: la preuve par témoins u’eft point admife
; en cette matière* ^ v f •
On peut tenir en fie f toutes fortes d immeubles ,
tels que les maifons & autres bâtimens, cours * baffe«
cours, iardins, & autres dépendances ,Ies terres la*.
u f T t t