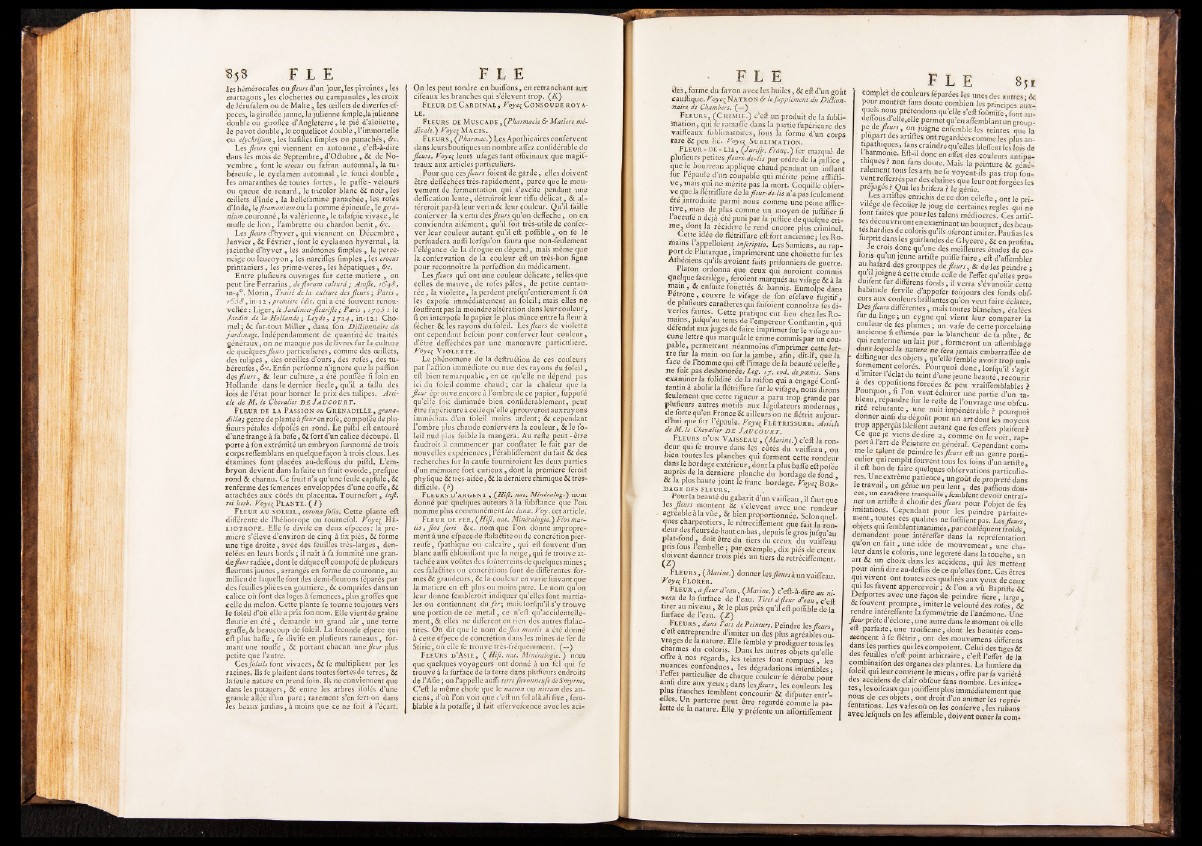
les hémérocales oufleurs d’un jour, les pivoines, les
martagons, les clochettes ou campanules , les croix
de Jérufalem ou de Malte., les oeillets dediyerfes ef-
peces, la giroflée jaune, la julienne limple,la julienne
double ou giroflée d’Angleterre, le pié d’aloiiette,
le pavot double, le coquelicot double, l’immortelle
ou elychrifum, les bafihcs limples ou panachés , &c.
Les fleurs qui viennent en automne, c’eft-à-dire
dans les mois de Septembre, d’Oéfobre, & de Novembre
, font le crocus ou fafran automnal, la tu-
béreufe, le cyclamen automnal, le fouci double ,
les amaranthes de toutes fortes, le paffe- velqurs
ou queue de renard, le tricolor blanc & noir , les
oeillets d’Inde , la bellefamine panachée, les rofes
d’Inde, lefiramonium ou la pomme épineufe, le géranium
couronné, la valérienne, le talafpic vivace, le
mufle de lion, l’ambrette ou chardon bénit, &c..
Les fleurs d’hy v e r , qui viennent en Décembre ,
Janvier, & Février, font le cyclamen hyvernal, la
jacinthe d’hy ver , les anémones Amples , le perce-
neige ou Ieucoyon, les narciffes Amples , les crocus
printaniers, les prime-veres, les hépatiques, &c.
Entre pluAeurs ouvrages fur cette matière , on
peut lire Ferrarius, deflorum culturd ; Amfle. 1 C 4 8 ,
in-40. Morin, Traité delà culture des fleurs ; P a r is ,
i € 5 8 , in-i a , première édit, qui a été fouvent renouv
e l le : Liger, le Jardinierfleurifle ; Paris , t y o 5 : le
Jardin de la Hollande ; Leyde, i j o . 4 , in-12: Cho-
mel ; & fur-tout Miller , dans fon Dictionnaire du
jardinage. Indépendamment de quantité de traités
généraux, on ne manque pas de livres fur la culture
de quelquesfleurs particulières, comme des oeillets,
des tulipes , des oreilles d’ours, des rofes, des tu-
béreufes, &c. Enfin perfonne n’ignore que la paflion
des fleurs, & leur culture, a été pouffée fi loin en
Hollande dans le dernier Aecle, qu’il a fallu des
lois de l’état pour borner le prix des tulipes. Ar ticle
de M . le Chevalier D E J a u COU R T .
F l e u r d e l a P a s s i o n ou G r e n a d i l l e , grana-
dilla} genre de plante à fleur en rofe, compofée de plu-
fieurs pétales difpofés en rond. Le piftil eft entouré
d’une frange à fa bafe, & fort d’un calice découpé. Il
porte à fon extrémité un embryon furmonté de trois
corps reffemblans en quelque façon à trois clous. Les
étamines font placées au-deflous du piftil. L’embryon
devient dans la fuite un fruit ovoïde, prefque
rond & charnu. Ce fruit n’a qu’une feule capfule, &
renferme des femences enveloppées d’unecoëffe, &
attachées aux côtés du placenta. Tournefort, infl.
rei herb. Foye[ P LAN T E , ( / )
F l e u r a u s o l e i l , coronaJolis. Cette plante eft
différente de l’héliotrope ou tournefol. Foye^ Hél
i o t r o p e . Elle fe divife en deux efpeces: la première
s’élève d’environ de cinq à fix piés, & forme
une tige droite, avec des feuilles très-larges, dentelées
en leurs bords ; il naît à fa fommité une gran-
defleur radiée, dont le difque eft compofé de plufieurs
fleurons jaunes, arrangés en forme de couronne, au
milieu de laquelle font des demi-fleurons féparés par
des feuilles pliées en gouttière, & comprifes dans un
calice oîi font des loges à femences, plusgroffes que
celle du melon. Cette plante fe tourne toujours vers
le foleil d’où elle a pris fon nom. Elle vient de graine
fleurie en été , demande un grand air , une terre
graffe, & beaucoup de foleil. La fécondé efpece qui
eft plus baffe , fe divife en plufieurs rameaux, formant
une touffe , & portant chacun une fleur plus
petite que l’autre.
Cesfoleils font vivaces, & fe multiplient par les
racines. Ils fe plaifent dans toutes fortes de terres, &
la feule nature en prend foin. Ils ne conviennent que
dans les potagers, & entre les arbres ifolés d’une
grande allée d’un parc ; rarement s’en fert-on dans
les beaux jardins, à moins que ce ne foit à l’écart.
On les peut tondre en buiffons, en retranchant aux
cifeaux les branches qui s’élèvent trop. (X)
Fleur de Cardinal , Voye^ Consoude royale
. FLEURS DE Muscade , (Pharmacie & Matière, médicale
J Voye^ Macis.
Fleurs , (Pharmaç.) Les Apothicaires eonfervent
dans leurs, boutiques un nombre affez confidérable de
fleurs. Voye^ leurs ufages tant officinaux que magistraux
aux articles particuliers.
. Po.ur que ces fleurs foientde garde, elles doivent
êtrq defféjçhées très-rapidement, parce que le mouvement
de fermentation qui s’excite pendant une
déification lente, détruiroit leur tiffu délicat, & altérerait
par-là leur vertu & leur couleur. Qu’il faille
conlerver la vertu des fleurs qu’on deffeche, on en.
conviendra aifément ; qu’il foit très-utile de confer-
ver leur couleur autant qu’il eft poflible, on fe le
perfuadera auffi lorfqu’on faura que non-feulement
l’élégance de la drogue en dépend, mais même que
la cqnfervation de la couleur eft un très-bon figne
pour reconnoître la perfeftion du médicament.
Les fleurs qui ont une couleur délicate, telles que
celles de mauve, de rofes pâles, de petite centaurée
, la violette, la perdent prefqu’entierement fi on
les expofe immédiatement au foleil ; mais elles ne
Souffrent pas la moindre altération dans leur couleur,
fi on interpofe le papier le plus mince entre la fleur à
fécher & les rayons du foleil. Les fleurs de violette
ont cependant befoin pour conferver leur couleur,
d’être defféchées par une manoeuvre particulière.
Foye^ V i o l e t t e .
Le phénomène de la deftru&ion de ces couleurs
par l’aûion immédiate ou nue des rayons du foleil,
eft bien remarquable, en ce qu’elle ne dépend pas
ici du foleil comme chaud ; car la chaleur que la
fleur é prouve .encore à l’ombre de ce papier, fuppofé
qu’elle foit diminuée bien cônfidérablement, peut
être fupérieure à celle qu’elle éprouveroit aux rayons
immédiats d’un foleil moins ardent ; & cependant
l’ombre plus chaude confervera la couleur, & le foleil
nud plus foible la mangera. Au refte peut - être
faudroit-il commencer par conftater le fait par de
nouvelles expériences ; l’établifl’ement du fait & des
recherches fur la caufe fourniroient les deux parties
d’un mémoire fort curieux, dont la première feroit
phyfique &très-aifée, & la derniere chimique & très-
difficile. (£)
F l e u r s d ’ a r g e n t , (Hift. nat. Minéralog.') nom
donné par quelques auteurs à la fubftance que l’on
nomme plus communément lac luna. Foy. cet article.
Fleur de fer, (Ffi/?. nat. Minéralogie.') Flos mar-
ù s , flo s ferri &c. nom que l’on donne improprement
à une efpece de ftalaétite ou de concrétion pier-
reufe, fpathique ou calcaire, qui eft fouvent d’un
blanc auffi ébloiiiffant que la neige, qui fe trouve attachée
aux voûtes des fouterreins de quelques mines ;
ces fala&ites ou concrétions font de differentes formes
& grandeurs, & la couleur en varie fui vant que
la matière en eft plus ou moins pure. Le nom qu’on
leur donne fembleroit indiquer qu’elles font martiales
ou contiennent du fer\ mais lorfqu’il s’y trouve
une portion de ce métal, ce n’eft qu’accidentelle-
ment, & elles ne different en rien des autres ftalac-
tites. On dit que le nom de flos martis a été donné
à cette efpece de concrétion dans les mines de fer de
Stirie, où elle fe trouve très-fréquemment. (—)
Fleurs d’Asie, ( Hijt. nat. Minéralogie. ) nom
que quelques voyageurs ont donné à un fel qui fe
trouve à la furface de la terre dans plufieurs endroits
de l’Afie ; on l’appelle auffi terre favonneufe deSmyrne.
C’eft la même chofe que le natron ou nitrum des anciens
, d’où l’on voit que c’eft un fel alkali fixe, fem-
blable à la potaffe; il fait effervefcence ayecles aci-
$ês, formé du favôn avec les huiles, & eft d’un gôut
cauftique. A ' Natron & lefupplémentdu Diction-
■ Kaire de Çhambers. (—)
F l e u r s , ( C h i m i e . ) c*eft,un produit de la fubli-
tfiation, qui fe ramaffe dans la partie fupérieure des
vaiffeaux fublimatoires , fous la forme, d’un corps
irare & peu lié. Voye^ S u b l i m a t i o n .
F l e u r - d e -L is , ( Jurifp. Franç.) fer marqué de
plufieurs peti tes fleurs-de-lis par ordre de la juftice ,
que le bourreau applique chaud pendant un inftant
fur 1 épaulé d un coupable qui mérite peine affliâi-
Ve, mais qui ne mérite pas la mort. Coquille obfer-
Ve que la flétriffure de ia fleur-de-lis n’a pas feulement
été introduite parmi nous comme une peine afflictive,
mais de plus comme un moyen de juftifier fi
l’accufé a déjà été puni par la juftice de quelque cri-
m e i dont la récidive le rend encore plus criminel.
. fitte idee de fletriffure eft fbrt ancienne; les Ro-
Iftains l’appelloient injcriptio. Les Samiens, au rapport
de Plutarque, imprimèrent une chouette fur les
Athéniens qu’ils avoient faits prifonniers de guerre.
Platon ordonna que ceux qui auroient commis
quelque faerilége, feroient marqués au vifage & à la -
mam, & enfuite foiiettés & bannis. Eumolpe dans
Pétrone, couvre le vifage de fon efclave fugitif *
oe plufieurs carafteres qui fâifoient connoîfre fes diverses
fautes. Cette pratiqué eut lieu chez les Ro-
1?,rinsj.lu^(lu,.au tems de l’empereur Conftantin, qui
détendit aux juges dé faire imprimer fur le vifage aucune
lettre qui marquât le crime commis par un coupable
, permettant néanmoins d’imprimer cette lettre
fur la main ou fur la jambe, afin, dit-il, que la
face de l’homme qui eft l’image de la beauté célefte ,
Jie foit pas deshonorée.* Leg. ty . cod. depcenis. Sans
examiner la folidité de la raifon qui a engagé Conftantin
à abolir la fletriffure fur le vifage, nous dirons
feulement que cette rigueur a paru trop grande par
plufieurs autres motifs aux légiflateurs modernes,
de forte qu’en France & ailleurs on ne flétrit aujourd’hui
que fur l’épaule. Foye^ F l é t r i s s u r e . Article
de M . le Chevalier DE J a u c o u r t .
F l e u r s d u n V a i s s e a u , (Marine.) c’eft la rondeur
qui fe trouve dans les côtés du vaiffeau, ou
bien toutes les planches qui forment cette rondeur
dans le bordage extérieur, dont la plus baffe eft pofée
auprès de la derniere planche du bordage de fond
& la plus haute joint le franc bordage. Foyer B o r d
a g e d e s f l e u r s .
Pour la beauté du gabarit d’un vaiffeau, il faut que
les fleurs montent & s’élèvent avec une rondeur
- agréable à la vue, & bien proportionnée. Selonquel-
ques charpentiers, le rétreciffement que fait la rom
deur des fleurs de-haut en-bas, depuis lé gros jufqu’au
plat-fond, doit être du tiers du creux du vaiffeau
pris fous 1 embelle ; par exemple, dix piés de creux
doivent donner trois piés un tiers de retréciffement.
_ F l e ü r s , (Marine.') donnerles/eariàunvaiffeau.
r eyeç F l o r e r .
F l e u r , à-fleur d'eau, (Marine.) c’eft-à-dire au niveau
de la furface de l’eau. Tirer à fleur d'eau , c’eft
tirer au niveau, & le plus près qu’il eft poflible de la
furface de l’eau. (Z)
, F l e u r s , dans Part de Peinture. Peindre les fleurs
c eft entreprendre d’imiter un-des plus agréables ouvrages
de la nature. Elle femble y prodiguer tous les
charmes du coloris. Dans les autres objets qu’elle
offre à nos regards, les teintes font rompues les
nuances confondues, les dégradations infenfibles ;
• r jP amcu ier de c^a(lue couleur fe dérobe pour
ainfi dire aux yeux; dans les fleurs, les couleurs les
plus tranches femblent concourir & difpùter entr’-
clles. Un parterre peut être regardé comme la palette
de la nature. Elle y préfente un affortiffement
ïôiHpiet âe cônle'ùrs fépai-ées les unès des autres • &
pour montfer fans doute combien les principes aùx-
I W .n o u s prétendons qu’elle s’eftfoûniife, font au-
deflous d elle,elle permet qu’en affemblant un eroup-
I on joigne enfemble les teintes que la
î P. uPJrt “ és artiftes ont fègaï-déés comme les plus antipathiques
j fans craindre qu’elles bleffent les lois dé
1 harmonie. Eft-,1 donc en effet des couleurs antipathiques
? non fans doute. Mais; la peinture & séné,
rarement tops les arts ne fe voyent-ils bas trop fou-,
vent reflerres par des chaînes que leur ont forgées les
prejugesi. Qw les brjfera ? tegénie-.
Les artifles enrichis,.de,ïe don célefte , pht le pri-
viiege de fecoiiêr le joug de certaines réglés qui né
lont faites que pour les talens médiocres.; Ces artif-
tes découvriront cil examinant un bouquet , des beau,
tes hardies de coloris qu’ils ofpront imiter. Patifias les
îurpnt dans lés guirlandes de Glycere, & en profita.
Je crois donc qu'une des meilleures études de coloris
qu un jeune artifte puiffe faire, eft d’aflemhler
au hafard des grouppes AeJUurs, & de les peindre 5
qu il joigne à cette étude celle dé l’effet qu’elles pro-
auifentfurdifferens fonds , il verra s’évanouir cetté
habitude fervile d’appofer toujours des fonds* obfs
curs aux copieurs brillantes quoi! veut faire éclater.
Desfleurs différentes, mais toutes blanches, étalées
<lir du linge; un cygne qui vient leur comparer la
couleur de fes plumes ; un vafe dé cette porcelaine
ancienne fi eftimée par la blancheur de fa pâte 8c
1 qui renferme un lait pur, formeront uii affemblagë
danslequeJia nature ne fera jamais embarraffée de
• dutinguer des objets , qu’elle femble avoir trop uniformément
colorés. Pourquoi donc, lorfqu’il s’agit
d imiter 1 éclat du teint d’une jeune beauté, recourir
a des oppofitions forcées, & peu vraiffemblables ?
Pourquoi, fi lon veut éclairer une partie d’un tableau,
répandre fur le refte de l’ouvrage une obfcu,
me rebutante, une nuit impénétrable ? pourquoi
donner amfidu dégoût pour un art dont les moyens
trop apperçusbleffent autant que fés effets plaifent?
Ce que je viens dédire a, comme dn le voit , rapport
à 1 art de Peinture en général. Cependant comme
le talent de peindre 1 esficurs eft un genre parti,
cuber qm remplit fonvént tous les. foins d’un artifte.
il eft bon de faire quelques bifervatiôns particulières.
Uneextrème patience, un goût de propreté dans
le travail, un geme un peu lent, des paflions douces,
un caraôere tranquille, femblent devoir entrai,
ner un artifte a choifir dès jlcurs pour l’objet de fes
imitations. Cependant pour les peindre parfaite!
ment, toutes ces qualités ne fùffifentpas. L e s jk u r s ,
objets qui fombleijtinanimés,par confequentfroids
demandent pour intéreffer dans la repréfentatioil
qu on en fait, une idée de mouvement, une chaleur
dans le coloris, une legereté dans la touche un
art & un choix dans les accidens, qui les mettent
pour ainfi dire au-deffus de ce qu’elles font. Ces êtres
qui vivent ont toutes ces qualités aux yeux de ceux
qui les fa vent appercevoir; & l’on a vû Baptifte &
Defportes avec une façon de peindre fiere, large ,
& fouvent prompte, imiter le velouté des rofes, 6 t
rendre ^intereffante la.fymmétrie de l’anémone. Une
fleur prete d’eclore, une autre dans le moment où elle
eft parfaite, une troifieme, dont les beautés commencent
à fe flétrir, ont des mouvemens différens
dans les parties qui les compofent. Celui des tiges &
des feuilles n’eft point arbitraire, c’eft l’effet de la
combinaifon des organes des plantes. La lumière du
foleil qui leur convient le mieux, offre par fa variété
des accidens de clair obfcur fans nombre. Les infectes
, les oifeaux qui joiiiffent plus immédiatement que
nous de ces objets, ont droit d’en animer les repré^
lentations. Les vafes où on les conferve, les rubans
avec lcfquels on les affemble, doivent orner la com