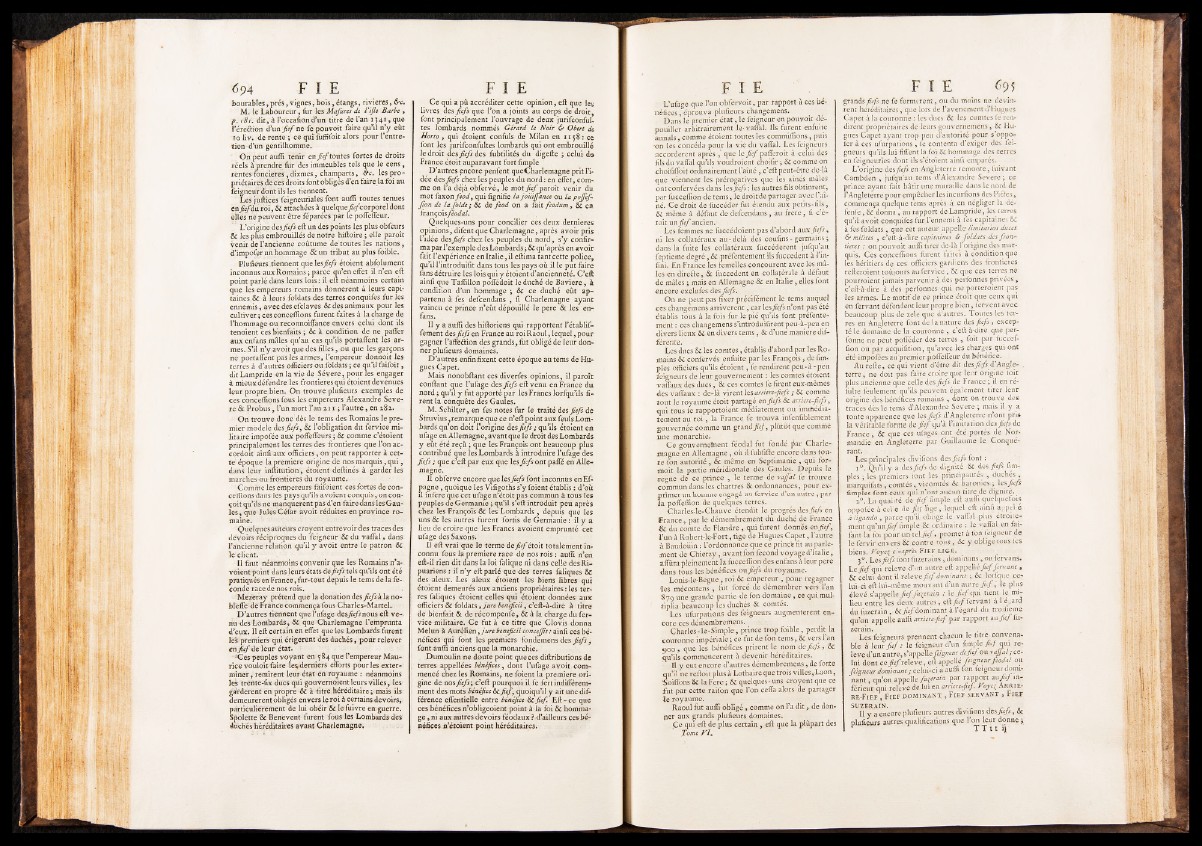
bourabïes, prés, vignes, bois, étangs, rivières, &c.
M. le Laboureur, fur les Mafures de Vifle Barbe ,
p. i8ï. dit, à l’oceafion d’un titre de l’an 1341, que
l’éreftion d’un fie f ne fe pou voit faire qu’il n’y eût
10 liv. de rente ; ce qui fuffifoit alors pour l ’entre*
•tien-d’un gentilhomme.
On peut aufli tenir en fie f toutes fortes de droits
réels à prendre flir des immeubles tels que le cens,
rentes foncières, dixmes, champarts, &c. les propriétaires
de ces droits font obligés d’en faire la foi au
leignèur dont ils lès tiennent.
Les juftices feigneuriales font aufli toutes tenues
enfie f du. roi, & attachées à quelque/«/corporel dont
elles në peuvent être féparées par le poffeffeur.
L’origine desfiefs eft un des points les plus obfcurs
& les plüs embrouillés de notre hiftoire ; elle paroît
venir de l’ancienne coutume de toutes les nations,
d’impofçr un hommage & u n tribut au plus foible.
Plufieurs tiennent qùeles/e/r étoient abfolument
inconnus aux Romains ; parce qu’en effet il. n’en eft
point parlé dans leurs lois : il eft néanmoins certain
que les, empereurs romains donnèrent à leurs capitaines
& à leurs foldats des terres conquifes fur les
ennemis ,,avec des efclaves & des animaux pour les
cultiver ; ces conceffio.ns furent faites à la charge de
l’hommage ou reconnoiffance envers celui dont ils
tenoierit ces bienfaits ; 6c à condition de ne paffer
aux enfans mâles qu’au cas qu’ils portaffent les armes.
S’il n’y avoit que des filles, ou que les garçons
ne portaffent pas les armes, l’empereur donnoit les
terres à d’autres officiers ou foldats ; ce qu’il faifoit,
ditLampride en la v ie de Sévere, pour les engager
à mieüx défendre les frontières qui étoient devenues
leur propre bien. On trouve plufieurs exemples de
ces concédions Cous les empereurs Alexandre Seve-
re & Probus, l’un mort l’an 211 ; l’autre, en 282.
Ori trouve donc dès le tems des Romains le premier
modèle des fiefs, & l’obligation du fervice militaire
impofée aux poffeffeurs ; & comme c’étoient
principalement les terres des frontières que l’on ac-
cordoit ainfi aux officiers, on peut rapporter à cette
époque la première origine de nos marquis, q u i,
dans leur inftitution, étoient deftinés à garder les
marches ou-frontières du royaume.
Comrhe les empereurs failoient ces fortes de con-
ceflionsdaris les pays qu’ils avoient conquis, on conçoit
qu’ils ne manquèrent pas d’en faire dans les Gaules
, que Jules Céfar avoit réduites en province romaine.
Quelques auteurs croyént entrevoir des traces des
dèvoirs réciproques du feigneur & du vaffal, dans
l’aincienne relation qu’il y avoit entre le patron &
le client.
Il faut néanmoins convenir que les Romains n’ a-
voient point dans leurs états de fiefs tels qu’ils ont été
pratiquésen France, fur-tout depuis le tems de la fécondé
race de nos rois. • .
Mezèray prétend que la donation des fiefs d la no-
blèffe de France commença fous Charles-Martel.
D ’autres tiennent que l’ufage des/«/nous eft venu
des Lombards, & que-Charlemagne l’emprunta
d’eux. Il eft certain en effet que les Lombards furent
lë§ premiers qui érigerent des duchés, pour relever
en fie f de leur état. ;
'Ges peuples voyant en 5 84 que l’empereur Maurice
vouloit-faire les-derriiers efforts pour les exterminer
| remirent leur état en royaume : néanmoins
les trente-fix ducs qui gouvernoient leurs villes, les
gardèrent en propre & à titre, héréditaire ; mais ils
demeurèrent obligés envers le roi à certains devoirs,
particuliérement de lui obéir & le fuivre en guerre.
Spolette & Benëvent furent fous les Lombards des
duchés héréditaires avant Charlemagne.
Ce qui a pu accréditer cette opinion, eft que les
livres des fiefs que l’on a joints au corps de droit,
font principalement l’ouvrage de deux jurifconful-
tes lombards nommés Gérard le Noir & Obéré de
Horto, qui étoient confuls de Milan en 1158: ce
font les jurifconfultes lombards qui ont embrouillé
le droit des fiefs des fubtilités du digefte ; celui do
France étoit auparavant fort fimple
D ’autres encore penfent queCharlemagne prit l’idée
des fiefs chez les peuples du nord : en effet, comme
on l’a déjà obfervé, le mot /«/paroît venir du
mot faxon feod, qui fignifie la. joüijjance ou la poffef-
Jion de la folde; & de feod on a fait feodurn, & en
françoisféodal.
Quelques-uns pour concilier ces deux dernieres
opinions, difent que Charlemagne, après avoir pris
l’idée des fiefs chez les peuples du nord, s’y confirma
par l’exemple des Lombards ; & qu’a près en avoir
fait l’expérience en Italie, il eftima tant cette police,
qu’il l’introduifit dans tous les pays où il le put faire
lans détruire les lois qui y étoient d’ancienneté. C ’eft
ainfi que Taflillon poffédoit le duché de Bavière, à
condition d’un hommage ; & ce duché eût appartenu
à fes defeendans , fi Charlemagne ayant
vaincu ce prince n’eût dépouillé le pere & les en-
fans.
Il y a aufli des hiftoriens qui rapportent l’établif*
fement des fiefs en France au roi Raoul, lequel, pour
gagner l’affeétion des grands, fut obligé de leur donner
plufieurs domaines.
D ’autres enfin fixent cette époque au tems de Hugues
Capet.
Mais nonobftant ces diverfes opinions, il paroît
confiant que l’ufage des fiefs eft venu en France du
nord ; qu’il y fut apporté par les Francs lorfqu’ils firent
la conquête des Gaules.
M. Schilter, en fes notes fur le traité des fiefs de
Struvius, remarque que ce n’eft point aux feuls Lombards
qu’on doit l’origine des fiefs ; qu’ils étoient en
ufage en Allemagne, avant que le droit des Lombards
y eût été reçû ; que les François ont beaucoup plus
contribué que les Lombards à introduire l’ufage des
fiefs ; que c’eft par eux que les fiefs ont paffé en Allemagne.
Il obferve encore que les fiefs font inconnus enEf-
pagne, quoique les Vifigoths s’y foient établis : d’oii
il inféré que cet ufage n’étôit pas commun à tous les
peuples de Germanie ; qu’il s’eft introduit peu après
chez les François & les Lombards , depuis que les
uns & les autres furent fortis de Germanie : il y a
lieu de croire que les Francs avoient emprunté cet
ufage des Saxons.
Il eft vrai que le terme de fie f étoit totalement inconnu
fous la première race de nos rois : aufli n’en
eft-il rien dit dans la loi falique ni dans1 celle des Ri-
puariens : il n’y eft parlé que des terres faliques &
des aïeux. Les aïeux étoient lés biens libres qui
étoient demeurés aux anciens propriétaires : les terres
faliques étoient celles qui étoient données aux
officiers & foldats, jure bénéficié, c’eft-à-dire à titre
de bienfait & de récompense, & à la charge du fer-
vice militaire. Ce fut à ce titre que Clovis donna
Melun à Aurélien ,jure bénéficié conceffit: ainfi ces bénéfices
qui font les premiers fondemens des fiefs ,
font aufli anciens que la monarchie.
Dumoulin ne doute point que ces diftributions de
terres appellées bénéfices, dont l’ufage avoit commencé
chez les Romains, ne foient la première origine
de nos/ç/i; c’eft pourquoi il fe fert indifféremment
des mots bénéfice & fief, quoiqu’il y ait une différence
effentielle entre bénéfice àefief E ft-ce que
ces bénéfices n’obligeoient point à la foi & hommage
, ni aux autres devoirs féodaux ? d’ailleurs ces bénéfices
n’étoient point héréditaires.
L’ufage que l’on obfervoit, par rapport à ces bénéfices
, éprouva plufieurs changemens. /
Dans le premier état, le feigneur en pouvoit dépouiller
arbitrairement le-vaffal. Ils furent enfuite
annals, comme étoient toutes les commiflions, puis
-on les concéda pour la vie du vaffal. Les feigneurs.
accordèrent après que le fie f pafferoit à celui des
fils du vaffal qu’ils voudroient choifir ; & comme on
choififloit ordinairement l’aîné , c’eft peut-être de-là
que viennent les prérogatives que les aînés mâles
ont confervées dans 1 es fiefs: les autres fils obtinrent,
par fucceffion de tems, le.droitde partager avec l’aîné.
Ce droit de fuccéder fut étendu aux petits-fils,
& même à défaut de defeendans, au frere, fi c’é-
toit un fie f ancien.-
Les femmes ne fuceédoient pas d’abord aux fiefs,
ni les collatéraux au-delà des coufins- germains ;
dans la fuite les collatéraux fuccéderent jufqu’au
feptieme degré, & préfentement ils fuccedent à l’infini.
En France les femelles concourent avec les mâles
en direûe, & fuccedent en collatérale à défaut
de mâles ; mais en Allemagne & en Italie, elles font
encore exclufes des fiefs.
On ne peut pas fixer précifément le tems auquel
ces changemens arrivèrent, car les fiefs n’ont pas été
établis tous à la fois fur le pié qu’ils font préfentement
: ces changemens s’introduifirent peu-à-peu en
divers lieux & en divers tems, & d’une maniéré différente.
Les ducs & les comtes, établis d’abord par les Romains
& confervés enfuite par les François, defim<
pies officiers qu’ils étoient, fe rendirent peu-à-peu
feigneurs de leur gouvernement : les comtes étoient
vaffaux des dues, & ces comtes fe firent eux-mêmes
des vaffaux : de-là virent les arriéré-fief s ; & comme
tout le royaume étoit partagé en fiefs & arriere-fiefs,
qui tous fe rapportoient médiatement ou immédiatement
au r o i , la France fe trouva infenfiblement
gouvernée comme un grand fief, plûtôt que comme
line monarchie.
Ce gouverneïnent féodal fut fondé, par Charlemagne
en Allemagne, où il fubfifte encore dans toute
fon autorité, & même en Septimanie , qui for-
moit la partie méridionale des Gaules. Depuis le
régné de ce prince , le terme de vafifal fe trouve
commun dans les Chartres & ordonnances, pour exprimer
un homme engagé au fervice d’un autre, par
la poffeflion de quelques terres.
Charles-le-Chauve étendit le progrès des fiefs en
France, par le démembrement du duché de France
& du comte de Flandre , qui furent donnés enfief,
l’un à Robert-le-Fort, tige de Hugues C apet, l’autre
à Baudoiiin : l’ordonnance que ce prince fit au parlement
de Chierzy, avant fon fécond voyage d’Italie,
affûra pleinement la fucceffion des enfans à leur pere
dans tous les bénéfices ou fiefs du royaume.
Louis-le-Begue, roi & empereur , pour regagner
les mécontens , fut forcé de démembrer vers l’an
^79 une grande partie de fon domaine, ce qui multiplia
beaucoup les duchés & comtes.
Les ufurpations des feigneurs augmentèrent encore
ces démembremens.
Charles - le-Simple, prince trop foible, perdit la
couronne impériale \ ce fut de fon tems, & vers 1 an
900, que les bénéfices prirent le nom de fiefs , &
qu’ils commencèrent à devenir héréditaires.
Il y eut encore d’autres démembremens, de for-te
qu’il ne reftoit plus à Lothaire que trois villes ,-Laon,
Soiffons & la Fere ; & quelques-uns croyent que ce
fut par cette raifon que l’on ceffa alors de partager
le royaume.
Raoul fut aufli obligé, comme on l’a d it, de donner
aux grands plufieurs domaines.
Ce qui eft de plus certain, eft que la plûpart des
Tome VI,
grand s fiefs ne fe formèrent, ou du moins ne devinrent
héréditaires, que lors de l’avenement d’Hugues
Capet à la couronne : les ducs & les comtes fe rendirent
propriétaires de leurs gouvernemens, & Hugues
Capet ayant trop peu d’autorité pour s’oppo-
ler à ces ufurpations , fe contenta d’exiger des feigneurs
qu’ils lui fiffent la foi & hommage des terres
en feigneuries dont ils s’étoient ainfi emparés.
L ’origine des fiefs en Angleterre remonte, fuivant
Cambden , jufqu’au tems d’Alexandre Severe ; ce
prince ayant fait bâtir une muraille dans le nord de
l’Angleterre pour empêcher lesincurfions des Pi clés,
commença quelque tems après à en négliger la dé-
fenfe, & donna, au rapport de Lampride, les terres
qu’il avoit conquifes fur l’ennemi à fes capitaines 6c
à fes foldats , que cet auteur appelle limitarios duces
& milites , c’elt-à-dire capitaines & foldats des frontières
: on pouvoit aufli tirer de-là/origine des marquis.
Ces concevions furent faites à condition que
les héritiers de ces officiers gardiens des frontières
refteroient toujours au fervice, ôc que ces terres ne
pourroient jamais parvenir à des perfonnes privées ,
c’eft-à-dire à des perfonnes,’qui ne porteroient pas
les armes. Le motif de ce prince étoit que ceux qui
en fervant défendent leur propre bien, fervent avec
beaucoup plus de zélé que d’autres. Toutes les terres
en Angleterre font de la nature des fiefs, excepté
le domaine de la couronne , c’eft à-dire que per-
fonne ne peut pofféder des terres , foit par fuccef-
fion ou par acquifition, qu’avec les charges qui ont
été impofées au'premier poffeffeur du bénéfice.
Au refte, ce qui vient d’être dit des fiefs d’Angle- ,
terre, ne doit pas faire croire que leur origine Toit
plus ancienne que celle des fiefs de France ; il en re-
lulte feulement qu’ils peuvent également tirer leur
origine des bénéfices romains , dont on trouve des
traces dès le tems d’Alexandre Severe ; mais.il y a
toute apparence que les fiefs d’Angleterre n’ont pris
la véritable forme de fie f qu’à l’imitation des/e/sde
France, & que ces ufageSyOnt^ été portés de Normandie
en Angleterre par Guillaume le Conquérant.
,
Les principales divifions des fiefs font :
i ° . Qu’il y a des fiefs de dignité & des fiefs fim,
pies ; les premiers font les principautés', duchés ,
marquifats, comtés, vicomtés & baronies ; 1 es fiefs
Amples font ceux qui n’ont aucun titre de dignité.
20. La qualité de fief fimple eft aufli quelquefois
oppofée à cel’e de fief lige,- lequel eft ainfi appel é
àligando , parce qu’il oblige, le vaffal plus étroitement
qu’un fie f fimple & ordinaire : le vaffal en fai-
fant la foi pour un tel fief, promet à fon feigneur de
le fërvir envers & contre tous, & y oblige;tous les
biens. Voye^ ci-après F l EF l i g e .
30. Les fiefs font fuzerains, dominans, ou fervans.
Le /«/qui releve d’un autre eft appelle fie f fervant ,
& celui dont il .releve fief dominant- ; & lorfque .celui
ci eft lui-même mouvant d’un autre f i e f ,' le plus
élevé s’appelle fieffuçerain : le fie f qui tient le milieu
entre les deux autres, eft/e/fervanf à l'égard
du fuzerain , & fief dominant à l’egard du troifieme
qu’on appelle aufli arriéré fie f par rapport au fie f fuzerain..
. ,
Les feigneurs prennent chacun le titre convenable
à leur fief : le feigneur d’un fimple fief qui releve
d’un autre, s’appelle feigneur de f ie f ou vaffal; celui
dont ce /«/releve, eft appelle feigneur féodal ou
feigneur dominant ; celui-ci a aufli fon feigneur dominant,
qu’on appelle fuzerain par rapport au/«/inférieur
qui releve de lui en arnerefief V>ye{ A r r i e -
r e -Fif .f F ie f d o m i n a n t . , F i e f s e r v a n t , F i e f
SUZERAIN. ,. r r 9
Il y a encore plufieurs autres divifions des Jiefs, &
plufieurs autres qualifications que l’on leur donne j
r T T 11 ij