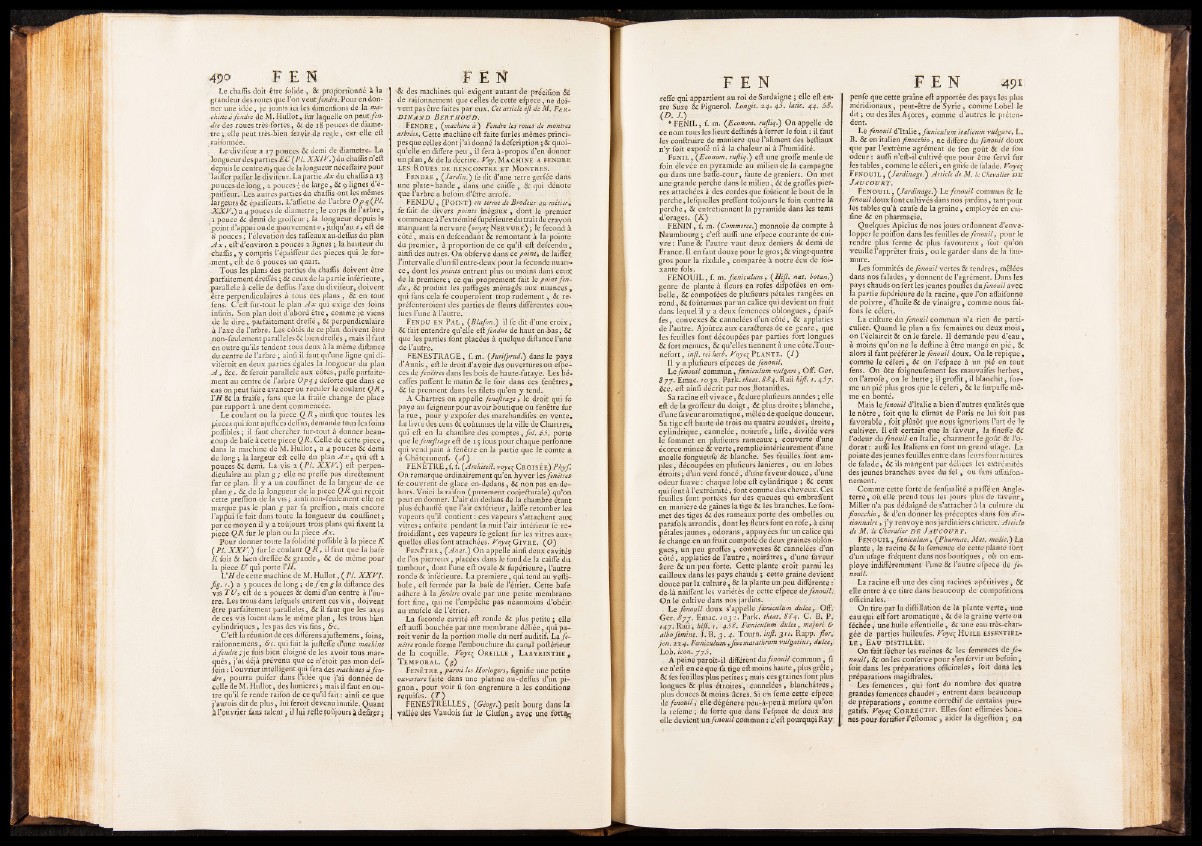
Le chaffis doit être folide, & proportionné à la
grandeur des roues que l’on veut fendre. Pour en don-
-ner une idée, je joints ici les dimenfions de la ma-
.chine à fendre de M. Hullot ,fu r laquelle on pcutfen-
■ dre des roues très-fortès, & de 18 pouces de diamètre
;^elle peut très-bien lervir de réglé, car elle; eft
-raifonnée.
Ledivifeur a 17 -pouces & demi de diamètre.- Ea
•longueur des parties E C (F/. X A 7^.)duchaffis n’eft
depuis le centre /»,-que de la longueur néceffaire pour
'laiffer paffer le diviièur. La partie du chaffis a 13
.poucesde long ,-2. pouces •j.de large, & 9 lignes d’e-
paiffeur.-Les autres -parties du; chaffis ont.les mêmes
largeurs & épaiffeurs. L’affiette de l’arbre O p q (P l,
X X V .') a 4 pouces de diamètre ; le corps de l’arbre,
1 pouce & dcmi de groffeur la longueur depuis le
-point d’appui ou de mouvement 0, jufqu’a u / , eft de
8 pouces ; l’élévation des taffeaux au-deffus du plan
A x , eft d’environ z pouces z lignes ; la hauteur du
chaffis,,y compris l’épaiffeur des pièces qui le for-
-ment, eft de 6 pouces un quart.
Tous les plans des parties du chaffis doivent être
parfaitement dreffés ; & ceux de la partie inférieure,
parallèle à celle de deffus l’axe du divifeur, doivent
être perpendiculaires à tous ces plans , & en tout
.fens., C ’eft fur-tout le plan A x qui exige des foins
infinis.. Son plan doit d’abord être, coinme je viens
de -le dire., parfaitement dreffé, & perpendiculaire
à l’axe de l’arbre. Les-côtés de ce plan doivent être
non-feulement parallèles ôc bien drefles, mais il faut
en outre qu’ils tendent tous deux à la même diftance
du centre de l’arbre ; ainfi il faut qu’une ligne qui dî-
viferoit en deux parties égales la longueur du plan
A , & c . & feroit parallèle aux côtés, paffe parfaitement
au centre de l’arbre Op q ; deforte que dans ce
cas on peut faire avancer ou reculer le coulant Q R ,
VH & la fraife, fans que la fraife change de place
par rapport à une dent commencée.
Le coulant ou la piece Q R , ainfi que toutes les
pièces qui font ajuftées deffus, demande tous les foins
poffibles; il faut chercher fur-tout à donner beaucoup
de bafe à cette piece QR. Celle de cette piece,
dans la machine de M. Hullot, a 4 pouces & demi
de long ; la largeur eft celle du plan A x , qui eft z
pouces & demi. La vis z ( PI. X X V ,) eft perpendiculaire
avi plan g ; elle ne preffe pas directement
fur ce plan. Il y a un couffinet de la largeur de ce
plan g , & de la longueur de la piece QR qui reçoit
cette preffion de la v is ; ainfi non-feulement elle ne
marque pas le plan g par fa preffion, mais encore
l’appui fe fait dans toute la longueur du couffinet ;
par ce moyen il y a toujours trois plans qui fixent la
piece QR fur le plan ou la piece Ax.
Pour donner toute la folidité poffible à la piece K
( PI. X X V . ) fur le coulant Q R , il faut que la bafe
K fbit & bien dreffée & grande, & de même pour
la piece U qui porte 1’//.
L’i f de cette machine de M. Hullot, ( PI. X X V I .
fig. /.) a 5 pouces de long ; de ƒ en g la diftance des
vis T U, eft de z pouces & demi d’un centre à l’autre.
Les trous dans lefquels entrent ces v is , doivent
être parfaitement parallèles, & il faut que les axes
de ces vis foient dans le même plan, les trous bien
cylindriques, les pas des vis fins, &c.
C ’eft la réunion de ces différens ajuftemens, foins,
raifonnemens, &c. qui fait la juftefïe d’une machine
à fendre ; je fuis bien éloigné de les avoir tous marqués,
j’ai déjà prévenu que ce n’étoit pas mon def-
fein : l’ouvrier intelligent qui fera des machines à fendre,
pourra puifer dans l’idée que j’ai donnée de
celle de M. Hullot, des lumières ; mais il faut en outre
qu’il fe rende raifon de ce qu’il fait : ainfi ce que
jj’aurois dit de plus, lui feroit devenu inutile. Quant
jÜ’oiiYrjer fans talent i il lui refte toujours à dçûrpr ;
•& des machines qui exigent autant dé précifion SÀ
de raifonnement que celles de cetfe efpêce, ne dot*
-vent pas être faites par eux. Cet article efi de M. F e r d
i n a n d B e r t h o v d .
Fen d re, (machine à) Fendre les totieS de montres
arbrées. Cette machine eft faite furies mêmes principes
que celles dont j’ai donné la deferiptioii ; & quoiqu’elle
en différé peu , il fera à-propos'd’en donner
un plan ,& de la décrire. Voy. Ma chin e a fendre
l e s .Roues de rencontre et Montres.
Fendre , (Jardin.) fe dit d’une terre gerfée dans
une plate-bande , dans une caille , & qui dénote
que l’arbre a befoin d’être'arrofé.
FENDU, (Po in t ) en terme de Brodeur au métier
fefait de divers points inégaux , dont le premier
commence à l’extrémité fupérieure du trait de crayon
marquant la nervure (voye^ Nervure) ; le fécond à
cô té, mais en defeendant & remontant à la pointe
du premier, à proportion de ce qu’il eft defeendu,
ainfi des autres. On obferve dans ce point, de laiffer,
l’intervalle d’un fil entre-deux pour la fécondé nuance
, dont les points entrent plus ou moins dans ceux
de la première ; ce qui proprement fait le point fend
u , & produit les paffages ménagés aux nuances ,
qui fans cela fe couperoient trop rudement, & re-
préfenteroient des- parties de fleurs différentes cou-;
fues l’une à l’autre.
Fendu en Pal , (Blafon.) il fe dit d’une croix,
& fait entendre qu’elle eft fendue de haut en-bas, 6c
que les parties, font placées à quelque diftance l’une
de l’autre.
FENESTRAGE, f. m. (Jurifprud.) dans le pays
d’Aunis, eft le droit d’avoir des ouvertures ou efpe-
ces de fenêtres dans les bois de haute-futaye. Les bé-
caffes paffent le matin & le foir dans ces fenêtres,
& fe prennent dans les filets qu’on y tend.
A Chartres on appelle fenejlrage , le droit qui fe
paye au feigneur pour avoir boutique ou fenêtre fur
la rue, pour y expofer des marchandifes en vente«'
Le livre des cens & coûtumes de la ville de Chartres^'
qui eft en la chambre des comptes, fol. 5 5. porte
que le fenejlrage eft de 15 fous pour chaque perfonne
qui vend pain à fenêtre en la partie que le comte a
à Châteauneuf. (A )
FENÊTRE ,f. r. (Architecl. voye^ C ro isé e ) Phyf.
On remarque ordinairement qu’en hy ver les fenêtres
fe couvrent de glace en-dedans, & non pas en-dehors.
Voici la raifon (purement conjecturale) qu’on
peut en donnèr. L’air du dedans de la chambre étant
plus échauffé que l’air extérieur, laiffe retomber les
vapeurs qu’il contient : ces vapeurs s’attachent aux
vitres ; enfuite pendant la nuit l’air intérieur fe re-
froidiffant, ces Vapeurs fe gelent fur les vitres auxquelles
elles font attachées. Voye{ G ivr e . (O)
Fenêtre , ( Anat.) On appelle ainfi deux cavités
de l’os pierreux, placées dans le fond de la caiffe du
tambour, dont l’une eft ovale & fupérieure, l’autre
ronde & inférieure. La première, qui tend au vefti-
bule, eft fermée par la bafë de l’étrier. Cette bafe
adhéré à la fenêtre ovale par une petite membrane
fort fine, qui ne l’empêche pas néanmoins d’obéir;
au mufcle de l ’étrier.
La fécondé cavité eft ronde & plus petite ; elle
eft auffi bouchée par une membrane déliée, qui pa-
roît venir de la portion molle du nerf auditif. Lu fenêtre
ronde forme l’embouchure du canal poftérieur
de la coquille. Voye^ Oreille , Labyrinth e ,
T empo ral. ( g)
Fenêtre , parmi les Horlogers, lignifie une petite
ouverture faite dans une platine au-deffus d’un pignon
, pour voir fi fon engrenure a les conditions
requifes. (T )
FENESTRELLES, (Gcogr.) petit bourg dans la
yallée des Vaudois fur le Clufon, avec une fortc^
reffe qui appartient au roi de Sardaigne ; elle eft entre
Suze &c Pignerol. Longit. 2.4. 4J. ladt. 44. 58.
( D . J , )'.v:
* FENIL, f. m. ( Econom. rufiiq.) On appelle de
ce nom tous les lieux deftinés à ferrer le foin : il faut
les conftruire de maniéré que l’aliment des beftiaux
n’y foit expofé ni à la chaleur ni à l’humidité.
Fe n il , ( Econom. rufiiq.) eft une groffe meule de
foin élevée en pyramide au milieu de la campagne
ou dans une baffe-cour, faute de greniers. On met
une grande perche dans le milieu, & de großes pierres
attachées à des cordes que foûtient le bout de la
perche, lefquelles preffent toujours le foin contre la
perche, & entretiennent la pyramide dans les tems
d’orages. (K )
. FENIN, f. m. ('Commerce.) monnoie de compte à
Naumbourg ; c’eft auffi une efpece courante de cuivre
: l’une & l’autre vaut deux deniers & demi de
France. Il en faut douze pour le gros ; & vingt-quatre
gros pour la rixdale, comparée à notre écu de foi-
xante fols.
FENOUIL, f. m. foeniculum, (Hifi\ nat. botan.)
genre de plante à fleurs en rofes difpofées en ombelle,
& compofées de plufieurs pétales rangées en
rond, & foûtenues par un calice qui devient un fruit
dans lequel il y a deux femences oblongues , épaif-
fes, convexes & cannelées d’un côté, Ôc applaties
de l’autre. Ajoûtez aux caraâeres de ce genre, que
les feuilles font découpées par parties fort longues
& fort menues, & qu’elles tiennent à une côte.Tour-
nefort, infi. rei herb. Voye[ PLANTE. ( / )
Il y a plufieurs efpeces de fenouil.
Le fenouil commun, foeniculum vjilgare, Off. Ger .
8yy. Emac. /032. Park, theat. 884. Raii hifi. 1. ^5y.
&cc. eft ainfi décrit par nos Botaniftes.
Sa racine eft viv a ce , & dure plufieurs années ; elle
eft de la groffeur du doigt, & plus droite ; blanche,
d’une faveur aromatique, mêlée de quelque douceur.
Sa tige eft haute de trois ou quatre coudées, droite,
cylindrique, cannelée, noiieufe, liiTe, divifée vers
le fommet en plufieurs rameaux ; couverte d’une
écorce mince & verte, remplie intérieurement d’une
moelle fongueufe & blanche. Ses feuilles, font amples
, découpées en plufieurs lanières, ou en lobes
étroits ; d’un verd foncé, d’uhe faveur douce, d’une
odeur fuave : chaque lobe eft cylindrique ; & ceux
qui font à l’extrémité, font comme des cheveux. Ces
feuilles font portées fur des queues qui embraffent
en manierede gaines la tige & les branches. Le fommet
des tiges & des rameaux porte des ombelles ou
parafols arrondis, dont les fleurs font en rofe, à cinq
pétales jaunes, odorans, appuyées fur un calice qui
fe change en un fruit compoféde deux graines oblongues
, un peu groffes , convexes & cannelées d’un
cô té , applaties de l’autre, noirâtres, d’une faveur
âcre & un peu forte. Cette plante croît parmi les
cailloux dans les pays chauds ; cette graine devient
douce par la.cùlture, & la plarfte un peu différente
de-là naiffent les variétés de cette elpèce de fenouil. .
On lé cultive dans nos jartjins.
. h t fenouil doux s’appelle foeniculum dulce y Off.
Ger. ^77. Emac. /032. Park, theat. 884. C . B; P,
147. Rau, hifl. 1. m m Foeniculum dulee, majori-&
alboftmine.i.B. 3 . 4. Tour il, infi. 311. Rapp, fior.
jen. 224, Foeniculum ,JLvemarathrum vuLgaiius, dulee ',
Lob. icon. yy5.
A peiné paroît-il différent du fenouil commun, fi
ce n’eft en ce que fa tige eft moins haute, plus grêle,
& fes feuilles plus petites ; mais cés graines font plus'
longues & plus étroites, cannelées , blanchâtres ,1
plus douces St, m^ins âcres. Si oh ferne cette efpece
dé fenouil ; elle dégénéré- pôulà-peu à mèfure qu’on
la îefemç; dé forte que dans l’efpace de deux ans
elle devient ;un fenouil commun j c’.eft pourquoi Ray.
penfe que cette graine eft apportée des pays les plus
méridionaux > peut-être de S yrie, comme Lobel le
dit ; ou des îles Açores , comme d’autres le prétendent.
Lé fenouil d’Italie, foeniculum italicum vulgare, L.
B. & ën italien finocchio, ne différé du fenouil doux
que par l ’extrême agrément de fon goût & de fo»
odeur : auffi n’eft-il cultivé que pour être fervi fur
les tables-, comme le céleri , en guife de faîade. Voye^
F f n o u i l , (Jardinage?) Article de M. le Chevalier DE
J A U C O U R T .
F e n o u i l , (Jardinage.) Le fenouil commun & le
fenouil doux font cultivés dans nos jardins, tant pour
les tables qu’à caufe de la graine, employée en cui-
fine & en pharmacie.
Quelques Apicius de nos jours ordonnent d’envelopper
le poiffon dans les feuilles de fenouil, pour le
rendre plus ferme & plus favoureux, foit qu’on
veuille l’apprêter frais, ouïe garder dans de là fau-
mure.
Les fommités de fenouil vertes & tendres, mêlées
dans nos falades, y donnent de l’agrément. Dans les
pays chauds onfert les jeunes pouues du fenouil avec
la partie fupérieure de la racine, que l’on affaifonne
de poivre, d’huile & de vinaigre , comme nous fai-
fons.le céleri.
La culture du fenouil commun n’ a rien de particulier.
Quand le plan a fix femainès ou deux mois,
on l’éclaircit & on le farcie. Il demande peü d’eau,
•à moins'qu’on né le deftine à être mangé en p ié , &
alors il faut préférer le fenouil doux. On le repique ,
comme le céleri, & on l’efpace à Un pié en tout
fens. On ôte foigneufement les mauvaifes herbes,
on l’arrofe, on le butte ; il groffit, il blanchit, forme
un pié plus gros que le céleri, & le furpaffe même
en bonté.
Mais 1 q fenouil d’Italie a bien d’autres qualités que
le nôtre, foit que le climat de Paris ne lui foit pas
favorable, foit plûtôt que nous ignorions l’art de le
cultiver. Il eft certain que la faveur, la fineffe Sc
l’odeur du fenouil en Italie, charment le goût & l’odorat
: auffi les Italiens en font un grand ufage. La
pointe des jeunes feuilles entré dans leurs fourititürés
de falade, & ils mangent par délices les extrémités
des jeunes branches avec du f e l , ou fans aflaifon-
nemént.
Comme-cette forte de fenfualité a pafféen Angleterre,
oh elle prend tous les jours plus de faveur -9
Miller n’a pas dédaigné de s’attacher à la culture du
finocchio , & d’en donner les préceptes dans fôh dictionnaire
, j’y renvoyé nos jardiniers curieux. Article
de M. le Chevalier d e JAUCOURT.
FENOUIL, foeniculum, (Pharmac. Mat. medic.) La
plante, la racine & l a femence de cette planté font
d’un ufage fréquent dans nôs boutiques, oh on employé
indifféremment l’une & l’àutre efpece'de fenouil.
r
La racine eft une des cinq racines apéritives , &
elle entre à ce titre dans beaucoup de compofitions
officinales/
On tije paï la diftillâtion de là plante vërtè * une
eàu <nii eft fort aromatique, & de la graine verte ou
féchee , une hiiile effentielle, & une eau très-char--
gée de parties huileufes. Voye^HviLZ e s s en t ie l l
e , E a u d i s t i l l é e .
On fait fécher les racines & les femences de fenouil,
& on les conferve pour s’en fervir-au befoin ;
foit dans les préparations officinales, foit dans le$
préparations magiftrales. ‘
Les femences, qui font du nombre des quatre
grandes femences chaudes ', entrent dans .beaucoup
de p rép a ration scomme correftif de certains purgatifs.
Voyei C orrect if . Elles font eftimées bonnes
pour fortifier l’eftomae , aider la digeftion ; pu