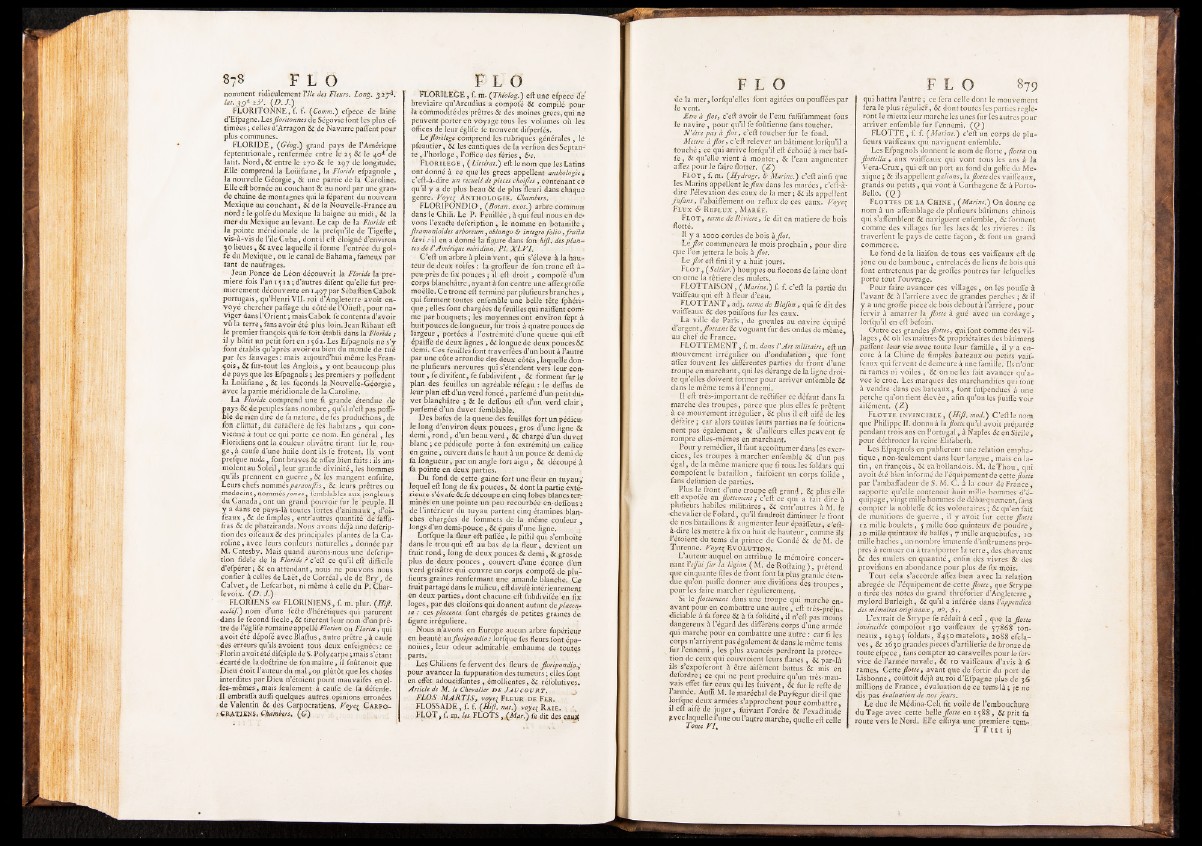
nomment ridiculement Vile des Fleurs. Long, g î j K
lut. $<) d 2.5 '. (D . J .)
FLOR1TONNE, f. f. (Comm.) efpece de laine
d’Efpagne. Les floritonnes de Ségovie font les plus ef-
timées ; celles d’Arragon & de Navarre paffent pour
plus communes»
FLORIDE, ([Géog.) grand pays de l’Amérique
feptenirionale, renfermee entre le 15 & le 40d de
latit. Nord* & entre le 270 & le 297 de longitude.
Elle comprend la Loiiifiane, la Floride efpagnole *
la nouvelle Géorgie, & une partie de la Caroline.
Elle eft bornée aucouchant & au nord par une gran-
de chaîne de montagnes qui la féparent du nouveau
Mexique au couchant, & de la Nouvelle-France au
nord : le golfe du Mexique la baigne au midi, & la
mer du Mexique au levant. Le cap de la Floride eft
la pointe méridionale de la prefqü’île de Tigefte,
vis-à-vis de File Cuba, dont il eft éloigné d’environ
30 lieues, & avec laquelle il forme l’entrée dugol-
fe du Mexique, ou le canal de Bahama, fameux par
tant de naufrages.
Jean Ponce de Léon découvrit la Floride la pre*
mierè fois l’an 1512; d’autres difent qu’elle fut premièrement
découverte en 1497 par SébaftienCabok
portugais, qu’Henri VII. roi d’Angleterre a voit envoyé
chercher paffage du côté de l’Oiieft, pour na-
viger dans l’Orient ; mais Cabok fe contenta d’avoir
vûla terre, fans avoir été plus loin. Jean Ribaut eft
le premier françois qui fe l'oit établi dans la Floride ;
il y bâtit un petit fort en 1562. Les Efpagnols ne s’y
font établis qu’après avoir eu bien du monde de tué
par les fauvages : mais aujourd’hui même les François,
& fur-tout les Anglois, y ont beaucoup plus
de pays que les Efpagnols ; les premiers y poffedent
la Loiiifiane , & les- féconds la Nouvelle-Géorgie,
avec la partie méridionale de la Caroline.
La Floride comprend une fi grande étendue de
pays & de peuples fans nombre, qu’il n’eft pas poffi-
ble de rien dire de fa nature, de fes produ&ions, de
fon climat, du caraûere de fes habitans , qui convienne
à tout ce qui porte ce nom. En général, les
Floridiens ont la couleur olivâtre tirant fur le rouge,
à caufe d’une huile dont ils-fe frotent. Ils vont
prefque nuds, font braves & affez bien faits : ils immolent
au Soleil, leur grande divinité, les hommes
qu’ils prennent en guerre , & les mangent enfuite.
Leurs chefs nommés paraoufiis, & leurs prêtres ou
médecins, nommés jo n a s , feniblables aux jongleurs
du Canada j ont un grand pouvoir fur le peuple. Il
y a dans cé pays-là toutes fortes d’animaux , d’oi-
leaux , & de lîmples, entr’autres quantité dè'faffa-
fras & de phatziranda. Nous avons déjà une defcrip-
tion des oifeaux & des principales plantes de la Caroline
, avec leurs couleurs naturelles, donnée par
M. Catesby. Mais quand aurons-nous une defcrip-
tion fidele de la Floride > c ’eft ce qu’il eft difficile
d’efpérer ; & en attendant, nous ne pouvons nous
confier à celles de Laët, de Corréal, de de Bry, de
Calvet, de Lefcarbot, ni même à celle dit P. Char-
levoix- (\D. J .)
FLORIENS ou FLORINIENS, f. m. plur. (Hijl.
eccléf.) nom d’une fefte d’hérétiques qui parurent
■ dans le fécond fiecle, & tirèrent leur nom d’un prê- j
tre de l’églife romaine appellé Florien ou Flor in , qui !
avoit été dépofé avec Blaftus, autre prêtre, à caufe
■ des erreurs qu’ils âvoient tous, deux enfeignées : ce
Florin avoit été difciple de S. Polycarpe ; mais s’étant
écarté de la doûrine de fon maître, il foûtenoit que
Dieii étoit l’auteur du mal, ou ..plutôt que les chofes
interdites par Dieu n’étoient point mauvaifes en el-
des-mêmes, mais feulement à caufe de fa défenfe. ?
Il embraffa auffi quelques autres,opinions erronées '
de Valentin & des Çarpocratiens. Voye^ C a r p o - i
« R A X J JEN S . Cflamber s. ( G ) |
FLORÏLÉÔE, f. m. ( Théolog.) eft une efpece dV
bréviaire qu’Arcudiiis a compofé & compilé pour
la commodité des prêtres & des moines grecs, qui ne
peuvent porteren voyage tous les volumes oii les
offices de leur égiife fè trouvent difperfés.
Lë florilège comprend les rubriques générales ,' lé
pfeautier, & les cantiques de la verfion des Septante
, l’horlogë, l’office des fériés, &c.
F l o r i l è g e , ( Littéral.) eft le nom que les Latins
ont donné à ce que les grecs appellent anthologie,
ç’eft-à-dire un recueil de pièces choifles, contenant ce
qu’il y a de plus beau & de plus fleuri dans chèque
genre. Voye% A n t h o l o g i e . Chambers.
FLORIPONDIO, (Bot an. exot.) arbre Commun
dans le Chili. Le P. Feuillée, à qui feul nous en devons
l’exatte defcription, le nomme en botanifte ,
flramonioides arboreum , oblongo & integro folio-, frucht
l<evi ; il en a donné la figure dans fon hijl.-des plan->
tes de l'Amérique méridion. PI. X L V I .
G’eft un arbre à plein vent, qui s’élève à la hauteur
de deux toifes : la groffeur de fon; tronc eft à-
peu-près de fix pouces ; il eft droit , compofé d’un
corps blanchâtre, ayant à fon centre une affez grôffe
moëlle. Ce tronc eft terminé par plufieurs branches ;
qui forment toutes enfemble une belle tête fphéri-
que ; elles font chargées de feuilles qui naiffent comme
par bouquets ; les moyennes ont environ fept à
huit pouces de longueur, fur trois à quatre pouces de
largeur, portées à l’extrémité d’une queue qui eft
épaiffe de deux lignes, & longue de deux pouces &
demi. Ces feuilles font traverses d’un bout à l’autrè
par une cote arrondie des deux côtés, laquelle donne
plufieurs nervures qui s’étendent vers leur con?
tour , fe divifent, fe fubdivifent, & forment fur le
plan des feuilles un agréable réfegu. : le deffus de
leur plan eft d’un verd foncé, parfemé d’un petit duvet
blanchâtre ; & le deffous eft d’un verd clair j
parfemé d’un duvet femblable.
Des bafes de la queue des feuilles fortunpédicur
le long d’environ deux pouces, gros d’une ligne &
demi, rond, d’un beau verd, & chargé d’un duvet
blanc ; ce pédicule porte à fon extrémité un calice
en gaine, ouvert dans le haut à un pouce & demi de
fa longueur, par un angle fort aigu, & découpé à
fa pointe en deux parties.
Du fond de cette gaine fort une fleur en tuyau,'
lequel eft long de fix pouces, & dont la partie extérieure
s’évafe&fe découpe en cinq lobes blancs terf-
minés'en une pointe un peu recourbée en-deflous/ï
de l ’intérieur du tuyau partent cinq étamines blanches
chargées de fômméts de la même couleur ,
longs d’un demi-pouce, & épais d’une ligne.
Lorfque la fleur eft paffée, le piftil qui. s’emboîte
dans le trou qui eft au bas de la fleur, devient un
fruit rond, long de deux pouces & demi, &,grqsde
plus de deux pouces , couvert d’une écorce; d’un
verd grisâtre qui couvre un corps compofé de plufieurs
graines renfermant une amande blanche. Ce
fruit partagé dans le milieu, eftdivifé intérieurement
en deux parties, dont chacune eft fubdivifée'en fix
loges, par des cloifons qui donnent autant de placenta
: ces placenta ■ font chargés de petites graines de
figure irrégulière.
Nous n’avons en Europe aucun arbre fupérieqr
en beauté au floripondio : \orfque fes fleurs font épanouies
, leur odeur admirable embaume de toutes
parts.
Les Chiliens fe fervent des fleurs de floripondio.^
pour avancer la fuppuration des tumeurs ; elles, font
en effet adouciflantes ,. émollientes, & réfolutives.
A rticle de M . le Chevalier D E J à u c o u r t .
F L O S M A R T I S , voyeç F l e u r d e F e r .
FLOSSADE, f . f . (Hijl. natV) voyeç R a i e .
FLOT, f. ip, les FLOTS , r(M a rJ fe dit des e.aujsj
F L O de la mer,lorfqu’eIles font agitées ou poiifféespar
le vent.
Etre à jlo t , c’eft avoir de l’eau fuffifamment fous
le navire , pour qu’il fe foûtienne fans toucher.
N'être pas à f lo t , c’eft toucher fur le fond.
Mettre à j l o t , c ’eft relever un bâtiment lorfqu’il a
touché ; ce qui arrive lorlqu’il eft échoiié à mer baffe
, & qu’elle vient à monter, & l’eau augmenter
aflëz pour le faire flotter. (Z)
F l o t , f. m. (Hydrogr. & Marine J c’eft ainfi que
les Marins appellent le f lu x dans les marées, c’eft-à-
dire l’élévation des eaux de la mer; & ils appellent
ju fa n t , l’abaiflement ou reflux de ces eaux. Voye^
F l u x & R e f l u x , M a r é e .
F l o t , terme de R ivière, f e d it e n m a t iè re d e b o is
f lo t té .
Il y a 2000 cordes de bois à jlot.
Le Jlot commencera le mois prochain, pour dire
que l’on jettera le bois à flo t.
Le jlo t eft fini il y a huit jours.
F l o t , (Sellier.) houppes ou flocons de laine dont
on orne la têtiere des mulets.
FLOTTAISON, (Marine.) f . f . c ’e f t la p a r t ie d u
V a ifle a u q u i e f t à f le u r d ’ e a u .
FLOTTANT , adj. terme de Blafon , qui fe dit des
vaifleaux & des poiflons fur les eaux.
t b.a ville de Paris , de gueules au navire équipé
d’argent, flottant & voguant fur des ondes de même,
au chef de France.
FLOTTEMENT, f. m. dans l'A r t militaire, eft un
mouvement irrégulier ou d’ondulation, que font
affez fouvent les différentes parties du front d’une
troupe en marchant, qui les dérange de la ligne droite
qu’elles doivent former pour arriver enfemble &
dans le même tems à l’ennemi.
Il eft très-important de reéiifier ce défaut dans la
marche des troupes, parce que plus elles fe prêtent
à ce mouvement irrégulier, & plus il eft aifé de les
défaire ; car alors toutes leurs parties ne fe foûtien-
nent pas également, & d’ailleurs elles peuvent fe
rompre elles-mêmes en marchant.
^ Pour y remédier, il faut accoutumer dans les exercices
, les troupes à marcher enfemble & d’un pas
égal, de la même maniéré que fi tous les foldats qui
compofent le bataillon, faifoient un corps folide,
fans defunion de parties.
Plus le front d’une troupe eft grand, & plus elle
eft expofée au flottement; c’eft ce qui a fait dire à
plufieurs habiles militaires, & entr’autres à M. le
-chevalier de Folard, qu’il faudroit diminuer le front
de nos bataillons & augmenter leur épaiffeur, c’eft-
à-clire les mettre à fix ou huit de hauteur, comme ils 1
l’étoient du tems du prince de Condé & de M. de
Turenne. Voye\[ E v o l u t i o n .
L’auteur auquel on attribue le mémoire concernant
Veffai fu r la légion ( M. de Roftaing), prétend
que cinquante files de front font la plus grande étendue
qu’on puiffe donner aux divifions des troupes
pour les faire marcher régulièrement.
Si le flottement dans une troupe qui marche en-
avant pour en combattre une autre, eft très-préjudiciable
à fa force & à fa folidité, il n’eft pas moins
dangereux à l’égard des différèns corps d’une armée
qui marche pour en combattre une autre : car fi les
corps n’arrivent pas également & dans le même tems
for l’ennemi, les plus avancés perdront la protection
de ceux qui couvroient leurs flancs , & par-là
ils s’expoferont à être aifément battus & mis en
defordre; ce qui ne peut produire qu’un très-mauvais
effet fur ceux qui les fuivent, & fur le refte de
l’armée. Auffi M. le maréchal de Puyfegur dit-il que
lorfque deux armées s’approchent pour combattre,
il eft aifé de juger, fuivant l’ordre & l’exafritude
fivec laquelle l’une ou l’autre marche, quelle eft celle
Tome V I ,
F L O 879
qui battra l’autre ; ce fera celle dont le mouvement
fera le plus régulier, & dont toutes les parties régleront
le mieux leur marche les unes fur les autres pour
arriver enfemble fur l’ennemi. (Q)
FLOTTE, f. f. (Marine.) c’eft un corps de plufieurs
vaiffeaux qui naviguent enfemble.
Les Efpagnols donnent le nom de flotte, flotta ou
flo t t illa , aux vaiffeaux qui vont tous les ans à la
Vera-Crux, qui eft un port au fond du golfe du Mexique
; & ils appellent galions, \a flotte des vaiffeaux,
grands ou petits, qui vont à Carthagene & à Porto-
Bello. (Q)
F l o t t e s d e l a C h in e , (Marine.) On donne ce
nom à un affemblage de plufieurs bâtimens chinois
qui s’affemblent & naviguent enfemble, & forment
comme des villages fur les lacs Sc les rivières : ils
traverfent le pays de cette façon, & font un grand
commerce.
Le fond de la liaifon de tous ces vaiffeaux eft de
jonc ou de bambouc, entrelacés de liens de bois qui
font entretenus par de groffes poutres fur lefquelles
porte tout l’ouvrage.
Pour faire avancer ces villages, on les pouffe à
l’ayant & à l’arriere avec de grandes perches ; & il
y a une groffe piece de bois debout à l’arriere, pour
fervir à amarrer \a flotte à gué avec un cordage,
lorfqu’il en eft befoin.
Outre ces grandes flottes, qui font comme des villages
, & oh les maîtres & propriétaires des bâtimens
paffent leur v ie avec toute leur famille, il y a encore
à la Chine de fimples bateaux ou petits vaiffeaux
qui fervent de demeure à une famille. Ils n’ont
ni rames ni voiles , & on ne les fait avancer qu’avec
le croc. Les marques des marchandifes qui font
à vendre dans ces bateaux, font fufpëndues à une
perche qu’on tient élevée, afin qu’on les puiffe voir
aifément. (Z)
F l o t t e i n v i n c i b l e , (Hifl.m od.) C ’eft le nom
que Philippe II. donna à la flotte qu’il avoit préparée
pendant trois ans en Portugal, à Naples & en Sicile ,
pour déthroner la reine Elifabeth.
Les Efpagnols en publièrent une relation emphatique
, non-feulement dans leur langue, mais en latin
, en françois, & en hollandois. M. deThou, qui
avoit été bien informé de l’équipement de cette flotte
par l’ambaffadefir de S. M. C. à la cour de France,
rapporte qu’elle contenoit huit mille hommes d’é-
quipage, vingt mille hommes de débarquement, fans
compter la nobleffe & les volontaires ; & qu’en fait
de munitions de guerre , il y avoit fur cett t flotte
12 mille boulets, 5 mille 600 quintaux de poudre ,
10 mille quintaux de b a lles , 7 mille arquebufes, 10
mille haches, un nombre immenfe d’inftrumens propres
à remuer ou à tranfporter là terre, des chevaux
& des mulets en quantité, enfin des vivres & des
provifions en abondance pour plus de fix mois.
Tout cela s’accorde affez bien avec la relation
abrégée de l’équipement de cette flo tte , que Strype
a tirée des notes au grand thréforier d’Angleterre ,
mylord Burleigh, & qu’il a inférée dans l'appendice
des mémoires originaux, n° . S i .
L’extrait de Strype fe réduit à ceci, que la flotte
invincible compofoit 130 vaiffeaux de 57868 tonneaux,
19295 foldats, 8450matelots, 2088 efcla-
ves, & 26 3 o grandes pièces d’artillerie de bronze de
toute efpece, Tans compter 20 caravelles pour le fér-
vice de l’armée navale, & 10 vaiffeaux d’avis à 6
rames. Cette flo tte, avant que de fortir du port de
Lisbonne, coûtoitdéjà au roi d’Efpagne plus de 36
millions de France, évaluation de ce tems-Ià; je ne
dis pas évaluation de nos jours.
Le duc de Médina-Celi fit voile de l’embouchure
duTage avec cette belle flotte en 1588, &prit fa
route vers le Nord. Elle effuya une première tem-
T T 11 1 ij ■