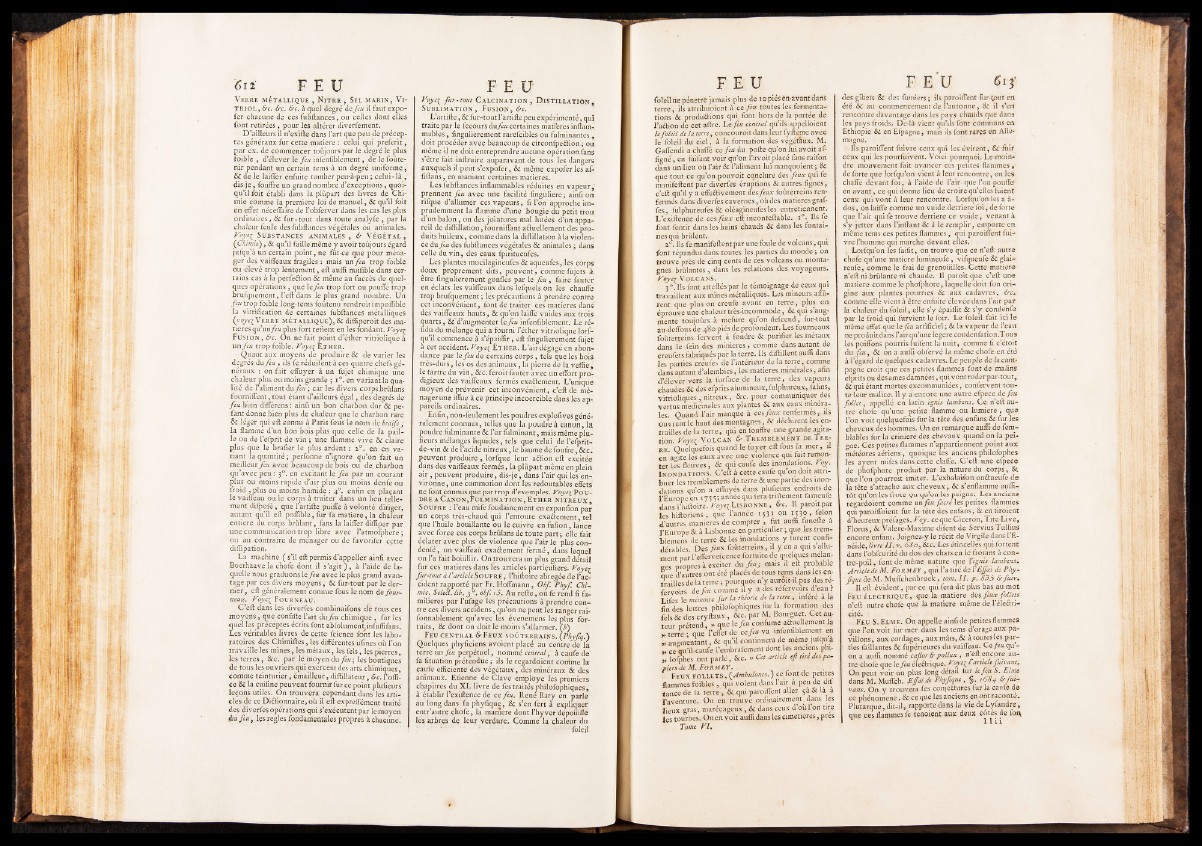
S i * F E U
V e r r e m é t a l l i q u e , N i t r e , S e l m a r i n , V i t
r i o l , &c. &c. &c. à quel degré de feu il faut expo-
fer chacune de ces fubftances, ou celles dont elles
font retirées, pour les altérer diverfement.
D ’ailleurs il n’exifte dans l’art que peu de préceptes
généraux fur cette matière : celui qui prefcrit,
par ex. de commencer toujours par le degré le plus
foible , d’élever \efeu infenfiblement, de le Soutenir
pendant un certain tems à un degré uniforme,
& de le laiffer enfuite tomber peu-à-peu ; celui - là ,
dis-je, fouffre un grand nombre d’exceptions, quoiqu’il
Soit établi dans la plupart des livres de Chimie
comme la première loi de manuel, & qu’il foit
en effet néceffaire de i’obferver dans les cas les plus
ordinaires, & fur-tout dans toute analyfe , par la
chaleur feule des fubftances végétales ou animales.
Voyt^ Su bstances animales , fa V ég é ta l ,
( Chimie) , & qu’il faille même y avoir toujours égard,
jufqu’à un certain point, ne fut-ce que pour ménager
des vaiffeaux fragiles : mais un feu trop foible
ou élevé trop lentement, eft aufli nuilible dans certains
cas à la perfeftion & même au fuccès de quelques
opérations , que le feu trop fort ou pouffé trop
brufquement, l’eft dans le plus grand nombre. Un
feu trop foible long-tems foûtenu rendroit impoflible
la vitrification de certaines fubftances métalliques
(voyeç V erre métalliq ue) , 8c difliperoit des matières
qu’un feu plus fort retient en les fondant. Foyei
Fu s io n , & c. On ne fait point d’éther vitriolique à
un feü trop foible. Ÿoye{ Ether. -
• Quant aux moyens de produire & de Varier les
degrés du feu , ils fe réduifent à ces quatre chefs généraux
: on fait effuyer à un fujet chimique une
chaleur plus ou moins grande ; i° . en variant la qualité
de l’aliment du feu ; car les divers corps brûlans
fourniffent, tout étant d’ailleurs éga l, des degrés de
feu bien différens : ainfi un bon charbon dur & pe-
fant donne bien plus de chaleur que le charbon rare
& léger qui eft connu à Paris fous le nom de braife ;
•la flamme d’un bon bois plus que celle de la paille
ou de l’efprit de vin ; une flamme vive & claire
plus que le brafier le plus ardent : i ° . en en variant
la quantité ; perfonne n’ignore qu’on fait un
meilleur feu avec beaucoup de bois ou de charbon
qu’avec peu : 30. en excitant le feu par un courant
plus ou moins rapide d’air plus ou moins denfe ou
froid , plus ou moins humide : 40. enfin en plaçant
le vaiffeau ou le corps à traiter dans un lieu tellement
difpofé, que l’artifte puiffe à volonté diriger,
autant qu’il eft poflible, fur fa matière, la chaleur
entière du corps brûlant, fans la laiffer difliper par
une communication trop libre avec l’atmofphere ;
ou au contraire de ménager ou de favorifer cette
diflipation.
La machine ( s’il eft permis d’appeller ainfi avec
Boerhaavela chofe dont il s ’agit ) , à l’aide de laquelle
nous graduons le feu avec le plus grand avantage
par ces divers moyens, & fur-tout par le dernier
, eft généralement connue fous le nom de fourneau.
Voye^ Fourneau.
C ’eft dans les diverfes combinaifons de tous ces
moyens, que confifte l’art du feu chimique , fur les
quel les préceptes écrits font abfolumentinfuffifans.
Les véritables livres de cette fcience font les laboratoires
des Chimiftes, les différentes ufines où l’on
travaille les mines, les métaux, les fels, les pierres,
les terres, &c. par le moyen du feu-, les boutiques
de tous les ouvriers qui exercent des arts chimiques,
comme teinturier, émailleur, diftillateur fac. l’office
& la cuifine peuvent fournir fur ce point plufieurs
leçons utiles. On trouvera cependant dans les articles
de ce Diûionnaire, où il eft expreffément traité
des diverfes opérations qui s’exécutent par le moyen
fax feu 9 les réglés fondamentales propres à chacune.
F E U
Voye^ fur-tout C a l c i n a t i o n , D i s t i l l a t i o n ,-
S u b l i m a t i o n , F u s i o n , fac.
L’artifte, & fur-tout l’artifte peu expérimenté, qui
traite par le fecours dufeu certaines matières inflammables
, fingulierement rarefcibles ou fulminantes ,
doit procéder avec beaucoup de cirçonfpe&ion ; ou
même il ne doit entreprendre aucune opération fans
s’être fait inftruire auparavant de tous les dangers
auxquels il peut s’expofer, & même expofer les af-
fiftans, en maniant certaines matières.
Les fubftances inflammables réduites en vapeur,'
prennent feu avec uiie facilité finguliere ; ainfi on
rifque d’allumer ces vapeurs, fi l’on approche imprudemment
la flamme d’une bougie du petit trou
d’un balon, ou des jointures mal lutées d’un appareil
de diftillation, fourniffant aâuellement des produits
huileux, comme dans la diftillation à la violence
du feu des fubftances végétales & animales ; dans
celle du v in, des eaux fpiritueufes.
Les plantes mücilagineufes & aqueufes, les corps
doux proprement dits, peuvent, comme fujets à
être fingulierement gonflés par le feu , faire fauter
en éclats les vaiffeaux dans lefquels on les chauffe
trop brufquement ; les précautions à prendre contre
cêt inconvénient, font de traiter ces matières dans
des vaiffeaux hauts, & qu’on laiffe vùides aux trois
quarts, d’augmenter le feu infenfiblement. Le réfidu
dit mélange qui a fourni l’éther vitriolique Iorf-
qu’il commence à s’épaiflir , eft fingulierement fujet
à cet accident. Foye(É ih e r . L ’air dégagé en abondance
par le feu de certains corps, tels que les bois
très-durs, les os des animaux, la pierre de la veflie,
le tartre du Vin, &C. feroit fauter avec un effort prodigieux
des vaiffeaux fermés exactement. L’unique
moyen de prévenir cet inconvénient, c’eft de ménager
une iffue à ce principe incoercible dans les appareils
ordinaires.
Enfin, non-feulement les poudres explofives généralement
connues, telles que la poudre à canon, la
poudre fulminante & l’or fulminant, mais même plufieurs
mélanges liquides, tels que celui de l’efprit-
de-vin & de l’acide nitreux, le baume de foufre, & c .
peuvent produire, lorfque leur a&ion eft excitée
dans des vaiffeaux fermes, la plupart même en plein
a ir , peuvent produire, dis-je, dans l’air qui les environne
, une commotion dont les redoutables effets
ne font connus que par trop d’exemples. Foye[ P o u d
r e a C a n o n , F u l m i n a t i o n , E t h e r n i t r e u x ,
S o u f r e : l’eau mife foudainement enexpanfion par
un corps très-chaud qui l’entoure exactement, tel
que l’huile bouillante ou le cuivre en fufion, lance
avec force ces corps brûlans de toute part ; elle fait
éclater avec plus de violence que l’air le plus con-
denfé, un vaiffeau exactement fermé, dans lequel
on l’a fait boiiillir. On trouvera un plus grand detail
fur ces matières dans les articles particuliers. Foye^
fur-tout à L'article S o u f r e ; l’hiftoire abrégée de l’accident
rapporté par Fr. Hoffmann, Obf. Phyf Chimie.
S cita. lib. J 0, o b f 1S. Au refte, on fe rend fi familières
par l’ufage les précautions à prendre contre
ces divers accidens, qu’on ne peut les ranger rai-
fonnablement qu’avec les évenemëns les plus fortuits
, & dont on doit le moins s’allarmer. (fi)
F e u c e n t r a l & F e u x s o û t e r r a i n s . ( Phyfiq.)
Quelques phyficiens avoient placé au centre de la
terre un feu perpétuel, nommé central, à caufe de
fa fituation prétendue ; ils le regardoient comme la
caufe efficiente des végétaux, des minéraux & des
animaufc. Etienne de Clave employé les premiers
chapitres du XI. livre de fes traités philofophiques ,
à établir l’exiftènee de ce feu. René Bary en parle
au long dans fa phyfique, & s’en fert à expliquer
entr’autre chofe, la manière dont l’hyver dépouille
les arbres de leur verdure. Comme la chaleur du
; • foleil
F E U
foleil ne pénétré jamais plus de iopiésèn-avanfdariS
terre., ils attribuoient à ce feu. toutes les fermentations
& productions qui font hors de la portée de
FaCtion de cet aftre. Le feu central qu’ils iappelloient
le foleil de la terre, concouroit dansleur fyftème avec
le foleil du ciel, à la formation des végétaux. M.
Gaffendi a chaffé ce feu du porte qu’on lui1 avoit af-
ligné, en faifant voir qu’un i’avoit placé fans raifon
dans un lieu où l’air & l’aliment lui manqùoient ; &
que tout ce qu’on pouvoit .conclure des feux qui fe
manifeftent par diverfes éruptions & autres Lignes,
c’eft qu’il y a effectivement des feux foûterreins renfermés
dans diverfes cavernes, où des matières greffes,
fulphureufes & oléagineufes les entretiennent.
L ’exiltence de ces feux eft inconteftable. i° . Ils fe
font fentir dans les bains chauds & dans les fontaines
qui brûlent. .
z°. Ils fe manifeftent par une foule de volcans, qui
font répandus dans toutes les parties du monde ; on
trouve près de cinq cents de ces volcans ou montagnes
brûlantes, dans les relations des voyageurs.
Foyei V o l c a n s .
30. Ils font atteftéspar le témoignage de ceux qui
travaillent aux mines métalliques. Les mineurs aflu*
rent que plus on creufe avant en terre, plus on
éprouve une chaleur très-incommode, &; qui s’augmente
toujoûrs à mefure qu’on defeend, fur-tout
au-deffous de 480 pies de profondeur. Les fourneaux
foûterçeins fervent à fondre & purifier les métaux
dans le fein des minières, comme dans autant de
creufets fabriqués par la terre. Ils diftillent aufli dans
les parties creufes de l’intérieur de la terre, comme
dans autant d’alembics, les matières minérales, afin
d’élever vers la furface de la terre, des vapeurs
chaudes & des efprits alumineux, fulphureux, falins,
vitrioliques , nitreux, &c. pour communiquer des
vertus médicinales aux plantes & aux eaux minérales.
Quand l’air manque à ces feux renfermés, ils
Ouvrent le haut des montagnes, & déchirent les entrailles
de la terre, qüi en fouffre une grande agitation.
Foyei V o l c a n & T r e m b l e m e n t d e T e r r
e . Quelquefois quand le foyer eft fous la mer, il
en agite les eaux avec une violence qui fait remonter
les fleuves, & qui caufe des inondations. Voy.
I n o n d a t i o n s . C ’eft à cette caufe qu’on doit attribuer
les tremblemens de terre & une partie des inondations
qu’on a effuyés dans plufieurs endroits de
l’Europe en 175 5 ; année qui fera triftement fameufe
dans l’ hiftoire. Foye{ L i s b o n n e , &c. Ilparoîtpar
les hiftoriens , que l’année 1531 ou 1530, félon
d’autres maniérés de compter , fut aufli funefte à
l ’Europe & à Lisbonne en particulier ; que les tremblemens
de terre & les inondations y furent confi-
dérables. Des feux foûterreins, il y en a qui s’allument
par l’effervelcence fortuite de quelques mélanges
propres à exciter du feu; mais il eft probable
que d’autres ont été placés de tous tems dans les entrailles
delà terre ; pourquoi n’y auroit-il pas des réservoirs
de feu comme il y a des refervoirs d’eau g
Lifez le mémoire fur la théorie de la terre, inféré à la
fin des lettres philofophiques fur la formation des
fels & des cryftaux , Sec par M. B ou rrâ t. Cet auteur
prétend, „ que le ƒ « confume aSuellement la
» te r re ; que l’effet de ce feu va infenfiblement en
» augmentant, & qu’il continuera de même ju iqui
» ce qu’il caufe l’embrafement dont les anciens, phi-
» lofphes ont parlé, &c. » Cet article cfturcdespa-
viers de M. FoRMEY.
F e u x f o l l e t s , ( Ambulones.) ce font de petites
flammes foibles , qui volent dans l’air à peu de dif-
tance de la terre, & qui paroiffent aller çà & la a
l’aventure. On en trouve ordinairement dans les
lieux gras, marécageux, & dans ceux d ou l’on tire
les tourbes. Onenvoit aufli dans les cimetières, près
Tome FI*
F E U des gibets & des fumiers ; ils paroiffent fur-tout ert
été ëc aii commencement de j ’autonne, & il s’eri
rencontre davantage dans les pays chauds que dans
les pays froids. De-là vient qu’ils fô'nt communs en
Ethiopie & en Efpagne, mais ils font rares en A 11e-
magne.
• Ils paroiffent fuivre ceux qui les évitent, Sc fuit
ceux qui les pourfuivent. Voici pourquoi. Le moindre
mouvement fait avancer ces petites' flammes ,
de forte que lorfqu’on vient à leur rencontre, on les
chaffe devant fo i, 1 à l’aide de l’air que l’on pouffe
en avant, ce qui donne lieu de croire qu’elles fuient
ceux qui vont à leur rencontre. Lorfqu’on les a à-
dos, on laiffe comme un vuide derrière foi, de forte
que l’air qui fe trouve derrière ce vuide, venant à
s’y jetter dans l’inftant & à le remplir, emporte en
même tems ces petites flammes, qui paroiffent fui-*
vre l’homme qui marche devant elles.
, Lorfqu’on les faifit, on trouve que ce n’eft autre
chofe qu’une matière lumineufe, vifqueufe & glai—
reufe, comme le frai de grenoiiilles. Cette matière
n’eft ni brûlante ni chaude. Il paroîtque c’ eft une
matière comme le phofphore, laquelle doit fon origine
aux plantes pourries & aux cadavres, & d
comme elle vient à être enfuite élevée dans l’air par
là chaleur du foleil, elle s’y épaifîit & s’y condenfe
par le froid qui furvient le foir. Le foleil fait ici le:
même effet que le feu artificiel ; & la vapeur de l’eau
; ne produit dans l’air qu’une legere.condenfation.Tou9
les poiffons pourris luifent la nuit, comme fi c’étoit
du feu , & on a aufli obfervé la même chofe en été'
à l’égard de quelques cadavres. Le peuple de la campagne
croit que ces petites flammes font de malins
efprits ou des âmes damnées, qui vont roder par-tout,
& qui étant mortes excommuniées, confefvent toute
leur malice. Il y a encore une autre efpece .de/ea
follet, appellé en latin ignis lambens. Ce n’eft autre
chofe qu’une petite flamme ou lumière, que
l’on, voit quelquefois fur la tête des enfans & fur les
cheveux des hommes. On en remarque aufli de fem-
blables fur la crinière des chevaux quand o a la peigne.
Ces petites flammes n’appartiennent point aux
météores aériens, quoique les anciens philofophes
les ayent mifes dans cette claffe.,G’eft une efpece
de phofphore produit par la nature du corps, &
que l’on pourroit imiter. L’exhalaifon on&ueufe d©
la tête s’attache aux cheveux, & s’enflamme aufli-
tôt qu’on les frote çu qu’on les peigne. Les anciens
regardoient comme un feu facré les petites flammes
qui paroifloient fur la tête des enfans ; St en tiroient
d’heureux préfages. Voy. ce que Cicéron, T ite Live,
Florus , & Valere-Maxime difent de Servius Tullius
encore enfant. Joignez-y le récit de Virgile dans l’E-
néïde,livre IL v. 6X0, ÔCc. Les étincelles quifortent
dans l’obfcurité du dos des chats en lé frotant à contre
poil , font de même nature que Yignis lambens..
Article de M. Form ey , qui l’a tiré de YEJfai de Phy-
1 Jique de M. Muflchenbroek, tom. IL p. 8$â & fù v .
Il eft évident , par ce qui fera dit plus bas au mot
F e u ÉLECTRIQUE, que la matière des feux follets
n’eft autre chofe que la matière même de l’éleélri-
cité. . , ~ /
Feu S. Elme. On appelle ainfi de petites flammes
que l’on voit fur mer dans les tems d’orage aux pavillons,
aux cordages , aux mâts, & à toutes les par-
' ties fâillantes & fupérieures du vaiffeau. Ce feu qu’on
a aufli nommé cajlor & pollux, n’eft enepre autre
chofe que le feu è leûrique. Foye^ Varticle fuivant.
On peut voir un plus long détail fur le feu S. Elmc
dans M. Muffch. E p i de Phyfique, $ .16 8 4 & fu i-
vans. On y trouvera fes conjectures fur la caufe de
ce phénomène, & ce que les anciens en ont raconte»
Plutarque, dit-il, rapporte dans la vie de Lyfandre,
que ces flammes fe tenoient aux deux cotes de foi^
1 1 i l