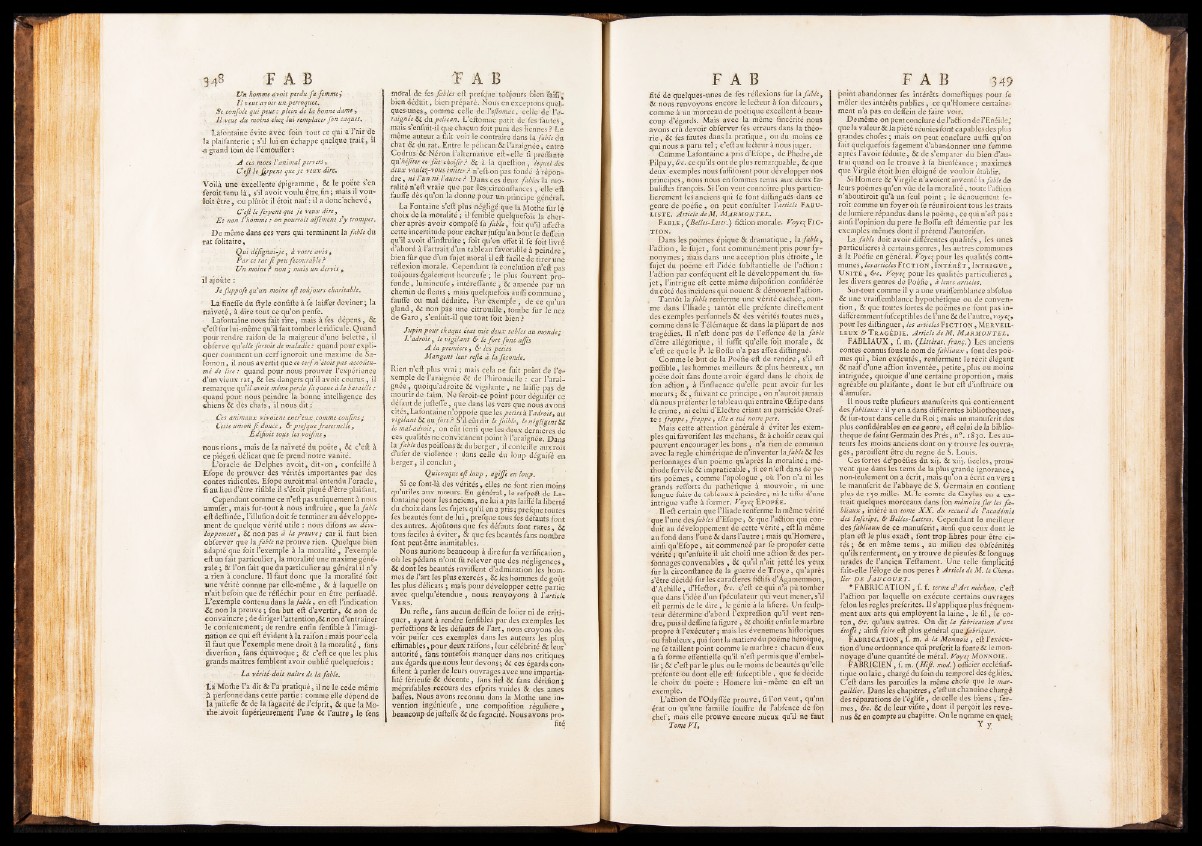
Un homme a voit perdu fa -femme j
I l veut -avoir un perroquet.
Se confole qui peut : plein de la bonne dame ->
\ I l -yeut du moins chez luiremplacer fin caquet.
Lafontaine évite avec foin tout ce qui -a l’air de
îa plaifanterie ; s’il lui en échappe quelque, trait , il
-a grand loin de l’ëmouffer :
A cès mots Vanimal pervers ,
C'efi le ffrpent que je yeux dire.
Voilà une excellènte épigramme, & le poete s'en
feroit t'enu là', s’il avôit voulu être, fin ; mais il vou-
lo it être, ou plutôt il étoit naïf: il a dohcachevé,
Cefi le fer peut que je veux dire ,
E t non rhomme : on pourroit aifément s'y tromper.
D e même dans ces vers qui terminent lu fable du
rat folitaire,
Qui défignai-je, à votre avis ,
Par ce rat f i peu fecourable ? '
Un moine J non ; mais un dervis ,
il ajoute :
Je fuppofe qu'un moine efi toujours chantable.
Là finette du ftyle confifte à fe laiffer deviner; la
naïveté, à dire tout ce qu’on penfe.
Lafontaine nous fait rire, mais à fes dépens, &
•c’eftfur lui-même qu’il fait tomber le ridicule. Quand
pour rendre raifon de la maigreur d’une belette, il
obferve qu’elle fortoit de maladie : quand pour expliquer
comment un cerf ignoroit une maxime de Salomon
, il nous avertit que ce cerf n étoit pas accoutumé
de lire: quand pour nous prouver l’expérience
d’un vieux rat, ôc les dangers qu’il avoit courus , il
remarque qu’i/ avoit même perdu fa queue a la bataillé :
quand pour nous peindre la bonne intelligence des
<chiens & dès chats, il nous dit .:
Ces animaux vivoient entdeux .comme confins;
Cette union J î douce , & prefque fraternelle y
.Edifioit tous les voifins ,
ïioüs rions, mais de la naïveté du poëte, & c’eft à
ce piège fi délicat que fe prend notre vanité.
L’oracle de Delphes avoit, dit-on, confeillé à
Efope de prouver des vérités importantes par des
contes ridicules. Efope auroit mal entendu l’oracle,
<i au lieu d’être rifible il s’étoit piqué d’être plaifant.
Cependant comme ce n’eft pas uniquement à nous
amufer, mais fur-tout à nous inftruire, que la fable
eft deftinée, l’illufion doit fe terminer au développement
de quelque vérité utile : nous difons au développement
, & non pas à la preuve; car il faut bien
obferver que la fable ne prouve rien. Quelque bien
adapté que foit l’exemple à la moralité , l’exemple
efi un fait particulier, la moralité une maxime générale;
& l’on fait que du particulier au général il n’y
a rien à conclure. Il faut donc que la moralité foit
une vérité connue par elle-même, & à laquelle on
n ’ait befoin que de réfléchir pour en être perfuadé.
L ’exemple contenu dans la fable, en efi: l’indication
& non la preuve ; foivbut eft d’avertir, & non de
convaincre ; de diriger l’attention,& non d’entraîner
le confentement; de rendre enfin fenfible à l’imagination
ce qui eft évident à la raifon : mais pour*cela
il faut que l’exemple mene droit à la moralité , fans
diverfion, fans équivoque ; & c’eft ce que les plus
grands maîtres femblerit avoir oublié quelquefois :
- La vérité doit naître de la fable.
Là Mothe l’à dit & l’a pratiqué, il ne le cede même
.à përibnnedans cette partie : comme elle dépend de
là jufteffe & de là fagacité de l’efprit, & que la Mo-
the-avoit fupérieurement l’une & l’autre, le fens
moral de fes fables eff prefc/ue toujours bien faifi '^
bien déduit, bien préparé. Nous en exceptons qirelu
ques-unes, comme celle deTefiomac, celle de 1’^-
raignée & du pélican. L’eftomac patit de fes fautes,
mais, s’enfuit-il que chacun foit puni des Tiennes ? Le
même auteur a fait voir le contraire dans la fable du
chat & du rat..,Entre le pélicancôc Fàraignée, entre
Codrùs:& Néron.l’alternative eft-elle fi prëffaritè
ayXhéfiter ce fût choifir? & à la queftion , lequel des
deux voulez-vous imiter ? n’eft-oh pas fondé à répon-
dre, ni l'un niVautre ? Dans ces deux fables -la moralité
n’eft vraie que par :les;circônftances , die eft
fauffe dès qu’pn la donne pour un.principe général.
La Fontaine s’eft plus négligé que la Mothe fur le
choix de la moralité ; il femble quelquefois la chercher
après avoir compofé fà fable, foit qu’il affette
cette incertitude pour cacher jufqu’au bout le deflein
qu’il avoit d’inftrùire ; foit qu’en effet il fe foit livré
d’abord à l’attrait d’un tableau favorable à peindre ,
bien fur que d’un fujet moral il eft facile de tirer .une
réflexion morale. Cependant fa conclufion n’eft pas
toujours également heureufe ; le plus fouvent profonde,
lumineufe , intéreflantè ', ôcamenée parurt
chemin de fleurs ; mais quelquefois auffi commune,
fauffe ou mal déduite. Par exemple, de ce qu’un
gland, & non pas une citrouille » tombe fur le nez
de Garo, s’enfuit-il que tout foit bien ?
Jupin pour ch aque état mit deux tables au monde;
L'adroit, le vigilant & le,fort font affis
A. la première, & les petits
Mangent leur refie à la fécondé.
Rien n’eft plus vrai ; mais cela ne fuit point de l’e-»
xemple de l'araignée & de l’hirOndelle : car l’araignée,
quoiqu’adroite & vigilante , ne laiffe pas de
mourir de faim.' Ne feroit-cè point pour déguifér ce
défaut de jufteffe, que dans les vers que nous avons
cites, Lafontaine n’oppofe que les petits à l’adroit, au
vigilant Sc au fart J S'il eût dit le faible, le négligent &
le mal-adroit, on eut fenti que les deux dernieres de
ces qualités rte conviennent point à l ’araignée. Dans
la fable des poiffons & du berger, il conlèille aux rois
d’ufer de violëncè : dans celle du loup déguifé en
berger, il conclut,
Quiconque efi loup , agijfe en loup.
Si ce font-là des vérités, elles ne font rien moins
qu’utiles aux moeurs. En général, le refpeét de Lafontaine
pour les anciens, ne lui a pas laiffé la liberté
du choix dans les fujets qu’il en a pris; prefque toutes
fes beautés font de lu i , prefque tous fes défauts font
des autres. Ajoutons que fes défauts font rares, ôc
tous faciles à éviter, & que fes beautés fans nombre
font peut-être inimitables. .
Nous aurions beaucoup â dire fur fa verfificatiori ,
oîi les pédans n’ont fû relever que des négligences,
& dont les beautés raviffent d’admiration les hommes
de l’art les plus exercés, & les hommes de goût
les plus délicats ; mais pour développer cette partie
avec quelqu’étendue, nous renvoyons à l'article
V ers.
Du refte, fans aucun deflein de louer ni de critiquer
, ayant à rendre fertfibles par des exemples les
perfe&ions & les défauts de l’art, nous croyons devoir
puifer ces exemples dans les auteurs les plus
I eftimables, pour deux raifons, leur célébrité & leur
autorité, fans toutefois manquer dans nos critiques
aux égards que nous leur devons ; & ces égards con-
fiftent à parler de leurs ouvrages avec une impartialité
férieufe & décente, fans fiel & fans dérifion ;
méprifables recours des efprits vuides & des âmes
baffes. Nous ayons reconnu dans la Mothe une invention
ingénieufe , une compofition régulière ,
beaucoup de jufteffe ôc de fagacité. Nous avons pro-
1 fité
fi'té dé quelques-unes de fes réflexions fur la fîble,
& nous renvoyons encore le leôeur à fon difeours,
comme à ün morceau de poétique excellent à beaucoup
d’égards. Mais avec la même fincérité nous
avons crû devoir obferver fes erreurs dans la théorie
& fes fautes dans la pratique, ou du moins ce
qui nous a paru tel ; c’eft au leûeur à nous juger. '
Comme Lafontaine a pris d’Efope, de Phedre, de
Pilpay, &c. ce qu’ils ont de plus remarquable, & que
deux exemples nous fuffifoient pour développer nos
principes, nous nous en fommes tenus aux deux fa-
buliftes françois. Si l’on veut connoître plus particulièrement
les anciens qui fe font diftingués dans ce
genre de poéfie , on peut confulter Xarticle Fabu l
is t e . Article d e M . M a r m o n t e l .
Fa b le , (’Belles-Lettr.) fi&ionmorale. Voye^Fi c t
io n .
Dans les poemes épique & dramatique, la fable ;
l’a&ion, le fujet , font communément pris pourfy-
nonymes ; mais dans une acception plus étroite, le
fujet du poeme eft l’idéè fubftantielle dè ■ l’aftion :
l ’aûion par conféquent eft le développement du fujet
, l’intrigue eft cette même difpofition confidérée
du côté dès incidens qui nouent & dénouent l’aétion.
Tantôt la fable renferme une vérité cachée, comme
dans l’Iliade ; tantôt elle préfente directement
des exemples perfonnels & des vérités toutes nues,
comme dans le Télémaque & dans la plûpart de nos
tragédies. Il n’eft donc pas de l’effence de la fable
d’être allégorique, il fuffit qu’elle foit morale, &
c ’eft ce que le P. le Boffu n’a pas affez diftingué.
Comme le but de la Poéfie eft de rendre, s’il eft
pofîible, les hommes meilleurs & plus heureux, un
poëte doit fans doute avoir égard dans le choix de
ion aCtion, à l’influence qu’elle peut avoir fur les
moeurs ; & , fuivant ce principe, on n’auroit jamais
dû nous présenter le tableau qui entraîne OEdipe dans
le crime, ni celui d’EleCtre criant au parricide Oref-
te : frappe > frappe , elle a tué notre pere. Mais cette attention ples qui favorifent les mgéécnhéarnasl;e &à àécvhioteirf ilre cse euxxe qmui
paveuecv elan tr éegnlcéo cuhriamgeérr ilqeus eb doen sn ’,i nnv’ean rtieern l ad e commun fable & les
tpheorfdoen fneargveilse d&’u nim pporëamtiec aqbule’a,p friè cs el na ’mefot draalnitsé d ;e m péetgirtsa
npdosë rmefefso,r tcso dmum pea lt’hapétoilqougeU eà , moùo ulv’ooni rn, ’an ni iu lnees longue fuite-de tableaux à peindre, ni le tiffu d’une
intrigue vafte à former. Voyt{ Epopée.
Il eft certain, que l’Iliade renferme la même vérité
que l’une des fables d’Efope ; & que l’àCtion qui conduit
au développement de cette v érité, eft la même
au fond dans l’une & dans l’autre ; mais qu’Homere,
ainfi qu’Efope, ait commencé par fe propofer cette
vérité ; qu’enfuite il ait choifi une aûion & des perfonnages
convenables , & qu’il n’ait jetté les yeux
fur la circonftance de la guerre de T ro y e , qu’après
s’être décidé fur les caraCteres fictifs d’Agamemnon,
d’Achille, d’HeCtor, &c. c’eft ce qui n’a pu tomber
que dans l’idée d’un fpéculateur qui veut mener, s’il
eft permis de le dire, le génie à la lifiere. Un fculp-
teur détermine d’abord l’expreflion qu’il veut rendre,
puis il defline fa figure, &choifit enfin le marbre
propre à l’exécuter ; mais les évenemens hiftoriques
ou fabuleux, qui font la matière du poëme héroïque,
ne fe taillent point comme le marbre : chacun d’eux
a fa forme effentielle qu’il n’eft permis que d’embellir
; & c’eft par le plus ou le moins de beautés qu’elle
préfente ou dont elle eft fufceptible , que fe décide
le choix du poëte : Homere lui-même en eft un
exemple.
L’aCtion de l’Odyflee prouve, fi l’on veu t, qu’un
état ou qu’une famille fouffre de l’abfençe de fon
iphef ; mais elle prouve encore mieux qu’il ne faut
Tome VL,
point abandonner fes intérêts domeftiqùes pour fe
mêler des intérêts publics , ce qu’Homere certainement
n’a pas eu deflein de faire voir.
De même on peut conclure de l’aftion de l’Eiiéïde,1
que la valeur & la piété réunies font capables des plus
grandes chofes ; mais on peut conclure aufli qu’on
fait quelquefois fagement d’abandonner une femm©
après l’avoir féduite, & de s’emparer du bien d’au*-
trui quand on le trouve à fa bienféance ; maximes
que Virgile étoit bien éloigné de vouloir établir.
Si Homere & Virgile n’avoient inventé la fa b l e de
leurs poëmes qu’en vûe de la moralité, toute L’aftion
n’aboutiroit qu’à un feul point ; le dénouement fe-
roit comme un foyer où fe réuniroient tous les traits
de lumière répandus dans le poëme, ce qui n’eft pas :
ainfi l’opinion du pere le Boffu eft démentie par les
exemples mêmes dont il prétend l’autorifer;
La fable doit avoir différentes qualités , les uneS
particulières à certains genres, les autres communes
à la Poéfie en général, Voye{ pour les qualités corn*-
munes j les articles Fic t io n , Intérê t , In t r ig u e ,
U nité , &c. Voyc^ pour les qualités particulières^
les divers genres de Poéfie, à. leurs articles.
Sur-tout comme il y a une vraiflemblance abfolue
& une vraiflemblance hypothétique ou de convention
, & que toutes fortes de poëmes ne font pas indifféremment
fufceptibles de l’une ôc de l’autre, voyej,
pour les diftinguer, les articles Fic t io n , Merveilleux
& T ragéd ie. Article d e M . M a r m o n t e l .
FABLIAUX, f. m. (Littérat. franç,) Les anciens
contes connus fous le nom dè fabliaux, font des poëmes
qui, bien exécutés, renferment le récit élégant
& naïf d’une aftion inventée, petite, plus ou moins
intriguée, quoique d’une certaine proportion, mais
agréable ou plaifante, dont le but eft d’inftruire ou
d’amufer.
Il nous refte plufieurs manuferits qui contiennent
des fabliaux : il y en a dans différentes bibliothèques,
& fur-tout dans celle du Roi ; mais un manüfcrit des
plus confidérables en ce genre, eft celui delà bibliothèque
de faint Germain des Prés, n°. 1830. Les auteurs
les moins anciens dont on y trouve les ouvrages
, paroiflént être du régné de S. Louis.
Ces fortes dë’poéfies du xij. & xiij< fieclës, prouvent
que dans les tems de la plus grande ignorance ;
non-feulement on a écrit, mais qu’on a écrit en vers s
le manüfcrit de l’abbaye de S. Germain en contient
plus de 150 mille. M. le comte de Caylus en a extrait
quelques morceaux dans fon mémoire fur les fabliaux
, inféré au tome X X . du recueil de Cacadémie
des Infcript. & Belles-Lettres. Cependant le meilleur
des fabliaux de ce manüfcrit, ainfi que ceux dont le
plan eft le plus exaft, font trop libres pour être cités
; ôc en même tems, au milieu des obfcénités
qu’ils renferment, on y trouve de pieufes & longues
tirades de l’ancien Teftament. Une telle fimplicité
fait-elle l’éloge de nos peres ? Article de M. le Chevalier
D E J a Ù C O U R T .
* FABRICATION, f. f. terme d* Art méckan. c’eft
l’aftion par laquelle on exécute certains ouvrages
félon les réglés preferites. Il s’applique plus fréquemment
aux arts qui employent la laine , le fil, le coton,
&c. qu’aux autres. On dit la fabrication d'une
étoffe ; ainfi faire eft plus général qu t fabriquer.
Fa b r ic a t io n , f. m. à la Monnaie, eft l’exécution
d’une ordonnance qui preferit la fonte & le inon-
noyage d’une quantité de métal. Voye^ Monnoie.
•FABRICIEN, f. m. (Hifi. mod.) officier eccléfiaf-
tique ou la ïc , chargé du foin du temporel des églifes.
C ’eft dans les paroiffes la même chofe que le mar-
guillier. Dans les chapitres, c’eft un chanoine chargé
des réparations de l’églife, de celle des biens fermes
, &c. & de leur vifite, dont il perçoit les revenus
ôc en compte au chapitre. On le nomme en quel$