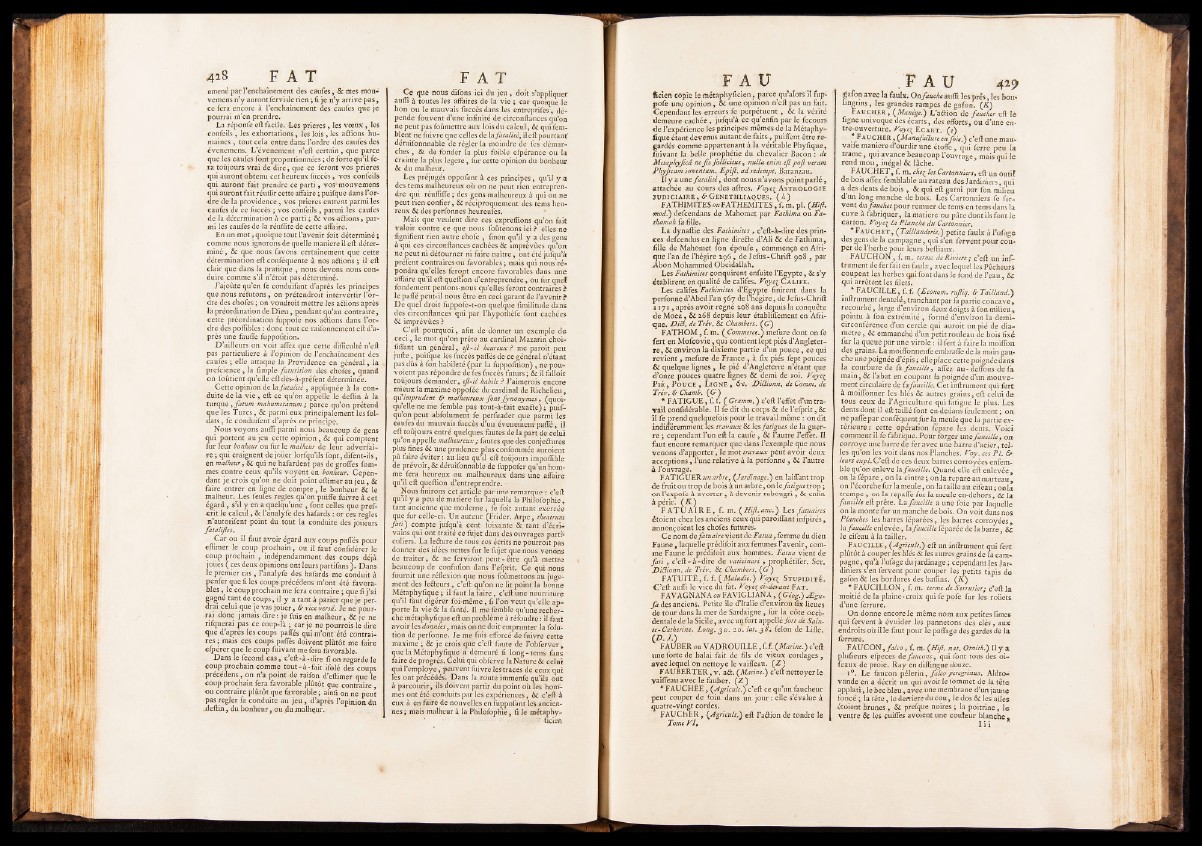
«mené par l’enchaînement des caufes, & mes mou-
vemens n’y auront fervi de rien ; fi je n’y arrive pas ,
ce fera encore à l’enchaînement des caufes que je
pourrai ni’en prendre»
La réponfe eft facile» Les prières, les voe iïx, les
confeils , les exhortations, les lois, les avions humaines
, tout cela entre dans l’ordre des caufes des
évenemens. L’évenement n’eft certain, que parce
que les caufes font proportionnées ; de forte qu’il fera
toûjours vrai de dire, que ce feront vos prières
qui auront obtenu cet heureux fuccès, vos confeils
qui auront fait prendre ce parti, vos*mouvemens
qui auront fait réuffir cette affaire ; puifque dans l’ordre
de la providence, vos prières entrent parmi les
caufes de ce fiiccès ; vos confeils , parmi les caufes
de la détermination à ce parti ; & vos «étions, parmi
les caufes de la réuffite de cette affaire.
En un mot, quoique tout l’avenir foit déterminé ;
comme nous ignorons de quelle manière il eft déterminé
, & que nous favons certainement que cette
détermination eft conféquente à nos aâions ; il eft
clair que dans la pratique , nous devons nous conduire
comme s’il n’étoit pas déterminé.
J’ajoute qu’en fe conduifant d’après les principes
que nous réfutons, on prétendroit intervertir l’ordre
des chofes ; on voudroit mettre les a étions après
la préordination de D ieu , pendant qu’au contraire,
cette préordination fuppofe nos adtions dans l’ordre
des poflibles : donc tout ce raifonnement eft d’après
une fauffe fuppofition.
D ’ailleurs on voit affez que cette difficulté n’eft
pas particulière à l’opinion de l’enchaînement des
caufes ; elle attaque la Providence en général, la
prefcience, la fimple futurition des chofes, quand
on foûtient qu’elle eft dès-à-préfent déterminée.
Cette opinion de la fatalité , appliquée à la conduite
de la vie , eft ce qu’on appelle le deftin à la
turque, fatum mahumetanum ; parce qu’on prétend
que les Turcs, & parmi eux principalement les fol-
dats, fe conduifent d’après ce principe.
Nous voyons auffi parmi nous, beaucoup de gens
qui portent au jeu cette opinion, & qui comptent
fur leur bonheur ou fur le malheur de leur adverfai-
re ; qui craignent de joiier lorfqu’ils font, difent-ils,
en malheur, & qui ne hafardent pas de groffes fom-
mes contre ceux qu’ils voyent en bonheur. Cependant
je crois qu’on ne doit point eftimer au jeu , &
faire entrer en ligne de compte, le bonheur & le
malheur. Les feules réglés qu’on puiffe fuivre à cet
égard, s’il y en a quelqu’une , font celles que pref-
crit le calcul, & l’analyfe des hafards : or ces réglés
n’autorifent point du tout la conduite des joiieurs
fataliïles.
Car ou il faut avoir égard aux coups paffés pour
eftimer le coup prochain, ou il faut confidérer le
coup prochain , indépendamment des coups déjà
joués ( ces deux opinions ont leurs partifans ). Dans
le premier cas , l’analyfe des hafards me conduit à
penfer que fi les coups précédens m’ont été favorables
le coup prochain me fera contraire ; que fi j’ai
gagne tant de coups, il y a tant à parier que je perdrai
celui que je vas joiier, & vice versa. Je ne pourrai
donc jamais dire : je fuis en malheur, & je ne
rifquerai pas ce coup-là ; car je ne pourrois le dire
que d apres les coups paffés qui m’ont'été contraires
; mais ces coups paffés doivent plutôt me faire
efpérer que le coup fuivant me fera favorable.
Dans le fécond ca s , c’eft-à-dire fi on regarde le
coup prochain comme tout-à-fait ifolé des coups
;précédens, on n’a point de raifon d’eftimer que le
coup prochain fera favorable plutôt que contraire
ou contraire plûtôt que favorable; ainfi on ne peut
pas regler fa conduite au jeu , d’après l’opinion du
deftin, du bonheur, ou .du malhçur.
Ce que nous difons ici du je u , doit s’appliquer
auffi à toutes les affaires de la vie ; car quoique le
bon oit le mauvais fuccès dans les entreprifes, dépende
fouvent d’une infinité de circonftances qu’on
ne peut pas foûmettre aux lois du calcul, & quifem-
blent ne fuivre que celles de la fatalité, il eft pourtant'
déraifonnnable de régler la moindre de fes démarches
, & de fonder la plus foible efpérance- ou la
Crainte la plus legere, fur cette opinion du bonheur
& du malheur.
Les préjugés oppofent à ces principes, qu’il y a
des tems malheureux où on ne peut rien entreprendre
qui réuffiffe ; des gens malheureux à qui on ne
peut rien confier, & réciproquement des tems heureux
& des perfonnes heureuies'.
Mais que veulent dire ces expreffions qu’on fait
valoir contre ce que nous foûtenons ici •? elles me
lignifient rien autre chofe , linon qu’il y a des gens
à qui ces circonftances cachées & imprévues qu’on
ne peut ni détourner ni faire naître, Ont été jufqu’à
préfent contraires ou favorables ; mais qui nous répondra
qu’elles feront encore favorables dans une
affaire qu’il eft queftion d’entreprendre, ou fur quel'
fondement penlôns-nous qu’elles feront contraires è
le paffé peut-il nous être en ceci garant de l’avenir £
De quel droit fuppofe-t-on quelque fimilitude dans
des circonftances qui par l’hypothèfe font cachées
& imprévues ?
C ’eft pourquoi, afin de donner un exemple de
c e c i, le mot qu’on prête au cardinal Mazarin choi-
fiffant un général, ejl-il heureux? me paroît peu
jufte, puifque les fuccès paffés de ce général n’étant
pas dûs à fon habileté (par la fuppofition) , ne pou-
voient pas répondre de fes fuccès futurs ; & il falloit
toujours demander, ejl-il habile ? J’aimerois encore
mieux la maxime oppofée du cardinal de Richelieu ,
qu imprudent & malheureux font fynonymes , (quoiqu’elle
ne me femble pas tout-à-fait exa&e) ; puif-
qu’on peut abfolument fe perfuader que parmi les
caufes du mauvais fuccès d’un événement'paffé, il
eft toûjours entré quelques fautes de la part de celui
qu’on appelle malheureux ; fautes que des conjectures
plus fines & une prudence plus confommée auroient
pû faire éviter : au lieu qu’il eft toûjours impoffible
de prévoir, & déraifonnable de fuppofer qu’un homme
fera heureux ou malheureux dans une affaire
qu’il eft queftion d’entreprendre. •
Nous nnirons cet article par une remarque : c’eft
qu’il y a peu de matière fur laquelle la Phiiofophie,
tant ancienne que moderne , fe foit autant exercée
que fur celle-ci. Un auteur (Frider. Arpe, theatrum
fati') compte jufqu’à cent foixante & tant d’écrivains
qui ont traité ce fujet dans des ouvrages particuliers.
La leCture de tous ces écrits ne pourroit pas
donner des idées nettes fur le fujét que nous venons:
de traiter, & ne ferviroit peut - être qu’à mettre
beaucoup de confufion dans l’efprit. Ce qui nous
fournit une. réflexion que nous foûmettons au jugement
des leCteurs, c’ eft qu’on ne lit point la bonne
Métaphyfique ; il faut la faire, c’eft une nourriture
qu’il faut digérer foi-même, fi l’on veut qu’elle apporte
la vie & la fanté. Il me femble qu’une recherche
métaphyfique eft un problème à réfoudre : il faut
avoir les données, mais on ne doit emprunter la folu-
tion de perfonne. Je me fuis efforcé de fuivre cette
maxime ; & je crois que c’eft faute de l’obferver ,
que la Métaphyfique a demeuré fi long - tems fans
faire de progrès. Celui qui obferve la Nature & celui
quil’employe, peuvent fuivre les traces de ceux qui
les ont précédés. Dans là route immenfe qu’ils ont
à parcourir, ils doivent partir du point où lés hommes
ont été conduits par les expériences, & c’eft à
eux à en faire de nouvelles en fuppofant lés anciennes
; mais malheur à la Phiiofophie, fi le métaphy-
H ficien
ftcîen copie le métaphyficien, parce qu’alors il fuppofe
une opinion, & une opinion n’eft pas un fait.
Cependant les erreurs fe perpétuent , & la vérité
demeure cachée, jufqu’à ce qu’ehfin par le fecours
de l’expérience les principes mêmes de la Métaphyfique
étant devenus autant de faits , puiffent être regardés
comme appartenant à la véritable Phyfique,
luivant la belle prophétie du chevalier Bacon : de
Metaphyjicd ne fis foUicitus , nulla enim ejl pojl veram
Phyjicam inventam. Epijl. ad redempt. Baranzau.
Il y a une fatalité , dont nous n’avons point parlé ,
attachée au cours des aftres. Voye^ A s t r o l o g i e
JUDICIAIRE , & G eNETHLIAQUES. ( h )
FATHIMITES oaFATHEMITES, f. m. pl. (Hifl.
mod.) defeendans de Mahomet par Fathima ou Fa-
thamah fa fille.
La dynaftie des Fathimites , c’eft-à-dire des princes
defeendus en ligne direéfe d’Ali & de Fathima,
fille de Mahomet fon époufe , commença en Afrique
l’an de l’hégire 19 6 , de Jefus-Chrift 908 , par
.Abon Mohammed Obeidallah.
Les Fathimites conquirent enfuite l’Egypte, & s’y
établirent en qualité de califes. Voye^ C a l i f e .
Les califes Fathimites d’Egypte finirent dans la
perfonne d’Abed l’an 567 de l’négire, de Jefus-Chrift
1 1 7 1 , après avoir régné 208 ans depuis la conquête
de M oez, & 268 depuis leur établiffement en Afrique.
Dicl. de Trév. & Chambers. (G)
FATHOM, f. m. ( Com m e r c e .) mefiire dont on fe
fort en Mofcovie, qui contient fept pies d’Angleterr
e , & environ la dixième partie d’un pouce, ce qui
revient, mefure de France , à fix pies fept pouces
& quelque lignes , le pié d’Angleterre n’étant que
d’onze pouces quatre lignes & demi de roi. V o y e {
P i é , P o u c e , L ig n e , & c . D i c t i o n n . d e C om m . d e
T r é v . & C h am b . ( G )
* FATIGUE, f. f. ( Grarnm. ) c’eft l’effet d’un trava
il confidérable. Il fe dit du corps & de l’efprit, &
il fe prend quelquefois pour le travail même : on dit
indifféremment les travaux & les fatigues de la guerre
; cependant l’un eft la caufe, & l’autre l’effet. Il
faut encore remarquer que dans l’exemple que nous
venons d’app,orter, le mot travaux peut avoir deux
acceptions, l’une relative à la perfonne, &: l’autre
à l’ouvrage.
FATIGUER#«arbre, (Jardinage.) en laiffanttrop
de fruit ou trop de bois à un arbre, on le fatigue trop ;
on l’expofe à avorter, à devenir rabougri, &. enfin
à périr. ( X )
F A T U A IR E , f. m. ( Hifi.anc. ) Les fatuaires
étoient chez les anciens ceux qui paroiffant infpirés ,
annonçoient les chofes futures.
Ce nom de fatuaire vient de Fatua , femme du dieu
Faune, laquelle prédifoit aux femmes l’avenir, comme
Faune le prédifoit aux hommes. Fatua vient de
fa r i, c’eft-à -d ire de vaticinari , prophétifer. Ser.
Dictionn. de Trév. & Chambers. (G )
FATUITÉ, f. f. {Maladie.} Voye£ St u p id it é .
C ’eft auffi le vice du fat. Vyye{ ci-devant Fa t .
FAVAGNANA owFAVIGLIANA , (Géog.) Ægu-
fa des anciens. Petite île d’Italie d’environ fix lieues
de tour dans la mer de Sardaigne, fur la côte occidentale
de la Sicile, avec un fort appel! éfort de Sainte
Catherine. Long. go. 3.0. lat. g8. félon de Lille.
(2>./.)
FAUBER ou VADROUILLE, f. f. (Marine.) c’eft
une forte de balai fait de fils de vieux cordages ,
avec lequel on nettoye le vaiffeau. ( Z )
FAUBERTER, v . a£f. (Marine.) c’eft nettoyer le
vaiffeau avec le fauber. (Z )
* FAUCHÉE, (Agricult.) c’eft ce qu’un faucheur
peut couper de foin dans un jour : elle s’évalue à
quatre-vingt cordes.
FAUCHER, (.Agricult.) eft l’a&ion de tondre le
fome VI,
fgalon avec ïa faulx. On fauche auffi les prés, les boitr
lingrins, les grandes rampes de gafon. (K )
Fa u ch e r , (Manège.) L’aélion de faucher eft Iè
figne univoque des écarts, des efforts, ou d’une entre
ouverture. Voyei Ec a r t , (e)
F a u c h e r , (Manufacture en foie.) c’eft une mau^
vaife maniéré d’ourdir une étoffe, qui ferre peu la
trame, qui avance beaucoup l’ouvrage > mais qui le
rend m ou, inégal & lâche.
FAUCHET, f. m. che^ le s C a n o n n i e r s , eft un ôuti!
de bois affez femblable au rateau des Jardiniers, qui
a^dqs dents de bois , & qui eft garni par fon milieu
d un long manche de bois. Les Cartonniers fe fervent
du fa u c h é e pour remuer de tems en tems dans la
cuve à fabriquer, la matière ou pâte dont ils font le
carfon. V o y e ^ l a P l a n c h e d u C a r to n n ie r .
* Fa u c h e t , ( T a i l la n d e r ie . ) petite faulx à l’ufage
des gens de la campagne, qui s’en fe rvent pour couper
de l ’herbe pour leurs beftiaux.
FAUCHON, f. m. terme de Rivière; c’eft un infiniment
de fer fait en faulx, avec lequel les Pêcheurs
coupent les herbes qui font dans le fond de l’eau, Sc
qui arrêtent les filets.
* FAUCILLE, f. f. (Èconoffi. rujliq. & Tailland.)
inftrument dentelé, tranchant par fa partie concave ,
recourbé, large d’environ deux doigts à fon milieu ,
pointu à fon, extrémité , formé d’environ la demi-
circonférence d’un cercle qui auroit un pié de diamètre
, & emmanché d’un petit rouleau de bois fixé
fur la queue par une virole : il fert à faire la moiffoii
des grains. La moiffonneufe embraffe de la main gauche
une poignée d’épis ; elleplace cette poignée dans
la courbure de fa faucille, affez au-defîous de fa
main, & l’abat en coupant la poignée d’un mouvement
circulaire de fa faucille. Cet inftrument qui fort
à moiffonner les blés & autres grains, eft celui de
tous ceux de l’Agriculture qui fatigue le plus. Les
dents dont il eft taillé font en-dedans feulement ; on.
ne paffe par confisquent fur la meule que la partie extérieure:
cette opération fépare les dents. Voici
comment il fe fabrique. Pour forger une faucille, on
corroyé une barre de fer avec une barre d’acier, telles
qu’on les voit dans nos Planches. Voy. ces P l. <S»
leurs expi. C ’eft de ces deux barres corroyées enfem.-
ble qu’on enleve la faucille. Quand elle eft enlevée ,
on la fépare, on la cintre ; on la repare au marteau,
on l’écorche fur la meule, on la taille au cifeau ; onia
trempe, on la repaffe fur la meule en-dehors, & la
faucille eft prête. La faucille a une foie par laquelle
on la monte fur un manche de bois. On voit dans nos
Planches les barres féparées, les barres corroyées ,
f i faucille enlevée, la faucille féparée de la barre, ôc
le cifeau à la tailler.
Fa u c il l e , (Agricult.) eft un inftrument qui fert
plûtôt à couper les blés & les autres grains de la campagne,
qu’à l ’ufage du jardinage ; cependant les Jardiniers
s’en fervent pour couper les petits tapis de
gafon & les bordures des baffins. (K )
* FAUCILLON, f. m. terme de Serrurier; c’ eft la
moitié de la plaine-croix qui fe pofe fur les roüets
d’une ferrure.
On donne encore le même nom aux petites limes
qui fervent à évuider les pannetons des clés, aux
endroits où il le faut pour le paffage des gardes de la
ferrure.
FAUCON, falco, f. m. (Hifl. nat. Omith.) Il y a
plufieurs efpeces de faucons, qui font tous des oi-
feaux de proie. Ray en diftingue douze.
i° . Le faucon pèlerin, falco peregrinus. Aldro-
vande en a décrit un qui avoir le fiommet de la tête
applati, le bec bleu, avec une membrane d’un jaune
foncé ; la tête, le derrière du cou, le dos & les ailes
étoient brunes , & prefque noires ; la poitrine, le
ventre & les cuiffes «voient une couleur blanche ,