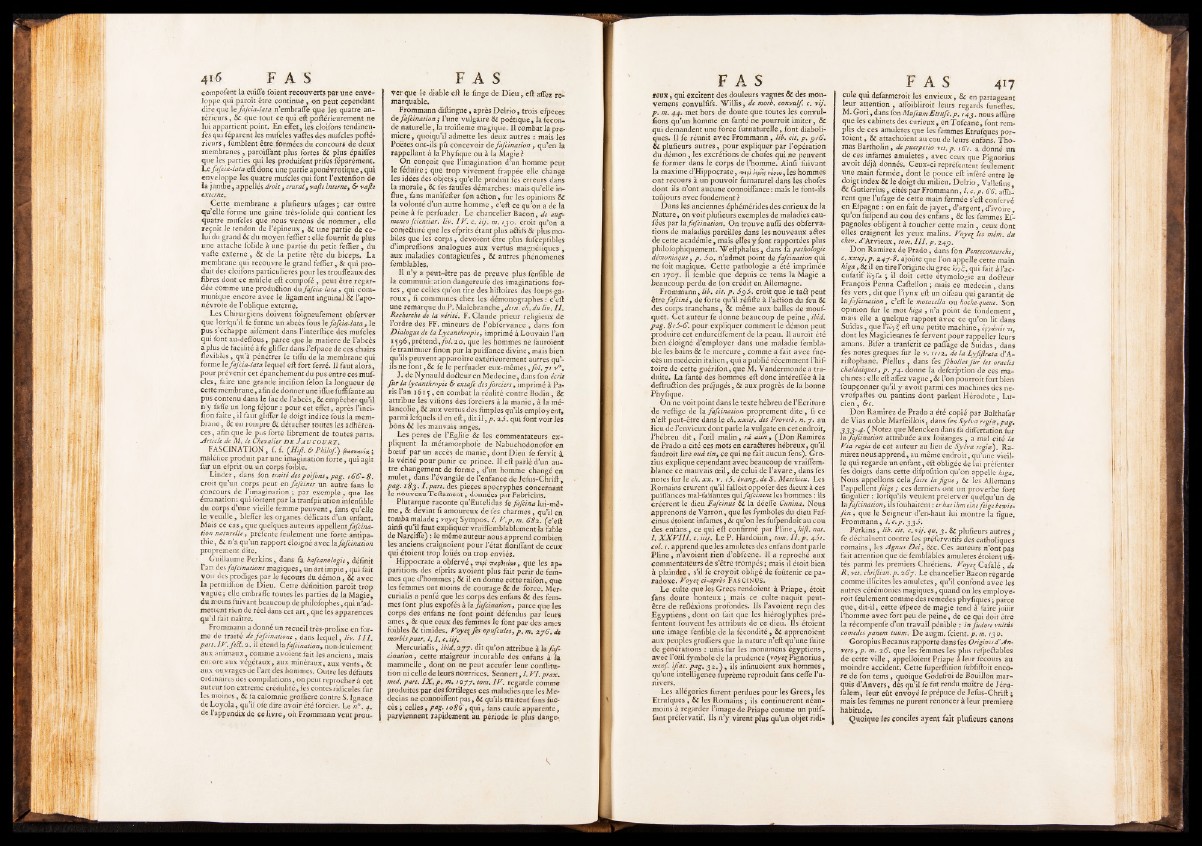
4*6 F A S compofent la cuiffe ibient recouverts par une enveloppe
qui paroît être continue , on peut cependant
dire que le fajcia-lata n’embraffe que les quatre antérieurs
, &c que tout ce qui eft poftérieurement ne
lui appartient point. En effet, les doifons tendineu-
fes qui féparent les mufcles vaftes des mufcles pofté-
rieurs, femblent être formées du concours de deux
membranes., paroiffant plus fortes & plus épaiffes
que les parties qui les produifent prifes féparément.
Lefzfcia-iata eft donc une partie aponévrotique, qui
enveloppe les quatre mufcles qui font l’extenfion de
la jambe, appelles droit, crural, vafie interne, & vafie
externe.
Cette membrane a plufieurs ufages; car outre
qu’elle forme une gaine très-folide qui contient les
quatre mufcles que nous venons de nommer, elle
reçoit le tendon de l’épineux, & une partie de celui
du grand & du moyen feffier : elle fournit de plus
une attache folide à une partie du petit feffier, du
vafte externe, 6c de la petite tête du biceps. La
membrane cjui recouvre le grand feffier, & qui produit
des cloifons particulières pour les trouffeaux des
fibres dont ce mufcle eft compofé , peut être regardée
comme une production du fafcia-lata, qui communique
encore avec le ligament inguinal 6c l’apo-
névroie de l’oblique externe.
Les Chirurgiens doivent foigneufement obferver
que lorfqu’il le forme un abcès fous le fafcia-lata, le
pus s’échappe aifément dans l’interftiee des mufcles
qui font au-deffous, parce que la matière de l’abcès
a plus de facilité à fe gliffer dans l’efpace de ces chairs
flexibles, qu’à pénérrer le tiflii de la membrane qui
forme le fafcia-lata lequel eft fort ferré. Il faut alors,
pour prévenir cet épanchement du pus entre ces mufcles,
faire une grande incifion félon la longueur de
cette membrane, afin de donner une iffue fuffifante au
pus contenu dans le fac de l’abcès, 6c empêcher qu’il
n’y falle un long féjour : pour cet effet, après l’inci-
fion faite, il faut gliffer le doigt indice fous la membrane
, 6c en rompre & détacher toutes les adhérences,
afin que le pus forte librement de toutes parts.
Article de M. Le Chevalier D E JA U C O U R T .
FASCINATION, f. f. {Hiß. & Philof.) ;
maléfice produit par une imagination forte, qui agit
fur un efprit ou un corps foible.
Linder, dans fon traité des poifons, pag. / 6 6 - 8.
croit qu’un corps peut en fafeiner un autre fans le
concours de l’imagination ; par exemple, que les
émanations qui fortent par la tranfpiration infenfible
du corps d’une vieille femme peuvent, fans qu’elle
le veuille, bleffer les organes délicats d’un enfant.
Mais ce cas, que quelques auteurs appellent fafeina-
tion naturelle, préfente feulement une forte antipathie
, 6c n’a qu’un rapport éloigné avec la fafeination
proprement dite.
Guillaume Perkins, dans fa bafcanologie, définit
l’art des fzjdnations magiques, un art impie, qui fait
voir des prodiges par le fecours du démon, 6c avec
la permiffion de Dieu. Cette définition paroît trop
vague ; elle embraffe toutes les parties de la Magie,
du moins.fuivant beaucoup de philofophes, qui n’admettent
rien de reel dans cet art, que les apparences
qu’il fait naître.
Frommann a donne un recueil très-prolixe en forme
de traité de fafeinatione , dans lequel, liv. I I I .
part. lV.fecl. 2. il etend la,fafeination, non-feulement
aux animaux, comme avoient fait les anciens, mais
encore aux végétaux, aux minéraux, aux vents &
aux ouvrages de l’art des hommes. Outre les défauts
ordinaires des compilations, on peut reprocher à cet
auteur Ion extreme crédulité, fes contes ridicules fur
les moines, 6c fa calomnie groffiere contre S. Ignace
de Loyola, qu’il ofe dire avoir été forcier. Le n°. 4.
de l’appendix de ce livre, oii Frommann veut prou-
F A S Ver que le diable eft le fmge de D ie u , eft allez remarquable.
Frommann diftingue, après Delrio, trois efpeces
d e fafeination } l’une vulgaire & poétique, la fécondé
naturelle, la troifieme magique. Il combat la première
, quoiqu’il admette les deux autres : mais les
Poètes ont-ils pu concevoir de fafeination , qu’en la
rappellant à la Phyfique ou à la Magie }
On conçoit que l’imagination d’un homme peut
le féduire ; que trop vivement frappée elle change
les idees des objets; qu’elle produit les erreurs dans
la morale, 6c fes fauffes démarches : mais qu’elle influe,
fans manifefter fon a&ion, fur les opinions &
la volonté d’un autre homme, c’eft ce qu’on a de la
peine à fe perfuader. Le chancelier Bacon, de aug-
mento feiendar. liv. IV . c. iij. m. 130. croit qu’on a
conjeûuré que les efprits étant plus a&ifs & plus mobiles
que les corps, dévoient etre plus fufceptibles
d’impreffions analogues aux vertus magnétiques ,
aux maladies contagieufes , 6c autres phénomènes
femblables.
Il n’y a peut-être pas de preuve plus fenfible de
la communication dangereuse des imaginations fortes
, que celles qu’on tire des hiftoires des loups-garoux
, fi communes chez les démonographes : c’eft
une remarque du P. Malebranche, dern, ch. du liv. I I .
Recherche de la vérité. F. Claude prieur religieux de
l’ordre des FF. mineurs de l’obfervance , dans fon
Dialogue de la Lycanthropie, imprimé à Louvain l’an
1 5S)6»prétend,/©/.2o. que les hommes ne fauroient
fe tranfmuer finon par la puiffanee divine, mais bien
qu’ils peuvent apparoître extérieurement aurres qu’ils
ne font, & fe le perfuader eux-mêmes ,fol. y i v°.
J. de Nynauld do&eur en Medecine, dans fon écrit
fur la lycanthropie <S* extafe des forciers, imprimé à Paris
l’an 161 ç , en combat la réalité contre Bodin, 6c
attribue les vifions des forciers à la manie, à la mélancolie,
6c aux vertus des fimples qu’ils employent,
parmi lefquels il en e ft, dit-il ,p .z S . qui font voir les
bons & les mauvais anges.
Les peres de l’Eglifè 6c les commentateurs expliquent
la métamorphofe de Nabuchodonofor en
boeuf par un accès de manie, dont Dieu fe fervit à
la vérité pour punir ce prince. Il eft parlé d’un autre
changement de forme, d’un homme changé en
mulet, dans l’évangile de l’enfance de Jefus-Chrift ,
pag. 1 8 3 .1.part. des pièces apocryphes concernant
le nouveau Teftament, données parFabricius.
Plutarque raconte qu’Eutelidas fe fafeina lui-même
, & devint fi amoureux de fes charmes , qu’il en
tomba malade ; voye^ Sympos. I. V.p.m. 682. (c’eft
ainfi qu’il faut expliquer vraiffemblablement la fable
de Narciffe) : le même auteur nous apprend combien
les anciens craignoient pour l’état floriflant de ceux
qui étoient trop loiiés ou trop enviés.
Hippocrate a obfervé, mpi •na.pûmay, que les apparitions
des efprits avoient plus fait périr de femmes
que d’hommes ; & il en donne cette raifon, que
les femmes ont moins de courage 6c de force. Mer-
curialis a penfé que les corps des enfans 6c des femmes
font plus expofés à la fafeination, parce que les
corps des enfans ne font point défendus par leurs
âmes, & que ceux des femmes le font par des âmes
foibles & timides. Voye^fes opufcules, p. m. zyG. de
morb'tspuer. 1 .1 . c. iij,
Mercurialis, ibid.zyy. dit qu’on attribue à la fafeination
, cette nlaigreur incurable des enfans à la
mammelle, dont on ne peut accufer leur conftitu-
tion ni celle de leurs nourrices. Sennert, I.VI. prax.
med. part. IX . p. m. toyy. tom. IV . regarde comme
produites par des fortileges ces maladies que les Médecins
ne connoiffent pas, 6c qu’ils traitent fans fuc-
cès ; celles, pag. 1086', qui,, fans caufe apparente,
parviennent rapidement au période le plus dange-
F A S yeux, qui excitent des douleurs vagues 6l des mou-
vemens convulfifs. 'Willis, de morb. convulf. c. vij.
p. m. 44. met hors de doute que toutes les convul-
fions qu’un homme en fanté ne pourroit imiter, 6c
qui demandent une force furnaturelle, font diaboliques.
Il fe réunit avec Frommann, lib. cit. p . ÿ tG.
6c plufieurs autres, pour expliquer par l’opération
du démon, les excrétions de chofes qui ne peuvent
fe former dans le corps de l ’homme. Ainfi fuivant
la maxime d’Hippocrate, «*»/» hpîlc vwov,les hommes
ont recours à un pouvoir furnaturel dans les chofes
dont ils n’ont aucune connoiffance : mais le font-ils
toûjours avec fondement ?
Dans les anciennes éphémérides des curieux de la
Nature, on voit plufieurs exemples de maladies cau-
fées par la fafeination. On trouve auffi des obferva-
tions de maladies pareilles dans les nouveaux aftes
de cette académie, mais elfes y font rapportées plus
philofophiquement. Weftphalus, dans la pathologie
démoniaque, p. So. n’admet point de fafeination qui
ne foit magique. Cette pathologie a été imprimée
en 1707. Il femble que depuis ce tems la Magie a
beaucoup perdu de fon crédit en Allemagne.
Frommann, lib. cit. p. S$ 5. croit que le taft peut
être fafeiné, de forte qu’il réfifte à l’a&ion du feu &
des corps tranchans, 6c même aux balles de mouf-
quet. Cet auteur fe donne beaucoup de peine, ibid.
pag. 81S-G. pour expliquer comment le démon peut
produire cet endurciffement de la peau. Il auroit été
bien éloigné d’employer dans une maladie fembla-
ble les bains 6c le mercure, comme a fait avec fuc-
cès un médecin italien, qui a publié récemment l’hif-
toire de cette guérifon,que M. Vandermondea traduite.
La fante des hommes eft donc intéreffée à la
deftrudion des préjugés, & aux progrès de la bonne
Phyfique.
On ne voit point dans le texte hébreu de l’Ecriture
de veftige de la fafeination proprement dite, fi ce
n’eft peut-être dans le ch. xxiij. des Proverb. n. y. au
lieu de l’envieux dont parle la vulgate en cet endroit,
l’hébreu dit, l’oeil malin, râ aiin, (Don Ramirez
de Prado a cité ces mots en carafteres hébreux, qu’il
faudroit lire ouâ tin, ce qui ne fait aucun fens). Grotius
explique cependant avec beaucoup de vraiflem-
blance ce mauvais oeil, de celui de l’avare, dans fes
notes fur le ch. x x . v. iS. évang. de S . Matthieu. Les
Romains crurent qu’il falloit oppofer des dieux à ces
puiflances mal-faifantes qui fafeinent les hommes : ils
créèrent le dieu Fafcinus & la déeffe Cunina. Nous
apprenons de Varron, que les fymboles du dieu Fafcinus
étoient infames, & qu’on les fufpendoit au cou
des enfans, ce qui eft confirmé par Pline, hiß. nat.
I. X X V I I I . c. iiij. Le P. Hardoiiin, tom. I I . p. 4S1.
col. /. apprend que les amuletes des enfans dont parle
P lin e, n’avoient rien d’obfcene. Il a reproché aux
commentateurs de s’être trompés ; mais il étoit bien
à plaindre, s’il fe croyoit obligé de foûtenir ce paradoxe.
Voye[ ci-après FASCINUS.
Le culte que les Grecs rendoient à Priape, étoit
fans doute honteux ; mais ce culte naquit peut-
être de refléxions profondes. Ils l’avoient reçu des
Egyptiens, dont on fait que les hiéroglyphes pré-
fentent fouvent les attributs de ce dieu. Ils étoient
une image fenfible de la fécondité, &c apprenoient
aux peuples groffiers que la nature n’eft qu’une fuite
de générations : unis fur les monumens égyptiens,
avec l’oeil fymbole de la prudence (voye^ Pignorius,
menf. ifiac.pag. 3 2 . ) , ils infinuoient aux hommes,
qu’une intelligence mprème reproduit fans cefle l’univers.
Les allégories furent perdues pour les Grecs, les
Etrufques , & les Romains ; ils continuèrent néanmoins
à regarder l’image de Priape comme un puif-
fant préfervatif, Ils n’y virent plus qu’un objet ridi-
F A S 417 cule qui defarmeroit les envieux, & en partageant
leur attention , affoibliroit leurs regards funeftes.
M. Gori, dans fon MufeumEtrufc.p. 143. nous affûre
que les cabinets des curieux, en Tofcane, font remplis
de ces amuletes que les femmes Etrufques por-
toient, & attachoient au cou de leurs enfans. Thomas
Bartholin, de puerperio vet.p. 1C1. z donné un
de ces infâmes amuletes, avec ceux que Pignorius
avoit déjà donnés. Ceux-ci repréfentent feulement
une main fermée, dont le pouce eft inféré entre le
doigt index & le doigt du milieu. Delrio, Vallefius
& Gutierrius, cités par Frommann, l. c. p. GG. aflu-
rent que l’ufage de cette main fermée s’eft confervé
en Efpagne : on en fait de ja y e t , d’argent, d’ivoire,
qu’on fufpend au cou des enfans, & les femmes Ef-
pagnoles obligent à toucher cette main, ceux dont
elles craignent les yeux malins. Voye{ les mém. du
chev. d’Arvieux, tom. I I I . p. 240.
Don Ramirez de Prado, dans fon Pentecontarche,
c .x x x j.p . 247-^. ajoute que l’on appelle cette main
higa, & il en tire l’origine du grec îu>?» qui fait à l’ac-
eufatif it^fa ; il doit cette étymologie au doôeur
François Penna Caftellon ; mais ce médecin , dans
fes vers, dit que l’iynx eft un oifeau qui garantit de
la fafeination, c’eft le rnotacella on hochequeue. Son
opinion fur le mot higa , n’a point de fondement,
mais elle a quelque rapport avec ce qu’on lit dans
Suidas, que 1 ’îw>£ eft une petite machine, opydvdv n
dont les Magiciennes fe fervent pour rappeller leurs
amans. Bifer a tranferit ce paflage de Suidas, dans
fes notes greques fur le v. 1112. de la Lyfiflrata d’A-
riftophane. Pfellus , dans fes feholies fur les oracles
chaldaxques, p. y 4. donne la defeription de ces machines
: elle eft affez vague, & l’on pourroit fort bien
foupçonner qu’il y avoit parmi ces machines des ne-
vrofpaftes ou pantins dont parlent Hérodote, Lucien
, &c.
Don Ramirez de Prado a été copié par Balthafar
de Vias noble Marfeillois, dans fes Sylva régies,pag.
3 3 3 ’4; ( Notez que Mencken dans fa diflertation fur
la fafeination attribuée aux loiianges , a mal cité la
Via regia de cet auteur au lieu de Sylva regia). Ramirez
nouaapprend, au même endroit, qu’une vieille
qui regarde un enfant, eft obligée de lui préfenter
fes doigts dans cette difpofition qu’on appelle higa.
Nous appelions cela faire la figue, 6c les Allemans
l’appellent feige ; ccs derniers ont un proverbe fort
fingulier : lorsqu'ils veulent pré(erver quelqu’un de
la fafeination, ils fouhaitent : erhatihmeine feige bewie-
Jèn, que le Seigneur d’en-haut lui montre la figue.
Frommann, l. c. p. 33S.
Perkins, lib. cit. c. vij. qu. 3 .6 c plufieurs autres,
fe déchaînent contre les préfervatits des catholiques
romains, les Agnus De i, &c. Ces auteurs n’ont pas
fait attention que de femblables amuletes étoient ufi-
tés parmi les premiers Chrétiens. Voye^ Cafalé , de
R. vet. chrijlian.p. zGy. Le chancelier Bacon regarde
comme illicites les amuletes, qu’il confond avec les
autres cérémonies magiques, quand on les employe-
roit feulement comme des remedes phyfiques ; parce
que, dit-il, cette efpece de magie tend à faire joiiir
l’homme avec fort peu de peine, de ce qui doit être
la récompenfe d’un travail pénible : in fudorc vultùs
comedes panem tuum. De augm. feient. p. m. 130.
Goropius Becanus rapporte dans fes Origines d’Anvers
, p. m. 2G. que les femmes les plus relpeftables
de cette v ille , appelloient Priape à leur fecours au
moindre accident. Cette fuperftition fubfiftoit encore
de fon tems, quoique Godefroi de Bouillon marquis
d’Anvers, des qu’il fe fut rendu maître de Jéru-
falem, leur eût envoyé le prépuce de Jefus-Chrift ;
mais les femmes ne purent renoncer à leur première
habitude.
Quoique les conciles ayent fait plufieurs canons