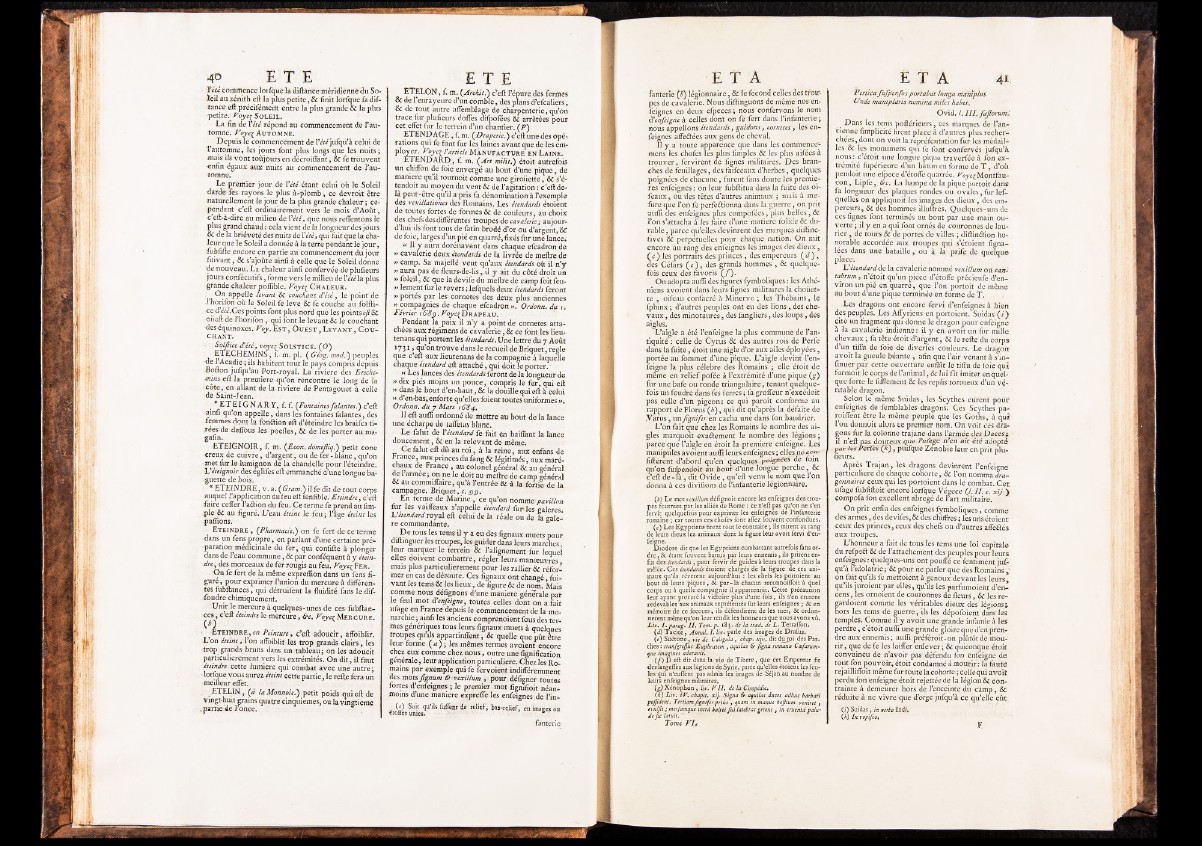
leil Vête commence lorfque lpa edtiiftteà,n &'ce -fminéitr ildoirefnqnuee d fua dSiof-
-tpanetcitee au e.zénith ft précifément eft la plus Soleil.
entre la plus grande &-la plus tomLan ef.i n Voye^de | été Automne.
répond au commencement de FauVoye{
Depuis le commencement de Vété jufqu’à celui de
'l’automne, les jours font plus longs que les nuits ;
•mais ils vont toujours en décroiffant, & fe trouvent
■ enfin égaux aux nuits au commencement de l’au-
-tomne.
Le premier jour de Vété étant celui oh le Soleil
•darde fes rayons le plus à-plomb, ce devroit être
naturellement le jour de la plus grande chaleur ; cependant
c’eft ordinairement vers le mois d’Août,
c’eft-à-dire au milieu de l’été, que nous reffentons le
plus grand chaud; cela vient de la longueur des jours
& de la brièveté des nuits de l’été, qui fait que la chaleur
que le Soleil a donnée à la terre pendant le jour,
Tubfifte encore en partie au commencement du jour
fuivant, & s’ajoûte ainfi à celle que le Soleil donne
de nouveau. La chaleur ainfi confervée de plufieurs
jours confécutifs, forme vers le milieu de l’été la. plus
■ grande chaleur poflible. Voye^ Chaleur.
On appelle levant■ & couchant d'été ,• le point' de -1 horifon oii le Soleil fe leve & fe couche au folfti-
ce d’éré.Ces points font plus nord que les points eji &
oiieft de l’horifon , qui font le levant & le couchant
■ deséquinoxes. Voy. Est , Ouest , Levant , Couchant.
■ Solftice d'été, voye^ SOLSTICE. ( 0 )
ETECHEM1NS, f.- m. pl.. ( Géog.• mod.) peuples
de l’Acadie ; ils habitent tout le pays compris depuis
Bofton jufqu’-au Port-royal. La riviere des Etechè-
■ mins eft la première qu’on rencontre le long de la
côte, en allant de la riviere de Pentagouet à celle
de Saint-Jean.
_ * E T E IG N A R Y , f. f. (Fontainesfalantes.) c’eft
-ainfi qu’on appelle, dans les fontaines falantes, des
femmes dont la fonction eft d’éteindre les braifes ti-
■ rees de deftous les poefles, ôc de les porter au ma- i
^gafin.
ETEIGNOIR, f. m. (Eùon. domejliq.’) petit cône
-creux de cuivre, d’argent, ou de fer - blanc, qu’on
■ met fur le lumignon de la chandelle pour l’éteindre.
Uéteignoir des eglifes eft emmanché d’une longue baguette
de bois.
■ * ETEINDRE, v . a. {Gram?) il fe dit de tout corps
auquel l’application du feu eft lenfible. Eteindre, c’eft
faire ceffer l’aâion du feu. Ce terme fe prend au Ample
& au figuré. L’eau éteint le feu; l’âge éteint les
pallions. • danEst uenin fdenrse p ,r o(Pphrear, menac piea.)r laonnt fde’u fneer tc edret acien ete prmréedpaanrast
dioe nl’ emaéud ciocimnamleu ndeu, f&er p, aqru cio cnofénqfiufteen tà à p ylo nger éteindre
, des morceaux de fer rougis au feu. Voye^ Fer. *
On fe fert de la même expreffion dans un fens figure
, pour exprimer l’union du mercure à différentes
fubftances, qui détruifent la fluidité, fans le dif-
foudre chimiquement.
ce-sU, nci’er.flte mercure à quelques-unes de ces fubftanéteindre
le mercure, &c. Voyez Mercure.
w • |E teindre, en Peinture, c’eft adoucir, affoiblir. .
L’on éteint, l’on affoiblit les trop grands clairs, les
trop grands bruns dans un tableau; on les adoucit
particulièrement vers les extrémités. On dit, il faut
éteindre cette lumière qui combat avec une autre;
- lorfque vous aurez éteint cette partie, le refte fera un
meilleur effet.
ETELIN, (à laMonnoie.) petit poids qui eft de
«. pvainrgtite-.hduei tl ’gornacines. quatre cinquièmes, ou la vingtième
ETELON, f. m. (Arcfùt.) c’ eft l’épure des fermes
& de 1 enrayeure d’un comble, des plans d’efcaüers,
&c de tout autre affemblage de charpenterie, qu’on
trace fur plufieurs doffes cufjpofées & arrêtées pour
cet effet fiur le terrein d’un chantier, (jP)
ratEioTnEs NquDi AfeG foEn,t f f. umr .l e(sD lraainpees raiveacn’et fqt uuen ed ed eless o epméployer.
V?ye{ Carticle Manufacture en Laine.
ETENDARD, f. m. (Art miiit.) étoit autrefois
un chiffon de foie envergé au bout d’une pique, de
maniéré qu’il tournoit comme une giroiiette, & s’é-
tendoit au moyen du vent & de l’agitation : c ’eft delà
peut-etre qu’il a pris fa dénomination à l’exemple
des vexillationes des Romains. Les étendards étoient
de toutes fortes de formes & de couleurs, au choix
des chefs des differentes troupes de cavalerie j aujour-
d’hui ils font tous de fatin brodé d’or ou d’argent, &C
de foie, larges d’un pié en quarré, fixés fur une lance*
« Il y aura dorénavant dans chaque efcadron de
» cavalerie deux étendards de la livrée de meftre de
» camp. Sa majefte veut qu’aux étendards oh il n’y
» aura pas de fleurs-de-lis, il y ait du côté droit un
» foleil, & que la devife du meftre de camp foit feu-
» lement fur le revers; lefquels deux étendards feront
» portes par les cornetes des deux plus anciennes
» compagnies de chaque efcadron». Ordonn. du i,
Février 168q. Voyei Drapeau.
Pendant la paix il n’y a point de cornetes attachées
aux régimens de cavalerie, & ce font les lieu*
tenans qui portent les étendards. Une lettre du 7 Août
1731 •> qn’on trouve dans le recueil de Briquet, réglé
que c’eft -aux lieutenans de la compagnie à laquelle
chaque étendard eft attaché, qui doit le porter.
• « Les lances des étendards feront de la longueur de
» dix piés mojns un pouce, compris le fer, qui eft
» dans le bout d’en-haut, & la douille qui eft à celui
» d’en-bas, enforte qu’elles foient toutes uniformes ».
Ordonn. du y Mars {(>84.
Il eft aufli ordonné de mettre au bout de la lance
une écharpe de taffetas blanc»
Le falut de Vétendard-k fait ên büiffant la lance
doucement, & en la relevant de même.
_ falut eft du au r o i , à la reine, aux enfans dé
rrance, aux princes du fang & légitimés, aux maréchaux
de France , au colonel général & au générai
de 1 armee; on ne le doit au meftre de camp général
<X au commiffaire, qu’à l’entrée & à la fortie de la
campagne. Briquet, t. g q .
En terme de Marine, . ce qu’on nomme-pavillon
fur les vaiffeaux s’appelle étendard fur- les galeres*
L’étendard royal eft celui de la réale ou de la galère
commandante. b
J ? e tous les tems Ü y a eu des fignaux muets pour
diftmguer les troupes, les guider dans leurs marches I
leur marquer le terrein & l’alignement fur lequel
elles doivent combattre, régler leurs manoeuvres
mais plus particulièrement pour les rallier & réformer
en cas de déroute. Ces fignaux ont changé, fuivant
les tems & les lieux-, de figure & de nom. Mais
comme nous defignons d’une maniéré générale par
le feul mot d’enfeigne f toutes celles dont on a fait
ufage en France depuis le commencement de la monarchie
; ainfi les anciens comprenoient fous des termes
génériques tous leurs fignaux muets à quelques
troupes qu’ils appartinffent, & quelle que pût être
leur forme (« ) ; les mêmes termes a voient encore
chez eux comme chez nous , outre une lignification
générale, leur application particulière. .Chez les Romains
par exemple qui fe feryoient indifféremment
'des, mots Jignum & vexillum , pour défigner toutes
fortes d’enfeignes ; le premier mot fignifioit néanmoins
d’une manier e.expreffe les enfeignes de l’in-
(a) Suit qu’ils fuffent de relief, bas-relief, en images ou
fanterie
fanterie (b) légionnaire , & le fécond celles des tfotr-
pes de cavalerie. Nous diftinguons de même nos enfeignes
en deux efpeces ; nous confervons le nom
d’enfeigne à celles dont on fe fert dans l’infanterie ;
nous appelions étendards, guidons, cornetes , lés enfeignes
affeûées aux gens de cheval.
Il y a toute apparence que dans les coirtmencé-
mens les chofes lès plus fimples & les plus aifées à
trouver, fervirent de lignes militaires. Des branches
de feuillages, des faifcealix d’hefbes, quelques
poignées de chacune, furent fans doute les premières
enfeignes : on leur fubftitua dans la fuite des oi-
feaux, ôti des têtes d’autres animaux ; mais à me-
fure que l’on fe perfectionna dans la guerre, on prit
aufîi des enfeignes plus compofées, plus belles, &
l’on s’attacha à les faire d’une matière folide & durable
, parce qu’elles devinrent des marques diftinc-
tives & perpétuelles pour chaque nation. On mit
encore au rang des enfeignes les images des dieux,
f c ) les portraits des princes, des empereurs ( d ) ,
des Céfars ( e ) , des grands hommes , & quelquefois
ceux des favoris ( ƒ ) .
On adopta aufli des figures fymboliqües : les Athéa
niens avoient dans leurs lignes militaires la chouette
, oifeau confacré à Minerve ; les Thébains, le
fphinx ; d’autres peuples ont eu des lions, des chevaux
, des minotaures, des fangliers, des loups , des
aigles. I I 1 1
L’aigle a été l’enfeigne la plus commune de l’antiquité
: celle de Cyrus & des autres rois de Perfe
dans la fuite, étoit une aigle d’or aux ailes éployées,
portée au fommet d’ime pique. L’aigle devint l’en-
feigne la plus célébré des Romains ; elle étoit de
même en relief pofée à l’extrémité d’une pique (g)
fur une bafe ou ronde triangulaire, tenant quelquefois
un foudre dans fes ferres ; fa groffeur n’exeédoit
pas celle d’un pigeon: ce qui paroît conforme au
rapport de Florus ( à ) , qui dit qu’après la défaite de
iVarus, unfignifer en cacha une dans fon baudrier.
L ’on fait que chez les Romains le nombre des aigles
marquoit exa&ement le nombre des légions ;
parce que l’aigle en étoit la première enfeigne. Les
manipules avoient aufli leurs enfeignes ; elles necoa-
fifterent d’abord qu’en quelques poignées de foin
qu’on fufpendoit au bout d’une longue perche, &
c’eft de - l à , dit Ovid e, qu’eft venu le nom que l’on
donna à ces divifions de l’infanterie légionnaire.
(b) Le mot vexillum défignoit encore les enfeignes des troupes
fournies par les alliés de Rome : ce n’eft pas qu’on ne s’en
lervîc quelquefois pour exprimer les enfeignes de l’infanterie
romaine ; car toutes ces chofes font affez louvent confondues.
(c) Les Egyptiens firent tout le contraire : ils mirent au rang
de leurs dieux les animaux dont la figure leur avoit fervi d’en*
feigne.
Diodore dit que les Egyptiens combattant autrefois fans ordre
, 8c étant fouvent battus par leurs ennemis, ils prirent enfin
des étendards, pour fervir de guides à leurs troupes dans la
mêlée. Ces étendards étoieht chargés de la figure de ces animaux
qu’ils révèrent aujourd’hui : les chefs les portoient au
bout de leurs piques, 8c par-là chacun reconnoiffoit à quel
corps ou à quelle compagnie il apparcenoit. Cette précaution
leur ayant procuré la victoire plus d’une fois, ils s’en crurent
redevables aux animaux repréfentés fur leurs enfeignes ; 8c en
mémoire de ce fecours, ils défendirent de les tuer, 8c ordonnèrent
même qu’on leur rendît les honneurs que nous avons vû.
Liv. I^parag. IJ. Totn.p. 183. de la trad. de L - Terrafîon.
(d) Tacite, Annal. I. liv• parle des images de Drufus.
(e) Suétone, vie de Caligula, chap. xjv. dit durpi desPâf-
thes : tranfgrejjus Euphratem, aquilas & figna romana Ctzfarum-
que imagines ddoravit.
(ƒ) Il eft dit dans, la vie de Tibere, que cet Empereur fit
des largeffes aux légions de Syrie, parce qu’elles étoient les feules
qui n’euffent pas admis les images de Séjan au nombre de
leurs enfeignes militaires.
(g) Xénophon, liv. VII. de la Ciropédie.
(h) Liv. IV. chapit. xij. Signa & aquilas duces adhuc barbari
poJJ'idcnt. Tertiam fignifer priùs , quam in manus hoftium veniret ,
evulfit; merjamque mtr à balfei fui latebras gerens, in cruentâ palu-
de fie latuit. ’*
Tome V it
Pertica fufpetifos portabdt longa ritahiplos
Un'de maniplaris nomina miles habét.
Ovid. I. Î I1, fajlorum'l
Dans les tems poftérieurs, ces niarques de l’antienne
fimplicité firent place à d’autres plus recherchées,
dont on voit la repréfentation fur les médailles
& les monumens qui fe font confervés jufqu’à
nous ; c’etoit une longue pique tra verfée à fon extrémité
fupérieure d’un bâton en forme de T , d’où
pendoit une efpece d’étoffe quarrée. foyc^Montfau-
con, Lipfe, &c. La hampe de la pique portoit dans
fa longueur des plaques rondes ou ovales, fur le s quelles
on appliquoit les images des dieux, des empereurs
j & dès hommes illuftrés. Quelques-uns dé
ces lignes font terminés au bout par une main ouverte
; il y en a qui font ornés de couronnes de laurier
, de tours & de portes de villes ; diftinûion honorable
accordée aux troupes qui s’éfoient figna-
lees dans une bataille, ou à la prife de quelque
place;
L’étendard de la câvalerie nommé vexillum ou can-
tabrum, n’étoit qu’un pièce d’étoffe précieufe d’environ
un pié en quarre, que l’on portoit de même
au bout d’une pique terminée en forme de T .
Les dragons ont encore fervi d’enfeignes à bien
des peuples. Les Affyriens en portoient. Suidas ( i )
cite un fragment qui donne le dragon pour enfeigne
à la cavalerie indienne: il y eii avoit un fur mille
chevaux ; fa tête étoit d’argent, & le refte du corps
d’un tiffu de foie de diverfes couleurs. Le dragon
avoit la gueule béante , afin que l’air venant à s’in-
finuer par cette ouverture enflât le tiffu de loie qui
formoit le corps de l’animal, & lui f ît imiter en quelque
forte le fiflîement & les replis tortueux d’un v éritable
dragon.
Selon le même Suidas, les Scythes éürènt poür
enfeignes de femblables dragons. Ges Scythes pa-
roiffent être le même peuple que les Gôths, à qui
l’on donnôit alors ce premier nom. On voit ces dragons
fur la colonne trajane dans l ’armée des Dacesf
il n’eft pas douteux qye J’uïa^e n’en ait été adopté
Far les Per fes (k ) , puifque Zenobie leur en prit plu-
lieurs.
Après Trajan, les dragons devinrent l’enfeigne
particulière de chaque cohorte, & l’on nomma dra-
gonnaires ceux qui les portoient dans le combat. Ce t
ufage fubfiftoit encore lorfque Végèce (/. II. c. x ij. )
compofa fon excellent abrégé de l’art militaire.
On prit enfin des enfeignes fymboliqües, comme
des armes, des devifes, & des chiffres ; les uris étoient
ceux des princes, ceux des chefs ou d’autres afféûés
aux troupes.
L’honneur a fait de tous les tems ufte loi capitale
du refpeft & de l’attachement des peuples pour leurs
enfeignes : quelques-uns ont pouffé ce fentiment jufqu’à
l’idolâtrie ; & pour ne parler que des Romains
on fait qu’ils fe mettoient à genoux devant les leurs,
qu’ils juroient par elles, qu’ils les parfumoieftt d’encens,
les ornoiertt de couronnes de fleurs, & les re-
gardoient comme les véritables dieux des légions j
hors les tems de guerre, ils les dépofoient dans lés
temples. Comme il y avoit une grande infamie à les
perdre, c’étoit aufîi une grande gloire que d’en prendre
aux ennemis; aufli préféroit-on plutôt de mbu->
rir, que de fe les laiffer enlever.; & quiconque étoit
convaincu de n’avoir pas défendu fon enleigne de
tout fon pouvoir, étoit condamné à mdufir: la fauté
rejailliffoit même fur toute la cohorte ; Celle qui avoit
perdu fon enfeigne étoit rejettée de la légion & contrainte
à demeurer hors de l’enceinte du camp, &
réduite à ne vivre que d’ôrge jufqu’à ce qu’elle eut
(t) Suidas, in verbe Indi.
(k) In vopifeo.
F,