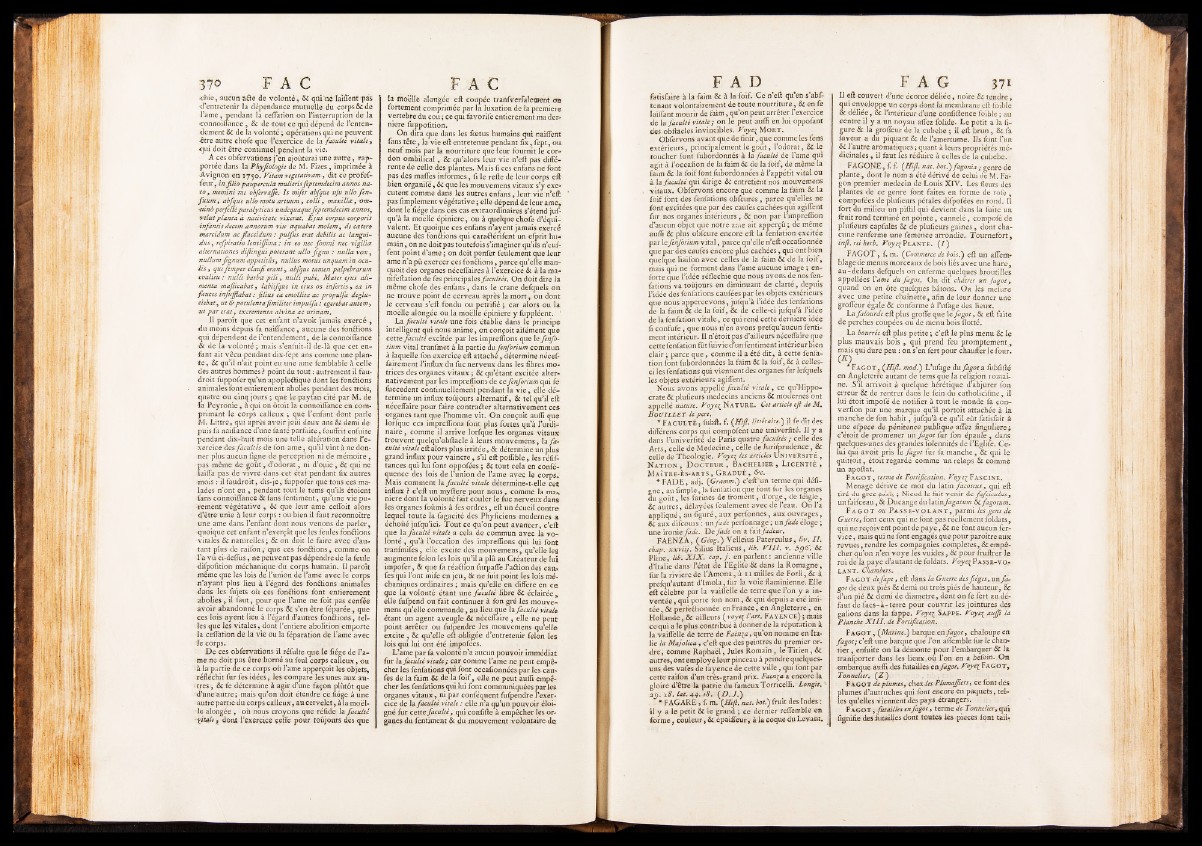
3 7 ° F A C
ch ie, aucun a&e de volonté, & qiii'nè laîffent pas
•d’entretenir la dépendance mutuelle du corps & de
Famé, pendant la ceffation on l’interruption de la
■ connoiffance, & de 'tout ce qui dépend de l’entendement
& de la volonté ; opérations qui ne peuvent
■ être autre choie que l’exercice de la faculté vitale,
<jui doit être continuel pendant la vie.
A ces obfervations j’en ajouterai une autre, rapportée
dans la Pkyjîologie de M. Fizes, imprimée à
Avignon en 1750. Vitam vegetativam, dit ce profef-
leur, infilio paupercula midi cri sfeptemdecim annos na-
to , mernini me obfervaffèIs mifer abfque ufit ullo fen-
fuum y abfque ullo motu artuum y colli , maxilice , ‘om-
■ ninb perfeclè paralyticus undequaque feptemdecim annos y
velut planta à naùvitate vixerat. Ejas corpus corporis
infantis decem annorum vix oequabat molem, de catero
marcidum ac flaccidum : p u f us erat debilis ac langui-
dus y refpiratio lentijjîma : in eo nec fourni nec vigilicc
alternationes dijlingui poterant ullo Jigno : nulla vox,
nullum fignum appetitiis, nullus motus unquam in ocu-
éis , qui femper claufi erant > abfque tamen palpebrarum
coalitu : nulli barba p ili, nulli pubi. Mater ejus alimenta
mafiicabat, labiifque in ejus os infertis, ea in
fautes infuffabat : filius ea emollita etc propulfa deglu-
tiebaty ut & potulentaJîmiliter impulfa : egerebat autem,
ut par erat y excrementa alvina ac urinam.
Il paroît que cet enfant n’avoit jamais exercé ,
du moins depuis fa naiffance, aucune des fondions
qui dépendent de l’entendement, de la connoilfance
•& de la volonté ; mais s’enfuit-il de-là que cet enfant
ait vécu pendant dix-fept ans comme une plante
, & qu’il n’ait point eu une ame femblable à celle
des autres hommes ? point du tout : autrement il fau-
droit fuppofer qu’un apoplectique dont les fondions
animales font entièrement abolies pendant des trois,
quatre ou cinq jours ; que le payfan cité par M. de
la Peyronie, à qui on ôtoit la connoiffance en comprimant
le corps calleux ; que l’enfant dont parle
M. Littré, qui après avoir joiii deux ans & demi depuis
fa naiffance d’une fanté parfaite, foufffit enfuite
pendant dix-huit mois une telle altération dans Fe-
xercice des facultés de fon ame, qu’il vint à ne donner
plus aucun figne de perception ni de mémoire,
•pas même de goût, d’odorat, ni d’ouie , & qui ne
laiffa pas de vivre dans cet état pendant fix autres
■ mois : il faudroit, dis-je, fuppofer que tous ces malades
n’ont eu , pendant tout le tems qu’ils étoient
fans connoiffance & fans fentiment, qu’une vie purement
végétative , & que leur ame ceffoit alors
d’être unie à leur corps : ou bien il faut reconnoître
une ame dans l’enfant dont nous venons de parler,
■ quoique cet enfant n’exerçât que les feules fondions
•vitales & naturelles ; & on doit le faire avec d’autant
plus de raifon,' que ces fondions, comme on
l’a vû ci-deffus, ne peuvent pas dépendre de la feule
difpofition mécha nique du corps humain. Il paroît
même que les lois de l’union de l’ame avec le corps
«’ayant plus lieu à l’égard des fondions animales
dans les fujets oit ces fondions font entièrement
abolies, il faut, pour que l’ame ne foit pas cenfée
avoir abandonné le corps & s’en être féparée, que
ces lois ayent lieu à l’égard d’autres fondions, telles
que les v itales, dont l’entiere abolition emporte
la ceffation de la vie ou la féparation de l’ame avec
le corps.
De ces obfervations il réfulte que le fiége de l’ame
ne doit pas être borné au feul corps calleux, ou
à la partie de ce corps où l’ame apperçoit les objets,
réfléchit fur fes idées, les compare les unes aux autre
s , & fe détermine à agir d’une façon plutôt que
d’une autre; mais qu’on doit étendre ce fiége à une
autre partie du corps calleux, au cervelet, à la moël-
- le alongée , où nous croyons que réfide la fa c u lté
■ \iude y dont l’exercice çeffe pour toujours dès que
F A C
f a m o e lle a lo n g é e e f t c o u p é e t ra rifv e rT a leo îen t o a
fo r tem e n t c om p r im é e p a r l a lu x a t io n d e la p rem ie r«
v e r t e b r e d u c o u ; c e q u i f a v o r i f e e n t iè rem en t m a d e r n
iè r e fu p p o f it io n .
On dira que dans les foetus humains qui naiffent
fans tête, la vie eft entretenue pendant f ix , fept, ou
neuf mois par la nourriture que leur fournit le cor-»
don ombilical, & qu’alors leur vie n’eft pas différente
de celle des plantes. Mais fi ces enfans ne font
pas des maffes informes, fi le refte de leur corps efl
bien organifé, & que les mouvemens vitaux s’y exe-
cutent comme dans les autres enfans, leur vie n’eft
pas Amplement végétative ; elle dépend de leur ame,
dont le fiége dans ces cas extraordinaires s’étend juf-
qu’à ia moelle épiniere, ou à quelque chofe d’équivalent.
Et quoique ces enfans n’ayent.jamais exercé
aucune des fondions qui caraôérifent un efprit hu*
main, on ne doit pas toutefois s’imaginer qu’iîs n’euf-
fent point d’ame ; on doit penfer feulement que leur
ame n’a pu exercer ces fondions, parce qu’elle man-
quoit des organes néceffaires à l’exercice & à la ma*
nifeftation de fes principales facultés. On doit dire la
même chofe des enfans, dans le crâne defquels on
ne trouve point de cerveau après la m ort, ou dont
le cerveau s’eft fondu ou pétrifié ; car alors ou la
moelle alongée ou la moelle épiniere y fuppléent. '
La faculté vitale une fois établie dans le principe
intelligent qui nous anime, on conçoit aifément que
cette faculté excitée par les impreffions que le fenfo-
rium vital tranfmet à la partie du fenforium commun
à laquelle fon exercice eft attaché, détermine nécefi
fairement l’influx du fuc nerveux dans les fibres mo*
trices des organes vitaux ; & qu’étant excitée alternativement
par les impreffions de ce fenforium qui fo
fuccedent continuellement pendant la v ie , elle détermine
un influx tdûjours alternatif, & tel qu’il eft
néceffaire pour faire contracter alternativement ces
organes tant que l’homme vit. On conçoit auffi que
lorfque ces impreffions font plus fortes qu’à l’ordinaire
, comme il arrive lorfque les organes vitaux
trouvent quelqu’obftacle à leurs mouvemens, la faculté
vitale eft alors plus irritée, & détermine un plus
grand influx pour vaincre, s’il eft poffible, les réfif-
tances qui lui font oppofées ; & tout cela en confé-
quence des lois de l’union de l’ame avec le corps.
Mais comment la faculté vitale détermine-t-elle cet
influx ? c’eft un myftere pour nous, comm.e la ma-*
niere dont la volonté fait couler le fuc nerveux dans
les organes fournis à fes ordres, eft un écueil contre
lequel toute la fagacité des Phyficiens modernes a
échoiié jufqu’ici. Tout ce qu’on peut avancer, c’eft
que la faculté vitale a cela de commun avec la volonté
, qu’à l’occafion des impreffions qui lui font
tranfmifes, elle excite des mouvemens, qu’elle les
augmente félon les lois qu’il a plû au Créateur de lui
impofer, & que fa réadion furpaffe l’adion des eau*
fes qui l’ont mife en jeu, & ne fuit point les lois mé-
chaniques ordinaires ; mais qu’elle en différé en ce
que la volonté étant une faculté libre &c éclairée ,
elle fufpend ou fait continuer à fon gré les mouvemens
qu’elle commande, au lieu que la faculté vitale
étant un agent aveugle & néceffaire , elle ne peut
point arrêter ou fufpendre les mouvemens qu’elle
excite , & qu’elle eft obligée d’entretenir félon les
lois qui lui ont été impofees.
L ’ame par fa volonté n’a aucun pouvoir immédiat
fur la faculté vitale; car comme l’ame ne peut empêcher
les fenfations qui font occafionnées par les cau-
fes de la faim & de la foif, elle ne peut auffi empêcher
les fenfations qui lui font communiquées par les
organes vitaux , ni par conféquent fufpendre l ’exercice
de la faculté vitale : elle n’a qu’un pouvoir éloigné
fur cette faculté, qui confifte à empêcher les organes
du fentiment & du mouvement volontaire de:
F A D fatisfaire à la faim & à la foif. Ce n’eft qu’en s’abf-
tenant volontairement de toute nourriture, & en fe
laiffant mourir de faim, qu’on peut arrêterl’exercice
de la faculté vitale ; on le peut auffi en lui oppofant
des obftacles invincibles. Vyye^ Mo r t .
Obfervons avant que de finir, que comme les fens
extérieurs, principalement le goût, l’odorat, & le
toucher font fubordonnés à la faculté de Famé qui
agit à l’occafion de la faim & de la foif, de même la
faim & la foif font fubordonnées à l’appétit vital ou
à la faculté qui dirige & entretient nos mouvemens
vitaux. Obfervons encore que comme la faim & la
foif font des fenfations obfcures, parce qu’elles ne
font excitées que par des caufes cachées qui agifîent
fur nos organes intérieurs, & non par l’impreffion
d’aucun objet que notre ame ait apperçû ; de même
auffi & plus obfcure encore eft la fenfation excitée
par 11 fenforium v ita l, parce qu’elle n’eft occafionnée
que par des caufes encore plus cachées, qui ont bien
quelque liaifon avec celles de la faim & de la fo if,
mais qui ne forment dans l’ame aucune image ; en-
forte que l’idée réfléchie que nous avons de nos fenfations
va toûjours en diminuant de clarté, depuis
l’idée des fenfations caufées par les objets extérieurs
que nous appercevons, julqu’à l’idée des fenfations
de la faim & de la foif, & de celle-ci jufqu’à l’idée
de la fenfation vitale, ce qui rend cette derniere idée
fi confufe, que nous n’en avons prefqu’aucun fentiment
intérieur. Il n’étoit pas d’ailleurs néceffaire que
cette fenfation fût fuivie d’un fentiment intérieur bien
clair ; parce q ue, comme il a été d it, à cette fenfation
font fubordonnées la faim & la foif, & à celles-
ci les fenfations qui viennent des organes fur lefquels
les objets extérieurs a^iffent. ^
Nous avons appelle faculté vitale, ce qu’Hippo-
crate & plufieurs médecins anciens & modernes ont
appellé nature. Voye£ N a t u r e . Cet article efl de M.
B oUILLET le pere.
* F a c u l t é , fubft. f. (Hifl. littéraire.) il fe dit des
différens corps qui compofent une univerfité. Il y a
dans l’univerfite de Paris quatre facultés ; celle des
Arts, celle de Medecine, celle de Jurifprudence, &
celle de Théologie. Voye{ les articles Un iv e r s it é ,
N a t i o n , D o c t e u r , Ba c h e l i e r , L i c e n t i é ,
M a î t r e -é s -a r t s , G r a d u é , & c.
* FADE, adj. (Gramm.') c’eft^un terme qui défi-
gne, au fimple, la fenfation que font fur les organes
du goût, les farines de froment, d’orge, de feîgle,
& autres, délayées feulement avec de l’eau. On l’a
appliqué, au figuré, aux perfonnes, aux ouvrages,
6c aux difeours : un fade perfonnage ; un fade éloge ;
une ironie fade. De fade on a faitfadeur.
FAENZA, ( Géog. ) Velleius Paterculus, Uv. II.
chap. xxviij. Silius Italicus, lib. VIII. v. 59 6. &
Pline, lib. X IX . cap. j . en parlent: ancienne ville
d’Italie dans l’état de l’Eglile & dans la Romagne,
fur la rivierede l’Amona, à 11 milles de Forli, & à
prefqu’autant d’Imola, fur la voie flaminienne. Elle
eft célébré par la vaiffelle de terre que l’on y a inventée
, qui porte fon nom, & qui depuis a été imité
e , & perfeâionnée en France, en Angleterre, en
Hollande, & ailleurs ( v o y t [ Part. Fa y e n c e ) ; mais
ce qui a le plus contribué à donner de la réputation à
la vaiffelle de terre de Fdén^a, qu’on nomme en Italie
la Majolica, c’eft que des peintres du premier ordre
* comme Raphaël, Jules Romain, le Titien , &
autres, ont employé leur pinceau à peindre quelques-
uns des vafes de fayence de cette v ille , qui font par
cette raifon d’un très-grand prix. Fatn^a a encore la
gloire d’être la patrie du fameux Torricelli.
uty. i8. lat. 44. >8. (.D .J .)
* FAGARE, f. m. (Hiß. nat. bot.) fruit des Indes':
i l y a le petit & le grand ; ce dernier reffemble en
forme, couleur 9 & épaiffeur, à la 6oque du Levant.
F A G 371 Il eft couvert d’une écorce déliée, noire &c tendre,
qui enveloppe un corps dont la membrane eft foible
& déliée, & l’intérieur d’une c o n f i f t e n c e foible ; au
centre il y a un noyau affez folide. Le petit a la figure
& la groffeur de la cubebe ; il eft brun, & fa
faveur a du piquant & de l’amertume. Ils font l’un
& 1 autre aromatiques ; quant à leurs propriétés médicinales
, il faut les réduire à celles de la cubebe.
FAGONE, f. f. (Hifl. nat. bot.) fagonia ; genre de
plante, dont le nom a été dérivé de celui de M. Fa-
gon premier médecin de Louis XIV. Les fleurs des
plantes de ce genre font faites en forme de rofe ,
compofées de plufieurs pétales difpofées en rond. Il
fort du milieu un piftil qui devient dans la fuite un
fruit rond terminé en pointe, cannelé, compofé de
plufieurs capfulés & de plufieurs gaines, dont chacune
renferme une femence arrondie. Tournefort,
injl.reiherb. Voye^ PLANTE, (ƒ )
FAGOT , f. m. (Commerce de bois.) eft un affem-
blage de menus morceaux de bois liés avec une hare,
au-dedans defquels on enferme quelques broutilles
appellées Y ame du fagot. On dit châtrer un fagot,
quand on en ôte quelques bâtons. On les mefure
avec une petite chaînette, afin de leur donner une
groffeur égale & conforme à l’ufage des lieux.
La falourde eft plus groffe que le fagot, & eft faite
de perches coupées ou de menu bois flotté.
La bourrée eft plus petite ; c’eft le plus menu & le
plus mauvais bois , qui prend feu promptement,
mais qui dure peu : on s’en fert pour chauffer le four.
m
* Fa g o t , (Hifl. mod.) L’ufage du fagot a fubfifté
en Angleterre autant de tems que la religion romaine.
S’il arrivoit à quelque hérétique d’abjurer fon
erreur & de rentrer dans le fein du catholicifme, il
lui étoit impofé de notifier à tout le monde fa con-
verfion par une marque qu’il portoit attachée à la
manche de fon habit, jufqu’à ce qu’il eût fatisfait à
une eüpece de pénitence publique affez finguliere ;
c’étoit de promener un fagot fur fon épaule , dans
quelques-unes des grandes fblennités de l’Eglife. Celui
qui avoit pris le fagot fur fa manche, & qui le
quittoit, étoit regardé comme un relaps & comme
un apoftat.
F a g o t , terme de Fortification. Voye£ F a s c i n e .
Ménagé dérive ce mot du latin facottus, qui eft
tiré du grec <pâx.lç ; Nicod le fait venir de fafciculus,
unfaifceau, & Ducange du latin fagatum ôc fagotum.
F a g o t ou Pas S.e-v o l an t , parmi les gens de
Guerrty font ceux qui ne font pas réellement foldats ,
qui ne reçoi vent point de pa ye, & ne font aucun fer-
vice , mais qui ne font engagés que pour paroître aux
revues, rendre les compagnies complétés ,& empêcher
qu’on n’en voye les vuides, & pour fruftrer le
roi de la paye d’autant de foldats. Voye^ Passe-v o ,-
LANT . Chambers.
F a g o t de fape, eft dans la Guerre des fiéges, un fa got
de deux piés & demi ou trois pies de hauteur , &
d’un pié & demi de diamètre, dont on fe fert au défaut
de facs-à-terre pour couvrir les jointures des
galions dans la fappe. Vçye^Sk.fVE. Voye£ auffi La
Planche X I I I . de Fortification.
F a g o t , (Marine.) barque.en fagot, chaloupe en
fagot; c’eft une barque que l ’on affemble fur le chantier
, enfuite on la démonte pour l ’embarquer & la
transporter dans les lieux,où l ’on en a befoin. On
embarque auffi des futailles en fagot. Viye{ Fa g o t ,
Tonnelier. ( Z ) ' , ; ' r : - • •• -,
F a g o t d e p lum e s y chez l e s P.lumaJJierSy ce font des
plumes d’autruches qui font encore en paquets, telles
qu’elles viennent des pays étrangers.
F a g o t , f u t a i l l e s en fa g o t y terme d e T o n n e li e r , qui
fignifie des fritailles dont toutes les pièces font tail