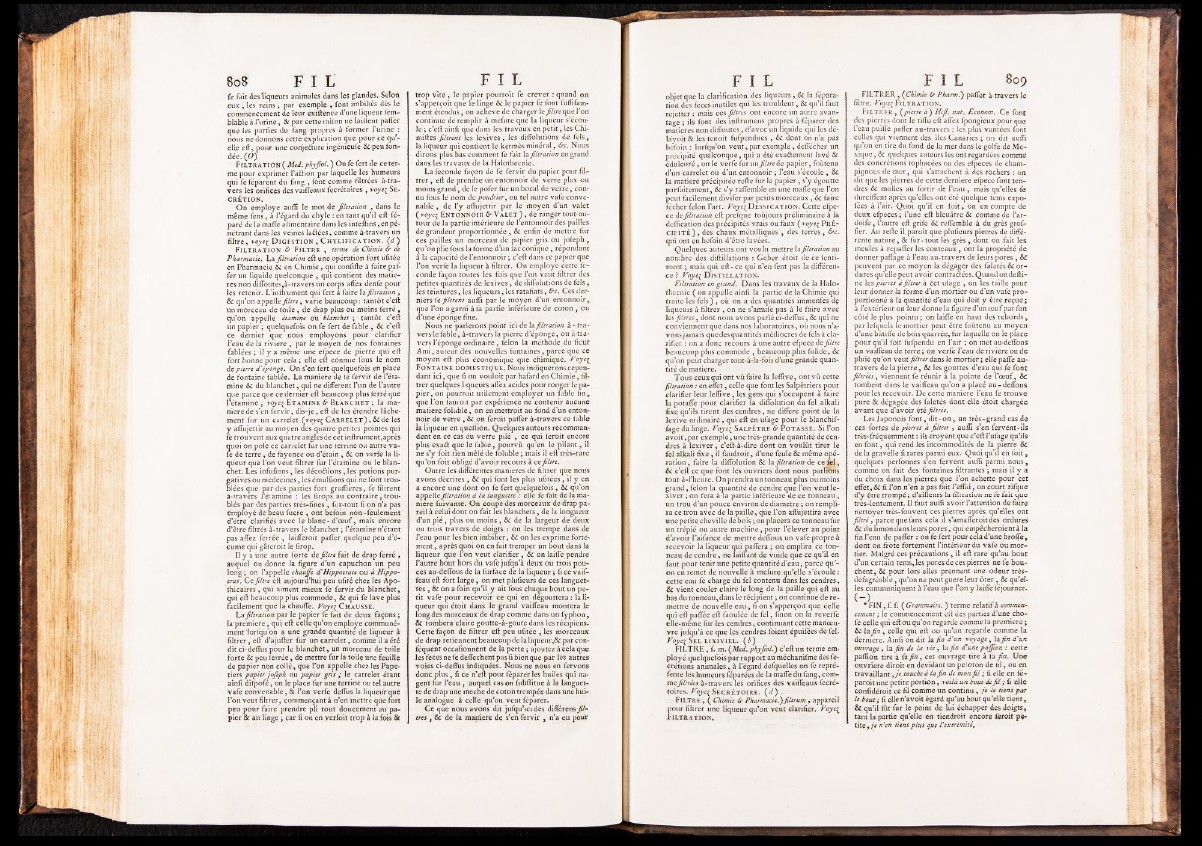
fe fait des liqueurs animales dans les glandes. Selon
eux , les reins , par exemple , font imbibés dès le
commencement de leur exigence d’une liqueur fem-
fclable à l’urine, & par cette railon ne laiflent paffer
que les parties du fang propres à former l’urine :
nous ne donnons cette explication que pour ce qu’elle
eft, pour une conjecture ingénieufe & peu fondée.
(O)
F i l t r a t i o n ( Med. phyjiol. ) On fe fert de ce terme
pour exprimer l’aâion par laquelle les humeurs
qui fe féparent du fang , font comme filtrées à-travers
les orifices des vaiffeaux fecrétoires , voye{ S ec
r é t i o n .
On employé aufli le mot de filtration , dans le
même fens, à l’égard du chyle : en tant qu’il eft fé-
paré de la maffe alimentaire dans les inteftins, en pénétrant
dans les veines laâées, comme à-travers un
filtre, voyei D i g e s t i o n , C h y l i f i c a t i o n . ( d )
F i l t r a t i o n & F i l t r e , terme de Chimie & de
Pharmacie. La filtration eft une opération fort ufitée
en Pharmacie & en Chimie, qui confifte à faire paffer
un liquide quelconque , qui contient des matières
non difloutes,à-travers un corps affez denfe pour
les retenir. L’inftrument qui fert à faire la filtration ,
& qu’on appelle filtr e, varie beaucoup : tantôt c’eft
un morceau de toile , de drap plus ou moins ferré t
qu’on appelle étamine ou blanchet ; tantôt c’eft
un papier ; quelquefois on fe fert de fable , & c’eft
ce dernier que noiis employons pour clarifier
l’eau de la riviere , par le moyen de nos fontaines
fablées ; il y a même une efpece de pierre qiii eft
fort bonne pour cela ; elle eft connue fous le nom
de pierre d'éponge. On s’en fert quelquefois en place
de fontaine fablée. La maniéré de le fervir de l’étamine
& du blanchet, qui ne different l’un de l’autre
que parce que ce dernier eft beaucoup plus ferré que
l’étamine , voye[ E t a m i n e & B l a n c h e t ; la maniéré
de s’en fervir, dis-je, eft de les étendre lâchement
fur un carrelet (yeyeç C a r r e l e t ) , & de les
y affujettir au moyen des quatre petites pointes qui
fe trouvent aux quatre angles de cet inftrument,après
quoi on pofe ce carrelet fur une terrine ou autre va-
le de terre, de fayence ou d’étain , & on verfe la liqueur
que l’on veut filtrer fur l’étamine ou le blanchet.
Les infufions, les décodions, les potions purgatives
ou médecines, les émulfions qui ne font troublées
que par des parties fort grofîieres, fe filtrent
à-travers l’étamine : les firops au contraire, troublés
par des parties très-fines , fur-tout fi on n’a pas
èmployé de beau fucre , ont befoin non-feulement
d’être clarifiés avec le blanc-d’oeuf, mais encore
d’être filtrés à-travers le blanchet ; l’étamine n’étant
pas affez ferrée , laifferoit paffer quelque peu d’écume
qui g’âteroit le firop.
Il y a une autre forte de filtre fait de drap ferré ,
auquel on donne la figure d’un capuchon un peu
long ; on l’appelle chauffe d'Hippocrate ou à Hippo-
cras. Ce filtre eft aujourd’hui peu ufité chez les Apothicaires
, qui aiment mieux fe fervir du blanchet,
qui eft beaucoup plus commode, & qui fe lave plus
facilement que la chauffe. Voye^ C h a u s s e .
La filtration par le papier fe fait de deux façons ;
la première, qui eft celle qu’on employé communément
lorfqu’on a une grande quantité de liqueur à
filtrer, eft d’ajufteï fur un carrelet, comme il a été
dit ci- deffus pour le blanchet, un morceau de toile
forte & peu ferrée, de mettre fur la toile Une feuille
de papier non collé, que l’on appelle chez les Papetiers
papier jofeph ou p'apier gris ; le carrelet étant
ainfi difpofé, on le place fur une terrine ou tel autre
vafe convenable, & l’on verfe deffus la liqueifr'que
l’on veut filtrer, commençant à n’en mettre qtfe fort
peu pour faire prendre pli tout doucement a1!! papier
& au linge ; car fi on en verfôit trop à la fois &
trop vîte , le papier pourroit fe crever : quand on
s’apperçoit que le linge & le papier fe font fufiifam-
ment étendus, on achevé de charger le filtre que l’on
continue de remplir à mefure que la liqueur s’écoule
; c’eft ainfi que dans les travaux en petit, les Chi-
miftes filtrent les lexives , les diffolutions de fels,
la liqueur qui contient le kermès minéral, &c. Nous
dirons plus bas comment fe fait la filtration en grand
dans les travaux de la Halothecnie.
La fécondé façon de fe fervir du papier pour filtrer
, eft de prendre un entonnoir de verre plus ou
moins grand, de le pofer fur un bocal de verre, connu
fous le nom de poudrier, ou tel autre vafe-conve-
nable, de l’y affujettir par le moyen d’un valet
( voye{ E n t o n n o i r 6* V a l e t ) , de ranger tout-autour
de la partie intérieure de l’entonnoir des pailles
de grandeur proportionnée , & enfin de mettre fur
ces pailles un morceau de papier gris ou jofeph ,
qu’on plie fous la forme d’un lac conique, répondant
à la capacité de l’entonnoir ; c’eft dans ce papier que
l’on verfe la liqueur à filtrer. On employé cette fécondé
façon toutes les fois que l’on veut filtrer des
petites quantités de lexives, de diffolutions de fels,
les teintures, les liqueurs, les ratafiats, &c. Ces derniers
fe filtrent auffi par le moyen d’un entonnoir,
que l’on a garni à fa partie inférieure de coton, ou
d une éponge fine.
Nous ne parlerons point ici de la filtration à - travers
le fable, à-travers la pierre d’éponge, ou à-travers
l’éponge ordinaire, félon la méthode du fieur
Ami, auteur des nouvelles fontaines, parce que ce
moyen eft plus économique que chimique. f^oyt[
F o n t a i n e d o m e s t i q u e . N o us indiquerons cependant
ici, que fi on vouloit par hafard en Chimie, filtrer
quelques liqueurs affez acides pour ronger le papier,
on pourroit utilement employer un fable fin,
que l ’on laïuoit par expérience ne contenir aucune
matière foluble, on en mettroit au fond d’un entonnoir
de verre , & on feroit paffer à-travers ce fable
la liqueur en queftion. Quelques auteurs recommandent
en ce cas du verre pilé , ce qui feroit encore
plus exaû que le fable, pourvû qu’en le pilant, il
ne s’y foit rien mêlé de foluble ; mais il eft très-rare
qu’on foit obligé d’avoir recours à ce filtre.
Outre les différentes maniérés de filtrer que nous
avons décrites , & qui font les plus ufitées, il y en
a encore une dont on fe fert quelquefois , & qu’on
appelle filtration à la languette : elle fe fait de la maniéré
fuivante. On coupe des morceaux de drap pareil
à celui dont on fait les blanchets, de la longueur
d’un pié, plus ou moins, & de la largeur de deux
ou trois travers de doigts : on les trempe dans de
l’eau pour les bien imbiber, & on les exprime fortement
, après quoi on en fait tremper un bout dans la
liqueur que l’on veut clarifier , & on laiffe pendre
l’autre bout hors du vafe jufqu’à deux ou trois pouces
au-dèffous de lafurfacé de la liqueur ; fi ce vaifi-
feau eft fort large, on met plufieurs de ces languettes
, & on a foin qu’il y ait fous chaque bout un petit
vafe pour recevoir ce qui en dégouttera : la liqueur
qui étoit dans le grand vaiffeau montera le
long des morceaux de drap comme dans un fyphon,
& tombera claire goutte-à-goute dans les récipiens.
Cette façon de filtrer eft peu ufitée , les morceaux
de drap retiennent beaucoup de la liqueur,& par con-
féquent occafionnént de la perte ; ajoutez à cela que
les feces ne fe déffechent pas fi bien que par les autres
voies ci-deffüs indiquées. Nous ne nous en fervons
donc plus, fi ce n’eft pour féparer les huiles qui nagent
mr l’eau, auquel cas on fUbftitue à la languette
de drap urte mecne de coton trempée dans une huile
analogue à celle qu’on veut féparer.
Ce que nous avcfns dit jufqu’ici des différens filtres
, ôc de la maniéré de S’en fervir , n’a eu pour
objet que la clarification des liqueurs, & la fépara-
tion des feces inutiles qui les troublent, & qu’il faut
rejetter : mais ces filtres ont encore un autre avantage
; ils font des inftrumens propres à féparer des
matières non difloutes, d’avec un liquide qui les dé-
layoit & les tenoit fufpendues , & dont on n’a pas
befoin : lorfqu’on veut, par exemple, deffécher un
précipité quelconque, qui a été exaftement lavé &
édulcoré , on le verfe fur un filtre de papier, foûtenu
d’un carrelet ou d’un entonnoir ; l’eau s’écoule , &
la matière précipitée refte fur le papier , s’y égoutte
parfaitement, & s’y raffemble en une maffe que l’on
peut facilement divifer par petits morceaux, & faire
lécher félon l’art. Voye^D e s s i c a t i o n . Cette efpece
de filtration eft prefque toujours préliminaire à la
déification des précipités vrais ou faux (voye^ P r é c
i p i t é ) , des chaux métalliques , des terres, &c.
qui ont eu befoin d’être lavées.
Quelques auteurs ont voulu mettre la filtration au
nombre des diftillations : Geber étoit de ce fenti-
ment.; mais qui eft-ce qui n’en fent pas la différenc
e ? Voye{ D i s t i l l a t i o n .
Filtration en grand. Dans les travaux de la Halothecnie
( on appelle ainfi la partie de la Chimie qui
traite les fels ) , oii on a des quantités immenfes dç
liqueurs à filtrer , on ne s’amufe pas à le faire avec
les filtres, dont nous avons parlé ci-deffus, & qui ne
conviennent que dans nos laboratoires, où nous n’avons
jamais que des quantités médiocres de fels à clarifier
: on a donc recours à une autre efpece de filtre
beaucoup plus commode , beaucoup plus folide, &
qu’on petit charger tout-à-la-fois d’une grande quantité
de matière.
Tous ceux qui ont vû faire la lelfive, ont vû cette
filtration : en effet, celle que font les Salpêtriers pour
clarifier leur lelfive, les gens qui s’occupent à faire
la potaffe pour clarifier la difîblution du fel alkali
fixe qu’ils tirent des cendres, ne différé point de la
lexive ordinaire, qui eft en ufage pour le blanchif-
fage du linge. Voye[ SALPÊTRE & POTASSE. Si l’on
avoit, par exemple, une très-grande quantité de cendres
à lexiver, c’eft-à-dire dont on voulût tirer le
fel alkali fixe, il faudroit, d’une feule & même opération
, faire la diffolution & la filtration de c e ie l,
& c’eft ce que font les ouvriers dont nous parfums
tout-à-l’heure. On prendra un tonneau plus ou moins
grand, félon la quantité de cendre que l’on veut lexiver
; on fera à la partie inférieure de ce tonneau,
un trou d’un pouce environ de diamètre ; on remplira
ce trou avec de la paille, que l’on affujettira avec
une petite cheville de bois ; on placera ce tonneau fur
un trépié ou autre machine, pour l’élever au point
d’avoir l’aifance de mettre deffous un vafe propre à
recevoir la liqueur qui paffera ; on emplira ce tonneau
de céndre, ne laiffant de vuide que ce qu’il en
faut pour tenir une petite quantité d’eau, parce qu’on
en remet de nouvelle à mefure qu’elle s’écoule :
cette eau fe charge du fel contenu dans les cendres,
& vient couler claire le long de la paille qui eft au
bas du tonneau, dans le récipient ; on continue de remettre
de nouvelle eau, fi on s’apperçoit que celle
qui eft paffée eft faoulée de fel, finon on la reverfe
elle-même fur les cendres, continuant cette manoeuvre
jufqu’à ce que les cendres foient épuifées de fel.
V oye{ S e l l i x i v i e l . ( é )
FILTRE , f. m. (Med, phyjiol.') c’eft un terme employé
quelquefois par rapport au méchanifme des fe-
çrétions animales, à l’égard defquelles on fe repréfente
les humeurs féparées de la maffe du fang, comme
filtrées à-travers les orifices des vaiffeaux fecrétoires.
Foye^SECRÉTOIRE, ( d ) ,
F i l t r e -,:( Chimie & Pharmacie.)filtrum, appareil
pour filtrer une liqueur qu’on veut clarifier. Voye^
.Fi l t r a t i o n , .............
FILTRER, ( Chimie & Pharm.) p a ffe r à-t r a v e r s le
filt r e . Foye^ F i l t r a t i o n .
F i l t r e r , ( pierre à ) Hijl. nat. Econom. Ce font
des pierres dont le tiffu eft affez fpongieux pour que
l’eau puiffe paffer au-travers : les plus vantées font
celles qui viennent des îles Canaries ; on dit aufli
qu’on en tire du fond de la mer dans le golfe de Mexique
, & quelques auteurs les ont regardées comme
des concrétions tophacées ou des efpeces de champignons
de mer, qui s’attachent à des rochers : on
dit qpe les pierres de cette derniere efpece font tendres
& molles au fortir de l’eau, mais qu’elles fe
durciffent après qu’elles ont été quelque tems expo-
fées à l’air. Quoi qu’il en foit, on en compte de
deux efpeces ; l’une eft bleuâtre & comme de l’ar-
doife, l’autre eft grife & reffemble à du grès grof-
fier. Au refte il paroît que plufieurs pierres de différente
nature, & fur-tout les grès, dont on fait les
meules à repaffer les couteaux, ont la propriété de
donner paffage à l’eau au-travers de leurs pores , &
peuvent par ce moyen la dégager des faletés & ordures
qu’elle peut avoir contractées. Quand on defti-
ne les pierres à filtrer à Cet ufage , on les taille pour
leur donner la forme d’un mortier ou d’un vafe proportionné
à la quantité d’eau qui doit y être reçue;
à l’extérieur on leur donne la figure d’un oeuf par fon
côté le plus pointu ; on laiffe en haut des rebords ,
par lefqiiels le mortier peut être foûtenu au moyen
d’une bâtiffe de bois quarrée, fur laquelle on le place
pour qu’il foit lufpendu en l’air ; on met au-deffous
un vaiffeau de terre ; on verfe l’eau de riviere ou de
pluie qu’on veut filtrer dans le mortier ; elle paffe au-
travers de la pierre, & les gouttes d’eau qui fe font
filtrées, viennent fe réunir à la pointe de l’oeuf, &
tombent dans le vaiffeau qu’on a placé au - deffous
pour les recevoir. De cette maniéré l’eau fe trouve
pure & dégagée des faletés dont elle étoit chargée
avant que d’avoir été filtrée.
Les Japonois font, dit-on, un très-grand cas de
ces fortes de pierres à filtrer , auffi s’en fervent-ils
très-fréquemment : ils croyent que c’eft l’ufage qu’ils
en font, qui rend les incommodités de la pierre &
de la gravelle fi rares parmi eux. Quoi qu’il en foit,
quelques perfonnes s’en fervent aufli parmi nous ,
comme on fait des fontaines filtrantes ; mais il y a
du choix dans les pierres que l’on achette pour cet
effet, & fi l’on n’en a pas fait l’effai, on court rifque
d’y être trompé ; d’ailleurs la filtration ne fe fait que
très-lentement. Il faut aufli avoir l’attention de faire
nettoyer très-fouvent ces pierres après qu’elles ont
filtr é, parce que fans cela il s’amafferoitdes ordures
& du limon dans leurs pores, qui empêcheroient à la
fin l’eau de paffer : on fe fert pour cela d’une broffe ,
dont on frote fortement l’intérieur du vafe ou mortier.
Malgré ces précautions , il eft rare qu’au bout
d’un certain tems, les pores de ces pierres ne fe bouchent,
& pour lors elles prennent une odeur très-
defagréable, qu’on ne peut guere leur ôter, & qu’elles
communiquent à l’eau que l’on y laiffe féjourner.
* FIN ,f. f. ( Grammaire, ) terme relatif à commencement
; le commencement eft des parties d’une cho-
fe celle qui eft ou qu’on regarde comme la première ;
& la f in , celle qui eft ou qu’on regarde comme la
derniere. Ainfi on dit la fin d'un voyage, la f in d'un
ouvrage , la fin de la vie , la fin eCune pajfion : cette
paflion tire à fa f in , cet ouvrage tire à fa fin. Une
ouvrière diroit en dévidant un peloton de fil, ou en
travaillant, j e touche à la Jin de mon f i l ; fi elle en fié-
paroit une petite portion, voilà un boue de f il ; û elfe
confidéroit ce fil comme un continu , j e le tiens par
le bout ; fi elle n’avoit égard qu’au bout qu’elle tient ,
& qu’il fût fur le point de lui échapper des doigts,
tant la partie qu’elle en tiendroit encore feroit petite
, je n'en tiens plus que l'extrémité,