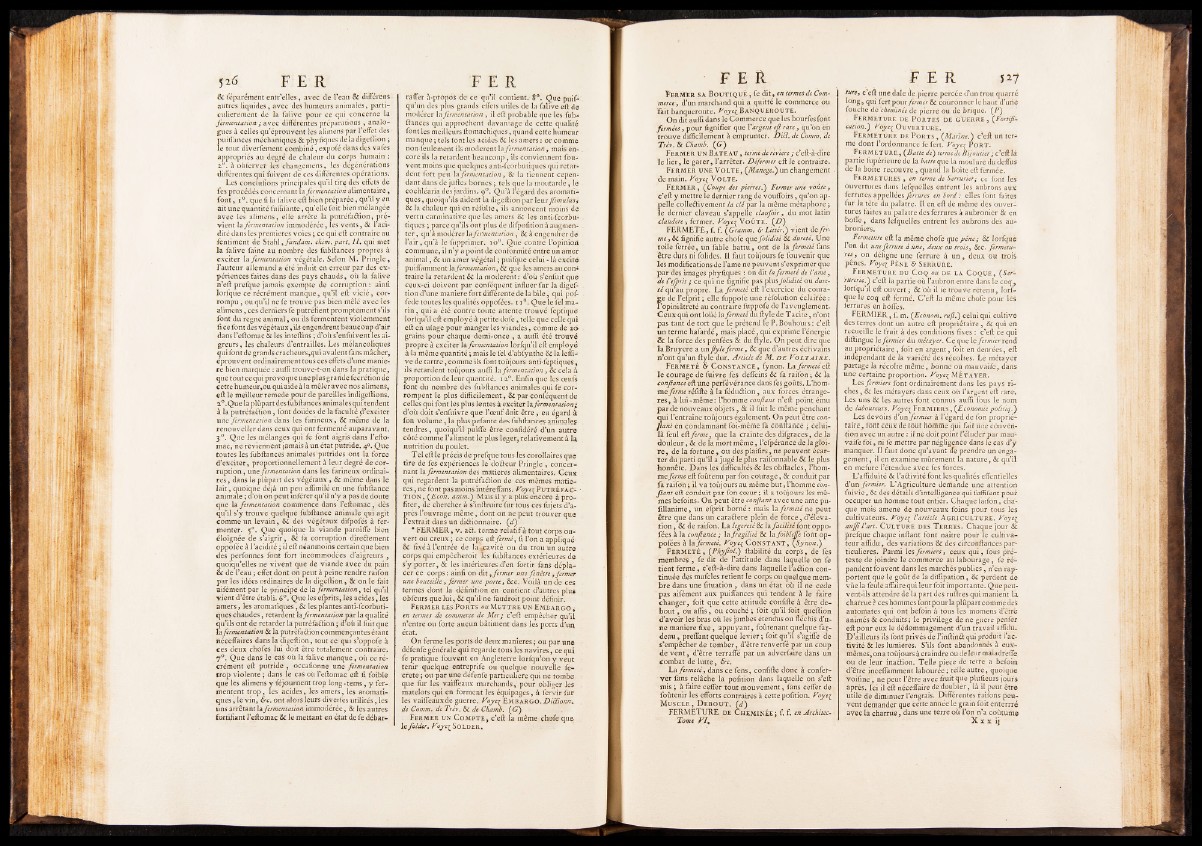
& féparément entr’elles, avec de l’eau 6c différens
autres liquides, avec des humeurs animales, particulièrement
de la falive pour ce qui concerne la
fermentation ; avec différentes préparations , analogues
à celles qu’éprouvent les alimens par l’eftet des
puiffances méchaniques & phy iiques de la digellion ;
le tout diverfement combiné, expofé dans des va les
appropriés au degré de chaleur du corps humain :
a°. à obferver les changemens, les dégénérations
différentes qui fuivent de ces différentes opérations.
Les conclufions principales qu’il tirq des effets de
fes procédés concernant la fermentation alimentaire,
fon t, i° . que fi la falive eft bien préparée, qu’il y en
ait une quantité fuffifante, qu’elle foit bien mélangée
avec les alimens, elle arrête la putréfaction, prévient
la fermentation immodérée, les vents, & l’acidité
dans les premières voies ; ce qui eft contraire au
fentiment de Stahl ,fundam. chim. part. II. qui met
la falive faine au nombre des fubftances propres à
exciter la fermentation végétale. Selon M. Pringle,
l’auteur allemand a été induit en erreur par des expériences
faites dans des pays chauds, oit la falive
n’eft prefque jamais exempte de corruption : ainfi
lorfque ce récrément manque, qu’il eft v ic ié, corrompu
, ou qu’il ne fe trouve pas bien mêlé avec les
alimens, ces derniers fe putréfient promptement s’ils
font du régné animal, ou ils fermentent violemment
fi ce font des végétaux, ils engendrent beaucoup d’air
dans l’eftomac & les inteftins ; d’où s’enfuivent les aigreurs,
les chaleurs d’entrailles. Les mélancoliques
qui font de grands cracheurs,qui avalent fans mâcher,
éprouvent ordinairement tous ces effets d’une maniéré
bien marquée : aufli trouve-t-on dans la pratique,
que tout ce qui provoque une plus grande fecrétion de
cette humeur,ou qui aide à la mêler avec nos alimens, eft le meilleur remede pour de pareilles indigeftions.
2°.Que la plupart des fubftances animales qui tendent
à la putréfaction, font doiiées de la faculté jl’exciter
une fermentation dans les farineux, 6c même de la
renouveller dans ceux qui ont fermenté auparavant.
3°. Que les mélanges qui fe font aigris dans l’efto-
mac, ne reviennent jamais à un état putride. 40. Que
toutes les fubftances animales'putrides ont la force
d’exciter, proportionnellement à leur degré de corruption
, une fermentation dans les farineux ordinaires
, dans la plupart des végétaux , 6c même dans le
la it , quoique déjà un peu aflimilé en une fubftance
animale ; d’oii on peut inférer qu’il n’y a pas de doute
que la fermentation commence dans l’eftomac, dès
qu’il s’y trouve quelque fubftance animale qui agit
comme un levain, 6c des végétaux dilpofés à fermenter.
50. Que quoique la viande paroiffe bien
éloignée de s’aigrir, & fa corruption directement
oppofée à l ’acidité ; il eft néanmoins certain que bien
des perfonnes font fort incommodées d'aigreurs ,
quoiqu’elles ne vivent que de viande avec du pain
& de l’eau ; effet dont on peut à peine rendre raifon
par les idées ordinaires de la digeftion, & on le fait
aifément par le principe de la fermentation, tel qu’il
vient d’être établi. 6°. Que les efprits, les acides, les
amers, les aromatiques, & les plantes anti-fcorbuti-
ques chaudes, retardent la fermentation par la qualité
qu’ils ont de retarder la putréfaction ; d’où il fuit que
la fermentation & la putréfaction commençantes étant
néceflaires dans la digeftion, tout ce qui s’oppofe à
ces deux chofes lui doit être totalement contraire.
7 0. Que dans le cas oh la falive manque, oit ce récrément
eft putride , occafionne une fermentation
trop violente ; dans le cas oit l’eftomac eft fi foible
que les alimens y féjournent trop long -tems, y fermentent
trop, les acides, les amers, les aromatiques
, le vin, &c. ont alors leurs diverfes utilités, les
uns arrêtant la fermentation immodérée, & les autres
fortifiant l’eftomac 6c le mettant en état de fe débarrafler
à-propôs de ce qu’il contient. 8°. Que puif*
qu’un des plus grands effets utiles de la falive eft de
modérer la fermentation, il eft probable que les fub*
ftances qui approchent davantage de cette qualité
font les meilleurs ftomachiques, quand cette humeur
manque ; tels- (ont les acides 6c les amers : or comme
non-Ieulement ils modèrent la fermentation , mais en- .
core ils la retardent beaucoup, ils Conviennent fou-
vent moins que quelques anti-fcorbutiques qui retar-.
dent fort peu la fermentation, & la tiennent cepen-* .
dant dans de juftes bornes ; tels que la moutarde, le
cochléaria des jardins. 90. Qu’à l’égard des aromatiques
, quoiqu’ils aident la digeftion par leur fiimuhlSf
& la chaléur qui en rél'ulte, ils annoncent moins de
vertu carminative que les amers 6c les anti-fcorbutiques
; parce qu’ils ont plus de difpofition à augmen-
te r , qu’à modérer la fefmentaiion, & à engendrer de
l’air, qu’à le fupprimer. io ° . Que contre l’opinion
commune, il n’y a point de conformité entre un amer
animal, 6c un amer végétal ; puifque celui - là excité
puiffamment la fermentation, 6c que les amers au contraire
la retardent 6c la modèrent : d’où s’enfuit que
ceux-ci doivent par conféquent influer fur la digeftion
d’une maniéré fort differente de la b ile, qui po(-
fede toutes les qualités oppofées. 1 1°. Que le fel marin
, qui a été contre toute attente trouvé feptiqué
lorfqu’il eft employé à petite dofe, telle que celle qui
eft en ufage pour manger les viandes, comme de iô
grains pour chaque demi-once , a auflï été trouvé
propre à exciter la fermentation lorfqu’il eft employé
à la même quantité ; mais le fel d’abfynthe 6c la lefli-
ve de tartre, comme ils font toujours anti-feptiqties ;
ils retardent toujours aufli la fermentation, 6c cela à
proportion de leur quantité. 1a0. Enfin que les oeufs
font du nombre des fubftances animales qui fe corrompent
le plus difficilement, & par conféquent de
celles qui font les plus lentes à exciter la fermentation*
d’où doit s’enfuivre que l’oeuf doit être, eu égard à
fon volume, la plus pefante des fubftances animales
tendres, quoiqu’il puiffe être confidéré d’un autre
côté comme l’aliment le plus leger, relativement à la
nutrition du poulet.
Tel eft le précis de prefque tous les corollaires que
tire de fes expériences le doCteur Pringle , concernant
la fermentation des matières alimentaires. Ceux
qui regardent la putréfaûion de ces mêmes matières
, ne font pas moinsintéreffans. Voye^ PuTRÉFACi- ■
TION, (Econ. anim.) Mais il y. a plus encore à profiter,
de chercher à s’inftruire fur tous ces fiijet-s d’après
l’ouvrage même, dont on ne peut trouver que
l’extrait dans un dictionnaire, (d)
* FERMER, v . aCt. terme relatif à tout corps ouvert
ou creux ; ce corps eft fermé, fi l’on a appliqué'
& fixé à l’entrée de la-pavité ou du trou un autre
corps qui empêcheroit Tes fubftances extérieures de
s’y porter, & les intérieures d’en fortir fans déplacer
ce corps: ainfi on dit, fermer une fenêtre , fermer
une bouteille , fermer une porte, 6cc. Voilà un de ces
termes dont la définition en contient d-autres plus
obfcurs que lui, 6c qu’il ne faudroit point définir.
Fe rm e r le s P o r t s ou M e t t r e u n Em b a r g o ;
en termes de commerce de Mer ; c’eft empêcher qu’il
n’entre ou forte aucun bâtiment dans les ports d’un
état.
On ferme les ports de deux maniérés ; ou par une
défenfe générale qui regarde tous les navires, ce qui
fe pratique fouvent en Angleterre lorfqu’on y veut
tenir quelque entreprife ou quelque nouvelle fe-
crete ; ou par une defenfe particulière qui ne tombe
que fur les vaiffeaux marchands, pour obliger les
matelots qui en forment les équipages, à fervir fur
les vaiffeaux de guerre. Voye% Em b a r g o . DiçUonn*
de Comm. de Trév. 6c de Chamb. (G)
; Fe r m e r u n C o m p t e , c ’eft la même chofe que-
le folder.V?ye^ S o l d e r ,
Î'ERMER SA Bo u t iq u e , f e dit, en termes de Commerce,
d’un marchand qui a quitté le commerce ou
fait banqueroute. Foye^B a n q u e r o u t e .
On dit aufli dans le Commerce que les bouffes font
fermées, pour lignifier que Vargent ejl rare, qu’on èh
trouve difficilement à emprunter. Dicl. de Comm. de
Trév. & Chamb. (G)
F e r m e r u n Ba t e a u , terme de rivière ; c’eft-à-dire
le lier, le garer, l’arrêter. Défermêr eft le contraire.
F e r m e r u n e V o l t e , (Manege.,) un changément
de main. Voye[ V o l t e .
F e rm e r , (Coupe des pierres.') Fermer une voûte,
c’eft y mettre le dernier rang dé vouffoirs, qu’on appelle
collectivement la clé par la même métaphore ;
le dernier claveau s’appelle claufoir, ,du mot latin
clandere; fermer. Voye^ V oÛ TE . (JD)
FERMETÉ, f. f. ( Gramm. & Littér.) Vient de ferme,
6c lignifie autre chofe que folidité SC dureté. Une
toile ferrée, un fable battu, ont de la fermeté fans
être durs ni folidès. Il faut toujours fe fouvenir què
les modifications de l’ame ne peuvent s'exprimer que
par des images phyfiquës : ôn dit la fermeté de l'ame,
de Vefprit ; ce qui ne fignifie pas plusJolidité ou dureté
qu’au propre. La fermeté eft l’exercice du courage
de l’efprit ; elle fuppofe une réfolution éclairée :
l ’opiniâtreté au contraire fuppofe de l’aveuglement.
Ceux qui ont loiié la fermeté du ftyle de T acite, n’ont
pas tant de tort que le prétend le P. Bôuhours : c’éft
un terme hafardé, mais placé, qui exprime l’énergie
& la force des penfées & du ftyle. On petit dire que
la Bruycre a un Jlyle ferme, 6c que d’autres écrivains
n’ont qu’un ftyle dur. Article de M . d e V o l t a i r e .
F e r m e t é & C o n s t a n c e , fynon. La fermeté eft
le courage de fuivre fes deffeins 6c fa raifon ; & la
confiance eft une perfé vérance dans fes goûts. L ’homme
ferme réfifte à la féduCtion, aux forces étrangères
, à lui-même: l’homme confiant n’eft point ému
par de nouveaux objets, & il fuit le même penchant
qui l’entraîne toûjoürs également. On peut être confiant
en condamnant foi-même fa conltàüce ; celui-
là feul eft ferme, que la crainte des difgraces, de la
douleur, & de la mort même, l’efpérânce de la gloir
e , de la fortune, ou des plaififs, ne peuvent écarter
du parti qu’il a jugé le plus raisonnable 6 c le plus
honnête. Dans les difficultés 6 c les obftacles, l’homme
ferme eft foûtenu par fon courage, & conduit par
fa raifon ; il va toujours au même but, l’hommé confiant
eft conduit par fon coeur ; il a toûjoürs lés mêmes
befoins. On peut être confiant avec une anie pu-
fillanime, un efprit borné : mais la fermeté ne peut
être que dans un caraCtere plein de forcé, d’élévation
, & de raifon. La legereté 6 c la facilité font oppo-
fées à la confiante ; la fragilité 6 c la foibleffe font oppofées
à la fermeté. Voye[ CONSTANT, (Syhon.)
F e r m e t é , (Phyfiol.) fiabilité du corps, de fes
membres , fe dit de l’attitude dans laquelle on fe
tient ferme, c’eft-à-dire dans laquelle l’aCtion continuée
des mufcles retient le corps ou quelque membre
dans une fituation , dans un état où il ne cede
pas aifément aux puiffances qui tendent à le faire
changer, foit que cette attitude çonfiftéà être debout
, ou aflis, ou couché ; foit qu’il foit queftion
d’avoir les bras où les jambes étendus ou fléchis d’une
maniéré fixe, appuyant, foûtenant quelque fardeau
, preffant quelque levier ; foit qu’il s’agiffe de
s’empêcher de tomber, d’être renverfé par un coup
de v en t, d’être terraffé par un adverfaire dans un
combat de lutte, &c.
La fermeté, dans ce fens, confifte donc à confer-
yer fans relâche la pofition dans laquelle on s’eft
mis ; à faire ceffer tout mouvement, fans ceffer de
foûtenir les efforts contraires à cette pofition. Voye%
M u s c l e , D e b o u t . ( d )
FERMETURE d e C h e m in é e ; f. f. enArchitec-
Tomc VI\
turc, c e ft une d a le de p ie r r e p e r c é e d’ un t ro u q u a r r é
lo n g j, qui' f e r t p o u r fermer 6c c o u r o n n e r le h au t d ’ urié
lo u c h e d e ‘cheminée de p ie r re ou de b r iq u e . ( P )
Fe rm e t u r e d e P o r t e s d e g u e r r e , ( F o r tifia
c a t io n . ) Voye-^ OUVERTURE.
F e r m e t u r e de P o r t s , (Marine.) 'c’eft uiï ter-
mé dont l’ordonnancé fe ’fert. Voye[ P oR T .
F e r m e t u r e , (fiat te de) terme “de Bijoutier ; c ’e f t Iâ
p a r t ie fu p é r ieu r e d e la batte q u e la m o u lu ré d'u d e ffu s
d e la b o ît e r e c o u v r e , q u a n d la b o îte eft fe rm é e .
F e r m e t u r e s , en ternie de Serrurier; ce font lés
ouvertures dans lefquëlles entrent les aubrons aux
ferrures âppellées ferrures en bord : elles font faites
fur la tête du palatre. Il en eft de même dès ouvertures
faites au palatre dés férrures à aubroniér & en
boffe, dans lefquelles entrent les aübrons des àu-
broniers.
Fermeture eft la mêrné chofe que pêne; & lorfquê
l’on dit une ferrure à itne, deux ou trois, & c . fermetures
, on défigne une ferrure à u n , deux o u trois
pênes. V o y e [ Pêne & SeR'r u r e .
F e r m e t u r e d u C o q ou d e l à C o q u e , ( Serrurerie.)
c’eft la partie où l’aubron entre dans le coq,
lorfqu’il eft ouvert ; 6C où il le trouve retenu, lorfque
le coq eft fermé. C ’éft la même chofe pour lèè
lerrures en boffes.
FERMIER, f. m. (Ecônom. ruft.) céluiqui cultive
des terres dont un autre eft propriétaire, 6c qui en
recueille le fruit à des conditions fixes : c’eft ce qui
diftingue le fermier du métayer. Ce que le fermier rend
au propriétaire, fôit en argent, foit en denrées, eft
indépendant dé là variété des récoltes. Le métayer
partage la récolte même, bonne oü mauvaife, dans
uné certaine proportion. Voye^ MÉTAYER.
Lés fe rm ie r s f o n t ordinairement dans les pays riches
, 6c les métayers dans ceux où l’argent eft rare*
Les uns 6c les autres font connus aufli fous le nom
de la b o u r e u r s . V o y e [ F e r m i e r s , (E c o n o m i e p o l i t J . )
Les devoirs d’un fermier à l’égard de fon propriétaire
, (ont céux dé tôut homme qui fait une con ven-
tion avec un autre : il ne doit point l’éluder par mauvaife
fo i, ni fe mettre par négiigenée dans le cas d’ÿ
manquer. Il faut donc qu’avânt de prendre un engagement
, il en examine mûrement la nature, & qu’il
en mefure l’étendue avec fes forces.
L’affiduité & l’a&ivité font les qualités effentielles
d’un fermier. L’Agriculture demande une attention
fuivie, & des détails d’intelligence qui fuffifent pouf
occuper un homme tout entier. Chaque laifon, chà-
que mois amene de nouveaux foins pour tous les
cultivateurs. Voye^ Varticle A G R ICU L TU R E . Voye^
duffi l'art. C ü L T U R E DES T e r r 'ËS. Chaque jour &
prefque chaque inftant font naître pour le cultivateur
aflidu, des variations 6c des cifconftances particulières.
Parmi les fermiers, ceux q ui, fous prétexte
de joindre le commerce au labourage, fé ré-
pahdent fouv'ent dans les marchés publics, n’en rapportent
que le goût de la diflipation, 6c perdent de
vûe la fêule affaire qui leur foit importante. Que peu-
vént-ils attendre dé là part des ruftres qui manient là
charrue} ces hômmes font pour la plûpart comme defc
automates qui ont befoin à tous les momens d’êrrê
animés & conduits; le privilège de ne guere pèrifer
eft pour eux le dédommagement d’ün travail aflïdü.
D ’ailleurs ils font privés de l’inftinâ qui produit l’activité
& les lumières. S’ils font abandonnés à eux-
mêmes, on a toûjoürs à craindre Où de léùr maladreffe
ou de leur iiiadion. Telle piece de terre a befoin
d’être inceffamment labourée ; telle autre, quoique
voifine, ne peut l’être avec fruit que plüfieiirs jours
après. Ici il eft néceffaire de doubler, là il peut être
utile de diminuer l’engrais. Différentes raifons peuvent
demander que cette aùnée le grain fôit enterrré
avec la charrue, dans une terre où l’on n’a coûtume
X x x ij