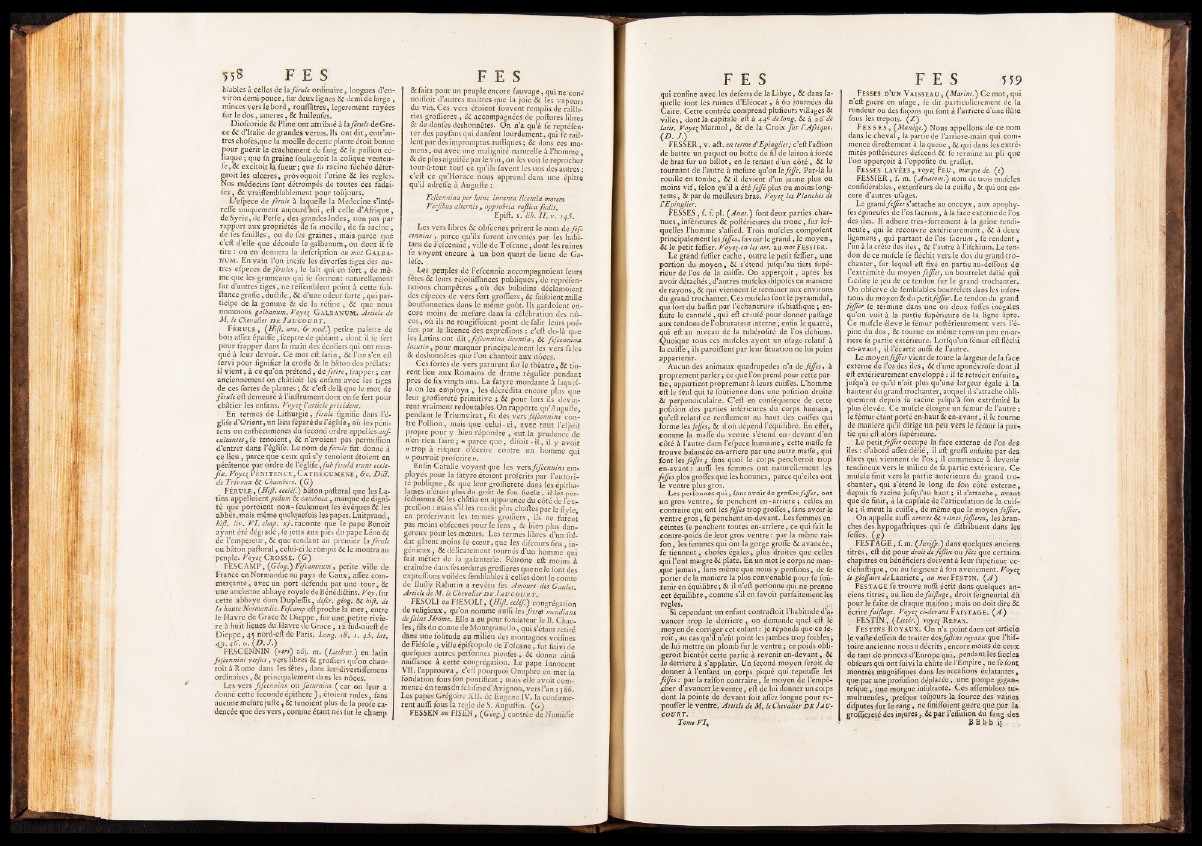
blables à celles de la férule ordinaire, longues d’environ
demi-pouce, fur deux lignes & demi de large ,
minces vers le bord, rouffâtres, legerement rayées
fur le dos, amcres, & huileufes.
Diofcoride & Pline ont attribué à la férule de Grèc
e & d’Italie de grandes vertus. Ils ont d it, entr’au-
tres chofes,que la moelle de cette plante étoit bonne
pour guérir le crachement de fang & la paillon cé-
liaque ; que fa graine foulageoit la colique venteu-
f e ,& excitoitla fueur; que fa racine fechée déter-
geoitles ulcérés, provoquoit l’urine & les réglés.
Nos médecins font détrompés de toutes ees fadai-
fe s , ßc vraiffemblablement pour toujours.
L ’efpece de férule à laquelle la Medecine s’inté-
reffe uniquement aujourd’hui, eft celle d’Afrique,
de Syrie, de Perfe, des grandes Indes, non pas par
rapport aux propriétés de fa moelle, de fa racine,
de fes feuilles, ou de fes graines, mais parce que
c’eft d’elle que découle le galbanum, ou dont i l fe
tire : on en donnera la defcription au mot G a l b a n
u m . En vain l’on incife les diverfes tiges des autres
efpeces de férules, le lait qui en fo r t , de même
que les grumeaux qui fe forment naturellement
fur d’autres tiges, ne reflfemblent point à cette fub-
ftance grade, duûile, & d’une odeur forte, qui participe
de la gomme & de la réfine , & que nous
nommons galbanum. Voye[ G a L b a n u m . Article de
M. le Chevalier Du J AV cou RT.
F é r u l e , (Hiß. anc. & mod.') petite palette de
bois affez épaiffe, fceptre de pédant, dont il fe fert
pour frapper dans la main des écoliers qui ont manqué
à leur devoir. Ce mot eft latin, & l’on s’en eft
fervi pour lignifier la crolfe & le bâton des prélats :
il vient, à ce qu’on prétend, de ferire, frapper ; car
anciennement on châtioit les enfans avec les tiges
de ces fortes de plantes ; & c’eft delà que le mot de
férule eft demeuré à l’inftrument dont on fe fert pour
châtier les enfans. Voye%_ Varticle précédent.
Eh termes de Lithurgie, férule lignifie dans l’é-
glife d’Orient, un lieu féparéde l’églile, oii les péni-
tens ou cathécumenes du fécond ordre appellés auf
cultantes, fe tenoient, & n’avoient pas permilfion
d’entrer dans l’églife. Le nom f e férule fiat donné à
c e lieu , parce que ceux qui s’y tenoient étaient en
pénitence par ordre de l’eglife ,fub ferula erant eccle- j
fia . Voye{ P é n i t e n c e , C a t h é c u m e n e , &c. Dicl.
de Trévoux & Chambers. (G)
F é r u l e , (Hiß. eccléf.) bâton paftoral que les Latins
appelloient pedum & caniboca, marque de dignité
que portaient noH - feulement les évêques & les
abbés, mais même quelquefois les papes. Luitprand,
hiß. liv. VI. chap. a?/, raconte que le pape Benoît
ayant été dégradé, fe jetta aux piés du pape Léon &
de l’empereur, & que rendant au premier la férule
ou bâton paftoral, celui-ci le rompit & le montra au
peuple. Voye^ C r o s s e . (G)
FESCAMP, (Géog.) Fifcamnum , petite ville de
France en Normandie au pays de Caux, affez commerçante,
avec un port défendu par une tour, &
une ancienne abbaye royale de Bénédiélins. Voy.iLucette
abbaye dom Dupleffis, defcr. géog. & hifi. de
la haute Normandie. Fefcamp eft proche la mer, entre
le Havre de Grâce & Dieppe, fur unevpetite rivière
à huit lieues du Havre de G râce, i ^ fud-oiieft de
Dieppe, 45 nord-eftde Paris. Long. 18. /. 46. lut,
| Ü f 4 G . o . (D. J.)
FESCENNIN (vers') adj. m. (Littéral.) en latin
fefcennini verfus , vers libres & grofliers qu’on chantait
à Rome dans les fêtes, dans les»divertiffemens
ordinaires, & principalement dans les noces.
Les vers fefcennins ou faturnins ( car on leur a
donné cette fécondé épithete ) , étoient rudes, fans
aucune mefure jufte, & tenoient plus de la profe cadencée
que des vers, comme étant nés fur le champ
& faits pour un peuple encore fauvage, qui ne'con-
noiffoit d’autres maîtres que la joie & les vapeurs
du vin. Ces vers étoient fouvent remplis de railleries
groflieres, & accompagnées de poftures libres
& de danfes deshonnêtes. On n’a qu’à fé repréfen-
ter des payfans qui danfent lourdement, qui fe raillent
par des impromptus ruftiques ; & dans ces mo-
mens, ou avéc une malignité naturelle à l’homme,
& de plus aiguifée parle v in , on les voit fe reprocher
tour-à-tour tout ce qu’ils favent les uns des autres :
c ’eft ce qu’Horace nous apprend dans une épître
qu’il adrefle. à Augufte :
Fefcennina per hune inventa licentia morem
Verßbus alternis , opprobria rußieafudit,
Epift. i . lib. I I . v. 14.5.
Les vers libres & obfcenes prirent le nom de fefcennins
, parce qu’ils furent inventés par les habi-
tans de Fefcennie, v ille de T ofcane, dont les ruines
fe voyent encore à un bon quart de lieue de Ga-
lèfe.
a Les peuples de Fefcennie accompagnoient leurs
fêtes & leurs réjoiiiffances publiques, de repréfen-
tations champêtres , où des baladins déclamoient
des efpeces de vers fort grofliers, & faifoient mille
bouffonneries dans le même goût. Ils gardoient encore
moins de mefure dans la célébration des nô-,
ces, où ils ne rougiffoient point de falir leurs poé-
fies par la licence des expreflions : c’eft de-là que
les Latins ont dit, fefcennina licentia, & fefcennina
locutio, pour marquer principalement les vers fa les
& deshonnêtes que l’on chantait aux noces.
Ces fortes de vers parurent fur le théâtre, & tinrent
lieu aux Romains de drame régulier pendant
près de.fix vingts ans. La fatyre mordante à laquelle
on les employa , les décrédita encore plus que
leur groffiereté jprimitive ; & pour lors ils devinrent
vraiment redoutables.On rapporte qu’Augufte,
pendant le Triumvirat, fit des vers fefcennins contre
Pollion, mais que c e lu i-c i, avec tout l’efprit
propre pour y bien répondre , eut la prudence de
n en rien faire ; « parce que, difoit - i l , il y avoit
» trop à rilquer d’écrire contre un homme qui
» pouvoit proferire».
Enfin Catulle voyant que les vers fefcennins employés
pour la fatyre étoient proferits par l’autorité
publique, & que leur groffiereté dans les épitha-
lamçs n’étoit plus du goût de fon fiecle, il les perfectionna
& les châtia en apparence du côté de l’ex-
preflion : mais s’il les rendit plus chaftes par le ftyle,
en proferivant les termes grofliers, ils ne furent
pas moins obfcenes pour le fens , & bien plus dangereux
pour les moeurs. Les termes libres d’un fol-
dat gâtent moins le coeur, que les difeours fins, ingénieux,
& délicatement tournés d’un homme qui
fait métier de la galanterie. Pétrone eft moins à
craindre dans fes ordures groflieres que ne le font des
expreflions voilées femblables à celles dont le comte
de Bufîy Rabutin a revêtu fes Amours des Gaules.
Article de M. le Chevalier D E J a u c o u r t .
FESOLI ou F IESOLI, (Hiß. ecléf.) congrégation
de religieux, qu’on nomme aufli les frerep mendians
defaint Jérôme. Elle a eu pour fondateur le B. Charles
, fils du comte de Montgranello, qui s’étant retiré
dans une folitude au milieu des montagnes voifines
de Fiéfole, ville épifcopale de Tofcane, fut fuivi de
quelques autres perfonnes pieufes , & donna ainfi
naiffance à cette congrégation. Le pape Innocent
VII. l’approuva, c’eft pourquoi Onuphre en met la
fondation fous fon pontificat ; mais elle avoit commencé
du tems du fçhifme d’Avignon, vers l’an 1386.
Les papes Grégoire XII. & Eugene IV. la confirmèrent
aufli fous la regle de S . Auguftin. (G)
FESSEN ou FISEN, (Géog.) contrée de Numidie
qui confine avec les deferts de la Libye, & dans laquelle
font les ruines d’Eléocat, à 60 journées du
Caire. Cette contrée comprend plufieurs villages &
villes, dont la capitale eft à 44d de long. & à zG de
latit. Poye{ Marmol, & de la Croix fur l ’Afrique.
( .D .J .) ......................,
FESSER, v . a61. en terme d'Epmglier; c eft 1 aéhon
de battre un paquet ou botte de fil de laiton à force
de bras fur un billot, en le tenant d’un côté , & le
tournant de l’autre à mefure qu’on le feffe. Par-là la
rouille en tombe, & il devient d’un jaune plus ou
moins v if , félon qu’il a été feffé plus ou moins long-
tems, & par de meilleurs bras. Voye%_ les Planches de
LEpinglief,
FESSES, f. frpl. (Anat.) font deux parties charnues
, inférieures & poftérieures du tronc, fur lef-
quelles l’homme s’amed. Trois mufcles compofent
principalement les fejfcs, favoir le grand, le moyen,
& le petit feflier. Voyeç-en les art. au mot F e s s i e r .
Le grand feflier cache, outre le petit feflier, une
portion du moyen, & s’étend jufqu’au tiers fupé-
rieur de l’os de la cuifle. On apperçoit, après les
avoir détachés, d’autres mufcles difpofés en maniéré
de rayons, & qui viennent fe terminer aux environs
du grand trochanter. Ces mufcles font le pyramidal,
oui fort du balfin par l’échancrure ifchialtique ; en-
fuite le cannelé, qui eft creufé pour donner paffage
aux tendons de l’obturateur interne ; enfin le quarré,
qui eft au niveau de la tubérofité de l’os ifehium.
Quoique tous ces mufcles ayent un ufage relatif à
la cuifle, ils paroiflent par leur fituation ne lui point
appartenir.
Aucun des animaux quadrupèdes n’a de fejfes, à
proprement parler ; ce que l’on prend pour cette partie
, appartient proprement à leurs cuifles. L’homme
.eft le feul qui le foûtienne dans une pofition droite'
& perpendiculaire. C’eft en conféquence de cette
pofition des parties inférieures du corps humain,
.qu’eft relatif ce renflement au -haut des cuifles qui
forme les fejfes, & d’où dépend l’équilibre. En effet,
.comme la mafle du ventre s’étend en - devant d’un
côté à l’autre dans l’efpece humaine, cette maffe fe
trouve balancée en-arriere par une autre maffe, qui
'font les fejfes ; fans quoi le : corps pencheroit trop
en-avant: aufli les femmes ont naturellement les
fejfes plos groffes que les hommes, parce qu’elles ont
le ventre plus gros.
Les perfonnes qui, flans avoir de grofîes fejfes y ont
.un gros ventre,.fe penchent en-arriere ; celles au
contraire qui ont les fejfes trop groffes, fans avoir le
,vèntre gros, fe penchent en-devant. Les femmes enceintes
fe penchent toutes en-arriere, ce qui fait le
.contre-poids de leur gros ventre : par la même rai-
fon, les femmes qui ont la gorge groffe & avancée ,
fe tiennent; choies égales-, plus droites que celles
qui l’ont maigre & plate. En un mot le corps né manque
jamais, fans même que nous y penfions, de fe
porter de la maniéré la plus convenable pour fe fpû-
tenir en équilibre ; & il n’eft perlonne qui ne prenne
cet équilibre, comme s’il en favoit parfaitement les
réglés. ^ ( .èq
Si cependant un enfant contraâoit l’habitude d’ar
vancer trop le derrière , on demande quel èft le
moyen de corriger cet enfant : je réponds que ee:feT
ro it, au cas qu’i l n’eût point les jambes trop foibles ;
.de lui mettre un plomb furie ventre ; ce poids, obli-
geroit bientôt cette partie à revenir en-devant, &
Te derrière à s’applatir. Un fécond moyen feroit de
.donner à l’enfant un corps piqué qui repoUffe les
feffes : par la raifon contraire, le moyen de l’empêcher
d’avancer le ventre, eft de lui donner un corps
dont la pointe de devant foit affez longue pour re-
-pouffer le ventre.^ Article d e M , le Chevalier D E J a u -
fO U R T .
Tome V I)
F esses d ’u n V a i s s e a u , (Marine.) Gemot,qu i
n eft guere en ufage, fe dit particulièrement de la
rondeur ou des façons qui font à l’arriere d’une flûte
fous les trepots. (Z )
F e s s e s , (Manège.) Nous appelions de ce nom
dans le cheval, la partie de l’arriere-main qui commence
direftement à la queue, & qui dans les extré-r
mités poftérieures defeend & fe termine au pli que
l’on apperçoit à l’oppofite du graffet.
Fe s s e s LAVÉES, voyei Fe u , marque de. (è)
FESSIER, f. m. (Anatom.) nom de trois mufcles
confidérables, extenfeurs de la cuifle, & qui ont encore
d’autres ufages.
Le grandfeJJiers’attache au coccyx, aux apophy-
fes épineufes de l’os facrum, à la face externe de l’os
des iles. Il adhéré très-fortement à la gaîne tendi-
neufe, qui le recouvre extérieurement, & à deux
ligamens, qui partant de l’os facrum , fe rendent,
l’un à la crête des iles, & l’autre à l ’ifchium. Le tendon
de ce mufcle fe fléchit vers le dos du grand trochanter,
fur lequel eft fixé en partie au-deffous de
l’extrémité du moyen feJJier, un bourrelet délié qui
facilite le jeu de ce tendon fur le grand trochanter.
On obferve de femblables bourrelets dans les infer-
tions du moyen & du petitfeJJier. Le tendon du grand
feJJier fe termine dans une ou deux foffes inégales
qu’on voit à la partie fupérieure de la, ligne âpre.
Ce mufcle éleve le fémur poftérieurement vers l’épine
du dos, & tourne en même tems un peu en-arriere
fa partie extérieure. Lorfqu’un fémur eft fléchi
en-avant, il l’écarte aufli de l’autre.
Le moyen feJJier vient de toute la largeur de la face
externe de l’os des iles, & d’une aponévrofe dont i l
eft extérieurement enveloppé : il fe rétrécit enfuite,
jufqu’à ce qu’il n’ait plus qu’une largeur égale à la
hauteur du grand trochanter, auquel il s’attache obliquement
depuis fa racine jufqu’à fon extrémité la
plus élevée. Ce mufcle éloigne un fémur de l’autre :
le fémur étant porté en-haut & en-avant, il le tourne
de maniéré qu’il dirige un peu vers le fémur la partie
qui eft alors fupérieure.
Le petit feJJier occupe la face externe de l’os des
iles : d’abord affez délié, il eft grofli enfuite par des
fibres qui viennent de l’os ; il commence à devenir
tendineux vers le milieu de fa partie extérieure. C e
mufcle finit vers la partie antérieure du grand trochanter,
qui s’étend le long de fon côté externe,
depuis fa racine jufqu’au haut ; il s’attache,, avant
que de finir, à la: capfule de l’articulation de la cuil-
fe ; il meut la cuifle, de même que le moyen feJJier.
On appelle aufli artères & veines fejjieres, les branches
des hypogaftriques qui fe diftribuent dans les
feffes^ (g )
FESTAGE, f. m. (Jurifp.) dans quelques anciens
titres, eft dit pour droit'de fejlin ou fête que certains
chapitres ou bénéficiers.doivent à leur fupérie.ur ec-
cléfiaftique, ou au feigneur à fon avenement. Voye£
le glojfaire de Laurierè ^ au 'mot FESTIN. (A )
Fe s t a g e le trouve aufli écrit dans quelques an*
ciens titres ,, au lieu fefùjlage, droit feigneurial du
pour le faîte.de chaque m,ajfo.n ; mais on doit dire Sc
écrire faijlage. Voye^ ci-devant F a i§t a GE. (A )
F EST IN ,,( Lfttér.) vcye% R e p a s .
F e s t in s R o y a u x . On n’a point dans çet article,
le vaftje'deflejn de.traiter des fejli'ns royaux que l’hif-
toire ancienne nous a décrits, encore moinsjde ceux
de tant 4 e princes.d’Europe qui., .pendantles fieclea
obfcurs qui ont fuivi la chûte de l ’Empire ', ne.fe font
montrés magnifiques dans les Oçeâfions éclatantes ,
qu e par ;une profufion. déplacée une pompe jgigan-
tefquB,) pne. morgue infuhante. .Çes affemblées tu-
mu ltueufes: p.relque toujours-la. fourcè des vaines
difputesîfiiç le rang, ne finiflbient.guere.que .par la
groffiereté des injures, & par l’efiufion du fang des,
B B b b ij