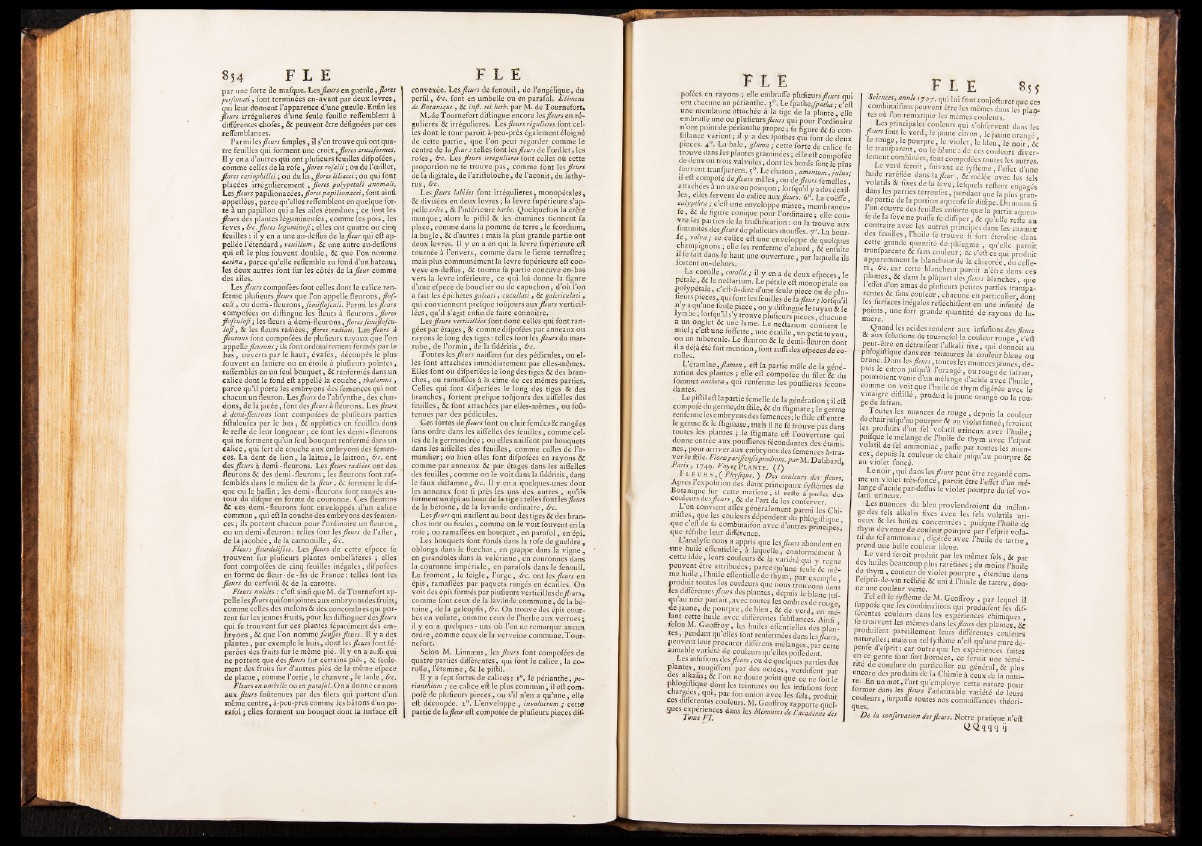
par une forte, de mafque, L esfleur s en gueule f flores
perfonati> font terminées en-avant par deux levres,
qui leur donnent l’apparence d’une gneule. Enfin les
fleurs irrégulières d’une feule feuille reflemblent à
différentes chofes, & peuvent être défignées par ces
reflem blanc es.
Par mi les fleurs fimples , il s’en trouve qui ont quatre
feuilles qui forment une croix, flores cruciformes.
Il y en a d’autres qui ont plufieurs feuilles difpofées,
comme celles de la rofe ,flores rofalli ; ou de l’oeillet,
flores cariophillci ; ou du lis, flores liliacei ; ou qui font
placées irrégulièrement , flores polypetali anomali.
Les fleurs papilionacées, flores papilionacei, font ainfi
-appellées, parce qu’elles reflemblent en quelque forte
à un papillon qui a les ailes étendues ; ce font les
fle u r sdes plantes légumineufes, comme les pois, les
feves, &c. flores leguminofl; elles ont quatre ou cinq
feuilles : il y en a une au-déflus de la fleur qui eft ap-
pellée l’étendard, vexillum, & une autre au-deffous
qui eft le plus fouvent double, & que l’on nomme
canna , parce qu’elle reffemble au fond d’un bateau;
les deux autres font fur les côtés de la fleur comme
tles ailes.
Les fleurs compofées font celles dont le calice renferme
plufieurs fleurs que l’on appelle fleurons ,f lo f-
culi » ou demi- fleurons, femiflofculi. Parmi les fleurs
compofées on diftingue les fleuçs à fleurons, flores
flofculoji; les fleurs à demi-fleurons,flores femiflofçu-
lo jiy & les fleurs radiées, flores radiati. Les fleurs à
fleurons font compofées de pdufieurs tuyaux que l’on
appelle fleurons ; ils font ordinairement fermés par le
bas, ouverts par le haut, évafés, découpés le plus
fouvent en laniere ou en étoile à plufieurs pointes,
raffemblés en un feul bouquet, & renfermés dans un
calice dont le fond eft appellé la couche, thalamus >
parce qu’Ü porte les embryons des femençes qui ont
chacun un fleuron. L e s fleurs de l’abfynthe, des chardons,
de la jacée, font des fleurs à fleurons. Les fleurs
à demi-fleurons font compofées de plufièurs parties
fiftuleufes par le bas, & applaties en feuilles dans
le refte de leur longueur ; ce font les demi-fleurons
qui ne forment qu’un feul bouquet renfermé dans un
calice, qui fert ae couche aux embryons des femen-
ces. La dent de lion, la laitue, Je, laitron, &c. ont
des fleurs à demi - fleurons. L e s fleurs radiées ont des
fleurons & des demi-fleurons ; les fleurons font raffemblés
dans le milieu de la fleur , & forment le dif-f
que ou le baffin ; les demi - fleurons font rangés autour
du difque en forme de couronne. Ces fleurons
& ces demi-fleurons font enveloppés d’un calice
commun, qui eft la couche des embryons des femen-
ces ; ils portent chacun pour l’ordinaire un fleuron,
ou un demi-fleuron: telies font les fleurs de l’after,
de la jacobée, de la camomille, &c.
Fleurs fleurdelifées. Les fleurs de cette efpece fe
trouvent fur plufieurs plantes ombelliferes ; elles
font compofées de cinq feuilles inégales, difpofées
en forme de fleur-de-lis de France: telles font les
fleurs du cerfeuil & de la carotte.
Fleurs nouées : c’eft ainfi que M. deTournefort appelle
lesfleurs qui font jointes aux embryonsdes fruits,
comme celles des melons & des concombres qui portent
fur les jeunes fruits, pour les diftinguer desfleurs
qui fe trouvent fur ces plantes féparément des embryons
, & que l’on nomme faufles fleurs. Il y a des
plantes, par exemple le buis, dont les fleurs font lé-
parées des fruits fur le même pié. Il y en a aufli qui
ne portent que d e s fleurs fur certains piés, & feulement
des fruits fur d’autres piés de la même efpece
de plante, comme l’ortie, le chanvre, le laule, &c.
Fleurs en umbelle ou en parafai. On a donné ce nom
vax. fleurs foûtenues par des filets qui partent d’un
même centre, à-peu-près comme les bâtons d’un pa-
rafol ; elles forment un bouquet dont la lurface eft
convexée. Les fleurs de fenouil., de l’angélique, dti
perfil, font en umbelle ou en parafai* Elément
de Botanique, & infl. rei herb. par M. de Tournefbru
M.-de Tournefort diftingue encore, les fleurs en régulières
& irrégulières* Les fleurs régulières i ont cel*
les dont le tour paroît à-peu-près également éloigné
de cette partie, que l’on peut regarder comme le
centre de la fleur : telles font les fleurs de l’oeillet ^ les
rofes, &c. Les fleurs irrégulières font celles où cette
proportion ne le trouve pas, comme font les fleurs
de la digitale, de l’ariftoloche, de l ’aconit, du lathy*
rus, & c . .
L es fleurs labiées font irrégulières, monopétales ,
& divilées en deux levres ; la levre fupérieure s’appelle
crête , & l’inférieure barbe. Quelquefois la crête
manque; alors le piftil & les étamines tiennent fa
place, comme dans la pomme de terre, le fcordium,
la bugle, & d’autres : mais la plus grande partie ont
deux levres. Il y en a en qui la levre fupérieure eft
tournée à l’envers, comme dans le lierre terreftre ;
mais plus communément la levre fupérieure eft convexe
en-deflus , & tourne fa partie concave en-bas
vers la levre inférieure, ce qui lui donne la figure
d’une efpece de bouclier ou de capuchon* d’où l’on
a fait les épithetes galeati, cucullati, & galericulati,
qui conviennent prefque toujours aux fleurs verticil-
lées, qu’il s’agit enfin de faire connoître.
Les fleurs verticillées font donc celles qui font rangées
par étages, & comme difpofées par anneaux ou
rayons le long des tiges : telles font les fleurs du mar-
rube, de l’ormin, de la fidéritis, &c.
Toutes les fleurs naiflent fur des pédicules, ou elles
font attachées immédiatement par elles-mêmes*
Elles font ou difperfées le long des tiges & des branches,
ou ramaflees à la cime de ces mêmes parties.
Celles qui font difperfées le long des tiges & des
branches, fartent prefque toujours des aiflelles des
feuilles, & font attachées par elles-mêmes, ou foû-
tenues par des pédicules.
Ces fortes de fleurs font ou clair femées & rangées
fans ordre dans les aiflelles des feuilles, comme celles
de la germandrée ; ou elles naiflent par bouquets
dans les aiflelles des feuilles, comme celles de l’amandier;
ou bien elles font difpofées en rayons &
comme par anneaux & par étages dans les aiflelles
des feuilles, comme on le voit dans la fidéritis, dans
le faux di&amne, &c. Il y en a quelques-unes dont
les anneaux font fi près les uns des autres , qu’ils
forment un épi au bout de la tige : telles (ontlesfleurs
de la bétoine, de la lavande ordinaire, &c.
Lesfleurs qui naiflent aii bout des tiges & des branches
font ou feules, comme on le voit fouvent en la
rofe ; ou ramaflees en bouquet, en parafol, en épi.
Les bouquets font fonds dans la rofe de gueldre ,
oblongs dans le ftoechas, en grappe dans la vigne ,
en girandoles dans la valériane, en couronnes dans
la couronne impériale, en parafols dans le fenouil.
Le froment, le feigle, l’orge, &c. ont les fleurs en
épis, ramaflees par paquets rangés en écailles. On
voit des épis formés par plufieurs verticilles d e fleurs,
comme font ceux de la lava'nde commune, de la bétoine
, de la galeopfis, &c. On trouve des épis courbes
en volute, comme ceux de l’herbe aux verrues;
il y en a quelques - uns où l’on ne remarque aucun
ordre, comme ceux de la verveine commune. Tournefort.
Selon M. Linnæus, les fleurs font compofées de
quatre parties différentes, qui font le calice, la corolle,
l’étamine, & le piftil.
Il y a fept fortes de calices : i° . le périanthe, pe~
rianthium ; ce calice eft le plus commun, il eft com-
pofé de plufieurs pièces, ou s’il n’en a qu’une, elle
eft découpée. i ° . L’enveloppe , involucrum ; cette
partie de la fleur eft compofée de plufieurs pièces dit
poféeS en rayons ; elle embraffe plufietirs-purs qui
ont cbacunetun përianthe.30. Le (paüieflpatha; c’eft
une membrane attachée à la tige de la plante elle
embraffe une ou plufieurs/«« qui pour l’ordinaire
n’ont .point,de périanthe propre ; fa figure & fa con-
fiftance varient; il y adesnfpathes qui font de deux
pièces; 4°. La bale, /«me,-cette forte de calice fe
trouve dansles plantes graminées ; elle.eft compofée
de deux ou,trois valvules., dont les-hords ïont le plus
iouvent tranfparens. 5*. Le chaton, amentum,julus;
il eft eoropofé A e p u r s mâles ,on'de/«trr femelles
attachées à un axe ou poinçon; lorfqu’ilyadés.écail-
Jes, elles.fervent de calice aux ' ,7 , ,• ^ fleurs; o6 °;•. LLaa ccooeëftftee,
calypthra; c eft une enveloppe mince, membtaneu-
le , oc de figure conique pour l’ordinaire ; elle couvre
les'parties de la fructification : on la trouve aux
îommites àesfleurs à s plufieurs rfioufles. 70. La bour-
ie , volya; ce calice eft une enveloppe de quelques
rPlgn° ftS * e^e *es renferme d’abord, & enfuite
il le fait dans le haut une ouverture, par laquelle ils
iortent;au-dehors,-'
La corolle,, ro/o//u; il y en a de deux efpeceS'Jiè
petaie, & le nectarium. Le pétale ell monopétalë ou
polypétale, c’elLâ-dire d’unê feule piece ou de plufieurs
pieBes, qui.font les feuilles de la fleu r ; lorfqu’il
y Xqu une feule piece, on y diftingue le tuyau & le
lymfae ; lorfqu il s’y trouve plufieurs pièces chacune
a un onglet & une lame. Le neSarium contient le
miel ; c eft une foffette, .une écaille, un petit tuyau
ou un tubercule. Le fleuron & le demi-fleuron dont
i l a déjà ete fait mention, font aufli des efpeces de corolles,
.
L’étàmine .flamen, eft la partie mâle de la génération
des plantes ; elle eft compofée du filet & du
fommet anthera qui renferme les pouffieres fécon
dantes.
Le piftil eft Iapartie femelle de la génération ; il eft
compofé du germe,du ftile, & du ftigmate ; le germe
renferme les embryons des femençes; le ftile eftentre
le germe & le ftigmate, mais il ne fe trouve pas dans
toutes les; plantes ; le ftigmate eft l’ouverture qui
donne entree aux pouflieres fécondantes des'établi
nés, pour arriver aux embryons des femençes à-tra^
ver le &ite.Floroepanflenflsprodrom.parM. Dalibard
F a n s , 1749- ^ ^ Plante.’ ( I )
FlE.URS.ÇiîAy/jur.) De s couleurs des-fleurs.
Apres 1 expofition des deux principaux fyftèmes de
Botanique fur cette matière, il refte à parler des
couleurs Aes fleur s , & de l’art de les conferver.
Lon convient allez généralement parmi les Chii
miftes, que les couleurs dépendent du phlogiûique,
que c eft de fa combination avec d’autres pnneipes
que refulte leur différence.
L’analyfe nous a appris que les p u r s abondent en
«ne huile effenttelle, à laquelle, conformément à
cette tdee, leurs couleurs & là variété qui y reene
peuvent etre attribuées ; parce qu’une feule & même
huile, 1 huile effenttelle de thym, par exemple
prodmt toutes les couleurs que nous trouvons dans
les^différentes/«« des plantes, depuis lë blanc ittf
qu au noir parfait ; avec'toutes les ombres de rouge
de jaune, de pourpre, de bleu, & de verd, en mfiî
tant cette huile avec différentes fubftances Ainfi
félon M. Geo ffro y, les huiles effentielles des plantes
, pendant qu’elles font renfermées dans les fleurs,
peuvent leur procurer diffirens mélanges,par cette
aimable variété de couleurs qu’elles poffedent.
Les infitfions-.àespu rs, ou de quelques parties des
5ia,ntnS’ r ° T <!fnt par des «ides, verdiffent par
-a? IS’ Ÿ l0I? ne doute Point fl“6 ce "e foitle
phlogtftique dont les teintures ou les infufions font
’ qU1 ’ pa5 fon union a« c lès fels, produit S SH g l CO" leurs: M- Geoffroy rapporte quelques
expériences dans les Mémoires de Vacadémie dis
lom e f 7.
Sciences, année i7 o y . qtu lut font conjefhirer que ces
combtnaxfons peuvent être ’les mêmes dans les plans
tes où lon remarque, les mêmes couleurs. '
, Lcs principales couleurs qui sobfcrverit dans les
fleurs font le verd; le jaune citron , le jaune orangé
le rouge, le pourpre , le violet, le bleu, le noir f &
le tranlparent, ou le blanc t-de ces couleurs diver-
tement combinées, font tompofées tomes les autres.
Le Verd feroit, fuivànt ce fyftème, d’effet d’une
;huile xarefiee dans la f le u r , & mêlée avec les fels
volatils;& fixes de la (eve. lefquels relient engagés
-dans Iesparties terreufes,. pendant que la plus grande
partie de la portion aqueufefè diffipe. Du moins fi
Lomcouvre des feuilles enforte que la partie aquett-
le de la feve ne puiflfe fe diflîper, & qu’elle refle au
-coutratre avec les • autreX principes dans les canaux
des feuilles, 1 huile-fe trouve fi fort étendue dans
cette. ,grande quantité dp. phlegme , qu’elle paroît
tranlparente & fans couleur ; & c’eft ce qui produit
apparemment la blancheur de la chicorée, du c elle-
ri , &c.\ car celte blancheur paroît n’être dans ces
plantes, & dans la plupart des/eurï blanches, que
. 1 eftet d un amas de plufieurs petites parties tranlpa-
j rentes & fans couleur, chacune en particulier, dont
les furfaces inégales refléchiffent en une infinité de
points, une fort grande quantité de rayons de lumière.
Quand les acides rendent aux infufions des fleurs
& aux folutions de tournefol la couleur rouge c’efl:
PMUt‘ f e e en ^ truifant l’alkaü fixe, qui donnoit au
phfogiflique dans ces teintures la couleur bleue ou
brune. Dans les/^rs, toutes les nuancesiaunés, depuis
le citron jufqu’à l’orangé, ou rouge de fafran
pourroient venir d’un mélange d’acide avec l’huile *
comme on voit que l’huile de thym digérée avec lé
vinmgre diftillé, produit le jaune orangé ou le rouge
de fafran. °
Tomes les/uances de rouge, depuis la"Couleur
de chair jufqu au pourpre & au violet foncé, feroient
les produits d’un fel volatil urineux avec l’huile *
pmlquele mélange de l’hui-le de thym avec l’efprit
volatil de fel ammoniac, paffe par tontes les nuan-
ces, depuis la couleur de chair jufqu’au pourpre &
au violet foncé. r
Le noir, qui dans les fleurs peut être regardé comme
un violet très-fonce, paroît être l’effet d’un mélange
d acide par-deffus le violet pourpre du fel volatil
urineux.
Les nuances du bleu proviendraient du mélange
des fels alkalis fixes avec les fels volatils uri-
neux & les huiles concentrées ; puifque l ’huile de
thym devenue de couleur pourpre par l’efprit volatil
du fel ammoniac, digérée avec l’huile de tartre
prend une belle couleur bleue.
Le verd ferait produit par les mêmes fels, & par
des huiles beaucoup plus raréfiées ; du moins l’huile
de thym , couleur de violet pourpre , étendue dans
1 eiprit-de-vin reêhfié & uni à l’huile de tartre, donne
une couleur verte.
Tel eft le iyftème de M. Geoffroy , par lequel il
iuppofe que les combmaifons qui produifent les dif-
ferentes couleurs dans les expériences chimiques
fe trouvent les mêmes dans les fleurs des plantes 6c
produifent pareillement leurs différentes couleurs
naturelles ; mais un tel fyftème n’eft qu’une pure dé-
penfe d’efprit ; car outre que les expériences faites
en ce genre font fort bornées, ce feroit une témérité
de conclure du particulier au général, & plus
encore des produits, de la Chimie à ceux de la nature.
En un mot,l’art qu’employe cette nature pour
tormer dans les fleurs l’admirable variété de leurs
couleurs, furpafle toutes nos eonnoiffances théori-
I
ques
D e la confervation des fleurs. Notre pratique n’efi:
Q Q q q q ij