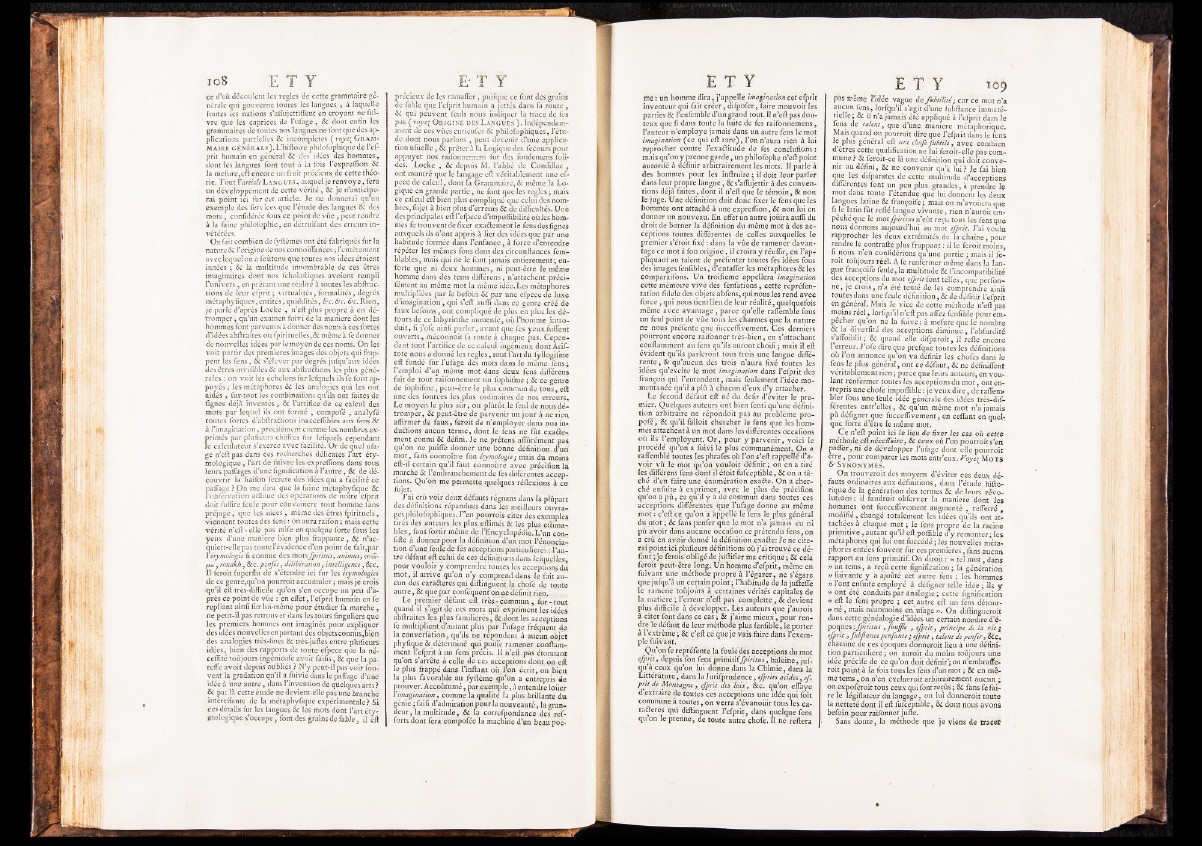
ce d’où découlent les réglés de cette grammaire generale
qui gouverne toutes les langues,, à laquelle
foutes les nations s’affujettiffent en croyant ne fui-
vre que les caprices de l’ufage, 8c dont enfin lès
grammaires de toutes nos langues ne font que des applications
partielles 8c incomplètes ( voye[ Grammaire
générale). L’hiftoire philofophique de l’efprit
humain en général 8c dès idées des hommes,
dont les langues font tout à la fois l’expreffion 8c
la mefure,eft encore un fruit précieux de cette théorie.
T ont Y article Lan gués , auquel je renvoyé, fora
un développement de cette vérité, 8c je n’anticiperai
point ici fur cet article. Je ne donnerai qu’un
exemple des forvices que l’étude des langues & des
mots , confidérée fous ce point de vue , peut rendre
à la faine philofophie, en détruifant des erreurs invétérées.
On fait combien de fyftèmes ont été fabriqués fur la
nature & l’origine de nos connoiffances ; l’entêtement
avec lequel on a foutenu que toutes nos idées étoient
innées ; 8c la multitude innombrable de ces êtres
imaginaires dont nos foholaftiques avoient rempli
l’univers , en prêtant une réalité à toutes les abfiractions
de leur efprit; virtualités, formalités, degrés
métaphyfiques, entités, quiddités, &c. &c. &c. Rien,
je parle d’après Locke , n’eft plus propre à en détromper
, qu’un examen fuivi de la maniéré dont les
hommes font parvenus à donner des noms à ces fortes
d’idées abftraites ou fpirituelles,& même à fe donher
de nouvelles idées parlemoyen de ces noms. On les
voit partir des premières images des objets qui frappent
les fens, 8c s’élever par degrés jufqu’aux idées
des êtres invifibles 8c aux abftratlions les plus générales
: on voit les échelons fur lefquels ils fo font appuyés
; les métaphores & les analogies qui les ont
aidés , fur-tout les combinaifons qu’ils ont faites de
lignes déjà inventés , 8c l’artifice de ce calcul des
mots par lequel ils ont formé , compofé , anâlyfé
toutes fortes d’abftraétion’s inacceffibles aux fons 8c
à l’imagination, précif ément comme les nombres exprimés
par plufieurs chiffres fur lefquels cependant
le calculateur s’exerce avec facilité. Or de quel ufa-
ge n’eft pas dans ces recherches délicates l’art étymologique
, l’art de fuivre les expreffions dans tous
leurs paffages d’une lignification à l’autre, 8c de découvrir
la liaifoh fecrete dés idées qui a facilité ce
pa!Tage ? On me dira' que la faine métaphyfique &
î’obforvation afiîdue des opérations de notre efprit
doit fufiire feule pour convaincre tout homme fans
préjugé, que les idées , même des êtres fpirituels,
viennent toutes des fens : on aura raifon ; mais cette
vérité n’eft - elle pas mife en quelque forte fous les
yeux d’une maniéré bien plus frappante, 8c n’ac-_
quiert-elie pas toute l’évidence d’un point de fait,par
l’étymologie fi connue des mots fpiritus, animus, çm£-
[jLa. , rouakJi, tkc.penfée, délibération, intelligence, & c .
Il foroit fuperflu de s ’étendre ici fur Xts étymologies
de ce genre,qu’on pourroit accumuler ; mais jè crois'
«qu'il eft très-difficile qu’on s’en occupe un peu d’après
ce point de vue : en effet, l’efprit humain en fe
repliant ainfi fur lui-même pour étudier fa marche ,
ne peut-il pas retrouver dans les tours linguliers que
les premiers hommes ont imaginés pour expliquer
des idées nouvelles en partant des objets connus,bien
des analogies très-fines & très-juftes entre plufieürS
idées, bien des rapports de toute éfpece que la né-,
ceffité toûjours ingénieufe avoit fàifis, 8c que la pa-
reffe avoit depuis oubliés ? N’y peut-il pas voir fou-
vènt'la gradation qu’il a fuivie dans le paffage d’une
idée à fine autre, dans l’invention de quelques arts ?
8c par-là cette étude ne devient-elle pas une branche
intéreffante de la métaphyfique expérimentale ? Si'
ces détails fur les langues & les mots dont l’art étymologique
s’occupe, font des grains de fable, il éft
précieux de les ramaffer, puifque. ce font des grains
de fable que l’efprit humain a jettes dans fa route ,
& qui peuvent fouis nous indiquer la trace de fos
pas (voyez Origine dès Langues ). Indépendamment
de ces vues curieufes 8c philosophiques, l’étude
dont nous parlons , peut devenir d’une application
ufuelle, 8c prêter à la Logique des fecours pour
appuyer nos raifonnemens fur des. fondemens foli*
des. Locke , & depuis M. l’abbé de Condiliac ,
ont montré que le langage eft véritablement une ef-
pece de calcul, dont la Grammaire, & même la Logique
en grande partie, ne font que les réglés ; mais
ce calcul eft bien plus compliqué que Celui des nombres,
fujet à bien plus d’erreurs 8c de difficultés. Unè
des principales eft l’efpece d’impoffibilité où les hommes
fo trouvent de fixer exactement le fens des lignes
auxquels ils n’ont appris à lier des idées que par une
habitude formée dans l’enfance , à force d’entendre
répéter les mêmes fons dans des circonftances fom-
blables, mais qui ne le font jamais entièrement ; en-
forte que ni deux hommes, ni peut-être le même
homme dans des tems différens, n’attachent précifément
au même mot la même idée. Les métaphores
multipliées par le befoin 8c par une efpece de luxe
d’imagination, qui s’eft aufîi dans ce genre créé de
faux befoins, ont compliqué de plus en plus les détours
de ce labyrinthe immenfe, où l’homme introduit,
fi j’ofo ainfi parler, avant que fos yeuxfufîent
ouverts, méconnoît fa route à chaque pas. Cependant
tout l’artifice de ce calcul ingénieux dont Arif-
tote nous a donné les réglés, tout l’art du fyllogifme
eft fondé fur l’ufage des mots dans le même fens;
l’emploi d’ un même mot dans deux fons différens
fait de tout raifonnement un fophifme ; & ce genre
de fophifme, peut-être le plus commun de tous, eft
une des fburces les plus ordinaires de nos erreurs.
Le moyen le plus sûr, ou plutôt le foui de nous détromper,
& peut-être de parvenir un jour à ne rien
affirmer de faux, foroit de n’employer dans nos inductions
aucun terme, dont le fons ne fût exactement
connu & défini. Je ne prétens affûrément pas
qu’on ne puiffe donner une bonne définition, d’un
mot, fans connoître fon étymologie; mais du moins
eft-il certain qu’il faut connoître avec précïfion la
marche & l’embranchement de fos différentes acceptions.
Qu’on me permette .quelques réflexions à ce
fujet.
J’ai crû voir deux défauts régnans dans la plupart
des définitions répandues dans les, meilleurs ouvrages
philofophiquès. J”en pourrois citer des exemples
tirés des auteurs les plus eftimés & les plus.eftima-
bles, fans fortir.même de [l’Encyclopédie. L’qp corn,
fille à donner pour la défimtipn, d’un mot l’énonciation
d’une feule de fés acceptions particulières : lo u tre
défaut eft celui de ces définitions dans lesquelles,
pour vouloir y comprendre toutes Tes acceptions^
mot, il arrive qu’on n’y comprend dans le fait'aucun
des caraéteres qui dîftinguent "ijj choie de toute
autre, 8c que.par conféquent'on ne définit rien.
Le premier défaut eft très"rcommun, fur-tout
quand il s’agit de ces mots qui expriment les idées
abftraites les plus familières, Seront les acceptions
fo multiplient d’autant plus par l’ufage fréquent de
la converfation, qu’ils ne repondent à aucun objet
phyfique & déterminé qui puiffe ramener conftam-
ment 1,’efprit à Un fons précis. II n’eft pas étonnant?
qu’on s’arrête à celle de ces acceptions dont.on eft
le plus frappé dans l’inftant où l’on écrit, ou .bien
la plus favorable au fyftème qu’on a entrepris de
prouver. Accoutumé, par exemple, à entendre loiier
Y imagination > comme la qualité la plus brillante du
génie ; faifi. d’admiration pour la nouveauté, lagran-.
deur, la multitude, & la correfpondance des ref*
forts dont fora compofée la machine d’un beau poëftièi
un homme dira > j’appelle imagination e tt êfprït
inventeur qui fait créer, difpofor, faire mouvoir les
parties & l’enfomble d’un grand tout. Il n’eft pas douteux
que fi dans toute la fuite de fos raifonnemens,
l’auteur n ’employe jamais dans un autre fons le mot
imagination (ce qui eft rare), l’on n’aura rien à lui
reprocher contre l’exaCtitude de fos conclufions ;
mais qu’on y prenne garde, Un philofophe n’eft point
autorifé à définir arbitrairement les mots. Il parle à
des hommes pour les inftruire ; il doit leur parler
dans leur propre langue, & s’affujettir à des conventions
déjà faites, dont il n’eft que le témoin, & non
le juge. Une définition doit donc fixer le fons que les
hommes ont attaché à une expreffion, 8c non lui en
donner un nouveau. En effet un autre jouira auffi du
droit de borner la définition du même mot à des acceptions
toutes différéntes de celles auxquelles le
premier s’é'toit fixé : dans la vûe de ramener davantage
ce mot à fon origine, il croira y réuffir, en l’appliquant
au talent de préfonter toutes fos idées fous
des images fonfibles, d’éntaffer les métaphores & les
comparaifons. Un troifieme appellera imagination
cette mémoire vive des fonfations, cette repréfon-
tation fidele des objets abfens, qui nous les rend avec
force, qui nous tient lieu dè leur réalité, quelquefois
même avec avantage, parce qu’elle raffemble fous
un foui point de vûe tous les charmes que la nature
ne nous prefonte que fucceffivement. Ces derniers
pourront encore raifonner très-bien, en s’attachant
conftamment au fens qu’ils auront choifi ; mais il eft
évident qu’ils parleront tous trois une langue différente
, & qu’aucun dés trois n’aura fixé toutes les
idées qu’excite le mot imagination dans I’efprit des
françois qui l’entendent, mais feulement l’idée momentanée
qu’il a plu à chacun d’eux d’y attacher.
Le fécond defaut éft né du defir d’éviter le premier.
Quelques auteurs ont bien fonti qu’une définition
arbitraire rie répondoit pas au problème pro-
pofé ; 8c qu’il falloit chercher le fens que les hommes
attachent à un mot dans les différentes occasions
oîi ils l’employent. O r , pour y parvenir, voici le
procède qu’on a fuiv ïle plus communément. On a
raffemble toutes les phrafes où l’on s’eft rappelle d’avoir
vû le mot qu’on youloit définir ; on en a tiré
les différëris fons aon't il étoit fûfoeptible, & on a tâché
d’e'rî faire une énumération exa£te. On a cherché
enfuite à exprimer, avec le plus de précifion
qu’on à pû, ce qu’il y a de commun dans toutes ces
acceptions différentes que l’ufage donne au même
mot s c’eft ce qu’on a appelle le fens le plus général
du mot ; 8ç fans penfer que le mot n’a jamais eu ni
pû avoir dânS aucune ocçafion ce prétendu fons,on
a crû èn avoir donné là définition exaCte: Je ne citerai
point ici plufiëiirs définitions où j’ai trouvé ce défaut
yjeforpis obligé de jiiftifier ma critiqué"; & cela
foroit peut-être long. Un homme dfofprit, même en
fuivant une méthode proprè à l ’égarer, ne s’égare
que jufqu’â un certain point; l’habitude de là jufteffe
le ramène toujours^à cèrtaines^^vérités capitales de
là matière ; l’erreur n’èft pas complette, & devient
plus difficile à développer. Lès auteurs que j’aurois
à citér font dans ce cas ; & j’aime mieux, pour rendre
lë défaut de leur méthode plus fonfible, le porter
à l’extrême ; 8c c’eft cë que je vais faire dans'l’exemple
fuivant*
Qu’on le reprefonte Ia foulé des acceptions du mot
efprit? depuis, fon fens primitiffpiritus , haleihe , juf-
qu’à.cçux qu’ôn lui doppe dans la Chimie, dans la
Littérature,.dans la Juriïprùdence, efpriis acides, ef-
Pfj1; ^ ont^ë.,} e » efprit des- lois & c. qu’on effaye
d’extraire, de toutes ces acceptions une idée qui foit ;
commune à toutes, on verra s’évanouir tous les ca- j
rafterés qui diftinguent l’efprit, dans quelque fons i
qu’on le prenne, de toute autre chofo. Il he reftera
pas iPeme Pidéè vague de fnbiiUtè; car ce mot n’a
aucun fens, lorfqu’il s’agit d’une fubftance immatérielle;
8c il n’a jamais été appliqué à l’efprit dans le
lens de talent, que d’une maniéré métaphorique.
Mais quand on pourroit dire que l’efprit dans le fons
le plus general eft une chofe fubtile, avec combien
d etres cette qualification ne lui foroit-elle pas commune
? & foroit-ce là une définition qui doit convenir
au défini, 8c ne convenir qu’à lui ? le fai bien
que^ les dilparates de cette multitude d’acceptions
différences font un peu plus grandes, à prendre le
mot dans toute l’étendue , que lui donnent les deux
langues latine & françoifo; mais on m’avoiiera que
fi le latin fût refté langue vivante, rien n’auroit empêché
que le mot fpiritus n’eût reçu tous les fens que
nous donnons aujourd’hui au mot efprit. J’ai voulu
rapprocher les deux extrémités de la chaîne, pour
rendre le^contrafte plus frappant : il le foroit moins,
fi nous n’en confidérions qu’une partie ; mais il fe-
roit toûjours réel. A fe renfermer même dans la langue
françoifo foule, la multitude 8c l’incompatibilité
des acceptions du mot efprit font telles, que personne,
je crois, n’a été tenté de les comprendre ainfi
toutes dans une foule définition, 8c de définir l’efprit
en general. Mais le vice de cette méthode n’eft pas
mA° ins reel^, Iorlqu’il n’eft pas affez fonfible pour empêcher
qu’on^ ne la fuive : à mefitre que le nombre
8c la diverfité des acceptions diminue, l’abfurdité
s’affoiblit ; 8c quand elle dilparoît, il refte encore
l’erreur. J’ofo dire que prefque toutes les définitions
ou l’on annonce qu’on va définir les chofes dans le
fons le plus général, ont ce défaut, 8c ne définiffent
véritablement rien ; parce que leurs auteurs, en voulant
renfermer toutes les acceptions du m ot, ont entrepris
une chofo impoffible : je veux dire, de raffem*
hier fous une feule idée générale des idées très-dif-
féyentes entr’elles, 8c qu’un même mot n’a jamais
pû défigner que fucceffivement, en ceffant en quel-
ique fortè d’être le même mot.
Ce n’eft point ici le lieu de fixer les cas où cette
méthode eft.n.éceiîaire, & ceux où l ’on pourroit s’en
gaffer, ni de développer l’ufage dont elle pourroit
être, pour comparer les mots entr’eux. Voye? Mo t s
& Synonymes.
On trquveroit des moyens d’éviter ces deux défauts
ordinaires aux définitions, dans l’étude hifto-
riqùe de la génération des termes 8c de leurs, revor
lutioris : il faudroit obforver la maniéré dont les
hommes ont fucceffivement augmenté , refferré
modifie, changé totalement les idées qu’ils ont attachées
à chaque mot ; le fons propre de la racine
primitive, -autant qu’il eft poffible d’y remonter ; les
métaphores qui lui ont fuccédé ; les nouvelles métaphores
entées fouvent fur ces premières, fans aucun
rapport au fons primitif. On diroit : « tel m ot, dans
» un tems, a reçû cette lignification ; la génération
» fuiyânte y a ajoûté cet autre fons ; les hommes
» l’ont enfuite employé à défigner telle idée ; ils y
» ont été conduits par analogie ; cette fignification
» eft le fons propre ; cet autre eft un fens détour-
» n é , mais neanmoins en ufage ». On diftingueroit
dans cette généalogie d’idées un certain nombre d’époques
’. fpiritus , foufjle , efprit, principe de la vie ;
efprit., fubftançepenfante; efprit, talent de penfer, & c .
chacune de ces époques donneroit lieu à une définition
particulière ; on auroit du moins toûjours une
idée précifo de ce qu’on doit définir; on n’embraffe-
roit point à la fois tous les fons d’un mot ; & en même
tems, on n’en exclueroit arbitrairement aucun ;
on expoforoit tous ceux qui font reçûs ; 8c fans fe faire
le légillateur du langage, on lui donneroit toute
la netteté dont il eft fûfoeptible, 8c dont nous avons
befoin pour raifonner jufte.
Sans doute, la méthode que je viens de tracer