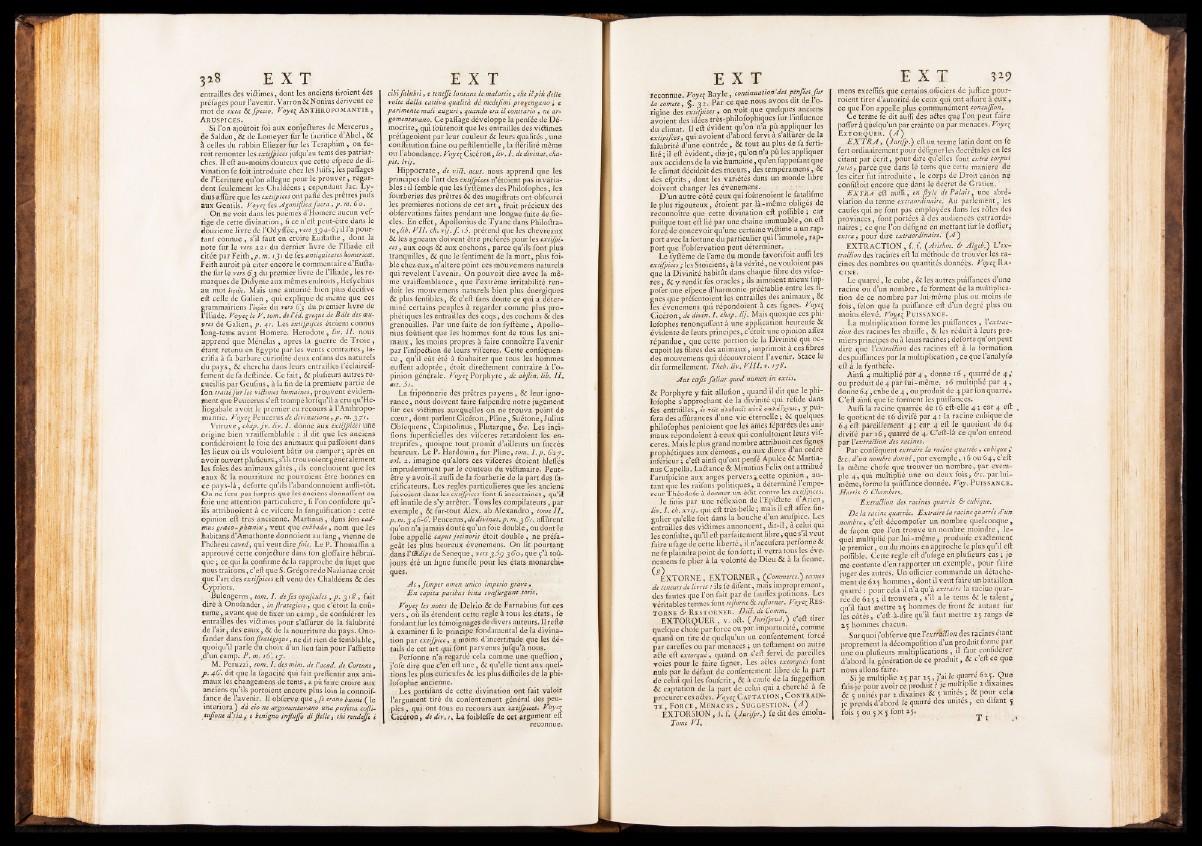
entrailles des victimes, dont les anciens tiroient des
préfages pour l’avenir. Varron &Nonius dérivent ce
mot ae exta 6c fpecio. P°ye!i A n th r o pom an t ie ,
A rüSPICES. r •
Si l’on ajoutoit foi aux conjeClures de Mercerus,
de Salden, & de -Lomeyer fur le facrifice d Abel, 6c
à celles du rabbin Ëliezer fur les Teraphim , on fe-
roit remonter les exùfpices jufqu’au tenis des patriarches.
Il eft au-moins douteux que cette efpece de divination
fe foit introduite chez les Juifs; les paffages
de l’Ecriture qu’on allégué pour le prouver, regardent
feulement les Chaldéens ; cependant Jac. L y - '
dius allure que les exùfpices ont paflé des prêtres juifs
aux Gentils. Voye^ fes Agonifica facra, p. m. 60.
On ne voit dans les poëmes d’Homere aucun vef-
tige de cette divination, li ce n’eft peut-être dans le
douzième livre de l’Odyffée, vers 3^4-6; il l’a pourtant
connue , s’ il faut en croire Euftathe , dont la
note fur le vers 2.2.1 du dernier livre de l’Iliade eft
citée par Feith ,p . m. 131 de fes antiquitates komericce.
Feith auroit pu citer encore le commentaire d’Eufta-
the fur le vers 63 du premier livre de l’Iliade, les remarques
de Didyme aux mêmes endroits , Hefychius
au mot îtptùc. Mais une autorité bien pius décifive
eft celle de Galien , qui explique de même que ces
grammairiens l’«p«<* du vers 63 du premier livre de
l ’Iliade. Voyeç le V. tom. de l'èd. greque de Bâle des oeuvres
de Galien, p. 41. Les exùfpifces étoient connus
ïong-tems avant Homere. Hérodote, liv. 11. nous
apprend que Ménélas , après la guerre de T ro ie ,
étant retenu en Egypte par les vents contraires, fa-
crifia à fa barbare curiofité deux enfans des naturels
du pays, 6c chercha dans leurs entrailles l’éclaircif-
fement de fa deftinée. Ce fait, 6c plufieurs autres recueillis
par Geulius, à la fin de la première partie de
fon traitéfur les victimes humaines, prouvent évidemment
que Peucerus s’ eft trompé lorlqu’il a cru qu’He-
liogabale avoit le premier eu recours à l’Anthropo-
mantie. Voye^ Peucerus de divinaùone, p.'m. 3 y 1.
Vitruve, chap.jv. liv. I . donne aux exùfpices une
origine bien vraiffemblable : il dit que les anciens
confidéroient le foie des animaux qui pafloient dans
les lieux oii ils vouloient bâtir ou camper ; après en
avoir ouvert plufieurs, s’ils trou voient généralement
les foies des animaux gâtés, ils concluoient que les
eaux 6c la nourriture ne pouvoient être bonnes en
ce pays-là, deforte qu’ils l’abandonnoient aufli-tôt.
On ne fera pas furpris que les anciens donnaffent au
foie une attention particulière, fi l’on confidere qu’ils
attribuoient à ce vifcere la fanguification : cette
opinion eft très-ancienne. Martinus, dans fon cad-
mus greeco-photnix, veut que cubbada, nom que les
habitans d’Âmathonte donnoient au fang, vienne de
l ’hébreu cavedy qui veut dire foie. Le P. Thomaflin a
approuvé cette conjeâure dans fon gloffaire hébraïque
; ce qui la confirme 6c la rapproche du fujet que
nous traitons, c’eft que S. Grégoire de Nazianze croit
que l’art des exùfpices eft venu des Chaldéens 6c des
Cypriots.
Bulengerus, tom. I. de fes opufcules , p. 3 1 8 , fait
dire a Onofander, in flrategicis, que c’étoit la coutume,
avant que de fixer un camp, de confidérer les
entrailles des victimes pour s’affûrer de la falubrité
,de l’airj des eaux, 6c de la nourriture du pays. Ono-
fander dans fonJlratégiquc, ne dit rien de femblable,
quoiqu’il parle du choix d’un lieu fain pour l’affiette
.d’un camp. P. m. 1,6. 17. •
M. Peruzzi, tom. I . des mém. dtVacad. de Cortone ,
p . 46~. dk que la fagacité qui fait preffentir aux animaux
les changemens de tems, a pu faire croire aux
anciens qu’ ils portoient encore plus loin la connoif-
fance de Favenir. Il obferve que ,fe erano buone ( le
interiora ) dà cio ne argomentavano una perfetta cofti-
tufione d jia f c benigno influffo di fclU 3 chi rendeffe i
cibi falubri, e leneffe lontane le malatùe, che ilpiù délit
vol te dalla cattiva qualitâ dé medejimi proyengano j c
parimente mali auguri, quando era il contrario, ne argomentavano.
Ce paffage développe la penfée de Dé-
mocrite, qui foûtenoit que les entrailles des victimes,
préfageoient par leur couleur 6c leurs qualités, une
conftitution faine ou peftilentielle, la ftérilité même
ou l’abondance. Voye^ Cicéron, liv. 1. dedivinat. cha-
pit. Ivij.
Hippocrate, de vict. acut. nous apprend que les
principes de l’art des exùfpices n’étoient pas invariables
: il femble que les fyftèmes des Philofophes, les
fourberies des prêtres 6c des magiftrats ont obfcurci
les premières notions de cet a r t , fruit précieux des
obfervations faites pendant une lôngue fuite de fie-
cles. En effet, Apollonius de T yane dans Philoftra-
te,lib. y I I . ch. v i j . f /5. prétend cjue les chevreaux
6c les agneaux doivent être préférés pour les exùfpices,
aux coqs 6c aux cochons, parce qu’ils font plus
tranquilles, 6c que le fentimeht de la mort, plus foi-
ble chez eux, n’altere point ces mouvemens naturels
qui revelent l’avenir. On pouvoit dire avec la même
vraiffemblance, que l’extrême irritabilité ren-r
doit les mouvemens naturels bien plus énergiques
6c plus fenfibles, 6c c’eft fans doute ce qui a déterminé
certains peuples à regarder comme plus prophétiques
les entrailles des coqs, des cochons & des
grenouilles. Par une fuite de fon fyftème, Apollonius
foûtient que les hommes font de tous les animaux,
les. moins propres à faire connoître l’avenir
par l’infpe&ion de leurs vifceres. Cette conféquen-
ce , qu’il eût été à fouhaiter que tous les hommes
euffent adoptée, étoit directement contraire à l’or
pinion générale. Voye^ Porphyre, de abflin. lib. I I .
art. Si.
La friponnerie des prêtres payens, 6c leur ignorance
, nous doivent faire fufpendre notre jugement
fur ces viâimes auxquelles on ne trouva point de
coeur, dont parlent Cicéron, Pline, Suétone, Julius
Obfequens, Capitolinus, Plutarque, &c. Les incitions
fupèrficielles des vifceres retardoient les efi-
treprifes, quoique tout promît d’ailleurs un fuccès
heureux. Le P. Hardouin, fur Pline, tom. l .p . 627.
col. 2. imagine qu’alors ces vifceres étoient bleffés
imprudemment par le couteau du viûimaire. Peut-
être y avoit-il Suffi de la fourberie de la part des fa-
crificateurs. Les réglés particulières que les anciens
Envoient dans les exùfpices (ont fi incertaines, qu’il
eft inutile de s’y arrêter. Tous les compilateurs, par
exemple, 6c fur-tout Alex, ab A lexandro, tome I I .
p. m.346-6. Peucerus, dedivinat.p. m .361. affûrent
qu’on n’a jamais douté qu’un foie double, ou dont le
lobe appellé caput jecinoris étoit double , ne présageât
les plus heureux évenemens. On lit pourtant
dans Y OEdipe de Seneque, vers 3 59 3 60, que ç’à toujours
été un figne funefte pour les états monarchiques.
A c , femper omen unico imperio grave ,
En capita paribus bina confurgunt toris.
Voye^ les notes de Delrio & de Farnabius fur ces
v er s , oii ils étendent cette réglé à tous les états, fe
fondant.fur les témoignages de divers auteurs. Il refte
à examiner fi le principe fondamental de la divination
par cxtifpice, a moins d’incertitude que les détails
de cet art qui font parvenus jufqu’à nous.
Perfonne n’a regardé cela comme une queftion ,
j’ofe dire que c’en eft une, & qu’elle tient aux quef-
tions les plus curieufes 6c les plus difficiles de la phi-
jlpfophie ancienne.
Les partifans de cette .cUyination opt fait valoir
l’argument tiré du confentement général des peuples
, qui ont tous eu recours aux exùfpices. P
Cicéron, de div, /, La foibleffe de cet argument eft
reconnue.
reconnue. ^oy^ Ba yle, continuation des p'tnfees.fur
la comete, § .3 2 . Par ce que nous avons dit de lo r
rigine des exùfpicesg on voit que quelques anciens
avoient des idées très-philofophiquesTur 1 influence
du climat. Il eft évident qu’on n a pu appliquer, les
cxùpifcesy qui avoient d’abord feryi à s’affûrer de la
falubrité d’une contrée, 6c tout au plus de fa fertir
lité ; il eft évident, dis^je,qu’on n’a pû les appliquer
aux accidensde la vie humaine, qu’en fuppofant que
le climat décidbit des moeurs, des tempéramens, 6ç
des efprits , dont les variétés dans un monde: libre
doivent changer les évenemens.-. • :
D ’un autre côté ceux qui foûtenoient le, fafajifme
le plus rigoureux, étoient par là-même obliges de
reconnoître que cette divination eft poffible ; car
puifque tout eft lié par une chaîne immuable , on eft
forcé de concevoir qu’une certaine vi&ime a un rapport
avec la fortune du particulier qui 1 immole, rapport
que l’obfervatioo peut déterminer.
Le fyftème de l’ame du monde favorifoit aufti les
exùfpices ; les Stoïciens, à la vérité., ne vouloient pas
que la Divinité habitât dans chaque fibre des vifceres
y 6c y rendît.fes oracles ; ils aimoient mieux fup-
pofer une efpec.e. d’harmonie préétablie entre les lignes
que préfentoient les entrailles des animaux, 6c
les évenemens. qui répondoient à ces lignes. Voye£
Cicéron, de divin. I. chap. lij. Mais quoique ces philofophes
renonçaflënt à une application heureufe &
évidente de leurs principes, c’étoit une opinion afifez
répandue, que cette portion de la Divinité qui oc-
cupoit les fibres des animaux, imprimoit à ces fibres
des mouvemens qui découvroient l’avenir. Stace le
dit formellement. Theb. liv. VIII. v.» 178.
A ut coefis faliat quod numen in extis.
6c Porphyre y fait allufion, quand il dit que le phi-
lofophe s’approchant de la divinité qui refide dans
fes entrailles, lv toîc àxnbivo7ç aù-ra y puifera
des aflïirances d’une vie éternelle ; 6c quelques,
philofophes penfoient que les âmes feparees des animaux
repondoient à ceux qui confukoient leurs vifceres.
Mais le plus grand nombre attribuoit ces tignes
prophétiques aux démons, ou aux dieux d un ordre
inférieur ; c’eft ainfi qu’ont penfé Apulee 6c Martia-
nus Capelia. Laftance & Minutius Félix ont attribué
i’arufpicine aux anges pervers j, cette opinion , autant
que les raifons politiques, a détermine 1 empereur
Théodofe à donner un édit contre les exùfpices.
Je finis par une réflexion de l’Epiftete d Arien,
liv. I. ch. xvij. qui eft très-belle ; mais il eft allez fin-
gulier qu’elle foit dans la bouche d’un arufpiçe.:LeS
entrailles des viûimes annoncent, dit-il, à celui qui
les confulte, qu’il eft parfaitement libre, que s’il veut
faire ufage de cette liberté, il n’accufera perfonne &
ne fe plaindra.point de fon fort; il verra tous les eve-
nemens fe plier à la volonté de Dieu & à la fienne.
EXTORNE , EXTORNER, (Commerce.) termes
de teneurs de livres : ils fe difent, mais improprement,
des fautes que Fon fait par de faufles pofitions. Les
véritables termes font rejlorne & rejlorner. Voye{ R e s -
TORNE & RESTORNER. Dict. de Comm.,
EX TO RQU ER , v. aft. ( Jurifprud.) c’eft tirer,
quelque choie par force ou par importunité, comme
quand on tire de quelqu’un un confentement. forcé
par carefles ou par menaces ; un teftament ou autre
atte eft extorqué y quand on s’eft fervi de pareilles
voies pour le faire ligner. Les a êtes extorques font
nuis par le défaut de confentement libre de la part
de celui qui les foufcrit, 6c à caufe de la fuggeftion
& captation de la part de celui qui a cherche à fe
procurer ces a&es. Voye%_ C a p t a t io n , C o n t r a in t
e , F o r c e , Me n a c e s ; Su g g e s t io n . Ç A )
EXTORSION, fi. f, ÇJurifpr.) fe dit des émolu-
fome VI. ,
mens exceffifs que certains,officiers de juftice,pour-
roient tirer d’autoritéjde ceüx qui ont affaire à eux ,
ce que l’on appelle,-pIus communément concuffion.
Ce ternie le dit auffi des aûes que l’on peut faire
palier â quelqu’un par crainte ou par menaces. Voye^
Extorquer. ( A )
E l f T R A , (Juùfpf) eft un terme latin dont on fe
fert ordinairement pour défigner les décrétales en les
citant par écrit, pour dire qu’elles font extra corpus
jurisf parce que dans lè. tems que cette maniéré de
les citer fut introduite lé corps de Droit canon ne
confiftoit encore que dans l,ë decret de Grâtieh. ' .
ËkjRÀ''ë$t auffi,' erifîylé de Palais, une abréviation
du tèrme extraordinaire. Au parlement, les
caufes qui ne font pas employées dans les rôles- des
provinces, font portées à des audiences 'extraordinaires
; ce que l’on défigne en mettant fur le doffier,'
extra, pour dire extraordinaire. (A )
EX TRA C TION , f..f. (Arithm. & Aigebf) U extraction
des "racines eft la méthode dé trouver les racines
des nombres ou quantités données. Veyeç Ra c
in e .
Le quarré, le cube, 6c lés autres puiffances d’une
racine ou d’un nombre, feTorment delà multiplication
de ce nombre par lui-’ifnême plus ou moins de
fois, félon que la puilfanCe eft d’un degré plus ou
moins élevé. Voye{ PUISSANCE.
La multiplication forme les puiffances , Y extraction
des racines les abaiffe, & les réduit à leurs premiers
principes du à leurs racines ; deforte qu’on peut
dire que Y extraction des racines eft à la formation
des puiffances par la multiplication, ce que l’analyfe
eft ,à la fynthèfè.
Ainfi 4 multiplié par 4 , donne 1 6 , quarré de 4
ou produit de 4 par lui-même." 16' multiplié par 4 ,
donne 6 4 , cnbe de 4 , ou produit de 4 par fon quarré-
C ’eft ainfi que fe forment les puiffances.
Aufti la racine quarrée de 16 eft-elle 4 ; car 4 eft ,
le quotient de 16 divifé par 4 : la racine cubique de
64 eft pareillement 4 ; car 4 eft le quotient de 64
divifé par r6, quarré de 4. C ’eft-là ce qu’on entend
par Y extraction des racines.
Par conféquent extraire la racine quarrée , cubique »
&c. d'un nombre donné, par exemple ,16 ou 64, c’eft
la même chofe que trouver un nombre, par exemple
4 , qui multiplié une ou deux fois, &c. par lui-
même,forme la puiffance donnée. V ^.-Pu issance.
Harris & Chambers.
Extraction des racines quarrée & cubique.
De la racine quarrée. Extraire la racine quarrée d'un
nombre, ç’eft décompofer un nombre quelconque ,
de façon que l’on trouve lin nombre moindre , lequel
multiplié par lui-même, produife exactement
le premier, ou du moins en approche le plus qu’il eft
poffible. Cette réglé eft d’ufage en plufieurs cas ; je
me contente d’en rapporter un exemple, pour faire
juger des autres. Un officier commande un détachement
de 615 hommes, dont il veut faire un bataillon
quarré : pour cela il n’a qu’à extraire la racine quarrée
de 615 ; il trouvera, s’il a le tems 6c le talent ;
qu’il faut mettre 15 hommes de front 6c autant fur
les côtés, c’eft à-dire qu’il faut mettre 15 rangs de
15 hommes chacun.
Sur quoi j’obferva que Y extinction des racines étant
proprement la décompofition d’un produit formé par
ï une ou plufieurs multiplications , il faut confiderer
d’abord la génération de ce produit, & c eft ce que
nous allons faire. > s ^
Si je multiplie 15 par , j ’ai le quatre 61J. Que
fais-je pour avoir ce produit ? je multiplie 2 dixaines
6c «» unités par 2 dixaines & 5 unîtes ; & P°yt cela
je prends d’abord le quarré des unîtes, en difant 5
fois 5 ou 5.X 5 font 25.