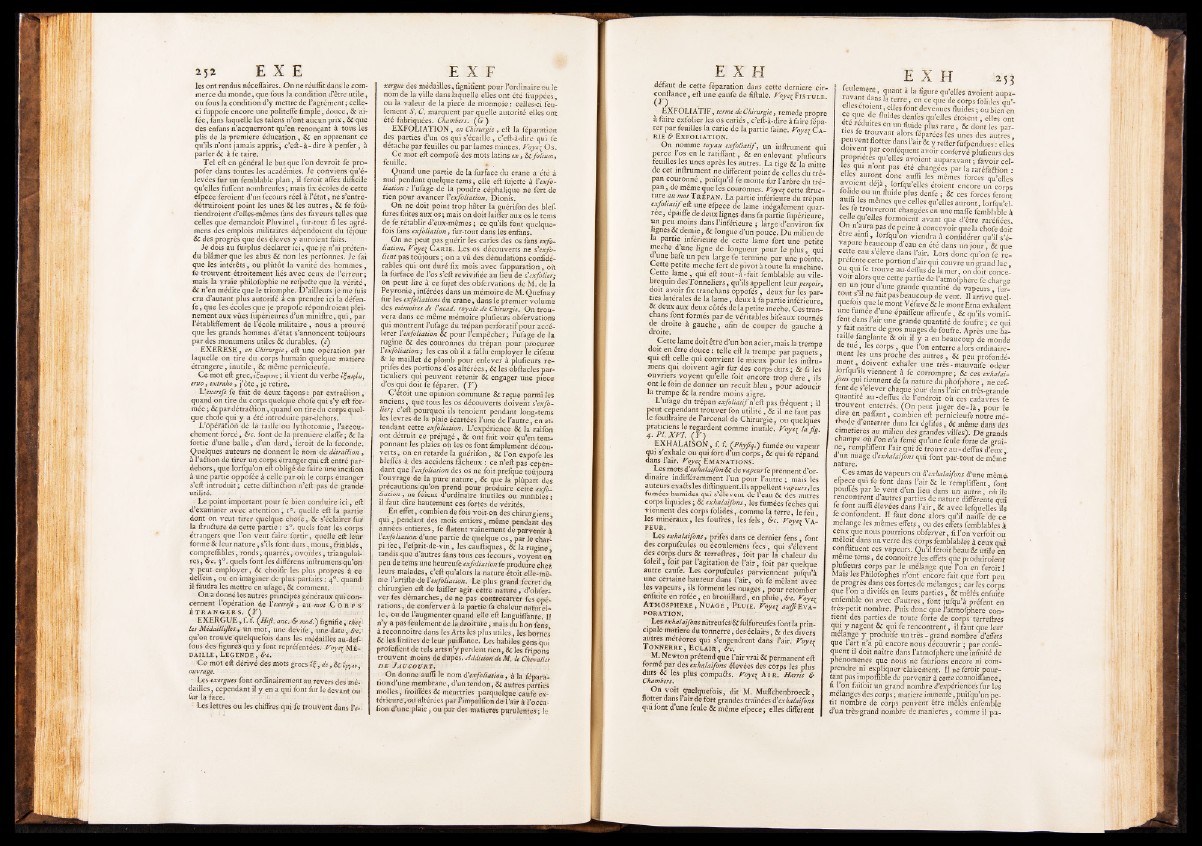
les ont rendus néceffaires. On ne réuffit dans le commerce
du monde, que fous la condition d’être utile,
ou fous la condition d’y mettre de l’agrément ; celle-
ci fuppofe encore une politeife fimple, douce, & ai-
fée,fans laquelle les talens n’ont aucun prix, & que
des enfans n’acquerront qu’en renonçant à tous les
plis de la première éducation , Sc en apprenant ce
qu’ils n’ont jamais appris, c’eft-à-dire à penfer, à
parler & à fe taire.
T el eft en général le but que l’on devroit le pro-
pofer dans toutes les académies. Je conviens qu’élevées
fur un femblable plan, il feroit allez difficile
qu’elles fuffent nombreuses ; mais lix écoles de cette
efpece feroient d’un fecours réel à l’état, ne s’entre-
detruiroient point les unes & les autres, & fe foii-
tiendroient d’elles-mêmes fans des faveurs telles que
celles que demandoit Pluvinel, fur-tout lî les agré-
mens des emplois militaires dépendoient du féjour
6c des progrès que des éleves y auroient faits.
Je dois au furplus déclarer ic i, que je n’ai prétendu
blâmer que les abus & non les perfonnes. Je fai
que les intérêts, ou plûtôt la vanité des hommes,
le trouvent étroitement liés avec ceux de l’erreur ;
mais la vraie philofophie ne refpeâe que la vérité,
& n’en médite que le triomphe. D ’ailleurs je me fuis
cru d’autant plus autorifé à en prendre ici iadéfen-
f e , que les écoles que je propôle répondroient pleinement
aux vues fupérieures d’un mmiftre, qui, par
l’établiffement de l’école militaire , nous a prouvé
que les grands hommes d’état s’annoncent toûjours
par des monumens utiles 6c durables, (e)
EXERESE, en Chirurgie, eft une operation par
laquelle on tire du corps humain quelque matière
étrangère, inutile, & même pernicieufe.
C e mot eft grec, i^eupt<nç ; il vient du verbe tÇctiptu,
eruo, extraho, j’ô te , je retire.
Uexerefefe fait de deux façons ; par extraftion,
quand on tire du corps quelque chofe qui s’y eft formée
; & par détraftion, quand on tire du corps quelque
chofe qui y a été introduite par-dehors. ■
L ’opération de la taille ou lythotomie, l’accouchement
forcé, &c. font de la première clalTe ; & la
fortie d’une balle, d’un dard, feroit de la fécondé.
Quelques auteurs ne donnent le nom de détracfion,
à l’attion de tirer un corps étranger qui eft entré par-
dehors, que lorfqu’on eft obligé de faire une incifion
à une partie oppofée à celle par où le corps étranger
s’eft introduit; cette diftinôion n’eft pas de grande
utilité.
Le point important pour fe bien conduire ic i, eft
d’examiner avec attention, i° . quelle eft la partie'
dont on veut tirer quelque chofe, & s’éclairer fur
la ftrufture de cette partie : 2°. quels font les corps
étrangers que l’on veut faire-fortir, quelle eft leur'
forme & leur nature, s’ils font durs, mous, friables,
comprelîibles, ronds, quarrés, ovoïdes, triangulaires,
&c. 3°. quels font les différens inftrumens qu’on- j
y peut employer, & choifir les plus propres à ce
deffein, ou en imaginer de plus parfaits : 40. quand-
il faudra les mettre en ufagé, & comment. ■ '
On a donné cernent l’operlaetsi oanu trdees principes généraux qui ConYexerefe
, au -mot -C o R P s-
É T R A N G -ER S. ( T )
EXERGUE , f. f. (Hijî. anc. & mod.) lignifié y
les MédaiUiJles-, Un mot, une deVife -, une date, &c. ‘ lqbuu’so:n d etrso- fuigvuér eqsu eqluqiu yef fooisn td raenpsr élefès nmtééédsa;i lles àû-dêf- -Voye? Médaille
»Légende , d*£.
1C e mot eft dérivé des mots grecs t f , de ,&c-ïpy6v,
ouvrage.
■ hes exergues font ordinairement au revers des médailles
, cependant il y en a qui font fur le devant ou-
fur la face.
; Les.lettres ou les chiffres-qui fe trouvent dans 1'ml
xirgue des médailles, fignifîent pour l’ordinaire ou le
nom de la ville dans laquelle elles ont été frappées,
ou la valeur de la piece de monnoie : celles-ci feulement
i 1. C. marquent par quelle autorité elles ont
été fabriquées. Chambers. (G )
EXFOLIATION, en Chirurgie , eft la féparation
des parties d’un os qui s’écaille , c’eft-à-dire qui fe
détache par feuilles ou par lames minces. Voye1 O s .
Ce mot eft compofé des mots latins ex, & folium,
feuille. *
Quand une partie de la furface du crâne a été à
nud pendant quelque tems, elle eft fujette à f exfoliation
: l ’ufage de la poudre céphalique ne fert de
rien pour avancer f exfoliation. Dionis.
On ne doit point trop hâter la guérifon des blef-
fures faites aux os ; mais on doit laiffer aux os le tems
de fe rétablir d’eux-mêmes ; ce qu’ils font quelquefois
fans exfoliation, fur-tout dans les enfans.
On ne peut pas guérir les caries des os fans exfoliation.
Voye^ C a r i e . Les os découverts ne s’exfolient
pas toûjours ; on a vu des dénudations considérables
qui ont duré fix mois avec fuppuration, où
la furface de l’os s’eft revivifiée au lieu de s’exfolier;
on peut lire à ce fujet des obfervations de M. de la
Peyronie, inférées dans un mémoire de M. Quefnay
fur les exfoliations du crâne, dans le premier volume
des mémoires de l ’acad. royale de Chirurgie. On trouvera
dans ce même mémoire plufieurs obfervations
qui montrent l’ufage du trépan perforatif pour accélérer
Y exfoliation 6c pour l’empêcher; l’ufage de la
rugine 6c des couronnes du trépan pour procurer
i Yzxfoliation ; les cas où il a fallu employer le cifeau
& le maillet de plomb pour enlever à plufieurs re-
prifes des portions d’os altérées, & les obftacles particuliers
qui peuvent retenir 6c engager une piece
d’os qui doit le féparer. ( F )
C ’étoit une opinion commune & reçue parmi les
anciens, que tous les os découverts doivent s’exfolier;
c’eft pourquoi ils tenoient pendant long-tems
les levres de la plaie écartées l’une de l’autre, en attendant
cette exfoliation. L’expérience & la raifon
ont détruit ce préjugé , & ont fait voir qü’en tem-
ponnant les plaies où les os font fimplement découverts,
on en retarde la guérifon, 6c l’on expofe les
blefles à dès accidens fâcheux : ce n’eft pas cependant
que l’exfoliation des os ne foit prefque toujours
l’ouvrage de la pure nature, 6c que la plûpart des
précautions qu’on prend pour produire cette exfoliation
, ne foient d’ordinaire inutiles ou nuifibles ;
il faut dire hautement ces fortes de vérités.
En effet, combien de fois voit-on des chirurgiens
qui >'pendant des mois entiers, même pendant des
années entières, fe flatent vainement de parvenir à
Yexfoliadond’une partie de quelque o s , par le char-
pi fec, l’efprit-de-vin, les cauftiques, & la rugine,
tandis .que d’autres fans tous ces lècours, voyent en
peu de tems une heureufe exfoliation fe produire ch et
leurs malades, c’eft qu’alors la nature étoit elle-mê-*-
me l’artiftede Y exfoliation. Le plus grand fecref du
chirurgien eft de laiffer agir- cette nature, d’obfer-
ver fes démarches, de ne pas contrecarrer feS opérations,
de conferver à la partie fa chaleur naturelle
» ou de Faugmenter quand elle eft laneuiftante. Il
n’y a pas feulement de la droiture, mais du bon fens
à reconnoître dans les Arts les plus utiles, les bornes
& leslitriites de leur puiffartce. Les habiles géns-qui
profeffentde tels a rts n’y perdent rien, 6c les fripons
trouvent fnoins de dupes. Addition de M. U Chevalier
D E J A V CO U R T .
- On donne aufli le nom d’exfoliation, à la féparà-
tion-d’une membrane, d’un tendon, & autres parties
molles; froiffées & meurtries parquelque caufe èx-
térieure ,-oiraltérées pat FimpÉilfion d e l’aïr à l’occa-
fion d’une ;plaie, ou par des matières purulentes ; le
defaut de cette féparation dans cette derniere cir-
conftance, eft une caufe de fiftulë. Voye^ Fistule.
EXFOLIATIF, terme de Chirurgie, remede propre
à faire exfolier les os cariés, c’eft-à-dire à faire fépa.
rer par feuilles la carie de la partie faine. Voyer Ca- rie & Exfoliation.
On nomme tuyau exfoliatif, un infiniment qui
perce 1 os en le ratifiant, 6c en enlevant plufieurs
feuilles les unes après les autres. La tige & la mitte
de cet mftrument ne different point de celles du trépan
couronne, puifqu’il fe monte fur l’arbre du trépan
, de meme que les couronnes. Voyei cette ftruc-
ture aa ^ « T répan. La partie inférieure du trépan
exfoliatif eft une efpece de lame inégalement quar-
ree, epaifle de deux lignes dans fa partie fupérieure,
un peu moins dans l’inférieure ; large d’environ fix
lignes & demie, & longue d’un pouce. D u milieu de
la partie inferieure de cette lame fort une petite
meche d’une ligne de longueur pour le plus, qui
d une bafe un peu large fe termine par une pointe.
Cette petite meche fert de pivot à toute la machine.
Cette lame, qui eft tout-à-fait femblable au vilebrequin
desTonneliers, qu’ils appellent leur perçoir,
doit avoir fix tranchans oppofés , deux fur les parties
latérales de la lame, deux à fa partie inférieure,
& deux aux deux côtés de la petite mèche. Ces tranchans
font formés par de véritables bifeaux tournés
de droite à gauche, afin de couper de gauche à
droite. 0
Cette lame doit être d’un bon acier, mais la trempe
doit en etre douce ; telle eft la trempe par paquets,
qui eft celle qui convient le mieux pour les inftrii-
mens qui doivent agir fur des corps durs ; & fi les
ouvriers voyent qu’elle foit encore trop dure , ils
ont le foin de donner un recuit bleu, pour adoucir
la trempe & la rendre moins aigre.
L’ufage du trépan exfoliatif n’eft pas fréquent ; il
peut cependant trouver fon utilité, & il ne faut pas
le fouftraire de 1 arcenal de Chirurgie, ou quelques
praticiens le regardent comme inutile. Voye7 la fie. 4’ PI. X V I . ( F ) 1 ë
quiE sX’eHxhAaLleA oIuS OquNi ,f of.r tf-.d ’(uPnh ycfoirqp.)s ,f umée ou vapeur dans l’air. Voyeç E 6c qui fe répand manations.
Les mots d’exhalaifon & de vapeur fe prennent d’ordinaire
indifféremment l’un pour l’autre ; mais les
auteurs exafrs les diftinguent.Ils appellent vapeurs,les
fumées humides qui s’elevent de l’eau & dès autres
Corps liquides ; & exhalaifons, les füméés feches qui
viennent deà corps folides,- comme la terre, le feu
les minéraux, les foufres, les fels, &c. Voyez Vapeur.
Les exhalaifons, prifes dans ce dernier fens , font
des corpufcules ou écoulemèns fecs, qui s’élèvent
des corps durs & têiteftres ,- foit par la chaleur du
folerl, foit par l’âgitatiôn do l’air, foit par quelque
autre caufe. Les corpufcules parviennent jufqu’à
une certaine hauteur dans l’air, où fe mêlant avec
les vapeurs, ils forment les nuages, pdur retomber
enftiite en rôfée, en brouillard, en p luie, &c. Voyez Atmosphère, Nuàgé , Pluie. Vèyeç aufli Evaporation.
cipLaeles emxhatailèariefo dnus tnoitnrenuefrerSe ,& d éflsi léfculraeiuffsè, s& fo dretts l ad ipvreinrs
autres météores qui s’engendrent dans l’air. Voyez Tonnerre, Eclair, & c.
M. Newton prétend que l’air vrai & permanent eft
formé par deS exhalaifons élevées des corps les plus
durs & les plus compaûs. Voye^ A i r . Harris &
Chambers.
On voit ^quelquefois, dit M. Muflchenbrôeck,
flotter dans l’air de fort grandes traînées d’exhalaifons
qui font d une feule & même efpece ; elles different
» 3uant ^ k* figure qu’elles avoient atipa-
ravant dans la terre, en ce que de corps folideS qu’elles
etoient, elles font devenues fluides : ou bien en
BBISMSI “ e fluides derifes qu’elles étoient, elles ont
été réduites en un fluide plus rare, & dont les parties
<e trouvant alors «paréesles unes des antres,
peuvent flotter dans l’air ôc y relier fufpendues : elles
doivent par conséquent avoir confervé plufieurs des
propriétés qu elles avoient auparavant ; fâvoir celles
qui nont pas été changées par la raréfeSion :
elles auront donc aufli lès mêmes forces qu’elles
avoient déjà , iorfqu’eües, étoient encore un corps
iofide ou un fluide plus denfe ; & ces forces ferom
auih les memes que celles qu’elles auront, lorfqu’el-
,, trf«veront changées en une maffe femblable à
celle <ju elles formoient avant que d’être raréfiées.
On n aura pas de peine à concevoir que la chofe doit
etre amli, lorfqu’on viendra à confidérer qu’il s’évapore
beaucoup d’eau en été dans un jou r, 6c que
cette eau s eleve dans l’air. Lors donc qu’on fe re-
preiente cette portion d’air qui couvre un grand lac ,
ou qui fe trouve au-defliis de la mer, on doit concevoir
alors que cette partie de l’atmofphere fe charge
en un jour d une grande quantité de vapeurs , fur-
tout s il ne fait pas beaucoup de vent. Il arrive quel-
querois c^ue le mont Véfuve & le mont Etna exhalent
une fumee d’une épaifièur affreufe, & qu’ils vomif-
lent dans 1 air une grande quantité de foufre ; ce qui
y lait naître de gros nuages de foufre. Après une bataille
fanglante & où il y a eu beaucoup de monde
de tue, les corps , que l’on enterre alors ordinairement
les uns proche des autres , & peu profondc-
ment doivent exhaler une très - mauvaife odeur
lonqu ils viennent à fe corrompre ; & ces exhalai-
Jons qui tiennent de la nature du phofphôre, ne cef-
lent de s elever chaque jour dans l’air en très-grande
quantité au-deffus de l’endroit où ces cadavres fe
trouvent enterrés. (On peut juger d e - là , pour le
™ ej en pâflant, combien eft pernicieufe notre méthode^
d enterrer dans les égliles, & même dans des
cimetières au milieu des grandes villes). De grands
champs où l’on n’a femé qu’une feule forte de graine,
rempliflent l’air qui fé trouve au-deffus d’eux,,
d un nuage $ exhalaifons qui font par-tout de même
nature.
Ces amas de vapeurs ou d’exhalaifons d’üne même
efpece qui fe font dans l’air & le rempliffént, font
pouffes par le vent d’un lieu dans un autre, où ils
rencontrent d’autres parties de nature différente qui
fe font aufli élevées dans l’air, 6c avec lefqitelles ils
fe confondent. Il faut donc alors g j§ j naiffe'de ce
mélangé les mêmes effets, ou des effets femblables à
ceux guenons pourrions obferver, fi l’on verfoit ou
mêloit dans un verre des corps femblables à ceux qui
conftituent ces vapeurs. Qu’il feroit beau & utile en
même tems, de connoître les effets qttè 'produiroient
plufieurs corps par le mélange que l’on en feroit !
Mais lés Philofophes n’bnf encore fait que for t peu
de progrès dans ces fortes de mélanges ; car les corps
que l’on a divifés en leurs parties, & mêlés enfuite
enfemble ou avec d’autres, font jufqu’à préfent en
tres-petit nombre. Puis donc quê l’atmofphere contient
des parties de toute forte de Corps'terieftres
qui y nagent 6c qui fe rencontrent, il faut que leur
mélangé y produife un très - grand nombre d’effets
que l’art n’a pû encore nous découvrir ; par cônfé-
quent il doit naître dans l’atttiofphere ühe infinité de
phenomenés que nous né fâûfions encore ni comprendre
ni expliquer •clairement. Il ne feroit pourtant
pas impomble de parvenir à cette connoiffance,
fi l’on faifoit un grand nombre d'expériences fur les
mélangés des' corps ; matière immenfè, puifqu’un petit
nombre de corps peuvent être mêlés enfemble
d’un très-grand nombre de maniérés, comme ii pa