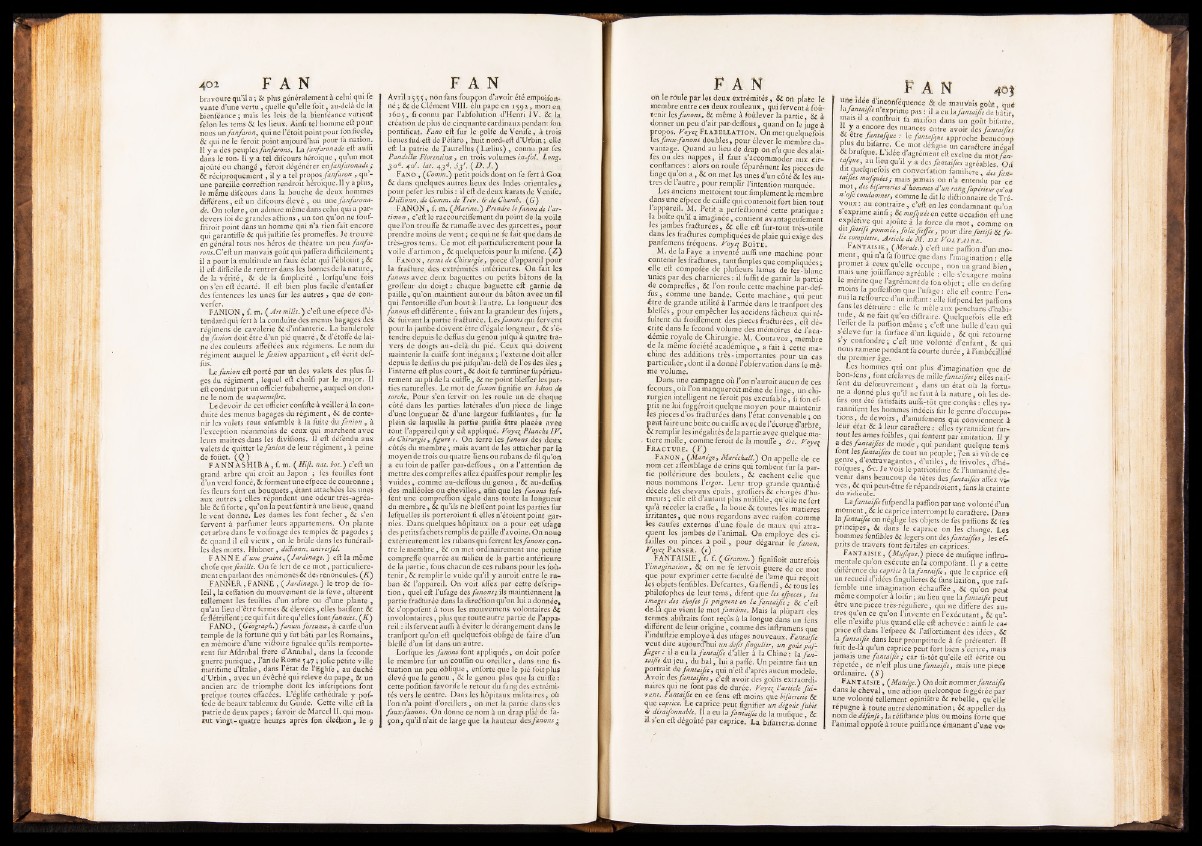
bravoure qu’il a ; & plus généralement à celui qui Te
vante d’une vertu, quelle qu’elle fo it , au-delà de la
bienféance ; mais les lois de la bienféance varient
félon les tems 6c les lieux. Ainfi tel homme eft pour
nous un fanfaron, qui ne l’étoit point pour fonfiecle,
& qui ne le feroit point aujourd’hui pour fa nation.
Il y a des peuples fanfarons. La fanfaronade eft aufli
dans le ton. Il y a tel difcours héroïque, qu’un mot.
ajouté ou changé , feroit dégénérer en fanfaronadt ;
6c réciproquement, il y a tel propos fanfaron , qu -
une pareille correélion rendroit héroïque. Il y a plus,
le meme difcours dans la bouche de deux nommes
différons, eft un difcours élevé , ou une fanfaronade.
On toléré, on admire même dans celui qui a par-
devers foi de grandes aâions , un ton qu’on ne fouf-
friroit point dans un homme qui n’a rien fait encore
qui garantiffe 6c qui juftifie fes promefl'es. Je trouve
en général tous nos héros de théâtre un peu fanfarons:
C ’eft un mauvais goût qui paffera difficilement ;
il a pour la multitude un faux éclat qui l’ébloiiit ; 6c
il eft difficile de rentrer dans les bornes de la nature,
de la vérité, & de la fimplicité , lorfqu’une fois
on s’en eft écarté. Il eft bien plus facile d’entaffer
des fentences les unes fur les autres, que de con-
verfer. : j
FANION, f. m. ( Art milit. ) c’eft une efpece d’étendard
qui fert à la conduite des menus bagages des
régimens de cavalerie 6c d’infanterie. La banderole
du fanion doit être d’un pié quarré, & d’étoffe de laine
des couleurs affeélées aux régimens. Le nom du
régiment auquel le fanion appartient, eft écrit def-
fus.
T f fanion eft porté par un des valets des plus fa-
ges du régiment, lequel eft choifi par le major. II
eft conduit par un officier fubalterne, auquel on donne
le nom de waquemejlre.
Le devoir de cet officier confifte à veiller à la conduite
des menus bagages du régiment, 6c de contenir
les valets tous enlemble à la fuite du fanion , à
l’exception néanmoins de ceux qui marchent avec
leurs maîtres dans les divifions. Il eft défendu aux
valets de quitter le fanion de leur régiment, à peine
de foiiet. (Q )
FAN N A SH IB A , f. m. W jjw nat‘ c’eft un
grand arbre qui croît au Japon ; fes feuilles font
d’un verd foncé, & forment une efpece de couronne ;
fes fleurs font en bouquets, étant attachées les unes
aux autres ; elles répandent une odeur très-agréable
& fi forte, qu’on la peut fentir à une lieue, quand
le vent donne. Les dames les font fecher, 6c s’en
fervent à parfumer leurs appartemens. On plante
cet arbre dans le voifinage des temples 6c pagodes ;
& quand il eft v ieu x , on le brûle dans les funérailles
des morts. Hubner , diclionn. univerfel.
F ANN E d'une graine, ( Jardinage. ) eft la même
chofe que feuille. On fe fert de ce mot, particulièrement
en parlant des anémones 6c des renoncules. (JC)
FANNER, FANNÉ , ( Jardinage.) le trop de lo-
le il, la ceffation du mouvement de la feve, altèrent
tellement les feuilles d’un arbre ou d’une plante ,
qu’au lieu d’être fermes & élevées, elles baillent 6c
le flétriffent ; ce qui fait dire qu’elles font fannèes. (JC)
FANO , (Géograph.) fanum fortunoe, à caufe d’un
temple de la fortune qui y fut bâti par les Romains,
en mémoire d’une viétoire fignalée qu’ils remportèrent
fur Afdrubal frere d’Annibal, dans la fécondé
guerre punique, l’an de Rome J47 ; jolie petite ville
maritime d’Italie, dans l’état ae l’Eglife , au duché
d’Urbin, avec un évêché qui releve du pape, & un
ancien arc de triomphe dont les inferiptions font
prefque toutes effacées. L’églife cathédrale y pof-
fede de beaux tableaux du Guide. Cette ville eft la
patrie de deux papes ; favoir de Marcel II. qui mourut
vingt- quatre heures après fon élection , le 9
Avril 15 f Ç, non fans foupçon d’avoir été empoifort-
né ; 6c de Clément VIII. élu pape en 15 9 1 , mort en
1605, fi connu par l’abfolution d’Henri IV . & la
création de plus de cinquante cardinaux pendant fon
pontificat. Fano eft fur le golfé de V enife, à trois
lieues fud-eft de Péfaro, huit nord-eft d’Urbin ; elle
eft la patrie de Taurellus (Lælius) , connu par fes
Pandecloe Florentins, en trois volumes in-fol. Long.
j o d. 40'. lat. 43 d. 5f . ( D . J. )
Fano , ( Comm.) petit poids dont on fe fert à Goa.
6c dans quelques autres lieux des Indes orientales y
pour peler les rubis : il eft de deux karats de Venife«
Diclionn. de Comm. de Trév. & de Çhamb. (G)
FANON, f. m. (Marine.) Prendre le faconde l'artimon
, c’eft le raccourciffement du point de la voile
quei’on trouffe 6c ramaffe avec des garcettes, pour
prendre moins de vent ; ce qui ne fe fait que dans de
très-gros tems. Ce mot eft particulièrement pour la
voile d’artimon, 6c quelquefois pour la mifene. ( Z )
Fa n o n , terme de Chirurgie, piece d’appareil pour
la fraéfure. des extrémités inférieures. On fait les
fanons avec deux baguettes ou petits bâtons de la
groflëur du doigt : chaque baguette eft garnie de
paille, qu’on .maintient autour du bâton avec un fil
qui l’entortille d’un bout à l’autre. La longueur des
fanons eft différente, fuivant la grandeur des fujets,
6c fuivant la partie fraéfurée. Les fanons qui fervent
pour la jambe doivent être d’égale longueur, &c s’étendre
depuis le deffus du genou jufqu'à quatre travers
de doigts au-delà du.pié*; Ceux qui doivent
maintenir la cuiffe font inégaux ; l’externe doit aller
depuis le deffus du pié jüfqu’au-delà de l’os des îles ;
l’interne eft plus court, 6c doit fe terminer fupérieu-
rement au pli de la cuiffe •, 6c ne point bleffer les parties
naturelles. Le mot de fanon fignifie un bâton du,
torche. Pour s’en fervir on les roule un de chaque
côté dans les parties latérales d’un piece de linge
d’une longueur 6c d’une largeur fuffifantes, fur le
plein de laquelle la partie puiffe être placée avec
tout l’appareil qui y eft appliqué. Voye{ Planche IV.
de Chirurgie, figure t. On ferre les fanons des ;deux
côtés du membre ; mais avant de les attacher par le
moyen de trois ou quatre liens ou rubans de fil qu’on
a eu foin de paffer par-deffous, on a l’attention de
mettre des compreffes affez épaiffes pour remplir les
vuides, comme au-deffous du genou , 6c au-deffus
des malléoles ou chevilles, afin que les fanons faf»
fent une compreffion égale dans toute la longueur
du membre, 6c qu’ils ne bleffent point les parties fur
lefquelles ils porteroient fi elles n’étoient point garnies.
Dans quelques hôpitaux on a pour cet ulage
des petits fachets remplis de paille d’avoine. On noue
extérieurement les rubans qui ferrent les fanons contre
le membre , 6c on met ordinairement une petite
compreffe quarrée au milieu de la partie antérieure
de la partie, fous chacun de ces rubans pour les foû-
tenir, & remplir le vuide qu’il y auroit entre le ruban
6c l’appareil. On voit affez par cette deferip-
tion, quel eft l’ufage des fanons; ils maintiennent la
partie fra&urée dans la direétion qu’on lui a donnée,
6c s’oppofent à tous les mouvemens volontaires ÔJ
involontaires, plus que toute autre partie de l’appareil
: ils fervent aufli a éviter le dérangement dans le
tranfport qu’on eft quelquefois oblige de faire d ’un
bleffé d’un lit dans un autre.
Lorfque les fanons font appliqués, on doit pofer
le membre fur un couffin ou oreiller, dans une fi-
tuation un peu oblique, enforte que le pié foit plus
élevé que le genou , 6c le genou plus que la cuiffe :
cette pofition favorife le retour du fang des extrémités
vers le centre. Dans les hôpitaux militaires, où
l’on n’a point d’oreillers, on met la partie dans des
faux-fanons. On donne ce nom à un drap plié de façon
, qu’il n’ait de large que la hauteur des fanons ^
oh le foule par les deüx extrémités, & ort plate té
imembre entre ces deux rouleaux, qui fervent à fofc
tenir les fanons, 6c même à fbûlever la partie, & à
donner un peu d’air par-deffous, quand on le juge à
propos. Voye{ Fl a b e l l a t io n . On met quelquefois
les faux-fanons doubles y pour élever le membre davantage.
Quand au lieu de drap on n’a que des alài-
fes ou des nappes, il faut s’accommoder aux eir^
confiances : alors on roule féparément les pièces de
linge qu’on a , & oh met les unes d’un côté 6c les aur
lies de 1 autre, pour remplir l’intention marquée.
Les anciens mettaient tout Amplement le membre
dans une efpece de caiffe qui contenoit fort bien tout 1 appareil.^M. Petit a perfectionné cette pratique:
la boite qu il a imaginée, contient avantageufement
les jambes fraClurees, & elle eft fur-tout très-utile
dans les fradures compliquées de plaie qui exige des
paniemens fféquens. Voye^ Bo ît e .
M. de la Faye a inventé aufli une machine pour
contenir les fraâures, tant fimples que compliquées ;
elle eft compofée de plufieurs lames de fer-blanc
unies par des charnières : il fuffit de garnir la partie
de compreffes, & l’on roule cette machine par-def-
fu s , comme une bande. Cette machine, qui peut
être de grande utilité à l’armée dans le tranfport des
bleffés, pour empêcher les accidens fâcheux qui réfutent
du froiffement des pièces fraâurées, eft décrite
dans le fécond volume des mémoires de l’académie
royale de Chirurgie. M. Coutavoz, membre
de la même fociété académique, a fait à cette machine
des additions très-importantes pour un cas
particulier, dont il a donné l’obfervation dans le même
volume.
Dans une campagne où l’on n’auroit aucun de ces
fecours, où l’on manqueroit même de linge, un chirurgien
intelligent ne feroit pas excufable, fi fon ef-
prit ne lui fuggéroit quelque moyen pour maintenir
les pièces d’os ffa&urées dans l’état convenable ; on
peut faire une boîte ou caiffe avec de l’écorce d’arbre,
& remplir les inégalités delà partie avec quelque matière
molle, comme feroit de la moufle , &c. Voyez
F r a c t u r e . ( Y )
Fa n o n , (Manège, Maréchall.) On appelle de ce
nom cet affemblage de crins qui tombent fur la partie
poftérieure des boulets, 6c cachent celle que
nous nommons l’ergot. Leur trop grande quantité
décele des chevaux épais, groffiers 6c chargés d’humeurs
; elle eft d’autant plus nuifible, qu’elle ne fert
tju’à réceler la craffe, la boue 6c toutes les matières
irritantes, que nous regardons avec raifon comme
les caufes externes d’une foule de maux qui attaquent
les jambes de l’animal. On employé des ci-
failles ou pinces à p o il, pour dégarnir le fanon.
Voye{ P a n s e r , (e)
FANTAISIE, f. f. ( Gramm. ) fignifioit autrefois
Ximagination, 6c on ne fe fervoit guere de ce mot
que pour exprimer cette faculté de l’ame qui reçoit
les objets fenfibles. Defcartes, Gaffendi, 6c tous les
philofophes de leur tems, difent que les ejbeces, Us
images des chofes fe peignent en la fantaijie ; 6c e’eft
de-là que vient le mot fantôme. Mais la plupart des
termes abftraits font reçus à la longue dans un fens
différent de leur origine, comme des inftrumens que
l’induftrie employé a des ufages nouveaux. Fantaijie
veut dire aujourd’hui un dejir Jingulier, un goût paj-
f aëer •' 11 a eu la fantaijie d’aller à la Chine : la fantaijie
du je u , du b a l, lui a paffé. Un peintre fait un
portrait de fantaijie , qui n’eft d’après aucun modèle.
Avoir des fantaifies , c’eft avoir des goûts extraordinaires
qui ne font pas de durée. Voyeç l'article fuivant.
Fantaijie en ce fens eft moins que bifarrerie &
que caprice. Le caprice peut lignifier un dégoût fubit
& déraifonnable. Il a eu ia fantaijie de la mufique, &
il s en eft dégoûté par caprice. La bifarrerie. donne
«né idée ffincortféqüence & de mauvais goût qué
t e fa n t a i j i e rt exprime pas : il a eu la f a n t a i j i e dé bâtir*
mais il a eonftruit fa maifon dans un goût bifarre.
II y a encore des nuances entre avoir des f a n t a i f i e s
I ,et J? V ntaf q u e : le fa n ta fq u e approche beaucoup
g i s du bifarre. Ce mot défigne un caraélere inégal
otbrufque. L idee d agrément eft exclue du mot far*
t a jq u e , au heu qu il y a d e s f a n t a i f i e s agréables. Orf
ait quelquefois en converfation familière, d e s fari*
ta j u s m u fq u é e s ; mais jamais on n’a entendu par ce
mot, d e s b ifa r r e r ie s d 'h om m e s d 'u n r a n g fu p é r ie u r q u ’ o n
n o fe c o n d am n e r , comnie le dit le dictionnaire de Tré-
voux : au contraire, c’eft en les condamnant qu’on
s exprime ainfi ; & m u fq u è e en cette occafion eu une
expletive qui ajoute à la force du mot, comme on
dit J o t t i f e p om m é e , f o l i e f i e f f é e , pour dire f o t t i f e 6 c f o l
i e c om p le t te . A r t i c l e d e M . d e V o l t a i r e .
Fa n t a i s i e , (Morale.) c’eft une paflion d’un moment
, qui n’a fa fource que dans l’imagination : elle
promet à ceux qu’elle occupe, non un grand bien «
mais une jouiffance agréable : elle s’exagere moins
le mente que l’agrément de fon objet ; elle en defire
moins la poffeflion que l’ufage : elle eft contre l’ennui
la reffource d’un inftant : elle fufpend les pallions
fans les dérruire : elle fe mêle aux penchans d’habit
î j i ÿ ’ & ne fait qu’en diftraire. Quelquefois elle eft
1 effet de la paflion même ; c’eft une bulle d ’eau qui
s^eleve fur la furface d’un liquide , 6c qui retourné
s y confondre ; c’eft une volonté d’enfant, 6c qui
nous ramene pendant fa courte durée, à l’imbécillité
du premier âge.
Les hommes qtii ont plus d’imagination que dé
bon-fens, font efclaves de mille fantaijies; elles naif-
fent du defoeuvrement, dans un état où la fortune
a donne plus qu’il ne faut à la nature, où les de-
firs ont été fatisfaits aufli-tôt que conçûs : elles ty-
rannifent les hommes indécis fur le genre d’occupations,
de devoirs j d’amufemens qui conviennent à
leur état & à leur caraélere : elles tyrannifent fur-
tout les âmes foibles, qui fentent par imitation. Il y
a des fantaijies de m ode, qui pendant quelque terni
font les fantaijies de tout un peuple ; j’en ai Vû de ce
genre, d extravagantes, d’utiles, de frivoles, d’héroïques
, &c. Je vois le patriotifme 6c l’humanité devenir
dans beaucoup de têtes des fantaijies affez v i ves
, & qui peut-être fe répandroient, fans la crainte
du ridicule.
La fantaijie fufpend la paflion par une volonté d’un
moment, 6c le caprice interrompt le cara&ere. Dans
la fantaijie on néglige les objets de fes pallions 6c fes
principes, & dans le caprice on les change. Les
hommes fenfibles 6c légers ont des fantaijies t les ef-
prits de travers font fertiles en caprices.
Fa n t a i s i e , (Mujique.) piece de mufique inftru-
mentale qu’on exécute en la compofant. Il y a cette
différence du caprice à la fantaijie, que le caprice eft
un recueil d’idées fingulieres 6c fans liaifon, que raf-
femble une imagination échauffée, 6c qu’on peut
meme compofer à Ioifir j au lieu que la fantaijie peut
être une piece très-réguliere, qui ne différé des autres
qu’en Ce qu*on l’invente en l’exécutant, 6c quelle
n’exifte plus quand elle eft achevée : ainfi le cas
price eft dans l’efpece 6c l’affortiment des idées, 6c
lafantaijie dans leuf promptitude à fe pfé/enter. Il
fuit dedà qu’un caprice peut fort bien s’écrire, mais
jamais une fantaijie ; car fi-tôt qu’elle eft écrite ou
repetée, ce n’eft plus une fantaijie, mais une piece
ordinaire. (S )
Fa n t a i s i e , (Manège.) On doit nommer fantaijie
dans le cheval, une aâion quelconque fuggérée par
une volonté tellement opiniâtre & rebelle, qu’elle'
répugne à toute autre dénomination; 6c appeller du
nom de défenfe, la réfiftance plus ou moins forte que
l’animal oppolè à toute puiffance émanant d’une v<*