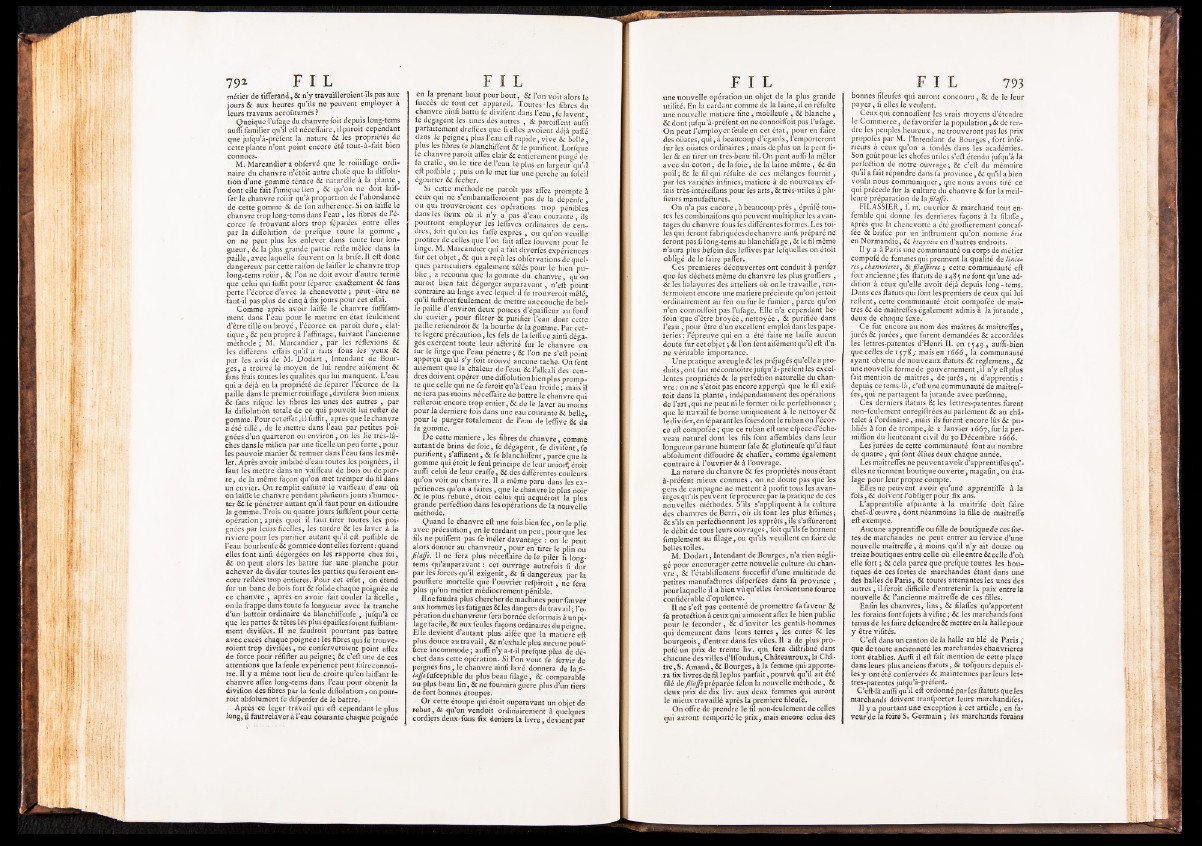
métier de tifferand, & n’y travailleroient-ils pas aux
jours & aux heures qu’ils ne peuvent employer à
leurs travaux accoutumés ?
Quoique l’ufage du chanvre Toit depuis long-tems
auffi familier qu’il eft néceffaire, il paroît cependant
que jufqu’à-préfent la nature 8c les propriétés de
cette plante n’ont point encore été tout-à-fait bien
■ connues-.
M. Marcandier a obfervé que le roiiiffage ordinaire
du chanvre n’étoit autre chofe que la diffolution
d’une gommé tenace 8c naturelle à la plante ,
dont elle fait l’unique lien , 8c qu’on ne doit laif-
fer le chanvre roiiir qu’à proportion de 1 abondance
de cette gomme & de fon adhérence. Si on laide le
chanvre trop long-tems dans l’eau , les fibres de 1 e-
corce fe trouvant alors trop féparées entre elles
par la diffolution de prefque toute la gomme ,
on ne peut plus les enlever dans toute leur longueur,
8c la plus grande partie refte mêlée dans la
paille, avec laquelle fouvent on la brife. Il eft donc
dangereux par cette raifon de laiffer le chanvre trop
long-tems roiiir, & l’on ne doit avoir d’autre terme
que celui qui fuffit pour féparer exactement 8c fans
perte l’écorce d’avec la chenevotte ; peut - être ne
faut-il pas plus de cinq à fix jours pour cet effai.
Comme après avoir laide le chanvre fuffifam-
ment dans l’eau pour le mettre en état feulement
d’être tillé ou broyé, l’écorce en paroît dure, élaf-
tique, 8c peu propre à l’affinage, fuivant l’ancienne
méthode ; M. Marcandier, par les réflexions 8c
les différens effais qu’il a faits fous les yeux 8c
par les avis de M. Dodart , Intendant de Bourges
, a trouvé le moyen de lui rendre aifément 8c
fans frais toutes les qualités qui lui manquent. L’eau
qui a déjà eu la propriété de.féparer l’écorce -de la
paille dans le premier roiiiffage ,divifera bien mieux
& fans rifque les fibres les unes des autres , par
la diffolution totale de ce qui pouvoit lui refier de
gomme. Pour cet effet, ilfuffit, après que le chanvre
a été tillé-, de le mettre dans l’eau par petites poignées
d’un quarteron ou environ, on les lie très-lâches
dans le milieu par une ficelle un peu forte, pour
les pouvoir manier 8c remuer dans l’eau fans les mêler.
Après avoir imbibé d’eau toutes les poignées, il
faut les mettre dans un vaiffeau de bois ou de pierre,
decla même façon qu’on met tremper du fil dans
un cuvier. On remplit enfuite le vaiffeau d’eau où
on laiffe le chanvre pendant plufieurs jours s’humecter
& fe pénétrer autant qu’il faut pour endiffoudré
la gomme. Trois ou quatre jours fuffifent pour cette
opération ; après quoi il faut tirer toutes les poignées
par leurs ficelles, les tordre 8c les laver à la
riviere pour les purifier autant qu’il efl poflîble de
Peau bourbeufe 8c gomméé dont elles fortent : quand
elles font ainfi dégorgées on les rapporte chez foi ,
8c on peut alors les battre fur une planche pour
achever de divifer toutes les parties qui feroient encore
.refiées trop entières. Pour cet effet, on étend
fur un banc de bois fort 8c folide chaque poignée de
ce .chanvre , après en avoir fait couler la ficelle,
on ia frappe dans toute fa longueur avec la tranche
d’un battoir ordinaire de blanchiffeufe , jufqu’à ce
que les pattes & têtes lés plus épaiffesfoient fuffifam-
ment divifees. Il ne faudroit pourtant pas battre
avec excès chaque poignée : les fibres qui fe' trouveraient
trop divifees-,- ne conferveroient point affez
de force pour réfifler au peigne; 8c c’eft une de ces
attentions que la feule expériencè peut faire connoî-
tre. Il y a même tout lieu de croire qu’en laiffant le
chanvre affez long-tems dans l’eau pour obtenir la
divifion des fibres par la feule diffolution, on:pourrait
abfohiment fe difpenfer de le battre.
Après >ee leger travail qui efl cependant le plus
long, d faut relaver à l’eau courante chaque poignée
en la prenant bout pour bout, & l’on voit alors le
fuccès de tout cet appareil. Toutes‘ les fibres du
chanvre ainfi battu fe divifent dans l’eau, fe lavent
fe dégagent les unes des autres , & paroiffent aufîî
parfaitement dreffées que fi elles avoient déjà paffé
dans le peigne ; plus l’eau efl rapide, vive & belle,
plus les fibres fe blanchiflent & iè purifient. Lorfque
le chanvre paroît affez clair 8c entièrement purgé de
fà craffe, on le tire de l’eau le plus en largeur qu’il
efl poffible ; puis on le met fur une perche au foleil
égoutter 8c fécher.
Si cette méthode ne paroît pas affez prompte à
ceux qui ne s’embarrafferaient pas de la dépenfe ,
ou qui trouveraient ces opérations trop pénibles
dans les lieux ou il n’y a pas d’eau courante, ils
pourront employer les leffives ordinaires de cendres,
foit qu on les faffe exprès , ou qu’on veuille
profiter de celles que l’on fait affez fouvent pour le
linge. M. Marcandier qui a fait diverfes expériences
fur cet objet, 8c qui a reçu les obfervations de quelques
particuliers également zélés pour le bien public
, a reconnu que la gomme du chanvre, qu’on
aurait bien fait dégorger auparavant, n’efl point
contraire au linge avec lequel il fe trouverait mêlé,
qu’il fuffiroit feulement de mettre une couche de belle
paille d’environ deux pouces d’épaiffeur au fond
du cuvier, pour filtrer & purifier l’eau dont cette
paille retiendrait 8c la bourbe & la gomme. Par cette
legere précaution, les fels de la leffive ainfi dégagés
exercent toute leur aftivité fur le chanvre ou
lur le linge que l’eau pénétré ; 8c l’on ne s’efl point
apperçû qu’il s’y foit trouvé aucune tache. On fent
aile ment que la chaleur de l’eau & l’alkali des cendres
doivent opérer une diffolution bien plus prompte
que celle qui ne fe ferait qu’àTeau froide ; mais il
ne lera pas moins néceffaire de battre le chanvre qui
relierait -encore trop entier, & de lé laver au moins
pour la derniere fois dans une eau courante & belle,
pour le purger totalement de l’eau de leffive & de
fa gomme.
De cette maniéré, les fibres du chanvre, comme
autant de brins de foie, fe dégagent, fe divifent, fe
purifient, s’affinent, & fe blanchiffent, parcè que la
gomme qui étoit le feul principe de leur unioif, étoit
auffi celui de leur craffe, 8c des différentes couleurs
qu’on voit au chanvre. Il a même paru dans les expériences
qu’on a faites, que le chanvre le plus noir
8c le plus rebuté, étoit celui qui acquérait la plus
grande perfe&ion dans les opérations de la nouvelle
méthode.
Quand le chanvre efl une fois bien fec, on le plie
avec précaution, en le tordant un peu, pour que les
fils ne puiffent pas fe mêler davantage : on le peut
alors donner au chanvreur, pour en tirer le plin ou
filaffe. Il ne fera plus néceffaire de le piler fi long-
tems qü’auparavant : cet ouvrage autrefois fi dur
par lés forcés qu’il exigeoit, & fi dangereux par la
pouffiere mortelle que l’ouvrier refpiroit, ne fera
plus qu’un métier médiocrement pénible.
Il ne faudra plus chercher de machines pour faiiver
aux hommes les fatigues & les dangers du travail ; l’opération
du chanvreur fera bornée déformais à unpi-
lage facile, 8c aux feules façons ordinaires du peigne.
Elle devient d’autant plus aifée que la matière eft
plus douce au travail, 8c n’exhale plus aucune pouf-
fiece incommode ; auffi n’y a-t-il prefque plus de déchet
dans cette opération. Si l’on veut fe fervir de
peignes fins ; le chanvre ainfi lavé donnera de l a ß -
/a^éfufceptible du plus beau filage, 8c comparable
au plus beau lin, & né fournira guère plus d’un tiers
de fort bonnes étoupes.
Or cette étoupe qui étoit auparavant un objet de
rebut, &-qu?on vendoit ordinairement à quelques
cordiers deux* fous fix deniers la livre, devient pat*
une nouvelle opération un objet de la plus grande
utilité. En la cardant comme de la laine,il en réfulte
une nouvelle matière fine, moëlleufe , 8c blanche ,
&c dont jufqu’à-préfent on neconnoiffoit pas l’ufage.
On peut 1’employer feule en cet état, pour en faire
des ouates, qui, à beaucoup d’égards, l’emporteront
fur les ouates ordinaires ; mais de plus on la peut filer
& en tirer un très-beau fil. On peut auffi la mêler
avec du coton, de la foie, de la laine même , 8c du
poil ; & le fil qui réfulte de ces mélanges fournit,
par les variétés infinies, matière à de nouveaux ef-
lais très-intéreffans pour les arts, & très-utiles à plufieurs
manufactures.
On n’a pas encore, à beaucoup près, épuifé toutes
les combinaifons qui peuvent multiplier les avantages
du chanvre fous fes différentes formes. Les toiles
qui feront fabriquées de chanvre ainfi préparé ne
feront pas fi long-tems au blanchifl’age, & le fil même
n’aura plus befoin des leffives par lefquelles on étoit
obligé de le faire paffer.
Ces premières découvertes ont conduit à penfer
que les déchets même du chanvre les plus groffiers ,
8c les balayures des atteliers où on le travaille, ren-
fermoient encore une matière précieufe qu’on jettoit
ordinairement au feu ou fur le fumier , parce qu’on
n’en connoiffoit pas l’ufage. Elle n’a cependant befoin
que d’être broyée, nettoyée , & purifiée dans
l’eau, pour être d’un excellent emploi dans les papeteries
: l’épreuve qui en a été faite ne. laiffe aucun
doute fur cet objet ; & l’on fent aifément qu’il eft d’une
véritable importance.
Une pratique aveugle & les préjugés qu’elle a produits
, ont fait méconnoître jufqu’à-préfent les excellentes
propriétés & la perfe&ion naturelle du chanvre
: on ne s’étoit pas encore apperçû que le fil exif-
toit dans la plante, indépendamment des opérations
de l’art, qui ne peut ni le former ni le perfectionner ;
que le travail fe borne uniquement à le nettoyer 8c
le divifer, en féparantles foies dont le ruban ou l’éçor-
ce eft compofée ; que ce ruban eft une efpece d’écheveau
naturel dont les fils font affemblés dans leur
longueur parune humeur fale 8c glutineufe qu’il faut
abfolument diffoudre 8c chaffer, comme également
contraire à l’ouvrier & à l’ouvrage.
La nature du chanvre 8c fes propriétés nous étant
à-préfent mieux connues , on. ne doute pas que les
gens de campagne ne mettent à profit tous les avantages
qu’ils peuvent fe procurer par la pratique de ces
nouvelles méthodes. S’ils s’appliquent à la culture
des chanvres de Berri, où ils font les plus feftimés;
8c s’ils en perfectionnent les apprêts, ils s’affûreront
le débit de tous leurs ouvrages, foit qu’ils fe bornent
fimplement au filage, ou qu’ils veuillent en faire de
belles toiles.
M. Dodart, Intendant de Bourges, n’a rien négligé
pour encourager cette nouvelle culture du chanvre
, 8c l’établiffement fucceffif d’une multitude de
petites manufactures difperfées dans fa province ,
pour laquelle il a bien vû qu’elles feroient une fource
confidérable d’opulence.
Il ne s’eft pas contenté de promettre fa faveur 8c
fa protection à ceux qui aimoient affez le bien public
pour le féconder, 8c d’inviter les gentils hommes
qui demeurent dans leurs terres , les curés 8c les
bourgeois, d’entrer dans fes vues. Il a de plus pro-
pofé un prix de trente liv. qui fera diftribue dans
chacune des villes d’Iffoudun, Châteauroux, la Châ>
tre,S. Amand, & Bourges, à la femme qui apportera
fix livres de fil le plus parfait, pourvû qu’il ait été
filé de filaffe préparée félon la nouvelle méthode, &
deux prix de dix liv. aux deux femmes qui auront
le mieux travaillé après la première fileufe.
On offre de prendre le fil non-feulement de celles
qui auraat remporté le prix, mais encore celui des
bonnes fileufes qui auront concouru, 8c de le leur
payer, fi elles le veulent,
Ceux qui connoiffent les vrais moyens d’étendre
le Commerce, de favorifer la population, & de rendre
les peuples heureux, ne trouveront pas les prix
propofés par M. l’Intendant de Bourges, fort inférieurs
à ceux qu’on a fondés dans les académies.
Son goût pour les chofes utiles s’eft étendu jufqu’à la
perfeClion de notre ouvrage; 8c c’eft du mémoire
qu’il a fait répandre dans fa province, 8c qu’il a bien
voulu,nous communiquer, que nous avons tiré ce
qui précédé fur la culture du chanvre & fur la meilleure
préparation de la filaffe.
FILASSIER, f. m. ouvrier & marchand tout en-
femble qui donne les dernieres façons à la filaffe,
après que la chenevotte a été groffierement concaf-
fée & brifée par un infiniment qu’on nomme brie
en Normandie, 8c brayoire en d’autres endroits.
Il y a à Paris une communauté ou corps de métier
compofé de femmes qui prennent la qualité de linie-
res, chanvrieres, & filaffieres ; cette communauté eft
fort ancienne ; fes ftatuts de 1485 ne font qu’une addition
à ceux qu’elle avoit déjà depuis long-tems.
Dans ces ftatuts qui font les premiers de ceux qui lui
relient, cette communauté étoit compofée de maîtres
8c de maîtreffes également admis à la jurande,
deux de chaque fexe.
Ce fut encore au nom des maîtres & maîtreffes ,
jurés 8c jurées, que furent demandées 8c accordées
les lettres-patentes d’Henri IL en 1Ç49 , auffi-bien
que celles de 1 <y8; mais en 1666, la communauté
ayant obtenu de nouveaux llâtuts & reglemens, &
une nouvelle forme de gouvernement, il n’yeftplus
fait mention de maîtres , de jurés, ni d’apprentis :
depuis ce tems-là, c’eft une communauté de maîtreffes,
qui ne partagent la jurande avec perfonne.
Ces derniers ftatuts 8c les lettres-patentes furent
non-feulement enregiftrées au parlement 8c au châtelet
à l’ordinaire, mais ils furent encore lûs 8c publiés
à fon de trompe, le 2 Janvier 1667,fur la per-
miffion du lieutenant civil du 30 Décembre 1666.
Les jurées de cette communauté font au nombre
de quatre, qui font élûes deux chaque année.
Les maîtreffes ne peuvent avoir d’apprentiffes qu’elles
ne tiennent boutique ouverte, m a g a f i n , ou étalage
pour leur propre compte.
Elles ne peuvent avoir qu’une apprentiffe à la
fois, & doivent l'obliger pour fix ans.
L’apprentiffe afpirante à la maîtrife doit faire
chef-d’oeuvre, dont néanmoins la fille de maîtreffe
eft exempte.
Aucune apprentiffe ou fille de boutique de ces fortes
de marchandes ne peut entrer au fervice d’une
nouvelle maîtreffe, à moins qu’il n’y ait douze ou
treize boutiques entre celle où elle entre & celle d’où
elle fort ; & cela parce que prefque toutes les boutiques
de ces fortes de marchandes étant dans une
des halles de Paris, 8c toutes attenantes les unes des
autres, il feroit difficile d’entretenir la paix entre la
nouvelle & l’ancienne maîtreffe de ces filles.
Enfin les chanvres, lins, 8c filaffes qu’apportent
les forains fontfujets à vifite ; 8c les marchands font
tenus de les faire defcendreSt mettre en la halle pour
y être vifités.
C ’eft dans un canton de la halle au blé de Paris
quç de toute ancienneté les marchandes chanvrieres
font établies. Auffi il eft fait mention de cette place
dans leurs plus anciens ftatuts, & toûjours depuis elles
y ont été confervées & maintenues par leurs lettres
patentes jufqu’à-préfent.
C’eft-là auffi qu’il eft ordonné parles ftatuts que les
marchands doivent tranfporter leurs marchandifes.
Il y a pourtant une exception à cet article, en faveur
de la foire S, Germain ; les marchands forains