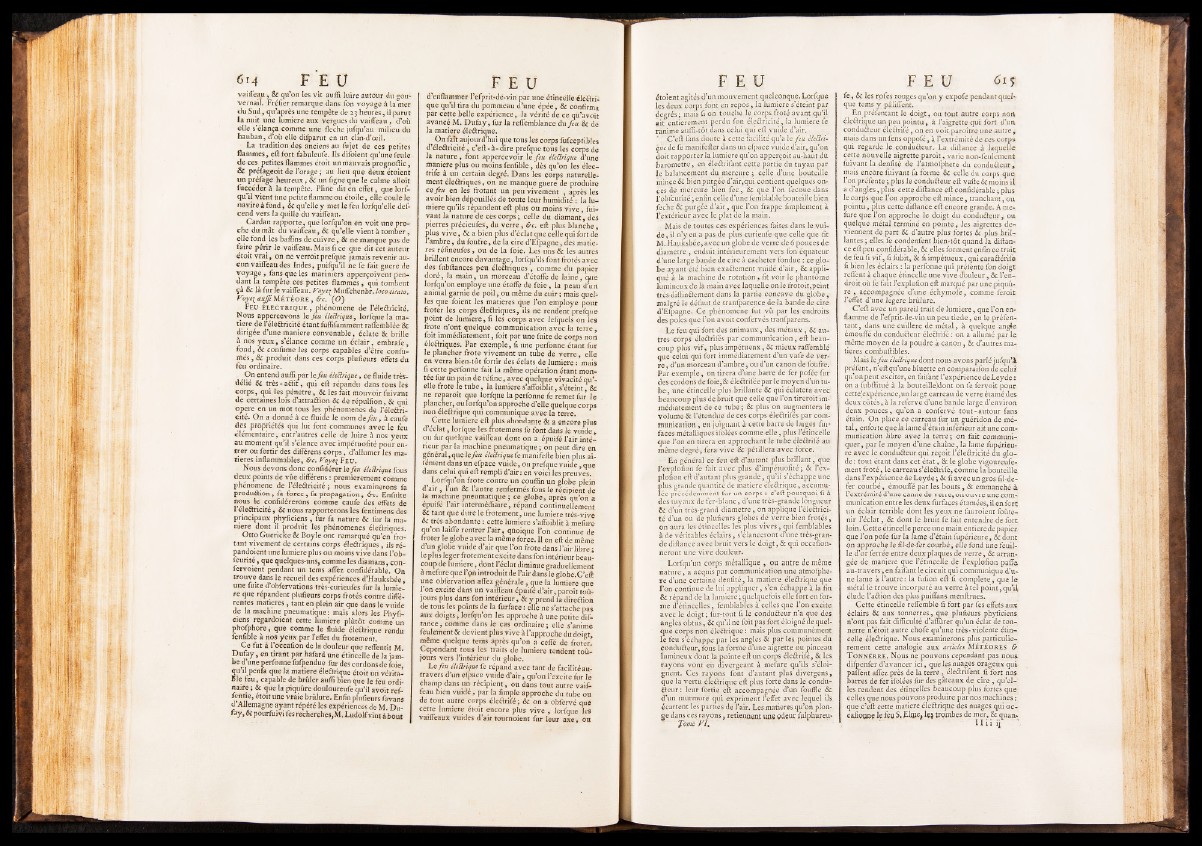
vaifleau, & qu’on les vit aufli luire autour du gou*
vcrnail. Fréfier remarque dans fon voyage à la mer
du Sud, qu’après une tempête de 13 heures, il parut
la nuit une lumière aux vergues du vaifleau | d’où
elle s’élança comme une fleehe jufqu’au milieu du
hauban, d’où elle difparut en un clin-d’ceil.
La tradition des anciens au fujet de ces petites
flammes, eft fort fabuleufe. Ils difoient qu’une feule
de ces petites flammes étoit un mauvais prognoflic,
& préfageoit de l’orage ; au lieu que deux étoient
un préfage heureux, 6c un flgneque le calnle alloit
fuccéder à la tempête. Pline dit en effet, que lorf-
qu’il vient Une petite flamme ou étoile, elle coule le
navire à fond , 6c qu’elle y met le feu lorfqu’elle def-
eend vers la quille du vaifleau.
Cardan rapporte , que lof fqu’on en voit une proche
du mât du vaifleau, & qu’elle vient à tomber,
elle fond les baflins de cuivre, & ne manque pas de
faire périr le vaifleau. Mais fi ce que dit cet auteur
étoit v rai, on ne verroit prefque jamais revenir aucun
vaifleau des Indes, puifqu’il ne fe fait guere de
vo y ag e , fans que les mariniers àpperçoivent pendant
la tempête ces petites flammes, qui tombent
çà 6c là fur le vaifleau. Voye%_ Muffchenbr. lococitato.
Voyc{ auffiM É T É O R E , &c. (O)
F e u El e c t r i q u e , phénomène de l’éleftricité.
Nous appercevons le feu électrique, lorfque la matière
de l’éleôricité étant fuffifamment raffemblée 6c
dirigée d’une maniéré convenable, éclate & brille
à nos y eu x, s’élance comme un éclair, embrafe,
fond, 6c confume les corps capables d’être confu-
més, & produit dans ces corps plufleurs effets du
feu ordinaire.
On entend aufli par le fe u électrique, ce fluide trè$-
délié 6c très - a â i f , qui efl répandu dans tous les
corps, qui les pénétré, 6c les fait mouvoir fuivant
de certaines lois d’attra&ion 6c de répuifion, & qui
opéré en un mot tous les phénomènes de Féleûri- ;
cité. On a donné à ce fluide le nom de f e u , à caufe i
des propriétés qui lui font communes avec le feu
élémentaire, entr’autres celle de luire à nos yeux
au moment qu’il s’élance avec impétuofité pour entrer
ou fortir des différens corps, d’allumer les matières
inflammables, &c. V o y e ^ F e u .
Nous devons donc confidérer 1 efeu électrique fous
deux points de vue différens : premièrement comme
phénomène de l’éleâricité ; nous examinerons fa
produ&ion, fa force, fa propagation, &c. Enfuite
nous le confidérerons comme caufe des effets de
l’éleâricité, 6c nous rapporterons les fentimens des
principaux phyficiens , fur fa nature & fur la maniéré
dont il produit les phénomènes éleâriques.
Otto Guericlce & Boyle ont remarqué qu’en frôlant
vivement de certains corps électriques , ils ré-
pandoient une lumière plus ou moins vive dans l’ob-
fcurité, que quelques-uns, comme les diamans, cofi-
fervoient pendant un tems affez confidérable. On
trouve dans le recueil des expériences d’Hauksbée
une fuite d’obfervations très-curieufes fur la lumière
que répandent plufleurs corps frotés contre différentes
matières , tant en plein air que dans le vuide
de la machine pneumatique : mais alors les Phyfi-
eiéns regardoient cette lumière plutôt comme un
phofphore, que comme le fluide éledrique rendu
fenfible à nos yeux par l’effet du frotement.
Ce fut à l’occafion de la douleur que reffentit M.
D u fa y , en tirant par hafard une étincelle de la jambe
d’une perforine fufpendue fur des cordons de foie,
qu’il penfa que la matière électrique étoit un véritable
feu, capable de brûler aufli bien que le feu ordinaire
; & que la piquûre douloureufe qu’il avoit ref-
fentie, étoit une vraie brûlure. Enfin plufleurs favans
d’Allemagne ayant répété les expériences de M. Dufay,
6c pourfuivi fes recherches,M. Ludolf vint àbout
d enflammer l’éfprit*dé-vin par une étincélle électrique
qu’il tira du pommeau d’une épéé, 6c confirma
par cette belle expérience, la vérité de ce qü’avoit
avancé M. Dufay , fur la reffemblance du feu 6c de
la matière éleCtrique.
On fait aujourd’ hui que tous les corps fufceptibles
d’éleâricité, c’eft-à-dire prefque tous les corps de
la nature, font appercevoir le feu électrique d’une
maniéré plus ou moins fenfible, dès qu’on les élec-
trife à un certain degré. Dans les corps naturellement
eleCtriques, on ne manque guere de produire
e t feu en les frotant un peu vivement , après les
avoir bien dépouillés de toute leur humidité : la lumière
qu’ils réparident eft plus ou moins v iv e , fuivant
la nature de cès corps ; celle du diamant, des
pierres précieufes, du verre, &c. eft plus blanche,
plus v iv e , 6c a bien plus d’éclat que celle qui fort de
l’ambre, du foufre, de la cire d’Efpagne, des matières
réfineufes, ou de la foie. Les uns & les autres
brillent encore davantage, lorfqu’ils font frotés avec
des fubftances peu électriques , comme du papier
doré, la main, un morceau d’étoffe de laine , que
lorfqu’on employé une étoffe de foie , la peau d’un
animal garnie de poil, ou même du cuir ; mais quel*
les que foient les matières que l’on employé pour
froter les corps éleûriques, ils ne rendent prefque
point de lumière, fi les corps avec lefquels on les
frote n’ont quelque communication avec la terre,
foit immédiatement, foit par une fuite de coçps non
électriques. Par exemple, fi une perfonne étant fur
le plancher frote vivement un tube de verre, elle
en verra bien-tôt fortir des éclats de lumière : mais
fi cette perfonne fait la même opération étant montée
fur un pain de réfine, avec quelque vivacité qu’elle
frote le tube, la lumière s’affoiblit, s’éteint, 6c
ne reparoît que lorfque la perfonne fe remet fur le
plancher, ouforfqu’on approche d’elle quelque corps
non éleCtrique qui communique avec la terre.
Cette lumière eft plus abondante & a encore plus
d’éclat, lorfque les frotemens fe font dans le vuide ,
ou fur quelque vaifleau dont on a épuifé l’air intérieur
par la machine pneumatique ; on peut dire en
général, que le feu électrique fe manifefte bien plus ai-
fement dans un efpace vuide, ou prefque vuide, que
dans celui qui eft rempli d’air : en voici les preuves.
Lorfqu’on ftote contre un couffin un globe plein
d’air , l’un & l’autre renfermés fous le récipient de
la machine pneumatique ; ce globe, après qu’on a
épuifé l’air intermédiaire, répand continuellement
& tant que dure le frotement, une lumière très-vive
6c très-abondante : cette lumière s’affoiblit à mefure
qu’on laiffe rentrer l’air, quoique l’on continue de
froter le globe avec la même force. Il en eft de même
d’un globe vuide d’air que l’on frote dans l ’air libre ;
le plus leger frotement excite dans fon intérieur beaucoup
de lumière, dont l’éclat diminue graduellement
à mefure que l’çn introduit de l’air dans le globe.C’eft
une obfervation affez générale, que la lumière que
l’on excite dans un yaiffeau épuifé d’air, paroît toujours
plus dans fon intérieur, & y prend fa direâioh
de tous les points de la furface : elle ne s’attache pas
aux doigts, lorfqu’on les approche à une petite dif-
tance, comme dans le cas ordinaire ; elle s’anime
feulement & devient plus vive à l’approche du doigt,
même quelque tems après qu’on a ceffé de froter.
Cependant tous les traits de lumière tendent toû-
jours vers l’intérieur du globe.
Le feu électrique fe répand avec tant de facilité au-
travers d’un efpace vuide d’air, qu’on l’excite fur le
champ dans un récipient, ou dans tout autre vaif-
feau bien vuidé, par la fimple approche du tube ou
de tout autre corps éleârifé ; 6c on a obfervé que
cette lumière étoit encore plus vive , lorfque les
vaiffeaux vuides d’air tournoient fur leur axe, ou
étoient agités d’un mouvement quelconque. Lorfque
les deux corps font en repos, la lumière s’éteint par
degrés ; mais fi on touche le corps froté avant qu’il
ait entièrement perdu fon é l e c t r i c i t é , la lumière fe
ranime aufîi-tôt dans celui qui eft vuide d’air.
' C ’eft fans doute à cette facilite qu’a le feu électrique
de fe manifefter dans un efpace vuide d’air., qu’on
doit rapporter l a l u m i è r e qu’on a p p e r ç o i t au-haut dü
baromètre, en éleûrifant cette partie du tuyau par
le balancement du mercure ; celle d’une bouteille
mince Sc b i e n purgée d’air,q i i i contient quelques onces
de. mercure bien fe c , 6c que l’on fecoue dans
i’obfcurité ; e n f i n celle d’une femblable bouteille bien
feche 6c purgée d’air, que l’on frappe Amplement à
l’extérieur avec le plat de la main.
Mais de toutes ces expériences faites dans le vuide
, il n’y en a pas de plus curieufe que celle que fit
M. Haulcsbée, avec un globe de verre de 6 pouces de
diamètre , enduit, intérieurement vers fon équateur
d ’une large bande de cire à cacheter fondue : ce globe
ayant été bien exactement vuidé d’air, 6c appliqué
à la machine de rotation, fit voir le phantôme
lumineux delà main avec laquelle on le frotoit,peint
très-diftinftement dans la partie concave du globe,
malgré le défaut de tranfparence de la bande de cire
d’Efpagne. Ce phénomène fut vû par les endroits
des pôles que l’on avoit confervés tranfparens.
Le feu qui fort des animaux, des métaux , & autres
corps électrifiés par communication, eft beaucoup
plus v if , plus impétueux, 6c mieux raffemblé
que celui qui fort immédiatement d’un vafe de verre
, d’un morceau d’ambre, ou d’un canon de foufrè;
Par exemple, on tirera d’une barre de fer pofée fur
des cordons de foie,& éleCtriféépar le moyen d’un tub
e , une étincelle plus brillante 6c qui éclatera avec
beaucoup plus de bruit que celle que l’on tireroit im-'
médiatement de ce tube; 6c plus on augmentera le
volume & l’étendue de ces corps éleftrifés par communication
, en joignant à cette barre de larges fur-
faces métalliques ifolées comme elle, plus l’étincelle
que l’on en tirera en approchant le tube éleétrifé au
même degré, fera vive & pétillera avec force.
En général ce feu eft d’autant plus brillant, que
l’explofion fe fait avec plus d’impétuofité ; & l’ex-
plofion eft d’autant plus grande, qu’ii s’échappe une
plus grande quantité de matière éleCtrique, accumulée
précédemment fur un corps : c’eft pourquoi fi à
des tuyaux de fçr-blanc, d’une très-grande longuèur
6c d’un très-grand diamètre, on applique l’éleftrici-
té d’un ou de plufleurs globes de verre bien frotés,
On aura les étincelles les plus v iv es, qui femblables
à de véritables éclairs, s’élanceront d’une très-grande
diftance avec bruit vers le doigt, & qui occafion-
neront une vive douleur.
Lorfqu’un corps métallique , ou autre de même
nature, a acquis par communication une atmofphe-.
re d’une certaine denfité, la matière électrique que
l’on continue de lui appliquer, s’èn échappe à la fin
6c répand de la lumière ; quelquefois elle fort en forme
d’étincelles, femblable,s à celles que l’on excite
avec le doigt ; fur-tout fi le condu&eur n’a que des
angles obtus, 6c qu’il ne foit pas fort éloigné de quelque
corps non électrique : mais plus communément
le feu s’échappe par les angles & pqr les pointes du
condu&eur, fç>us, la forme d’une aigrette ou pinceau
lumineux dont la pointe eft un corps éleétrifé, & les
rayons vont eh divergeant à mefure qu’ils s’éloignent.
Ces rayons font d’autant plus divergens,
que la vertu électrique eft plus forte dans le conducteur
: leur fortie eft accompagnée d’un fouffle 6c
d’un murmure qui expriment l’effet avec lequel ils
écartent les parties de l’air. Les matières qu’on plonge
dans ces rayons, retiennent une odeur fulphurep-
fomé VI%
fe , 6c les rofes rouges qu’on y expofe pendant quelque
tems y paliffent.
En prélentant le doigt, ou tout autre corps non
électrique un peu pointu, à l’aigrette qui fort d’un
conducteur éleCtrifé, on en voitparoître une autre,
mais dans un fens oppofé, à l’extrémité de ces corps
qui regarde le conducteur. La diftance à laquelle
cette nouvelle aigrette paroît, varie non-feulement
fuivant la denfité de l’atmofphere du conducteur,
mais encOre fuivant fa forme 6c celle du corps que
l’on préfente ; plus le conducteur eft vafte 6c moins il
a d’angles, plus cette diftance eft confidérable ; plus
lecorjis que l’on approche eft mince, tranchant, ou
pointu, plus cette diftance eft encore grande. A mefure
que l’on approche le doigt du conducteur, ou
quelque métal terminé en pointe, les aigrettes deviennent
de part & d’autre plus- fortes & plus brillantes
; elles fe condenfent bien-tôt quand la diftance
eft peu. confidérable, & elles forment enfin ce trait
de feu fi v if, fi fubit, & fi impétueux, qui caraCtérife
fi bien les éclairs : la perfonne qui préfente fon doigt
reffent à chaque étincelle une v ive douleur, 6c l’endroit
où fe fait l’explofion eft marqué par une piquûre
, accompagnée d’une échymofe, comme feroit
l’effet d’une legere brûlure.
C’eft avec un pareil trait de lumière, que l’on enflamme
de l’efprit-de-vin un peu tiede, en le préfen-
tant, dans une cuillère de métal, à quelque angle
émouffé du conducteur éleCtrifé : on a allumé par le
même moyen de la poudre à canon, & d’autres matières
combuftibles.
Mais le feu électrique dont nous avons parlé jufqu’à
préfent, n’eft qu’une bluette en comparaifon de celui
qu’on peut exciter, en faifant l’expérience de Leyde :
on a fubftitué à la bouteille)dont on fe fervoit pour
cette'expérience,un large carreau de verre étamé des
deux côtés, à la referve d’une bande large d’environ
deux pouces, qu’on a confervé tout-autour fans
étain. On place ce carreau fur un guéridon de métal,
enforte que la lame d’étain inférieur ait une communication
libre avec.-la terre; on fait communiquer,
par le moyen d’une chaîne, la lame fupérieu-
re avec le conducteur qui. reçoit l ’éleCtricité du glo-
de : tout étant dans cet état, & le globe yigpureufe-
ment froté, le carreau s’élèCtrife, comme la bouteille
dans l’expérience de Leyde ; & fi avec un gros fil-de-
fer courbé, émouflé par les bouts, & emmanché à
l’extrémité d’une canne de verre, on ouvre une communication
entre les deux furfaces étamées, il en fort
un éclair terrible dont les yeux ne fauroient foûte-
nir l’éclat, & dont le bruit fe fait entendre-de fort
loin. Cette étincelle perce une main entière de papier
que l’on pofe fur la lame d’étain fupérieure, 6c dont
on approche le fil-de-fer courbé; elle fond une feuille
d’or ferrée entre deux plaques de verre, 6c arrangée
de maniéré que l’étincelle de l’explofion paffô
au-travers, en faifant le circuit qui communique d’une
lame à l’autre : la fufion eft fi complété, que le
métal fe trouve incorporé au verre à tel point, qu’H
élude l’aûion des plus puiflan-s menftrues.
Cette étincelle reffemble fi fort par fes effets aux
éclairs 6c aux tonnerres, que plufleurs phyficiens
n’ont pas fait difficulté d’aflurer qu’un éclat de tonnerre
n’étoit autre chofe qu’une très-violente étincelle
éleûrique. Nous examinerons plus particulièrement
cette analogie aux articles Météores &
T onnérre. Nous ne pouvons cependant pas nous
difpenfer d’avancer ic i, que les nuages orageux qui
paffent affez près de la terre, éleûrifent fi fort nos
barres de fer ifolées fur des gâteaux de cire , qu’el-'
les rendent des étincelles beaucoup plus fortes que
celles que nous pouvons produire par nos machines :
que c’eft cette matière éle&rique des nuages qui oc-
cafiomie le feu S, les trçmbes de mer, & quan-
1 1 i i il '