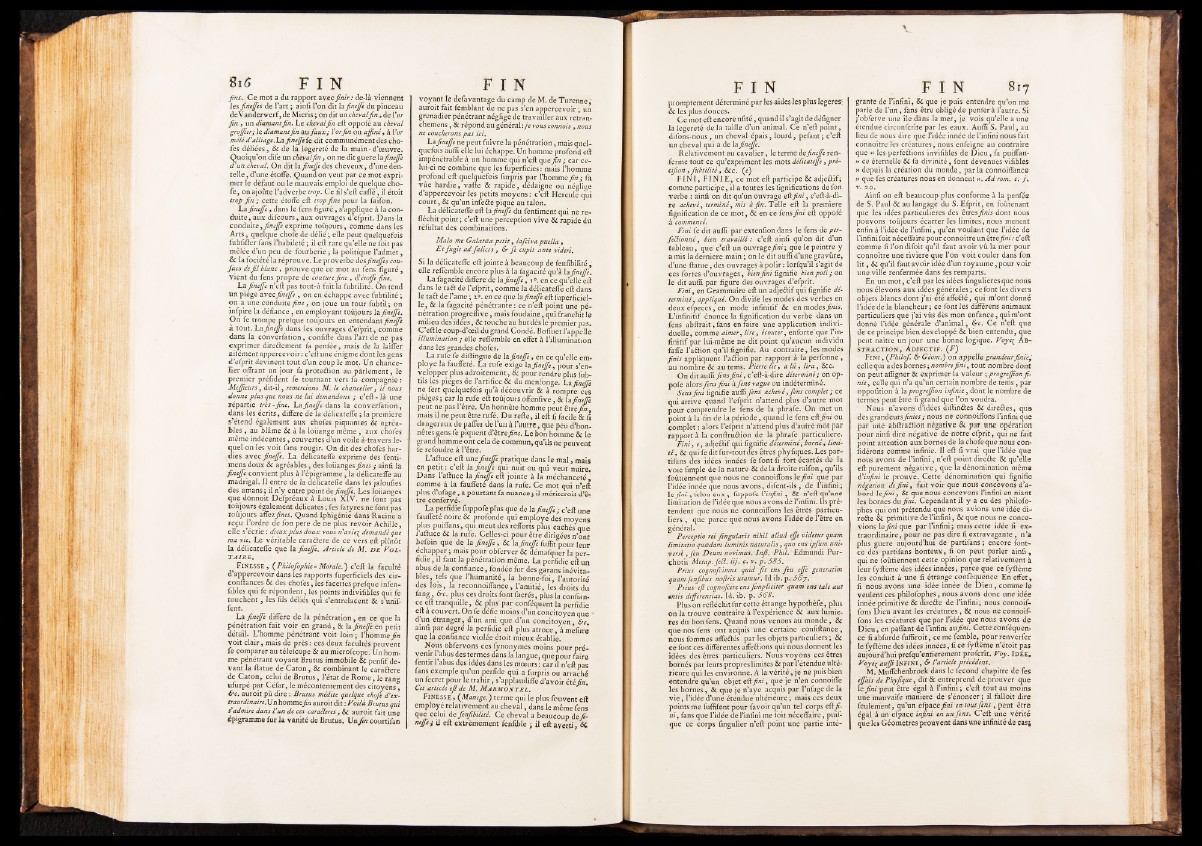
fins. Ce mot a du rapport avec finir : de-là viennent
les fineffes de l’art ; ainli l’on dit la fineffe du pinceau
de Vanderwerf, de Mieris ; on dit un chevalfin, de l’or
f in , un diamantfin. Le chevalfin eft oppofé au cheval
grojjier; le diamantfin au fa u x ; l’orfin ou affiné, à l’or
mêlé d'alliage. La fineffe fe dit communément des choies
déliées, 6c de la legereté de la main-d’oeuvre.
Quoiqu’on dife un cheval f in , on ne dit guere la fineffe
d'un cheval. On dit la fineffe des cheveux, d’une dentelle
, d’une étoffe. Quand on veut par ce mot exprimer
le défaut ou le mauvais emploi de quelque cho-
fe, on ajoûte l’adverbe trop. Ce fil s’eft caffé, il étoit
trop fin ; cette étoffe eft trop fine pour la faifon.
La fineffe, dans le fens figuré, s'applique à la conduite,
aux difeours, aux ouvrages d’efprit. Dans la
conduite, fineffe exprime toujours, comme dans les
Arts, quelque choie de délié ; elle peut quelquefois
fubfifter fans l’habileté ; il eft rare qu’elle ne foit pas
mêlée d’un peu de fourberie; la politique l’admet,
& la fociété la réprouve. Le proverbe desfineffes conf
i e s de f i l blanc, prouve que ce mot au fens figuré ,
vient du fens propre de couture f in e , à!étoffe fine.
La fineffe n’eft pas tout-à fait la fubtilité. On tend
un piège avec fineffe , on en échappe avec fubtilité ;
on a une conduite f in e , on joue un tour fubtil; on
infpire la défiance, en employant toûjours la fineffe.
On fe trompe prefque toujours en entendant fineffe
à tout. La finejfe dans les ouvrages d’efprit, comme
dans la converfation, confifte dans l’art de ne pas
exprimer direâement fa penfée, mais de la laiffer
aifement appercevoir : c’eft une énigme dont les gens
d’efprit devinent tout d’un coup le mot. Un chancelier
offrant un jour fa proteâion au parlement, le
premier préfident fe tournant vers fa compagnie :
Meffieurs, dit-il, remercions M. le chancelier, i l nous
donne plus que nous ne lui demandons ; c’eft - là une
répartie très-fine. La fineffe dans la converfation,
dans les écrits, différé de la délicateffe ; la première
s’étend également aux chofes piquantes 6c agréables
, au blâme & à la loiiange même , aux chofes
même indécentes, couvertes d’un voile à-travers lequel
on les voit fans rougir. On dit des chofes hàr-
. dies avec fineffe. La délicateffe exprime des fenti-
mens doux 6c agréables, des loiianges fines ; ainfi la
fineffe convient plus à l’épigramme, la délicateffe au
madrigal. Il entre de la délicateffe dans les jaloufies
des amans ; il n’y entre point de fineffe. Les loiianges
que donnoit Defpréaux à Louis XIV. ne font pas
toûjours également délicates ; fes fatyres ne font pas
toujours affezfines. Quand Iphigénie dans Racine a
reçu l’ordre de fon pere de ne plus revoir Achille,
elle s’écrie : dieux plus doux vous n'avie£ demandé que
ma vie. Le véritable caraâere de ce vers eft plûtôt
la délicateffe que la fineffe. Article de M . d e V o l t
a i r e .
F i n e s s e , ( P hilofophie - Morale. ) c’eft la faculté
d’appercevoir dans les rapports fuperficiels des cir-
conftances 6c des chofes, les facettes prefque infen-
libles qui fe répondent, les points indivifibles qui fe
touchent, les fils déliés qui s’entrelacent & s’unif-
fent.
La fineffe différé de la pénétration, en ce que la
pénétration fait voir en grand, & la fineffe en petit
détail. L’homme pénétrant voit loin ; l’homme fin
voit clair, mais de près : ces deux facultés peuvent
fe comparer au télefeope & au microfcope. Un homme
pénétrant voyant Brutus immobile 6c penfîf devant
la ftatue de Caton, 6c combinant le caraâere
de Caton, celui de Brutus, l’état de Rome, le rang
ufurpé par Céfar, le mécontentement des citoyens,
&c. auroit pu dire : Brutus médite quelque chofe d.'extraordinaire
Xén homme ƒ /z auroit dit : Voilà Brutus qui
s'admire dans l'un de ces caractères , 6c auroit fait une
(épigramme fur la vanité de Brutus. Un fin courtifan
voyant le defavantage du camp de M. de Turenne '
auroit fait femblant de ne pas s’en appercevoir ; un
grenadier pénétrant néglige de travailler aux retran-
chemens, & répond au général: j e vous connois, nous
ne coucherons pas ici.
La fineffe ne peut fuivre la pénétration, mais quelquefois
aufli elle lui échappe. Un honime profond eft
impénétrable à un homme qui n’eft que fin ; car celui
ci ne combine que les fuperficies: mais l’homme
profond eft quelquefois furpris par l’homme f in ; fa
vue hardie, vafte & rapide, dédaigne ou néglige
d’appercevoir les petits moyens : c’eft Hercule qui
court, 6c qu’un infeâe pique au talon.
La délicateffe eft la fineffe du fentiment qui ne réfléchit
point; c’eft une perception vive 6c rapide du
réfultat des combinaifons.
Malo me Galatoea p e t it , lafeiva puella ,
E t fug it ad falices , & f e cupit ante videri.
Si la délicateffe eft jointe à beaucoup de fenfibilité
elle reffemble encore plus à la fagacité qu’à la fineffe.
La fagacité différé de la fineffe, i°. en ce qu’elle eft
dans le taâ de l’efprit, comme la délicateffe eft dans
le taâ de l’ame ; i°. en ce que la finejfe eft fuperficiel-
le, & la fagacité pénétrante : ce n’eft point une pénétration
progremve, mais foudaine, qui franchit le
milieu des idées, & touche au but dès le premier pas.
C’eft le coup-d’oeil du grand Condé. Bofîuet l’appelle
illumination ; elle reffemble en effet à l’illumination
dans les grandes chofes.
La rufe fe diftingue de la fineffe , en ce qu’elle employé
la fauffeté. La rufe exige la finejfe, pour s’envelopper
plus adroitement, & pour rendre plus fub-
tils les pièges de l’artifice 6c du menfonge. La fineffe
ne fert quelquefois qu’à découvrir & à rompre ces
pièges; car la rufe eft toûjours offenfive, & la fineffe
peut ne pas l’être. Un honnête homme peut être f in ,
mais il ne peut être rufé. Du refte, il eft fi facile & fi
dangereux de paffer de l’un à l’autre, que peu d’honnêtes
gens fe piquent d’être fins. Le bon homme & le
grand homme ont cela de commun, qu’ils ne peuvent
le refoudre à l’être.
L’aftuce eft uns finejfe pratique dans le mal, mais
en petit : c’eft la fineffe qui nuit ou qui veut nuire.
Dans l’aftuce la fineffe eft jointe à la méchanceté,
comme à la fauffetedans la rufe. Ce mot qui n’eft
plus d’ufage, a pourtant fa nuance ; il mériteroit d’ê-,
tre confervé.
La perfidie fuppofe plus que de la fineffe ; c’eft une
fauffeté noire 6c profonde qui employé des moyens
plus puiflans, qui meut des refforts plus cachés que
l’aftuce 6c la rufe. Celles-ci pour être dirigées n’ont
befoin que de la fineffe, 6c la fineffe fuffit pour leur
échapper ; mais çour obferver 6c démafquer la perfidie
, il faut la pénétration même. La perfidie eft un
abus de la confiance, fondée fur des garans inévitables,
tels que l’humanité, la bonne-foi, l’autorité
des lois, la reconnoiffance, l’amitié, les droits du
fang, &c. plus ces droits font facrés, plus la confiance
eft tranquille, 6c plus par conféquent la perfidie
eft à couvert. On fe défie moins d’un concitoyen que '
d’un étranger, d’un ami que d’un concitoyen, &cm
ainfi par degré la perfidie eft plus atroce, à mefurè
que la confiance violée étoit mieux établie.
Nous obfervons ces fynonymes moins pour prévenir
l’abus des termes dans la langue, que pour faire
fentir l’abus des idées dans les moeurs : car il n’eft pas
fans exemple qu’un perfide qui a furpris ou arraché
un fecret pour le trahir, s’applaudiffe d’avoir été^&z.
Cet article e f l d e M . M a r m o n t e l .
F i n e s s e , ( Manege. ) terme qui le plus feuvent eft
employé relativement au chevâl, dans le même fens
que celui de fenfibilité. Ce cheval a beaucoup à efi-
neffe} il eft extrêmement fenfible ; il eft averti, &
promptement déterminé par les aides les plus legeresi
6c les plus douces.
Ce mot eft encore ufité, quand il s’agit de défigner
la legereté de la taille d’un animal. Ce n’eft point,
difons-nous, un cheval épais, lourd, pefant ; c’eft
un cheval qui a de la fineffe.
Relativement au cavalier, le terme de fineffe renferme
tout ce qu’expriment les mots délicateffe, précïfion
, fubtilité , &c. («)
FINI, FINIE, ce mot eft participe 6c adjeâif;
comme participe, il a toutes les lignifications de fon
verbe : ainfi on dit qu’un ouvrage eft f in i , c’eft-à-di-
re achevé, terminé, mis à fin. Tèlle eft la première
lignification de ce mot, 6c en ce fens fini eft oppofé
à commencé.
Fini fe dit aufli par extenfion dans le fens de perfectionné
, bien travaillé : c’eft ainfi qu’on dit d’un
tableau, que c’eft un ouvrage fin i ; que le peintre y
a mis la derniere main ; on le dit aufli d’une gravûre,
d’une ftatue, des ouvrages à polir : lorfqu’il s’agit de
ces fortes d’ouvrages, bien fini lignifie bien poli ; on
le dit aufli par figure des ouvrages d’efprit.
F in i, en Grammaire eft un adjeâif qui fignifie déterminé,
appliqué. On divife les modes des verbes en
deux efpeces, en mode infinitif & en modes finis.
L’infinitif énonce la lignification du verbe dans un
fens abftrait, fans en faire une application individuelle,
comme aimer, lire, écouter, enforte que l’infinitif
par lui-même ne dit point qu’aucun individu
fafîe l’aâion qu’il fignifie. Au contraire, les modes
finis appliquent l’aâion par rapport à la perfonne ,
au nombre 6c au tems. Pierre l i t , a l u , lira , &c.
On dit aufli f in s f in i , c ’eft-à-dire déterminé; on op-
pofe alors f in s fin i à f in s vague ou indéterminé.
Sens fin i fignifie aufli f in s achevé, f in s complet ; ce
qui arrive quand l’efprit n’attend plus d’autre mot
pour comprendre le lens de la phrafe. On met un
point à la fin de la période, quand lé fens eft fin i ou
complet : alors l’efprit n’attend plus d’autre mot par
rapport à la conftruâion de la phrafe particulière.
F in i, e, adjeâif qui fignifie détermine, borné, limit
é , 6c qui fe dit fur-tout des êtres phyfiques. Les par-
tifans des idées innées fe font fi fort écartés de la
voie fimple de la nature & de la droite raifon, qu’ils
.foûtiennent que nous ne connoiffons le fin i que par
l’idée innée que nous avons, difent-ils , de l’infini;
le f in i , félon eux, fuppofe l'in fin i, & n’eft qu’une
limitation de l’idée que nous avons de l’infini. Ils prétendent
que nous ne connoiffons les êtres particuliers
, que parce que nous avons l’idée de l’être en
général.
Perceptio rei Jingularis nïhil aliud effe videtur quam
limitatio quoedam luminis naturalis, quo ens ipfum uni-
yersé , feu Deum novimus. In jl. P lui. Edmundi Pur-
chotii Metap.fect. iij. c. v. p . 68S .
Prius cognofcimus quid f i t ens feu effe generatim
quam fenjibus noftris utamuf. Id ib. p .f iS y .
Prius efl cognofcère ens fimpliciter quam ens taie aut
tntis dijferentias. Id. ib. p. 5 6 8 .
Plus on réfléchit fur cette étrange hypothèfe, plus
on la trouve contraire à l’expérience 6c aux lumières
du bon fens. Quand nous venons au monde, 6c
que nos fens ont acquis une certaine confiftance ,
nous fommes affeâés par les objets particuliers; 6c
ce font ces différentes affeâions qui nous donnent les
idées des êtres particuliers. Nous voyons; ces êtres
bornés par leurs propres limites & par l’étendue ultérieure
qui les environne. A la vérité, je ne puis bien
entendre qu’un objet eft f in i , que je n’en connoiffe
les bornes, & que je n’aye acquis par l’ufage de la
v ie , l’idée d’une étendue ultérieure ; mais ces deux
points me fuflifent pour favoir qu’un tel corps eft f i ni
, fans que l’idée de l’infini me toit néceffaire, puif-
que ce corps fingulier n’eft point une partie intégrante
de l’infini, 6c que je puis entendre qu’on me
parle de l’un, fans être obligé de penfer à l’autre. Si
j’obferve une île dans la mer, je vois qu’elle a une
étendue circonfcrite par les eaux. Aufli S. Paul, au
lieu de nous dire que l’idée innée de l’infini nous fait
connoître les créatures, nous enfeigne au contraire
que « les perfeâions invifibles de Dieu, fa puiffan-
» ce éternelle 6c fa divinité, font devenues vifibles
» depuis la création du monde, par la connoiffance
» que fes créatures nous en donnent ». A d rom. c.
v. 20.
Ainfi on eft beaucoup plus conforme à la penfée
de S. Paul 6c au langage du S. Efprit, en foûtenant
que les idées particulières des êtres finis dont nous
pouvons toûjours écarter les limites, nous mènent
enfin à l’idée de l’infini, qu’en voulant que l’idée de
l’infini foit néceffaire pour connoître un êtrefini: c’eft
comme fi l’on difoit qu’il faut avoir vû la mer pour
connoître une riviere que l’on voit couler dans fon
li t , 6c qu’il faut avoir idée d’un royaume, pour voir
une ville renfermée dans fes remparts.
En un mot, c’eft par les idées fingulier es que nous
nous élevons aux idées générales ; ce font les divers
objets blancs dont j’ai été affeâé, qui m’ont donné
l’idée de la blancheur; ce font les differens animaux
particuliers que j’ai vûs dès mon enfance, qui m’ont
donné l’idée générale d’animal, & c. Ce n’eft que
de ce principe bien développé 6c bien entendu, que
peut naître un jour une bonne logique. Voye{ Abs
t r a c t i o n , A d j e c t i f . ( F )
F i n i , (Philof. & Géôm.) on appelle grandeurfinie,
celle qui a des bornes ; nombre f in i, tout nombre dont
on peut afligner & exprimer la valeur ; progreffion f i nie,
celle qui n’a qu’un certain nombre de tems, par
oppofition à la progreffion infinie, dont le nombre de
termes peut être fi grand que l’on voudra.
Nous n’avons d’idées diftinâes 6c direâes, quo
des grandeurs finies ; nous ne connoiffons l’infini que
par une abftraâion négative & par une opération
pour ainfi dire négative de notre efprit, qui ne fait
point attention aux bornes de la chofe que nous con-
fidérons comme infinie. Il eft fi vrai que l’idée que
nous avons de l’infini, n’eft point direâe 6c qu’elle
eft purement négative, que la dénomination même
d'infini le prouve. Cette dénomination qui fignifie
négation de f in i , fait voir que nous concevons d’abord
le f in i , 6c que nous concevons l’infini en niant
les bornes du fini. Cependant il y a eu des philofo-
phes qui ont prétendu que nous avions une idée direâe
6c primitive de l’infini, & que nous ne concevions
le fin i que par l’infini ; mais cette idée fi extraordinaire,
pour ne pas dire fi extravagante, n’a
plus guere aujourd’hui de partifans ; encore font-
ce des partifans honteux, fi on peut parler ainfi ,
qui ne foûtiennent cette opinion que relativement à
leur fyftème des idées innées, parce que ce fyftème
les conduit à une fi étrange conféquence En effet,
fi nous avons une idée innée de Dieu, comme le
veulent ces philofophes, nous avons donc une idée
innée primitive 6c direâe de l’infini; nous connoiffons
Dieu avant les créatures , 6c nous ne connoiffons
les créatures que par l’idée que nous avons de
Dieu, en paffant de l’infini aufini. Cette conféquence
fi abfurde fufliroit, ce me femble, pour renverfer
le fyftème des idées innées, fi ce fyftème n’étoit pas
aujourd’hui prefqu’entierement proferit. Voy. Idée.
Voye{ au (fi INFINI, & l'article précédent.
M. Muffehenbroek dans le fécond chapitre de fes
effais de Phyfique, dit & entreprend de prouver que
le f in i peut être égal à l’infini ; c’eft tout au moins
une mauvaife maniéré de s’énoncer ; il falloit dire
feulement, qu’un efpace fin i en tout fens , peut être
égal à un efpace infini en un fens. C’eft une vérité
que les Géomètres prouvent dans une infinité de cas;