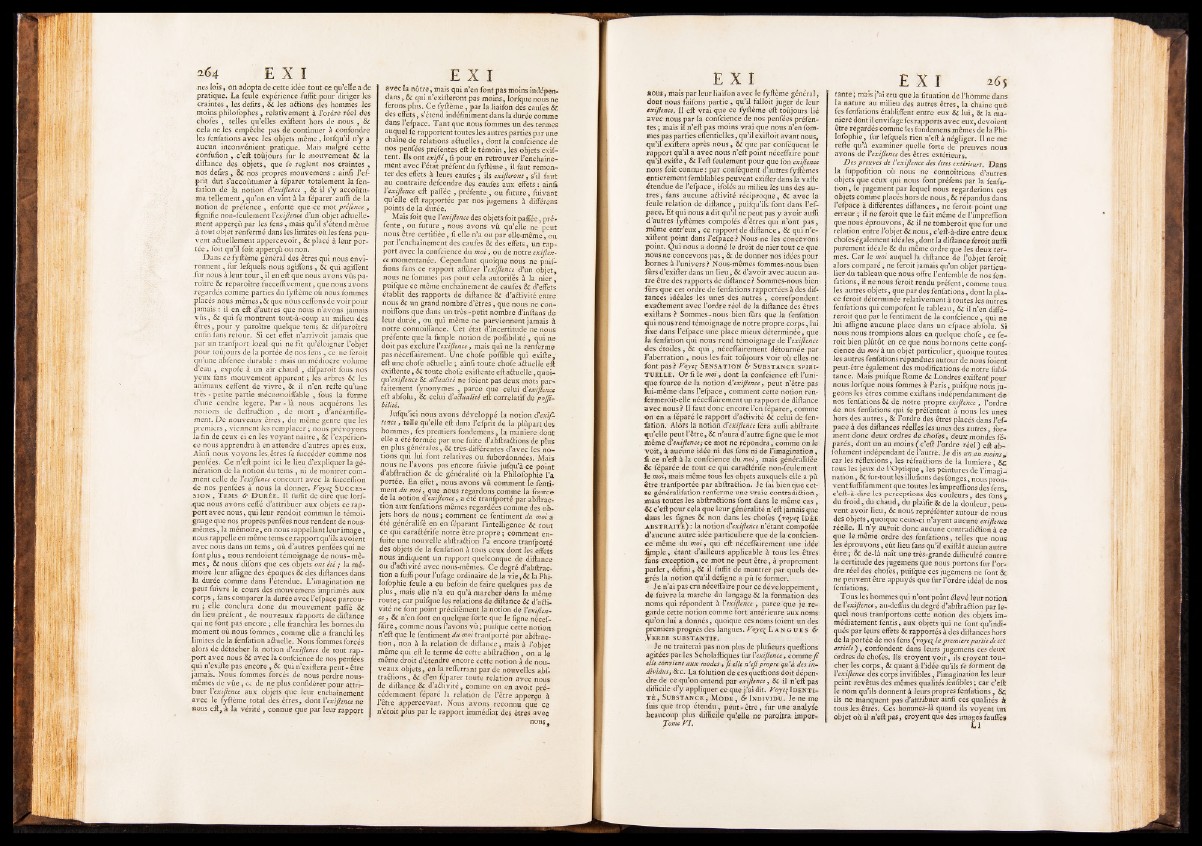
gtffe E X I nés lois , on adopta de cette idée tout ce qu’elle a de
pratique. La feule expérience fuffit pour diriger les
craintes , les defirs , & les avions des hommes les
moins philofophes , relativement à l ’ordre réel des
chofes , telles qu’elles exiftent hors de -nous., ,6c
cela ne.les empêche pas de continuer à confondre
les fenfationsavec les objets même , lorsqu’il n’y a
aucun inconvénient pratique. Mais malgré cette
confufion , c’eft toûjours mr le mouvement & la
diftance des objets, que fe règlent nos craintes ,
nos defirs, & nos propres mouvemens : ainfi l’ef-
prit dut s’accoutumer à féparer totalement la fen-
lation de la notion à'exijlence , & il s’y accoutuma
tellement, qu’on en vint à la féparer aufli de la
notion de préfence , enforte que ce mot préfinu ,
.lignifie non-feulement Vexijîence d’un objet actuellement
apperçû par les fens, mais qu’il s’étend même
à tout objet renfermé dans les limites où les fens peuvent
actuellement appercevoir, & placé à leur portée
, foit qu’il foit apperçû ou non.
Dans ce fyftème général des êtres qui nous environnent
, fur lefquels nous agiffons, 6c qui agiffent
-fur nous à leur tour, il en eft que nous avons vûs pa-
roitre 6c reparoître fucce/Iivement, que nous avons
regardés^comme parties du fyftème où nous fommes
placés nous mêmes, & que nous celions de voir pour
jamais : il en eft d’autres que nous n’avons jamais
v û s , 6c qui fe montrent tout-à-coup au milieu des
êtres, pour y paroître quelque tems 6c difparoître
enfin fans retour. Si cet effet n’arrivoit jamais que
par un tranfport local qui ne fit qu’éloigner l’objet
pour toûjours de la portée de nos lens , ce ne feroit
qu’une abfenee durable : mais un médiocre volume
d’eau , expofé à un air chaud , difparoît fous nos
yeux fans mouvement apparent ; les arbres 6c les
animaux celfent de vivre, & il n’en refte qu’une
très - petite partie méconnoiffable , fous la forme
d’une cendre legere. Par - là nous acquérons les
notions de deftru&ion , de mort , d’anéantiffe-
ment. De nouveaux êtres, du même genre que les
premiers, viennent les remplacer ; nous prévoyons
la fin de ceux ci en les voyant naître, 6c l’expérience
nous apprendra à en attendre d’autres après eux.
Ainfi nous voyons les.êtres fe fuccéder comme nos
.penfées. Ce n’eft point ici le lieu d’expliquer la génération
de la notion du tems , ni de montrer comment
celle de l’exijlence concourt avec la fucceffion
de nos penfées à nous la donner. Voye^ Su c c e s s
io n , T em s & D u r é e . Il fuffit de dire que lorf-
.que nous avons ceffé d’attribuer aux objets ce rapport
avec nous, qui leur rendoit commun le témoignage
que nos propres penfées nous rendent de nous-
mêmes, la mémoire, en nous rappellant leur image,
nous rappelle en même tems ce rapport qu’ils avoient
avec nous dans un tems, où d’autres penfées qui ne
font plus, nous rendoient témoignage de nous-mêmes
, 6c nous difons que ces objets ont été ; la mémoire
leur affigne des époques 6c des diftances dans
la durée comme dans l’étendue. L’imagination ne
peut fuivre le cours des mouvemens imprimés aux
corps, fans comparer la durée avec l’efpace parcouru
; elle conclura donc du mouvement paffé 6c
du lieu préfent, de nouveaux rapports de diftance
qui ne font pas encore ; elle franchira les bornes du
moment où nous fommes, comme elle a franchi les
limites de la fenfation actuelle. Nous fommes forcés
alors de détacher la notion d’exijlence de tout rapport
ayec nous 6c avec la confcience de nos penfées
qui n’exifte pas encore , 6c qui n’exiftera peut - être
jamais. Nous fommes forcés de nous perdre nous-
mêmes de v û e , ài. de ne plus confidérer pour attribuer
Vexijtence aux objets que leur enchaînement
avec le fyftème total des êtres , dont V exijlence ne I
nous eft, à la v érité, connue que par leur rapport I
E X I avec la nôtre \ mais qui n’en font pas moins indépen-
dans, & qui n’exilleront pas moins, lorfque nous ne
ferons plus. Ce fyftème, par la liaifon des caufes 6c
des effets, s’étend indéfiniment dans la durée comme
dans l’efpace. Tant que nous fommes un des termes
auquel fe rapportent toutes les autres parties par une
chaîne de relations aôuelles, dont la confcience de
nos penfées préfentes eft le témoin, les objets exiftent.
Ils ont exiflé, fi-pour en retrouver l’enchaînement
avec l’état préfent du fyftème, il faut remonter
des effets à leurs caufes ; ils txijlcront, s’il faut
au contraire defeendre des caufes aux effets : ainfi
1 exijlence eft paffée , préfente , ou future, fuivant
qu’elle eft rapportée par nos jugemens à différens
points de la durée.
Mais foit que l’exijlence des objets foit paffée, préfente
, ou future , nous avons vu qu’elle ne peut
nous être certifiée, fi elle n’a ou par elle-même, ou
par l’enchaînement des caufes 6c des effets, un rapport
avec la confcience du moi, ou de notre exijlence
momentanée. Cependant quoique nous ne puif-
fions fans ce rapport aflùrer Vexifienct d’un objet,
nous ne fommes pas pour cela autorifés à la nier ,
puifque ce même enchaînement de caufes 6c d’effets
établit des rapports de diftance 6c d’aftivité entre
! nous 6c un grand nombre d’êtres, que nous ne con-
noiffons que dans un très-petit nombre d’inftans de
leur durée, ou qui même ne parviennent jamais à
notre connoiffance. Cet état d’incertitude ne nous
préfente que la fimple notion de poflibilité , qui ne
doit pas exclure Vexijlence, mais qui ne la renferme
pas néceffairement. Une chofe pofïible qui exifte,
eft une chofe aêhielle ; ainfi toute chofe a&uelle eft
exiftente, & toute chofe exiftente eft actuelle , quoi-
a\\’exijlence 6c actualité ne foient pas deux mots parfaitement
fynonymes , parce que celui à’exijlence
eft abfolu, 6c celui d’actualité eft corrélatif de pojjî-
bilité.
Jufqu’ici nous avons développé la notion d’exifi
tence , telle qu’elle eft dans l’efprit de la plûpart des
hommes, fes premiers fondemens, la maniéré dont
elle a été formée par une fuite d’abftrallions de plus
en plus générales, & très-différentes d’avec les notions
qui lui font relatives ou fubordonnées. Mais
nous ne l’avons pas encore fuivie jufqu’à ce point
d’abftra&ion 6c de généralité où la Philofophie l’a
portée. En effet, nous avons vû comment le fenti-
ment du moi, que nous regardons comme la fource
de la notion d'exijlence, a été tranfporté par abftrac-
tion aux fenfatiôns mêmes regardées comme des objets
hors de nous ; comment ce fentiment du moi a
été généralifé en en féparant l’intelligence 6c tout
ce qui cara&érife notre être propre ; comment en-
fuite une nouvelle abftraâion l’a encore tranfporté
des objets de la fenfation à tous ceux dont les effets
nous indiquent un rapport quelconque de diftance
ou d’aftivité avec nous-mêmes. Ce degré d’abftrac-
tion a fiiffi pour l’ufage ordinaire de la v ie , & la Philofophie
feule a eu befoin de faire quelques pas de
plus, mais elle n’a eu qu’à marcher dans la même
route ; car puifque les relations de diftance 6c d’afti-
vité ne font point précilèment la notion de Vexiflen-
ce, 6c n’en font en quelque forte que le figne necef-
fàire, comme nous l’avons vû ; puifque cette notion
n’eft que le fentiment du moi tranfporté par abftrac-
tion, no,n à la relation de diftance, mais à l’objet
même qui eft le terme de cette abftraôion, on a le
même droit d’étendre encore cette notion à de nouveaux
objets, en la refferrant par de nouvelles abf-
traélions, 6c d’en féparer toute relation avec nous
de diftance 6c d’aû ivité, comme on en avoit précédemment
féparé la relation de l’être apperçû à
l’être appercevant. Nous avons reconnu que ce
n’etoit plus par le rapport immédiat des êtres avec nous !
E X I nous , mais par leur liaifon avec le fyftème général ,
dont nous faifons partie, qu’il falloit juger de leur
txijlence. Il eft vrai que ce fyftème eft toûjours lié
avec nous par la confcience de nos penfées préfentes
; mais il n’eft pas moins vrai que nous n’en fom-
mes pas parties effentielles, qu’il exiftoit avant nous,
qu’il exiftera après nous, 6c que par eonféquent le
rapport qu’il a avec nous n’eft point néceffaire pouf
qu’il exifte, 6c l’eft feulement pour que fon exijlence
nous foit connue : par eonféquent d’autres fyftèmes
entièrement femblables peuvent exifter dans la vafte
étendue de l’efpace, ifolés au milieu les uns des autres,
fans aucune attivité réciproque, 6c avec la
foule relation de diftance, puifqu’ils font dans l’efpace.
Et qui nous a dit qu’il ne peut pas y avoir aufli
d ’autres fyftèmes compofés d’êtres qui n’ont pas,
même entr’eux, ce rapport de diftance, 6c qui n’e-
xiftent point dans l’efpace? Nous ne les concevons
point. Qui nous a donné le droit de nier tout ce que
nous ne concevons pas, & de donner nos idées pour
bornes à l’univers ? Nous-mêmes fommes-nous bien
fûrs d’exifter dans un lieu, 6c d’avoir avec aucun autre
être des rapports de diftance? Sommes-nous bien
fûrs que cet ordre de fenfatiôns rapportées à des difi
tances idéales les unes des autres , correfpondent.
exactement avec l’ordre réel de la diftance des êtres
exiftans ? Sommes-nous bien fûrs que la fenfation
ui nous rend témoignage de notre propre corps, lui
xe dans l’efpace une place mieux déterminée, que
la fenfation qui nous rend témoignage de Vexijlence
des étoiles, 6c q u i, néceffairement détournée par
l ’aberration , nous les fait toûjours voir où elles ne
font pas? Voyc{ Sensation & Substance spirituelle.
Or fi le moi, dont la confcience eft l’unique
fource de la notion d’exiflence, peut n’être pas
lui-même dans l’efpace, comment cette notion ren-
fermeroit-elle néceffairement uji rapport de diftance
avec nous ? Il faut donc encore l’en féparer, comme
on en a féparé le rapport d’adivité 6c celui de fenfation.
Alors la notion d’exiflencc fera aufli abftraite
qu’elle peut l’être, 6c n’aura d ’autre figne que le mot
même d?exijlence; ce mot ne répondra, comme on le
v o it, à aucune idée ni des fens ni de l’imagination,
fi ce n’eft à la confcience du moi, mais genéralifée
6c féparée de tout ce qui caraétérife non-feulement
le moi, mais même tous les objets auxquels elle a pû
être tranfportée par abftraftion. Je fai bien que cet-’
te généralifation renferme une vraie contradiftioil,;
mais toutes les abftraétions font dans le même cas ,
6c c’eft pour cela que leur généralité n’eft jamais que
dans les lignes 6c non dans les chofes (voyeç Idée
abstraite) : la notion exijlence n’étant compofée
d’aucune autre idée particulière que de la conlcien-
ce même du moi, qui eft néceffairement une idée
fpnple, étant d’ailleurs applicable à tous les êtres
fans exception, ce mot ne peut être, à proprement
parler, defini, 6c il fuffit de montrer par quels degrés
la notion qu’il défigne a pû fe former.
Je n’ai pas cru néceffaire pour ce développement,
de fuivre la marche du langage 6c la formation des
noms qui répondent à Vexijlence , parce'que je regarde
cette notion comme fort antérieure aux noms:
qu’on lui a donnés, quoique ces noms foient un des
premiers progrès des langues. Voye^ L a n g u e s 6* .Verbe substantif.
Je ne traiterai pas non plus de plufieurs queftions
agitées par les Scholaffiques fur Vexijlence , comme Ji
elle convient aux modes, f i elle n ’ejl propre qu’à des individus;
& c. La folution de ces queftions doit dépendre
de ce qu’on entend par exijlence, 6c il n’eft pas
difficile d’y appliquer ce que j’ai dit. Voyt{ Identit
é ,; Substance , Mode , o* Individu. Je ne me
fuis que trop étendu, peut-être, fur une analyfe
beaucoup plus difficile qu’elle ne paroîtra impor-
Tome Kl.
E X I *6* tante ; mais j’ai cru que la fituation de l’homme dans
la nature au milieu des autres êtres, la chaîne que-
fes fenfatiôns établiffent entre eux & lui, & la maniéré
dont il envifage fes rapports avec eux, dévoient
etre regardés comme les fondemens mêmes de la Philofophie,
fur lefquels rien n’eft à négliger. Il ne me
refte qu*à examiner quelle forte de preuves nous
avons de Vexijlence des êtres extérieurs.
Des preuves de Vexijlence des êtres extérieurs. Dans
la fuppofition où nous ne eonnoîtrions d’autres
objets que ceux qui nous font préfens par la fenfa,-
tipn, le jugement par lequel nous regarderions ces
objets comme placés hors de nous, & répandus dans
l’efpace à différentes diftances, ne feroit point une
erreur ; il ne feroit que le fait même de l’impreflion
que nous éprouvons, & il ne tomberoit que fur une
relation entre l’objet 6c nous, c ’eft-à-dire entre deux
chofes également idéales, dont la diftance feroit aufli
purement idéale & du même ordre que les deux termes.
Car le moi auquel la diftance de l’objet feroit
alors comparé, ne feroit jamais qu’un objet particulier
du tableau que nous offre l’enfemble de nos fen-
fatiôns, il ne nous feroit rendu préfent, comme tous
les autres objets, que par des fenfatiôns, dont la place
feroit déterminée relativement à toutes les autres
fenfatiôns qui compofent le tableau, 6c il n’en diffé-
reroit que par le fentiment de la confcience, qui ne
lui afligne aucune place dans un efpaee abfolu. Si
nous nous trompions alors en quelque chofe, ce feroit
bien plûtôt en ce que nous bornons cette confcience
du moi à un objet particulier, quoique toutes
les autres fenfatiôns répandues autour de nous foient
peut-être également des modifications de notre fubfi
tance. Mais puifque Rome & Londres exiftent pour
nous lorfque nous fommes à Paris, puifque nous jugeons
les êtres comme exiftans indépendamment de
nos fenfatiôns 6c de notre propre exijlence , l’ordre
de nos. fenfatiôns qui ,fe préfentent à nous les unes
hors des autres, & l’ordre des êtres placés dans l’efpace
à des diftances réelles les unes des autres, forment
donc deux ordres de chofes, deux mondes réparés,
dont un au moins ( c’eft l’ordre réel ) eft absolument
indépendant de l’autre. Je dis un au moins*
car les réflexions, les réfraôions de la lumière 6c
tous les jeux de l ’Optique, les peintures de l’imagi-i
nation , 6c fimtout les illufions des fonges, nous prouvent
fuffifamment que toutes les impreflîonsdes fens,
c’eft-à-dire les perceptions des couleurs, des fons *
du froid, du chaud, du plaifir & de la douleur, peuvent
avoir lieu, 6c nous repréfénter autour de nous
des objets » quoique ceux-ci n’ayent aucuné exijlence
réelle. Il n’y auroit donc aucune contradiction à ce
que le ihême ordre des fenfatiôns, telles que nous
les éprouvons, eut lieu fans qu’il exiftât aucun autre
être ; & de-là naît une très-grande difficulté contre
la certitude des jugemens que nous portons fur l’ordre
réel des chofes, puifque ces jugemens ne font 8c
ne peuvent être appuyés que fur l’ordre idéal de nos.
fenfatiôns.
Tous les hommes qui n’ont point élevé leur notion
de:Vexijlence, au-dellus du degré d’abftraftion par lequel
nous tranfportons cette notion des objets immédiatement
fentis, aux objets qui ne font qu’indiqués
par leurs effets & rapportés à des diftances hors
de la portée de nos fens (voyeç la première partit de cet
article') , confondent dans leurs jugemens ces deux
Ordres de chofes. Ils croyent vo ir , ils croyent toucher
les corps, & quant à l’idée qu’ils fe forment de
Vexijlence des corps invifibles, l’imagination les leur*
peint revêtus des mêmes qualités fonfibles; car c’eft
le nom qu’ils donnent à leurs propres fenfatiôns, 6c
ils ne manquent pas d’attribuer ainfi ces qualités à
tous les êtres. Ces hommes-là quand ils voyent tm
objet où il n’eft pas, croyent que des images fauffeS