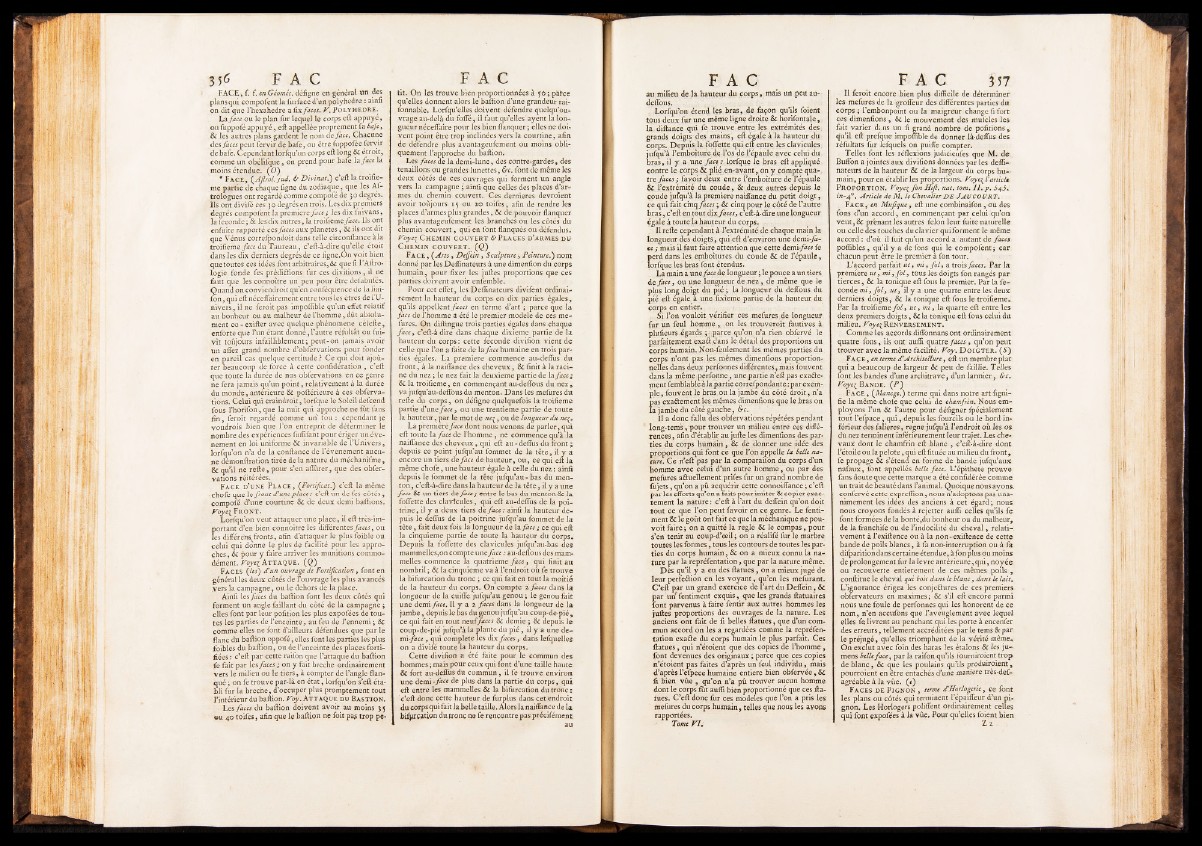
FACE, f. f. tn Géomét. défigne en général un des
plans qui compofent la furface d’un polyhedre : ainfi
on dit que l’hexahedre a fix faces. V. Po lyhedre.
La face ou le plan fur lequel le corps eft appuyé,
ou fuppofé appiiyé, eft appellée proprement fa bafe,
<8c les autres pians gardent le nom de face. Chacune
des faces peut fervir de bafe, ou être fuppofée fervir
de bafe. Cependant lorfqu’un corps eft long 8c étroit,
comme un obélifque, on prend pour bafe la face la
moins étendue. (O)
* Fa c e , {Afirol.jud. & ï>ivinat.) c*eft la troifieme
partie de chaque ligne du zodiaque, que les Af-
trologues ont regardé comme çompofé de 30 degres.
Ils ont divifé ces 30 degrés en trois. Les dix premiers
degrés compofent la premiere/à« ,• les dix luivans,
la fécondé; & les dix autres, la troifiéme^ce; Ils ont
enfuite rapporté ces faces aux planètes, 8c ils ont dit
que Vénus correfpondoit dans telle circonftance à la
troifieme face du T aureau, c’eft-à-dire qu’elle étoit
dans les dix derniers degrés de ce figne.On voit bien
que toutes ces idées font arbitraires, & quefi l’Aftro-
logie fonde fes prédirions fur ces divilions, il ne
faut que les connoître un peu pour être defabufés.
Quand on conviendroit qu’en conféquence de la liai-
fon, qui eft néceffairement entre tous les êtres de l’U-
nivers, il ne feroit pas impoflîble qu’un effet relatif
au bonheur ou au malheur de l’homme, dût abiolu-
ment co - exifter avec quelque phénomène célefte,
enforte que l’un étant donné, l’autre réfultât ou fui-
yît toujours infailliblement; peut-on jamais avoir
lin affez grand nombre d’obfervations pour fonder
en pareil cas quelque certitude ? Ce qui doit ajouter
beaucoup de force à cette confidération, c’eft
que .toute la durée de nos ôbfervations en ce genre
ne fera jamais qu’un point, relativement à la durée
du monde, anterieure 8c poftérieure à ces obferva-
' fions. Celui qui craindroit, lorfque le Soleil defeend
fous l’horifon, que la nuit qui approche ne fut fans
fin, feroit regardé comme un fou : cependant je
voudrois bien que l’on entreprît de déterminer le
nombre des expériences fuffifant pour ériger un événement
en loi uniforme 8c invariable de l’Univers,
lorfqu’on n’a de la conftance de l’évenement aucune
démonftration tirée de la nature du méchanifme,
& qu’il ne refte, pour s’en affurer, que des obfer-
vations réitérées.
F a.c e d ’u n e P l a c e , ('Fortificat.) c’eft la même
• chofe que le front d'une place: c’eft un de fes côtés,
compofé d’une courtine 8c de deux demi baftions.
Voye^ F r o n t .
Lorfqu’on veut attaquer une place, il eft très-important
d’en bien connoître les différentes faces, ou
les différèïis. fronts, afin d’attaquer le plus foible ou
celui qui donne le plus de facilité pour les approches
, 8c pour y faire arriver les munitions commodément.
Foye{ A t t a q u e . (Q )
Fa c e s (/es) dun ouvrage de Fortification , font en
général les deux côtés de l’ouvrage les plus avancés
.vers la campagne, ou le dehors de la place.
Ainfi les faces du baftion font les deux côtés qui
forment un angle faillant du côté de la campagne ;
elles font par leur pofition les plus expofées de toutes
les parties de l’enceinte, au feu de l’ennemi ; 8c
comme elles ne font d’ailleurs défendues que par le
flanc du baftion oppofé, elles font les parties les plus
foibles du baftion, ou de l’enceinte des places fortifiées
: c’eft par cette raifon que l’attaque du baftion
fe fait par les faces ; on y fait breche ordinairement
vers le milieu ou le tiers, à compter de l’angle flanqué
; on fe trouve par-là en état, lorfqu’on s’eft établi
fur la breche, d’occuper plus promptement tout
l’intérieur du baftion. Vyy. A t t a q u e d u Ba s t io n .
Les faces du baftion doivent avoir au moins 3 5
ou 40 toifes, afin que le baftion ne foit pas trop petit.
On les trouve bien proportionnées à 50 ; pàfrce
qu’elles donnent alors le baftion d’une grandeur rai-
lonnable. Lorfqu’elles doivent défendre quelqu’ou-
vrage au-delà du foffé, il faut qu’elles ayent la Ion-»
gueur néceffaire pour les bien flanquer ; elles ne doivent
point être trop inclinées vers la courtine, afin
de défendre plus avantageufement ou moins obliquement
l’approche du baftion.
Les faces de la demi-lune, des contre-gardes, des
tenaillons ou grandes lunettes, &c. font de même les
deux côtés de ces ouvrages qui forment un angle
vers la campagne ; ainfi que celles des places d’armes
du chemin couvert. Ces dernieres devroient
avoir toujours 15 ou 20 toifes, afin dé rendre les
places d’armes plus grandes, 8c de pouvoir flanquer
plus avantageufement les branches ou lés côtés du
chemin couvert, qui en font flanqués ou défendus.
V j y e ^ C h e m in c o u v e r t & Pl a c e s d ’a r m e s d u
C h e m in c o u v e r t . (Q )
F a c e , {Arts, Dejfein, Sculpture> Peinture.) nom
donné par les Deflinateurs à une dimenfion du corps
humain, pour fixer les juftes proportions que ces
parties doivent avoir enfemble.
Pour cet effet, les Deflinateurs divifent ordinairement
la hauteur du corps en dix parties égales,
qu’ils appellent faces en terme d’art ; parce que la
face de l’homme à été le premier modèle de ces me-
fures. On diftingue trois parties égales dans chaque
face , c’eft-à dire dans chaque dixième partie de la
hauteur du corps : cette fécondé divifion vient de
celle que l’on a faite de la face humaine en trois parties
égales. La première commence au-deffus du
front, à la naiffance des cheveux, 8c finit à la racine
du nez ; le nez fait la deuxieme partie de la face ;
8c la troifieme, en commençant au-deffous du nez ,
v a jufqu’au-deffous du menton. Dans les mefures du
refte du corps, on défigne quelquefois la troifieme
partie d’une face , ou une trentième partie de toute
la hauteur, par le mot de ne^, ou de longueur du ne%*
La première face dont nous venons de parler, qui
eft toute la face de l’homme, ne commence qu’à la
naiffance des cheveux, qui eft au-deffus du front ;
depuis ce point jüfqu’au fommet de la tête, il y a
encore un tiers de face de hauteur, ou, ce qui eft la
même chofe, une hauteur égale à celle du nez : ainfi
depuis le fommet de la tête jufqü’au - bas du menton,
c’eft-à-dire dans la hauteur de la t ê te , il y a une
face 8c un tiers de face; entre le bas du menton & la
foffette des clavicules, qui eft au-deffus de la poitrine
, il y a deux tiers de face : ainfi la hauteur depuis
le deffus de la poitrine jufqu’au fommet de la
tê te , fait deux fois la longueur de la face ; ce qui eft
la cinquième partie de toute la hauteur du corps.
Depuis la foffette des clavicules jufqu’au-bas des
mammelIeSjOn compte une face : au-defl’ous des mam-
melles commence la quatrième face, qui finit au
nombril ; 8c la cinquième va à l’endroit où fe trouve
la bifurcation du tronc ; ce qui fait en tout la moitié
de la hauteur du corps. On compte 2 faces dans la
longueur de la cuiffe jufqu’au genou ; le genou fait
une demi face. Il y a 2 faces dans la longueur de la
jambe, depuis le bas du genou jufqu’au coup-de-pié ,
ce qui fait en tout neuffaces 8c demie ; 8c depuis le
coup-de-pié jufqu’à la plante du p ié , il y a une de-
mi-face , qui complété les dix faces, dans lefquelles
on a divilé toute la hauteur du corps.
Cette divifion a été faite pour le commun des
hommes ; mais pour ceux qui font d’une taille haute
8c fort au-deffus du commun, il fe trouve environ
une demi - face de plus dans la partie du corps, qui
eft entre les mammelles & la bifurcation du tronc :
c’eft donc cette hauteur de furplus dans cet endroit
du corps qui fait la belle taille. Alors la naiffance delà
bifurcation du tronc n® fe rencontre pas précifément
au
F A C
au milieu de la hauteur du corps, mais un peu au-
deffous.
. Lorfqu’on étend lès bras, de façon qu’ils foient
tous deux fur une même ligne droite 8c horifontale,
la diftance qui fe trouve entre les extrémités des;
grands doigts des mains, eft égale à la hauteur du
corps. Depuisia fouette qui eft entre les clavicules,
jufqu’à l’emboîture de l’os de lfépaule avec celui du
bras, il y a une face .vlprfque le bras eft appliqué,
contre le corps 8c plié.en-avant, on y compte qua-.
îre faces ; favoir deux entre l’emboîture de l’épaule
8c l’extrémité du coude, & deux autres depuis le
coude jufqu’à la première naiffance du petit doigt,
ce qui fait cinq faces ; 8c cinq pour le coté de l’autre
bras, c’eft en tout dix faces, c’eft-à-dire une longueur
égale à toute'la hauteur du corps. •
Il refte cependant à l’extréipité de chaque main la
longueur des doigts, qui eft d’environ une demi fa ce
; mais il faut faire attention que cette demi-face fe
perd dans les emboîtures du coude 8c de l’épaule,
lorfque les bras font .étendus.
La main a une face de longueur ; le pouce a un tiers
de face y ou une longueur de n e z , de même que le
plus long doigt du pié ; la longueur du deffous du
pié eft égale à une fixieme partie de la hauteur du
corps en entier.
Si l’on vouloit vérifier ces mefures .de longueur
fur un feul homme , on les trcoiyeroit fautives à
phifieurs -égards ; jparce qu’on n’a rien obfervé le
parfaitement exafrdans le détail des proportions au
corps humain.,Non-feulement les mêmes parties du
corps n’ont pas, fes mêmes dimenfions proportionnelles
dans deux perfonnes différentes, mais fouvent
dans la même pérfonne, une partie n’ell pas exactement
femblable à la partie correspondante : par exemp
le , fouvent le bras ou la jambe du côté droit, n’a
pas exactement les mêmes dimenfions que le bras ou
la jambe du côté gauche, &c.
Il a donc fallu des obfervations répétées pendant
long-tems, pour trouver un milieu entre ces différences
, afin d’établir au jufte les dimenfions des parties
du corps humain, & de donner une idée des
proportions qui font ce que l ’on appelle la belle nature.
Ce n’eft pas par la comparaifôn du corps d’un
homme avec celui d’un autre homme, ou par des
mefures actuellement prifes fur un grand nombre de
Sujets, qu’on a pu acquérir cette connoiffance ; c’eft
par les efforts qu’on a faits pour imiter & copier exactement
la nature: c’eft à l’art du deffein qu’on doit
tout ce que l’on peut favoir en ce genre. Le fenti-
ment 8c le goût ont fait ce que la méchanique ne pou-
voit faire ; on a quitté la réglé & le compas, pour
s’en tenir au coup-d’oeil ; on a réalifé fur le marbre
toutes les formes, tous les contours de toutes les parties
du corps humain, & on a mieux connu la nature
par la repréfentation, que par la nature même.
Dès qu’il y a eu des ftatues, on a mieux jugé de
leur perfefrion en les voyant, qu’en les mefurant.
C ’eft par un grand exercice de l’art du D effein, 8c
par unr fentiment exquis, que les grands ftatuaires
font parvenus à faire fentir aux autres hommes les
juftes proportions des ouvrages de la nature. Les
anciens ont fait de fi belles ftatues, que d’un commun
accord on les a regardées comme la repréfentation
exaâe du corps humain le plus parfait. Ces
ftatues, qui n’étoient que des copies de l’homme,
font devenues des originaux ; parce que ces copies
n’étoient pas faites d’après un feul individu, mais
d’après l’efpece humaine entière bien obfervée, 8c
fi bien vûe , qu’on n’a pu trouver aucun homme
dont le corps fut aufli bien proportionné que ces ftatues.
C ’eft donc fur ces modèles que l’on a pris les
mefures du corps humain, telles que nous les avons
rapportées.
Tome VI.
Il feroit encore bien plus difficile de déterminer
les mefures de la 'groffeur des différentes parties du
corps ; l’embonpoint ou la maigreur change fi fort
ces dimenfions, 8c le mouvement des mufcles les
fait varier dc.ns un fi grand nombre de pofitions ,
qu’il eft prefque impoflible de donner là-deffus des
réfultats fur lefquels on puiffe compter.
Telles font les réflexions judicieufes que M. de
Buffon a jointes aux divifions données par les deflinateurs
de la hauteur 8c de la largeur du corps hu-'
main, pour en établir les proportions. Voye^Tarticle
Pr o p o r t io n . Voye^fon Hïfi. nat. tom. 11. p. $^5.
in - jf . Article de M. le Chevalier D E J a u c o u r t .
Fa c e je n Mufique, eft une combinaifon, Ou des
fons d’un accord, en commençant par celui qu’on
veut, 8c prenant les autres félon leur fuite naturelle
ou celle des touches du clavier quiforment le même
accord : d’où il fuit qu’un accord a' autant de faces
poflibles , qu’il y a de fons qui le compofent ; car
chacun peut être le premier à fon tour.
L ’accord parfait ut, mi, fo l y a trois faces. Par la
première ut, mi, fo l, tous les doigts fon rangés par
tierces, 8c la tonique eft fous le premier. Par la fécondé
mi y fo l, ut y il y a une quarte entre les deux
derniers doigts, 8c la tonique eft fous le troifieme.
Par la troifieme fo l y ut y mi y la quarte eft entre les
deux premiers doigts, 8c la tonique eft fous celui du
milieu. V o y e ^ R e n v e r s em e n t .
' Comme les accords diffonnans ont ordinairement
quatre fons, ils ont aufli quatre faces , qu’on peut
trouver avec la même facilité. Voy. D o ig t e r . («S")
Fa c e , en terme dArchitecture, eft un membre plat
qui a beaucoup de largeur 8c peu de faillie. Telles
font les bandes d’une architrave, d’un larmier, &c.
V c y e { Ba n d e . ( P )
Fa c e , {Manege.') termé qui dans notre artfigni-
fie la même chofe que celui de chamfrin. Nous employons
l’un 8c l’autre pour défigner fpécialement
tout l’efpace, q ui, depuis les fourcils ou le bord inférieur
des falieres, regne jufqu’à l’endroit où les os
du nez terminent inférieurement leur trajet. Les chevaux
dont le chamfrin eft blanc , c’eft-à-dire dont
l’étoile ou la pelote, qui eft fituée au milieu du front,
fe propage 8c s’étend en forme de bande jufqu’aux
nalaux, font appellés belle face. L’épithete prouve
fans doute que cette marque a été confidérée comme
un trait de beauté dans l’animal. Quoique nous ayons,
confervé cette expreflion, nous n’adoptons pas unanimement
les idées des anciens à cet égard ; nous
nous croyons fondés à rej etter aufli celles qu’ils fe
font formées de la bonté,du bonheur ou du malheur,
de la franchife ou de l’indocilité du cheval, relativement
à l’exiftence ou à la non-exiftence de cette
bande de poils blancs, à fa non-interruption ou à fa
difparition dans certaine étendue, à fon plus ou moins
de prolongement fur la levre antérieure, qui, noyée
ou recouverte entièrement de ces mêmes poils ,
conftitue le cheval qui boit dans le blanc, dans le lait.
L’ignorance érigea les conjeûures de ces premiers
obiervateurs en maximes ; 8c s’il eft encore parmi
noùs une foule de perfonnes qui les honorent de ce
nom, n’en accufons que l’aveuglement avec lequel
elles fe livrent au penchant qui les porte à encenfer
des erreurs, tellement accréditées par le tems & par
le préjugé, qu’elles triomphent de la vérité même.
On exclut avec foin des haras les étalons 8c les ju-
mens belle face, par la raifon qu’ils fourniroient trop
, de blanc, 8c que les poulains qu’ils produiroient,
pourroient en être entachés d’une maniéré très-def-
: agréable à la vûe. («)
F a c e s d e Pig n o n , terme dHorlogerie, ce font
les plans ou côtés qui terminent l’épaiffeur d’un pignon.
Les Horlogers poliffent ordinairement celles
qui font expofées à la vûe. Pour qu’elles foient bien
Z z -