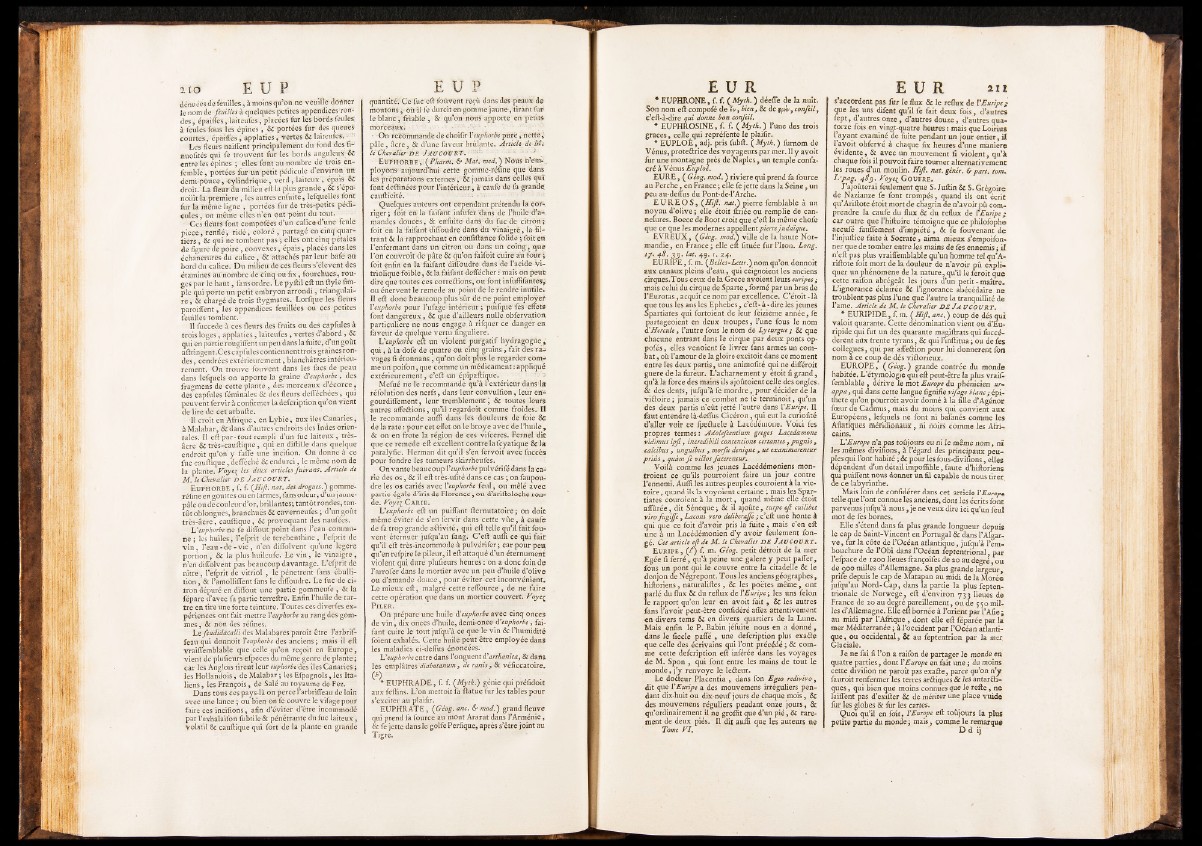
aio E U P dénuées de féuilles, à moins qu’on, ne veuille dôffner
le nom de feuilles à quelques petites appendices róndes
, épaiffes, laiteufes, placées fur les bords feulès:
à feules fous lëè épines , & portées fur des queues
courtes, épaiffes f applaties-, vertes 8c laiteufes.
Les fleurs h aillent principalement du fond des fi-:
nuofités qui fe trouvent fur les bords anguleux-8c
entre les épifiés ; elles fönt ali nombre de trois en-
femble, portées fur un pétit pédicule d’environ un
demi-pOuce , cylindrique , v erd, laiteux , épais 8C
droit. La fleur du milieu eft la plus grande, & s épanouit
la première, les autres enfuite, lefquelles font
fur la même ligne , portées fur de tres-petits pédicules
, on même elles n’en ont point du tout.
■ Ces fleurs font compoféeS d’un calice d’une feule
piece, renfle y ridé, co lo ré, partagé en cinq quartiers
, 8c qui ne tombent p as:; elles ont cinq petales
de figuré de poire, convexes, épais, placés dans les
cchancritrês du ca lice, & attachés par leur bafé au
bord du calice. Du milieu de cés fleurs s’élèvent des
étamines aunombre de cinq ou f ix , fourchues, rouges
par le h aut, fans ordre. Le pyftil eft un ftyle Ample
qui porte im petit embryon arrondi, triangulair
e , & chargé de trois ftygmates. Lorfque lèS fleurs
paroiffent, les appendices feuillées ou ces petites
feüillès tombent. : 1 , . ■
Il fuccede à ces fleurs des fruits ou des capfules à
trois loges, applaties, laiteufes, vertes d’abord, 8c
qui en partie rougifient un peu dans la fuite, d’un goût
aftringent.CeS capfules contiennenttrois graines rondes,
cendrées extérieurement, blanchâtres intérieurement.
On trouve fouvent dans les facs de peau
dans lefquels on apporte la graine d'euphorbe , des
fragmèns de cette plante , des morceaux d’eeorce,
des capfules féminales & des fleurs defféchees, qui
peuvent fervir à confirmer la defeription qu’on vient
de lire de cetarbufte.
'Il croît en A frique, en L yb ie, aux îles Canaries,
à Malabar, 8c dans d’autres endroits des Indes orientales.
Il eft par-tout rempli d’un fuc laiteux, tres-
âcre & très-cauftique, qui en diftille dans quelque
endroit qu’on y faffe une incifion. On donne à ce
fuc cauftique, defféché 8c endurci, le même nom de
la plante. Voye[ les deux articles fuivans. Article de
M. le Chevalier DE J a u COURT.
E u p h o r b e , f. f. ( H i j l . nat. des drogues.) gomme-
réfineen gouttes Ou en larmes, fans odeur, d’un jaune-
pâle ou de couleur d’or, brillantes; tantôt rondes, tantôt
oblongties, branchuës 8c caverneufes ; d’un goût
très-âcre, cauftique, 8c provoquant des naufées.
L ’euphorbe-ne fe diffout point dans l’eau commune
; les huiles; l’efprit de terebenthine, l’efprit de
Vin, l’e a u -d e - v ie , n’en diffolvent qu’une légere
portion, & la plus huileufe. Le v in , le vinaigre,
n’en diffolvent pas beaucoup davantage. L’efprit de
nitre, l’efprit de vitriol , le pénètrent fans ébullition
, & l’amolliffent fans le diffoudre. Le fuc de citron
dépuré en diffout une partie gommeufé , & la
fépare d’avec fa partie terreftre. Enfin l’huile de tartre
en tire une forte teinture. Toutes ces diverfes expériences
ont fait mettre Y euphorbe au rang des gommes
, & non des réfines.
Le fcadidacalli àes Malabares paroît être l’ârbrif-
feau qui donnoitTeuphorbe des anciens ; mais il eft
vraiffemblable que celle qu’on reçoit en Europe,
vient de plufieurs efpeces du même genre de plante ;
car les Anglois tirent leur euphorbe des îles Canaries ;
les Hollandois, de Malabar ; les Efpagnols, les Italiens,
les François, de Salé au royaume de Fez.
Dans tous ces pays-là on perce l’arbriffeau de loin
avec une lance ; ou bien on fe couvre le vifage pouf
faire ces incifions, afin d’éviter d’être incommodé
par l’exhalaifon fubtile & pénétrante du fuc laiteux,
volatil 8c cauftique qui fort de la plante en grande
E U P quantité: Ce-fuc eft’foûvent reçu dans des peaux d©
moutons ô û ll fe durcit en gomme jaune, tirant fur
le blanc, friable , & qu’on nous apporte en petits
morceaux; ■ • - v -
| -On recommandé dè choifir Y euphorbe piit'è ; nette*
pâle, âcre, & d’une faveur brûlante. Article-âe 'Mi
le Chevalier D E JJAUCOU RT.
• Ëup'HôkBiÉf f Pharrn. & Matïtned. ) Ndfls h’dra*,
ployéns^aujourd’hui cette gomme-réfine que dans
les préparations externes y §& j-amàis dans éèllëS qüt
font deftinééS pour l’intérieur;; à' caufe de fa grande:
caufticité.
Quelques auteurs ont cependant ptétéftdù la eor-.
riger; foit en la faifant infufer. dans de l’huile d e mandes
douces , & efïfliiïef; dafi's-du fuc de citron^
foit en la faifant diffoudre dairtS du vinaigré, là-filtrant
& la rapprochant en confiftànce folidé ; foit ëh
l ’enfermant dans un citron ou dans un coing , que
l ’on couvroit de pâte 8c qu’on faifoit cuire âii four j
foit enfin en la faifant diffoudre dans de l’acide Vi-
triolîque foiblë, & la faifant deffécher : mais on peut
dire que toutes ces corrélions, ou font infuffifantes*
ou énervent le remede au,point de le rendre inutile.
Il eft donc beaucoup plus sûr de ne point employer
Y euphorbe pour l’ufage intérieur ; puifque’fés effet»
font dangereux, 8c que d’ailleurs nulle obfervation
particulière ne nous engage, à rifquer ce danger en
faveur de quelque vertu finguliere.
Veuphorbe eft un violent purgatif hydragogûe,'
q ui, à la dofe de quatre ou cinq grains, fait des rda
vagesfi étonnans, qu’on doit plus le regarder comme
uri poifon, que comme lin médicament : appliqué
extérieurement, c’éft un épipaftique.
Mefué ne le recommande qu’à l’extérieur dans la
réfolution des nerfs, dans leur convulfion, leur èrt-
gourdiffement, leur tremblement * 8c toutes ;lêuf si
autres affections, qu’il regardoit comme froides. I!
le recommande aüfli dans les douleurs de foie 8e
de la rate : pour cet effet on le broyé avec de l’huile ,
8c on en frote la région de Ces vifeeres. Fernel dit
que ce remède eft excellent contre la feyatique & la
paralyfie. Herman dit qu’il S’en férvoit avec fuccès
pour fondre les tumeurs skirrheitfes.
On vante beaucoupYeuphorbe pulvérifé dans la carie
dés o s , 8c il eft très-ufité dans Ce cas ; on faüpou-
dre les os cariés avec Y euphorbe fen l, ou mêlé avec
partie égale d’iris de Florence, Ou d’ariftoloche ronde.
Voyeç Carie.
L’euphorbe eft un puiffant fternutatoire ; on doit
même éviter de s’en fervir dans cette v û e , à caufe
de fa trop grande activité, qui eft telle qu’il fait fou-
vent éternuer jufqu’au fang. C ’eft auffi ce qui fait
qu’il eft très-incommode à pulv.érifer; car pour peu
qu’en refpire le pileur, il eft attaqué d’un éternument
violent qui dure plufieurs heures : on a donc foin de
l’arrofer dans le mortier avec un peu d’huile d’olive
ou d’amande douce, pour éviter cet inconvénient.
Le mieux eft, malgré cette reffourCe , de ne faire
cette opération que dans un mortier couvert. Voye^ Piler.
On prépare une huile d’euphorbe avec cinq onces
de v in , dix onces d’huile, demi-once d’euphorbe, faifant
cuire le tout jufqu’à ce que le vin 8c l’humidité
foient exhalés. Cette huile peut être employée dans
les maladies ci-deflus énoncées.
L 'euphorbe entre dans l’onguent d’arthanita, 8c dans
les emplâtres ‘diabotanum , de ranis , 8c véficcatoire. ü ■ I WÊÊÊ WM. * EUPHRADE, f. f. (Afy thé) geme qui préfidoit
aux feftins. L’on mettoit fa ftatue fur les tables pour
s’exciter au plaifir.
EUPHRATE, (Géog. anc. & mod.') grand fleuve
qui prend fa fource au mont Ara rat dans l’Arménie,
8c fe jette dans le golfePerfique, après s’être joint au
Tigre.
E U R
* EUPHRONE, f. f. (Myth. ) déeffe de la nuit.
Son nom eft compofé de tw, bien, 8c de fyw yconftil,
C*eft-à-dire qui donne bon confeil.
* EUPHROSINE, f. f. ( Myth. ) l’une des trois
grâces, celle qui repréfente le plaifir.
* EUPLOÉ, adj. pris fubft. ( Myth. ) furnom de
Vénus, prote&rice des voyageurs par mer. Il y avoit
fur une montagne près de N aples, un temple confa-
cré à'Vénus Euplùe.
EURE, ( Géog. mod. ) riviere qui prend fa fource
au Perche, en France ; elle fe jette dans la Seine, un
peu au-deffus du Pont-de-1’Arche.
E U RE O S , (Hijl. nat Y) pierre femblable à un
noyau d’olive ; elle étoit ftriée ou remplie de cannelures.
Boece de Boot croit que c’eft la même chofe
que ce que les modernes appellent pierre judaïque.
EVREUX, (Géog. modS ville de la haute Normandie,
en France ; elle eft fituée fur l ’Iton. Long.
*7' 4* - 3S>-lat' 49- '• * 4-
EURIPE, f. m. (Belles-Leur.} nom qu’on donnoit
aux canaux pleins a’eau, qui ceignoient les anciens
çirques.Tous ceux de la Grece avoient leurs euripes ;
mais celui du cirque de Sparte, formé par un bras de
l ’Eurotas, acquit ce nom par excellence. C ’étoit - là
que tous les ans les Ephebes, c’eft - à - dire les jeunes
Spartiates qui fortoient de leur feizieme année, fe
partageoient en deux troupes, l’une fous le nom
a 'Hercule , l’autre fous le nom de Lycurgue ; 8c que
chacune entrant dans le cirque par deux ponts op-
pofés, elles venoient fe livrer fans armes un combat
, où l’amour de la gloire excitoit dans ce moment
entre les deux partis, une animofité qui ne différoit
guere de la fureur. L’acharnement y étoit fi grand,
qu’à la force des mains ils ajoûtoient celle des ongles.
& des dents, jufqu’à fe mordre, pour décider de la
viôoire ; jamais ce combat ne fe terminoit, qu’un
des deux partis n’eût jetté l’autre dans YEuripe. Il
faut entendre là-deffus Cicéron, qui eut la curiofité
d’aller voir ce fpeâacle à Lacédémone. Voici fes
propres termes : Adolefcentium greges Lacedamone
yidimus ipji , incredibili contentione certantes , pugnis ,
calcibus , unguibus , morfu denique , ut exanimarentur
priùs y quant fe viclos faterentur.
Voilà comme les jeunes Lacédémeniens mon-
troient ce qu’ils pourroient faire un jour contre
l’ennemi. Auffi les autres peuples couroient à la victoire
, quand ils la voyoient certaine ; mais les Spartiates
couroient à la mort, quand même elle étoit
affûrée, dit Séneque ; 8c il ajoûte, turpe efi cuilibet
viro fugijfe, Lacom yero deliberajfe ; c’eft une honte à
qui que ce foit d’avoir pris la fuite , mais c’en eft
une à un Lacédémonien d’y avoir feulement fon-
gé. Cet article ejl de M. le Chevalier D E J A V CO U R T . Euripe , ( f ) f. m. Géog. petit détroit de la mer
Egée fi ferré, qu’à peine une galere y peut paffer,
fous un pont qui le couvre entre la citadelle & le
donjon de Négrepont. Tous les anciens géographes,
hiftoriens, naturaliftes, 8c les poëtes même, ont
parlé du flux 8c du reflux de YEuripe ; les uns félon
le rapport qu’on leur en avoit fait , 8c les autres
fans l’avoir peut-être confidéré affez attentivement
en divers tems 8c en divers quartiers de la Lune.
Mais enfin le P. Babin jéfuite nous en a donné,
dans le fiecle paffé , une defeription plus exaâe
que celle des écrivains qui l’ont précédé ; 8c comme
cette defeription eft inférée dans les voyages
de M. Spon , qui font entre les mains de tout le
monde, j’y renvoyé le leéteur.
Le doéteur Placentia , dans fon Egeo redivivo,
dit que YEuripe a des mouvemens irréguliers pendant
dix-huit ou dix-neuf jours de chaque mois, 8c
des mouvemens réguliers pendant onze jours, &
qu’ordinairement il ne groffit que d’un pié, 8c rarement
de deux piés. Il dit auffi que les auteurs ne
Tome VI.
E U R a n
s’accordent pas fur le flux 8c le reflux de YEuripe ;
que les uns difent qu’il fe fait deux fois, d’autres
fept, d’autres onze, d’autres douze, d’autres quatorze
fois en vingt-quatre heures : mais que Loirius
l’ayant examiné de fuite pendant un jour entier, il
1 avoit obferve à chaque fix heures d’une maniéré
evidente, 8c avec un mouvement fi violent, qu’à
chaque fois il pouvoit faire tourner alternativement
les roues d’un moulin. Hiß. nat. génér. & part, tom.
L ’pag. 4&S' Voyei GoUFRE.
J’ajouterai feulement que S. Juftin 8c S. Grégoire
de Nazianze fe font trompés, quand ils ont écrit
qu’Ariftote étoit mort de chagrin de n’avoir pu comprendre
la caufe du flux 8c du reflux de YEuripe ;
car outre que l ’hiftoire témoigne que ce philofophe
accufé fauffement d’impiété, & fe fouvenant de
l’injuftice faite à Socrate , aima mieux s’empoifon-
ner que de tomber entre les mains de fes ennemis ; il
n’eft pas plus vraiffemblable qu’un homme tel qu’Ariftote
foit mort de la douleur de n’avoir pû expliquer
un phénomène de la nature, qu’il le ieroit que
cette rauon abrégeât les jours d’un petit - maître.
L’ignorance éclairée 8c l’ignorance abécédaire ne
troublent pas plus l’une que l’autre la tranquillité de
l’ame. Article de M. le Chevalier DE Ja u c o u r t .
* EURIPIDE, f. m. ( Hiß. anc. ) coup de dés qui
valoit quarante. Cette dénomination vient ou d’Euripide
qui fut un des quarante magiftrats qui fuçcé-
derent aüx trente tyrans, 8c qui l’inftitua ; ou de fes
collègues, qui par affeftion pour lui donnèrent fon
nom à ce coup de dés viûorieux.
EUROPE, ( Géog. ) grande contrée du monde
habitée. L ’étymologie qui eft peut-être la plus v ra if
femblable, dérive le mot Europe du phénicien ur-
appa y qui dans cette langue fignifie vifage blanc ; épithète
qu’on pourroit avoir donné à la fille d’Agénor
foeur de Cadmus, mais du moins qui convient aux
Européens, lefquels ne font ni baianés comme les
Afiatiques méridionaux, ni noirs comme les Africains.
VEurope n’a pas toûjours eu ni le même nom, nï
les mêmes divifions, à l ’égard des principaux peuples
qui l’ont habité ; & pour les fous-divifions, elles
dépendent d’un détail impoflible, faute d’hiftoriens
qui puiffent nous donner un fil capable de nous tirer
de ce labyrinthe.
Mais loin de confidérer dans cet article Y Europa
telle que l’ont connue les anciens, dont les écrits font
parvenus jufqu’à nous, je ne veux dire ici qu’un feul
mot de fes bornes.
Elle s’étend dans fa plus grande longueur depuis
le cap de Saint-Vincent en Portugal 8c dans l’Algar-
v e , lur la côte de l’Océan atlantique, jufqu’à l’embouchure
de l’Obi dans l’Océan leptentrional, par
l’efpace de i zoo lieues françoifes de zo au degré, ou
de ooo milles d’Allemagne. Sa plus grande largeur,
prife depuis le cap de Matapan au midi de la Morée
jufqu’au Nord-Cap, dans la partie la plus fepten-
trionale de Norvège, eft d’environ 733 lieues de
France de 10 au degré pareillement, ou de 5 50 milles
d’Allemagne. Elle eu bornée à l’orient par l’Afie ;
au midi par l’Afirique , dont elle eft féparée par la
mer Méditerranée ; à l’occident par l’Océan atlantique,
ou occidental, & au feptentrion par la mer
Glaciale.
Je ne fai fi l’on a raifon de partager le monde en
quatre parties, dont Y Europe en fait une ; du moins
cette divifion ne paroît pas exa&e, parce qu’on n’y
fauroit renfermer les terres arôiques & les antarctiques
, qui bien que moins connues que le refte, ne
laiffent pas d’exifter 8c de mériter une place vuide
fur les globes 8c fur les cartes.
Quoi qu’il en foit, Y Europe eft toûjours la plus
petite partie du monde ; mais, comme le remarque
D d ij