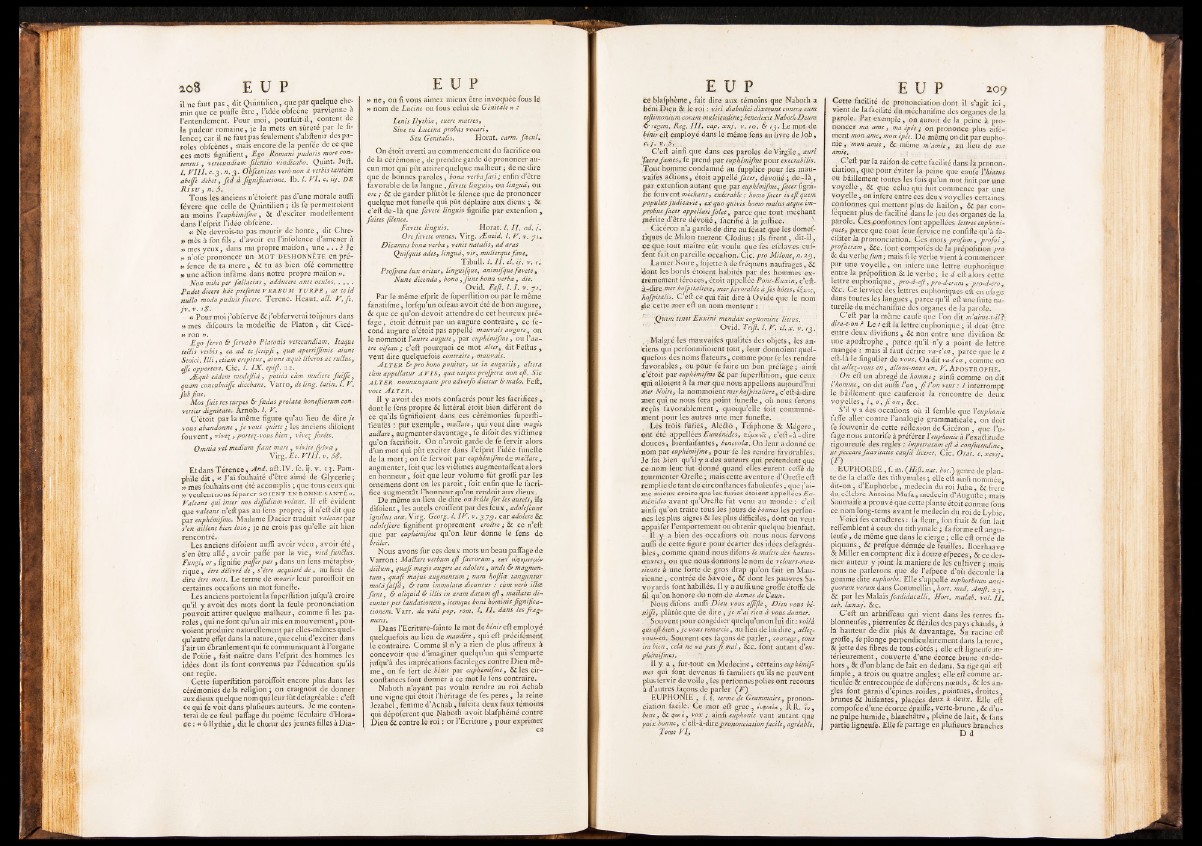
I l
il ne faut pa s, dit Quintilien, que par quelque chemin
que ce puifle être, l’idée obfcène parvienne à
l’entendement. Pour moi, pourfuit-il, content de .
la pudeur romaine, je la mets en sûreté par le ü-
lence; car il ne faut pas feulement s’abftenir des paroles
obfcènes, mais encore de la penfée de ce que
ces mots lignifient, Ego Romani pudoris more non-
tentus , verecundiam Jîlentio vindicabo. Quint. Juft.
/. V III. c.3. n. 3 . Obfcenitas verbnon à verbis tantum
abcjfè débet, fed à fignificatione. Ib. I. VE c. iij. DE
R i s u y n. 5.
Tous les anciens n’étoient pas d’une morale aufli
févere que celle de Quintilien ; ils fe permettaient
au moins Y euphèmifme, & d’exciter modeftement
dans l’efprit l’idée obfcène.
« Ne devrois-tu pas mourir de honte , dit Chre-
» mès à fon fils* d’avoir eu l’infolence d’amener à
» mes yeux, dans ma propre maifon, une . . . ? Je
« n’ofe prononcer un m o t déshonnête en pré-
» fence de ta mere, 8c tu as bien ofé commettre
» une attion infâme dans notre propre maifon ».
Non mihiper fallucias, adducere ante oculos. . . . .
Pudet dicere hâc prefenteVERBUM TURPE , at teid
nullo modo puduit facere. Terenc. Heaut. act. V. fc.
jv . v. 18.
« Pour moi j’obferve & j’obferverai toujours dans
» mes difeours la modeftie de Platon, dit Cicé-
» ron ».
Ego fervo & fervabo Platonis verecundiam. Itaque
tc3is verbis, ea ad te ftripfi, quoe apertijjimis aiunt
Stoici. Illi,etiam crepitus, aiunt cequè liberos ac rucius,
ejje opportere. Cic. I. IX . epift. 22.
Æquï eâdem modejiiâ , potiiis eum muliere fuiffe,
quam concubuiffe dicebant, Varro, de ling. Latin. I. V ,
fub fine.
Mos fuit res turpes & fcédas prolata honefiiorum con-
yertier dignitate. Arnob. I. V .
C ’étoit par la même figure qu’au lieu de dire je
vous abandonne , je vous quitte ; les anciens difoient
fouvent, vivez , portez-vous bien , vivez forêts. I
Omnia vel medium fiant mare, vivite fylvoe ,
Virg. Ec. V III. v. 38.
Et dans Térence, And. aft.1V. fc. ï). v . 13. Pamphile
d it , « J’ai fouhaité d’être aimé de Glycerie ;
» mes fouhaits ont été accomplis ; que tous ceux qui
» veulent nous féparer soient en bonne s a n t é ».
Valeant qui inter nos difjidium volunt. Il eft évident
que valeant n’eft pas au fens propre; il n’eft dit que
par euphèmifme. Madame Dacier traduit valeant par
s ’en aillent bien loin; je ne crois pas qu’elle ait bien
rencontré.
Les anciens difoient aufli avoir v é cu , avoir é té,
s’en être allé, avoir paffé par la v ie , vitâfunclus.
Fungi, or 9 lignifie pajfer par , dans un fens métaphorique
, être délivré de , s'être acquitté de , au lieu de
dire être mort. Le terme de mourir leur paroifloit en
certaines occafions un mot funefte.
Les anciens portoient la fuperftition jufqu’à croire
qu’il y a voit des mots dont la feule prononciation
pouvoit attirer quelque malheur, comme fi les paroles
, qui ne font qu’un air mis en mouvement, pou-
voient produire naturellement par elles-mêmes quek>
qu’autre effet dans la nature, que celui d’exciter dans
l’air un ébranlement qui fe communiquant à l ’organe
de l’oiiie , fait naître dans l ’efprit des hommes les
idées dont ils font convenus par l’éducation qu’ils
ont reçûe.
Cette fuperftition paroifloit encore plus dans les
cérémonies de la religion ; on craignoit de donner
aux dieux quelque nom qui leur fût defagréable : c’eft
ce qui fe voit dans plufieurs auteurs. Je me contenterai
de ce feul paflage du poëme féculaire d’Horace
: « ô llythie, dit le chçeur des jeunes filles à Dia-
» ne, ou fi vous aimez mieux être invoquée fous le,
» nom de Lucine ou fous celui de Génitale » i
Lenis Ilythia, tuere. matres,
S'ive tu Ludna probas vocari,
Seu Genitalis. Horat. cartn. foeCull
On était averti au commencement du facrifice ou
de la cérémonie, de prendre garde de prononcer aucun
mot qui pût attirer quelque malheur ; de ne dire
que de bonnes paroles, bona verba fari; enfin d’être
favorable de la langue, favete Unguis, ou linguâ, ou
ore ; 8c de garder plutôt le filence que de prononcer
quelque mot funefte qui pût déplaire aux dieux ; &
c’eft d e -là que favete Unguis lignifie par extenfion ,
faites filence.
Favete Unguis. Horat. I. I I . od. /*.-
Ore favete omnes, Virg. Ænéid. I. V. v. y i .
Dicamus bond verba , venit natalis, ad aras
Quifquis ades, linguâ, vir, mulierque fave.
Tibull. L. I I . el. ij. v. /.'
Profpera lux oritur, linguifque, animifque favete ,
N une dicenda, bono ,ftint bona verba , die.
Ovid. Faß. 1. 1. v. yt.
Par le même efprit de fuperftition ou par le même
fanatifme, lorfqu’un oifeau avoit été de bon augure,
8c que ce qu’on devoit attendre de cet heureux pré-
fage, étoit détruit par un augure contraire, ce fécond
augure n’étoit pas appellé mauvais augure, on
le nommoit Y autre augure, par euphèmifme, ou Y autre
oifeau ; c’eft pourquoi ce mot alter, dit Feftus ,
veut dire quelquefois contraire, mauvais.
A l t e r & pro bono ponitur, ut in auguriis, altera
cùm appellatur A VIS, quee utique profpera non eft. Sic
ALTER nonnunquam proadverfo-dicitur &malo. Feft.
voce A l t e r ,
Il y avoit des mots confacrés pour les facrifices ,
dont le fens propre 8c littéral étoit bien différent de
ce qu’ils fignifioient dans ces cérémonies fuperfti-
tieufes : par exemple, maclate, qui veut dire magis
auctare, augmenter davantage, fe difoit des viélimes
qu’on facrifioit. On n’a voit garde de fe fervir alors
d’un mot qui pût exciter dans l’efprit l’idée funefte
de la mort ; on fe fervoit par euphèmifme de maclare ,
augmenter, foit que les viétimes augmentaflent alors
en honneur, foit que leur volume fût grofli par les
ornemens dont on les paroit, foit enfin que le facrifice
augmentât l’honneur qu’on rendoit aux dieux.
De même au lieu de dire on brûle fur les autels, ils
difoient, les autels croiflent par des feux, adolefcunt
ignibus ara. Virg. Georg. I. IV . y.^yc). car adolere &
adolefcere lignifient proprement croître ; & ce n’eft
que par euphèmifme qu’on leur donne le fens de
brûler.
Nous avons fur ces deux mots un beau paflage de
Varron : Maclare verbum eft facrorüm, «.ht tùtpn/ju<rpov
dictum, quafi magis augere ac adolere , unde & magmen-
tum, quafi majus augmentum ; nam hoftia tanguntur
molâ falfây & tum immolata dicuntur : cüm verb iclce
funt, & aliquid & illis in aram datum eft , maciata dicuntur
per laudationem , itemque boni hominis fignifica-
tionem. Varr. de vitâ pop. rom. I. I I . dans les frag-
mens.
Dans l’Ecriture-faintè le mot de bénir eft employé
quelquefois au lieu de maudire, qui eft précifément
le contraire. Comme il n’y a rien de plus affreux à
concevoir que d’imaginer quelqu’un qui s’emporte
jufqu’à des imprécations facrileges contre Dieu même
, on fe fert de bénir par euphèmifme s 8c les cir-
conftances font donner à ce mot le fens contraire.
Naboth n’ayant pas voulu rendre au roi Achab
une vigne qui étoit l’héritage de fes peres, la reine
Jezabel, femme d’Achab, lufcita deux faux témoins
qui dépoferent que Naboth avoit blafphémé contre
Dieu 8c contre le roi ; or l ’Ecriture, pour exprimer
ce
ce blafphème, fait dire aux témoins que Naboth a
béni Dieu & le roi : viri diaboliçi dixerunt contra eum
teftimoniq.m çoram multitudme ; benedixit Naboth F)eum
<rregem. Reg. I I I . cap. x x j. v. 10. & 13. Le mot de
bénir eft employé dans le même ferts au livre de Job,
C ’eft ainfi que dans ces paroles de Virgile ^-auri
faerd famés * fe prend par êuphémifme pour execrabilis.
Tout hpqime,condamné au fupplice pour fes mau-
yaifes actions, était appellé facer, dévoilé ; d e - l à ,
par extenfion autant que par euphèmifme, facer lignifie
fouvent méchant, exécrable: homofacer is- eft quern
popuLu? judi cavit, ex quo quivis homo malus atque im-
prppus façer appellari folet, parce que tout méchant
mérite d’être dévoiié , facrifié à La juftice.
. Cicéron n’a garde; de' dire au fénat; qye-les domef-
iiques.de Milon tuerent Clpdius : ils firent, dit-il,
ce que. tout maître eût voulu que fes- elclaves euf-
fent fait en:pareille ôccafion. Cic. pro Milone^n. zg .
Lamer Noire, fujette à de fréquens naufrages, &
'dont les bords étaient habités par des hommes extrêmement
féroces.,-était appellée Pont-Euxin, c’eft-;
àsdûrÇ; mtrhofpitaliiircymerfavorable à fies hôtes, t^iyoç,,
hofpitalis. C ’eft ce qui fait dire à Ovide que le nom
jle cet|e -mer eft un nom menteur :
Quern tenet Euxini mendax cognomme litttis.. ‘
' Ovid. Trïft. l.'V. èl.x. v. 13.
, ; Malgré'les; mauvaifes; qualités des objets , les anciens
qui perfonnifioient tout, leur donnoientquelquefois
des noms flateurs, comme pour fe les rendre
favorables, ou pour fe faire un bon préfage;. ainfi
c ’étoit par euphèmifme & par fuperftition, que ceux
qui alloient à la mer que nous appelions aujourd’hui
■ mer Noire, la nommoient mer hofpitaliere , c’eft-à-dire
mer qui ne nous fera point funefte, où nous ferons
reçûs favorablement;, quoiqu’elle foit communément
pour les autres une mer funefte.
( ■ Les; trois furies, A leâo , Tifiphone & Mégere,
ont 'été appellées Euménides, Eù/junTç, c’eft-à-dire
douces , bienfaifantes, benevola. On leur a donné ce
jiom par euphèmifme, pour fe les rendre favorables.
Je fai bien qu’il y a des auteurs qui prétendent que
ce nom leur fut donné quand elles eurent ceffé de
tourmenter Qrefte ; mais cette aventure d’Orefte eft
remplie de tant de eireonftances fabuleufes, que j’aime
mieux croire que les.furies étaient appellées -E//-
mènides avant qu’Orefte fût venu au monde : c’eft
ainfi qu’on traite tous les jours de bonnes les perfon-
nes.les plus aigres & les plus difficiles, dont on veut
appaifer l’emportement ou obtenir quelque bienfait.
• Il .-y-a bien des occafions où nous nous fervons
aufli de cette figure pour écarter des idées defagréa-
feles- , comme quand nous difôns le maître des hautes-
auvres, ou que nous donnons le nom àe velours-mau-
rienne à une forte de gros drap qu’on fait en Maurienne
, contrée de Savoie, & dont les pauvres Savoyards
font habillés. Il y a aufli une grofle étoffe de
fil qu’qn honore du nofn de damas de Caux.
Nous difons aufli Dieu vous ajfifte, Dieu vous bè-
niffe, plûtôt que de dire, je tYai rien à vous donner.
; Souvent pour congédier quelqu’un on lui dit: voilà
qui eft bien, je vous remercie, au lieu de lui dire, allez-
vous-en. Souvent ces façons de parler, courage, tout
ira bien, ’cela ne va pas f i mal, & c . font autant düeu-
phémifmes.
Il y a , fiir-tout en Medeçine, certains euphèmif-
mes qui font devenus fi familiers qu’ils ne peuvent
pluslèrvir dé v o ilé, les perfonnés polies ont recours
à d’autres façons de parler (F")
EUPHONIE , f. f. terme de Grammaire, prononciation
facile. Ce mot eft g rec , iufwtct, RR. «Uj
bene, & fuv«, vox ; ainfi euphonie vaut autant que
voix bonne, c’eft-à-dire prononciation facile, agréable.
J'orne VI*
Cette facilité de prononciation dont il s’agit i c i ,
vient de la facilite du méchanifme des organes de la
parole. Par exemple, on auroit de la peine à prononcer
ma ame, ma épée ; on prononce plus aifé-'.
ment mon ameymon épée..De même on dit par eupho-,
nie^ mon amie, & -même m'amie, au .lieu de ma
amie.
C eft par la raifon de cette facilité dans là prononciation,
que pour éyiter la peine que caufe Y hiatus
ou bâillement toutes lès fois qu’un mot finit par une
voyelle , & que celui qui fuit commence par une
voyelle, on inféré entre ces deux voyelles certaines
cpnfonnes qui mettent plus de liaifon, & par con-
fequènt plus de facilité dans le jeu .desorganes.de la,
parole* Çes^onfonnes font appellées lettres euphoni-
ques, parce que tout leur fer-vice ne confifte qu’à faciliter
la prononciation. Ces mots profum, profui,
profueram, &c. font Compofés de la prépofition pro
& du verbefum; mais fi le verbe vient.à commencer
par une voyelle , on inféré une lettre euphonique
entre la prépofition & le verbe ; le d eft alors cette
lettre euphonique, pro-d-eft, pro-d-eram ,- pro-d-ero ,
& c . Ce lervice deslettres euphoniques eft en ufage
dans toutes les langues, parce qu’il eft une fuite naturelle
duméchanifme des organes de la parple.
C ’eft par la même caufe que l’on dit m'aime-t-il ?
dirait-on > Le t eft la" lettre euphonique ; il doit être
entre deux divifions, & non entre une divifion 8c
une apoftrophe , parce qu’il n’y a point de lettre
mangée': mais il fautéçrire,vÆ-/’e/2, parce que I e t
eft-Ià le fingulier de vous. On dit va-Cen, comme on
dit allez-vous en, allons-nous en. V. A PO STR O PH E .
On eft un abrégé de homme; ainfi comme, on dit
l homme., on dit aufli l'on, J i l'on veut : L interrompt
le bâillement que cauferoit la rencontre de deux
voyelles, i , o , f io n , 8tc.
S’il y a des occafions où il femble que Y euphonie
faffe aller contre l’analogie grammaticale, on doit
fe fouvenir.de cette réflexion de Cicéron, que l’u-
fage nous autorife à préférer Y euphonie à i’exaélitude
rigoureulê des réglés impetratum eft à confuetudine y
ut peccare fuavitatis caufâ liceret. Cic. O rat. c. xcvii
m ■ . :
, EUPHORBE, f. m. (JFlift. nat. botè) genre de plante
de la claffe des tithymales ; elle eft ainfi nommée,
dit-on, d’Euphorbe, médecin du roi Juba, & frere
du célébré Antoine M ufa, médecin d’Augufte ; mais
Saumaife a prouvé que cette plante étoit connue fous
cê nom long-tems avant le médecin du roi de Lybie.
Voici fes carafteres : fa fleur, fon fruit 8c fon lait
reffemblent à ceux du tithymalê ; fa forme eft angu-
leufe, de même que dans le cierge ; elle eft ornée de
piquans, 8c prefque dénuée de feuilles.-Boerhaave
8c Miller en comptent dix à douze efpeces, & çe dernier
auteur y joint la maniéré de les cultiver ; mais
nous ne parlerons que de l’efpece d’où découle la
gomme dite euphorbe. Elle s’appelle euphorbium antiquorum
verum dans Commellin , hort. med. Amft. 2 3.
8t par les Malais fcadidacalli. Hort. malab. vol. I I .
tab. Ixxxj. &c.
.C’eft un arbrifleau qui vient dans les terres fa-
blonneufes, pierreufes 8c ftériles des pays chauds, à
là hauteur de dix pies 8c davantage. Sa racine eft
grofle , fe plonge perpendiculairement dans la terre,
& jette des fibres de tous côtés ; elle eft ligneufe intérieurement
, couverte d’une écorce brune en-dehors
, 8c d’un blanc de lait en dedans. Sa tige qui eft
fimple, a trois ou quatre angles; elle eft comme articulée
8c entrecoupée de difrerens noeuds, 8c les angles
font garnis d’epines roides, pointues, d roites,
brunes 8c luifantes, placées deux à deux. Elle eft
compofée d’une écorce épaiffe, verte-brune, 8c d’une
pulpe humide, blanchâtre, pleine de lait, 8c fans
partie ligneufe. Elle fe partage en plufieurs branches